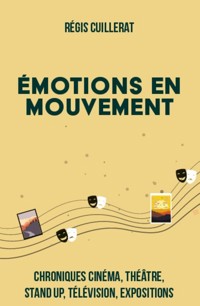Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
J’ai voulu avec ce recueil de chroniques partager avec vous ma passion pour la littérature, vous faire découvrir ou redécouvrir des livres souvent très différents les uns des autres, dont le point commun est de m’avoir donné envie d’écrire ce que j’en pensais. J’ai concentré l’essentiel de mon attention et de ma réflexion sur le contenu des livres plutôt que sur la personnalité et l’histoire de leurs auteurs. Ces chroniques se veulent accessibles, claires, ouvertes sur la vie que j’ai perçue entre les lignes.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Régis Cuillerat est un écrivain, essayiste et chroniqueur français. Il est principalement connu pour son travail de réflexion sur la littérature et sa passion pour les livres. Son approche de la critique littéraire est caractérisée par une écriture accessible et personnelle, visant à partager ses impressions de lecture avec un large public, sans entrer dans des analyses trop académiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
RÉGIS CUILLERAT
LA VIE ENTRE LES LIGNES
CHRONIQUES LITTÉRAIRES
INTRODUCTION
D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours éprouvé une passion pour le mot écrit.
J’ignore pourquoi.
Quand j’écris une chronique littéraire, le plus souvent ma première ambition est de vous donner envie de lire ou de relire les livres, peu importe leur genre, qui d’une façon ou d’une autre m’ont marqué et sont restés dans mon souvenir.
Je passe un temps non négligeable à feuilleter les livres dans les librairies.
La distinction entre les livres de valeur et les autres m’apparaît en général très rapidement.
Juste à la lecture de deux paragraphes, un livre m’apparaît souvent comme une fabrication complètement artificielle, vaine, forcée et maladroite.
Quand l’auteur n’a pas le talent ou le savoir-faire pour me donner l’impression de lire quelque chose de vital, qu’il n’a pas saisi et restitué quelque chose des réalités de la vie dans ses écrits, je me sens rapidement découragé dans mon espoir de lire quelque chose qui me toucherait intérieurement.
Heureusement, depuis les débuts de l’écriture il a toujours existé des auteurs de talent.
Ces auteurs ont le « truc », si difficile à décrire et à définir, qui me donne envie de connaître l’intégralité de leurs textes.
Certaines personnes ont le don de raconter des histoires de par leur usage de la parole et de par leurs expressions physiques.
Je crois que la caractéristique principale d’un bon écrivain, qu’il écrive des récits de fiction ou autre chose, est sa faculté à me faire croire en l’histoire qui constitue la colonne vertébrale sous cette suite de paragraphes, de pages et de parties que l’on appelle un livre.
Naturellement il s’agit ici de ma conception toute personnelle de ce que je recherche dans un livre, conçue au fil de plusieurs décades de lectures diverses et variées.
J’espère que vous partagez quelque chose de mon goût pour les histoires captivantes et bien racontées.
Si la lecture de quelques paragraphes de livres ratés me pèse à ce point, alors pourquoi consacrer l’écriture d’une partie de mes chroniques à des livres que je considère comme ratés ?
Eh bien c’est parce que je crois fermement que la chronique littéraire est en elle-même un genre littéraire de valeur.
Je crois même qu’elle peut être lue avec intérêt, voire même avec enthousiasme pour sa propre valeur littéraire et humaine, que le livre qu’elle évoque soit réussi oupas.
Mon goût prononcé pour la critique littéraire est rempli de paradoxes.
Parce que ce qui m’en a donné le goût, ce sont les émissions de radio du Masque et la Plume ainsi que la lecture de vieux numéros des années 70 du magazine Best, dont les journalistes écrivaient très peu à propos de livres.
Bref mon goût pour la critique littéraire a été déclenché par la radio et par des critiques de disques !
J’ai bien sûr lu ensuite des chroniques littéraires dans les magazines littéraires, qui généralement ne m’ont pas marqué à ce point.
C’est probablement difficile d’affirmer et de justifier qu’une chronique à propos d’un livre puisse être aussi importante et intéressante pour le lecteur que le livre lui-même.
D’autant plus que sans le livre dont elle parle, la chronique en question n’existeraitpas.
Je ne réfléchis pas souvent à cet aspect de ma passion pour l’écriture de chroniques.
Quand cela m’arrive, je me dis simplement en mon for intérieur : pourquoi hiérarchiser ?
Tout comme le cycliste ne doit pas trop réfléchir sur son pédalage sous peine de tomber, je sens qu’il ne sert à rien pour moi de remettre en question les fondements de ce que jefais.
Chacun peut trouver facilement en librairie les recueils de chroniques littéraires de Nabokov, dont personne ne semble remettre en cause la présence dans les rayonnages aux côtés des « classiques » de la littérature.
Donc d’une certaine façon pratique, le genre des chroniques trouve une reconnaissance au moins implicite aux yeux des professionnels du « monde du livre ».
Pourquoi écrire des chroniques de romans plutôt que d’écrire moi-même des romans ?
Parce que j’aime ça, profondément, irrationnellement et sans justification.
Agatha Christie, Virginia Woolf, Philip Roth, Stephen King, David Lodge et tant d’autres ont écrit des livres à propos de l’art d’écrire des livres.
Chacun a ses propres motivations et explique ses propres recettes d’écriture qu’il croit souvent indispensable de suivre pour écrire de bons livres.
Je crois que souvent, à l’origine de leur vocation, le point commun de tous ces brillants écrivains c’est la croyance profondément enracinée en eux que ce qu’ils écrivent est intéressant pour le reste de l’humanité.
C’est également moncas.
La présence ou l’absence d’encouragements de la part de mes frères et sœurs êtres humains n’y fait pas une grande différence : je reste intérieurement persuadé quelque soient les retombées de mes écrits que les chroniques que vous trouverez ci-après constituent une contribution de qualité à la multitude de livres qui forment la matière première de ce qu’on appelle la littérature.
J’ai inclus à ce recueil mes chroniques à propos de bande dessinée. Cette forme artistique a beaucoup compté pour moi pendant mon enfance et mon adolescence et je la redécouvre aujourd’hui.
J’espère bien sûr que vous aimerez ces chroniques et que vous les trouverez intéressantes et enrichissantes.
LE COUSIN PONS d’Honoré de Balzac (Le Livre de Poche,1847)
Paris 1844, dans le quartier pauvre du Marais subsiste chichement Sylvain Pons, ancien compositeur et chef d’orchestre à succès qui cachetonne, dirigeant désormais les musiques de fond dans des pièces de théâtre sans prestige. Pons a deux passions ou deux vices : une superbe collection d’objets d’art constituée au fil des années, presque sans égale sur Paris, et la bonne chère, pour laquelle il supporte bien des humiliations de pique-assiette mondain.
Instigatrice d’une suite de malveillances et de vexations qui frappent le vieux célibataire, l’épouse de son cousin Mme de Marville finit par le désigner coupable de l’échec des négociations qui devaient mener aux fiançailles de la fille de Marville et de M Brunner, un jeune allemand prétendument fortuné.
Pons, brouillé avec le Tout-Paris et soutenu par son seul ami, le musicien allemand Schmucke, tombe gravement malade.Sa concierge Mme Cibot découvre fortuitement la valeur de la collection Pons, ce qui déclenche en elle la volonté irréductible d’hériter des riches œuvres d’art alignées dans le musée personnel du musicien. La Cibot s’allie avec quelques sinistres personnages qui conspirent pour s’emparer des biens du cousin Pons : le brocanteur Rémonencq, l’antiquaire et collectionneur Elie Magus, Mme de Marville et surtout le redoutable avoué aux ambitions frustrées le sieur Fraisier.
Je n’avais pas lu de roman de Balzac depuis le lycée et c’est avec une certaine appréhension que j’ai commencé la lecture du Cousin Pons. Il m’a fallu une quinzaine de pages pour m’habituer au style souvent didactique, parfois claironnant, mettant en scène le contraste entre l’élégance ancien régime de la voix de l’auteur et l’âpreté, la rudesse des dialogues, souvent menés avec les parlers populaires de l’époque, parisiens ou régionaux.
Je me suis longtemps demandé quel était le point de vue de Balzac sur ses personnages car le roman ressemble à une machinerie extraordinairement puissante mais au ton détaché, qui décrit méticuleusement l’avancée de la machination qui broie les deux vieux messieurs trop naïfs.
Toutefois, vers la fin du roman, le musicien allemand nous est plusieurs fois désigné comme le « pauvre Schmucke ». Comme si une fois le triomphe de la ruse et de l’entregent sur la sincérité et le bon droit quasiment assuré, Balzac s’autorisait enfin à témoigner de son affection pour son personnage.
Je crois que Balzac aurait pu à juste titre intituler ce roman « l’Argent », cinquante ans environ avant le roman d’Emile Zola, tant les thèmes du manque d’argent, de la quête de l’argent, de la consolidation de l’argent acquis, animent le déroulement du récit..
Quand l’intrigue se détache de la conspiration pour serpenter dans le vieux Paris et nous raconter la vie des personnages clefs et leurs conditions d’existence, Balzac signe un passionnant roman-fleuve, équilibré entre les portraits très vivants, les réflexions de l’auteur et les rebondissements de l’intrigue financière.
Toutefois le dernier tiers du roman se concentre sur la machination qui écrase les deux musiciens. L’humour très particulier de l’auteur disparaît ainsi que toute la verve et parfois la générosité, la drôlerie spontanées, qui éclairent souvent le vieux Paris.
Balzac dépeint un monde souterrain d’intrigues, où l’hypocrisie jusque-là sournoise se fait venimeuse et les manœuvres juridiques frappent impitoyablement Pons et Schmucke.
Les deux vieux messieurs se trouvent menacés de spoliation par une coalition qui représente une grande partie des pouvoirs de l’époque : une grande bourgeoisie anoblie et une aristocratie embourgeoisée qui verrouillent l’accès aux places et aux affaires, des hommes de loi monnayent la légitimation par des actes de certaines combines occultes et de riches commerçants se voient consacrés intermédiaires en échange de certains risques courus à la place de leurs maîtres.
L’air semble s’être retiré des pages de cette dernière partie uniformément effroyable, mais hélas réaliste je crois.
Malgré ce dernier tiers étouffant de noirceur, le Cousin Pons figure parmi les réussites de Balzac qui distille quelques scènes inoubliables, ses idées uniques et enfin un moment d’histoire saisi sur le vif, dans un Paris à la fois difficile à reconnaître et parfois étonnamment proche de notre capitale d’aujourd’hui.
LES ILLUSIONS PERDUES d’Honoré de Balzac (Le Livre de Poche,1843)
Quand l’école m’obligeait à lire les classiques, j’étais trop jeune pour les comprendre, et maintenant que je suis en âge de les comprendre, je suis trop fatigué pour leslire.
Heureusement Balzac a brillamment annihilé mes raisons de ne pas le lire avec Illusions Perdues, un chef-d’œuvre captivant qui se lit comme un thriller.
Il contient presque tout : ambition, amour, argent, amitié, aventure, comédie, politique, mondanités…
L’intrigue gravite autour des premiers pas de deux amis dans l’âge adulte : Lucien Chardon le poète ambitieux, talentueux, fringant, frivole et David Séchard, un inventeur loyal, sérieux, mais également un rêveur peu fait pour les réalités du commerce auxquelles il doit pourtant se confronter quand son père lui revend l’imprimerie familiale.
Illusions Perdues, c’est la charge précise et argumentée de Balzac contre les milieux du journalisme, de l’édition, de la librairie et du théâtre.
Le romancier, malin, réduit cette fois-ci au minimum ses explications pédagogiques habituelles à propos des différentes professions qui jouent un rôle clef dans le récit.
Habile, il adopte un ton bonhomme, celui d’un vieil oncle qui observe avec une bienveillance amusée les erreurs et les travers de ses neveux.
En surface il décrit, en profondeur il dénonce implacablement l’imbrication entre les pouvoirs financiers, politiques avec ceux de la presse et de l’édition.
Non, dans le Paris de 1820, les critiques n’écrivent pas ce qu’ils pensent vraiment à propos des livres de leurs amis ou concurrents.Et le succès ou l’échec d’une pièce de théâtre n’a pas grand-chose à voir avec le talent des acteurs et de l’auteur.
Après le premiers quart d’Illusions Perdues, le romancier suit plus particulièrement le destin de Lucien, qui réussit temporairement à s’imposer dans le milieu journalistique grâce aux femmes et à l’amitié que lui voue Lousteau, un journaliste sans illusions impliqué dans un système complexe de revente de livres et de places de théâtre.
Lucien, qui se fait désormais appeler De Rubempré, infatué par l’argent, la renommée, le luxe et une liaison avec une jeune actrice, ne comprend pas ce qu’il doit aux uns et aux autres, qui ne tardent pas alors à scier la branche sur laquelle il se pavane.
Le dernier quart du roman se concentre sur le milieu de l’imprimerie où David, inventeur d’un procédé pour produire du papier à bas coût, se voit traîné en justice par les Cointet, deux frères diaboliques bien introduits auprès de l’aristocratie et du clergé, assistés par Saint Claud, un jeune avoué au physique ingrat, retors et très ambitieux.
Tout semble s’acheminer tout à fait logiquement vers une fin catastrophique pour les deux amis, mais l’auteur démiurge, avec un pétillement ironique dans le regard, prive Lucien des fruits de son éphémère réussite et David des droits sur son invention révolutionnaire, mais leur conserve l’exercice de leur liberté pour commencer chacun une nouvellevie.
LE PLUS GRAND DÉFI DE L HISTOIRE DE L’HUMANITÉ d’Aurélien Barrau (Michel Lafon,2019)
Cyclones, typhons, tempêtes, tsunami, canicules, sécheresses, extinction d’espèces, je commence à me demander s’il n’y a pas un problème sur notre planète…
Jusqu’ici j’avais lu trop peu d’articles de presse et de livres consacrés à l’écologie pour concevoir une opinion cohérente et bien informée à propos de nos problèmes environnementaux, alors j’ai acheté le livre de l’astrophysicien Aurélien Barrau que j’ai écouté l’autre jour à latélé.
Le constat, les causes, les solutions, Barrau présente une vision claire et cohérente des problèmes. L’angle de vue varie intelligemment du stratosphérique jusqu’au microscopique.
L’auteur ne fait visiblement pas partie des fanatiques et présente quelques informations nouvelles pour moi, par exemple je n’avais pas réalisé à quel point les animaux sauvages manquent d’un espace de liberté dans une nature de plus en plus structurée par l’humanité.
Malgré tout après la lecture de ces 143 pages j’ai l’impression finalement de n’avoir pas appris grand-chose de plus de ce que j’ai vu à la télévision. L’essai ressemble souvent à une juxtaposition un peu vague, sans ordre logique, d’idées et de thèmes peu approfondis.
L’importance du sujet méritait à mon sens une démonstration progressive, implacable, apte à provoquer une remise en question de notre vision du monde.
Souvent l’analyse et l’argumentation font brusquement place à l’indignation, le tout écrit dans un style agréable mais inégal. Soudainement Barrau cesse d’écrire d’une façon maîtrisée et travaillée, alors les phrases se mettent à ressembler à un monologue prononcé de derrière une tribune.
La dernière partie prend la forme d’une auto-interview dont le vocabulaire manque parfois de la précision qu’exigent les réalités scientifiques.
En outre l’auteur semble avoir certains tabous, comme par exemple au sujet de la surpopulation : une vision du problème qu’il tente d’évacuer avec une exaspération visible.
Ce manque de rigueur au niveau de l’expression écrite et de l’argumentation m’a surpris de la part d’un scientifique déjà auteur de 11 livres.
Je trouve Aurélien Barrau sympathique et ce qu’il écrit a le mérite de résumer clairement les éléments d’une situation extrêmement inquiétante.
Toutefois en tant que livre Le Plus Grand Défi n’est tout simplement pas à la hauteur de son sujet.
LA FORCE DE L’AGE de Simone de Beauvoir (Folio,1960)
La Force de l’Âge m’a impressionné, ne serait-ce que par l’épaisseur du livre, l’ampleur de la période historique abordée (1929- 1944) et l’ambition de l’auteur qui entrecroise le récit de son autobiographie et l’histoire de cette époque, à la fois prise sur le vif et longuement analysée et réfléchie : histoire des idées, des arts et celle des hommes pris dans d’intenses et dramatiques bouleversements.
Simone de Beauvoir n’a pas écrit un monument de complexité mais plutôt un travail long, limpide, méthodique, d’approfondissement de ses idées et des thèmes qui lui tiennent à cœur, à la lumière du déroulement des événements historiques et des trajectoires des êtres qui ont traversé savie.
Cette façon qu’a sa plume d’avancer progressivement, sans agitation mais avec une détermination implacable jusqu’aux ultimes conclusions de ses recherches se trouve peut-être à l’origine de son surnom : « le Castor ».
Ce livre possède un ton particulier, une sorte de froide passion.
Les cent premières pages pourraient aisément s’intituler « Le Parcours d’un Esprit ». La vie de la jeune enseignante Simone de Beauvoir semble alors pauvre en péripéties et l’autobiographie se concentre sur l’évolution de ses idées, de sa vision d’elle-même, de la société, et de ce qu’elle cherche à accomplir avec savie.
La Force de l’Âge raconte une jeune Simone de Beauvoir nullement préoccupée par l’opinion des autres, mais qui avec son compagnon Jean Paul Sartre se lie avec un certain nombre d’artistes, d’enseignants et d’étudiants dont certains deviendront leurs amis.
L’intransigeance dont elle fait preuve pour façonner sa vie à l’image des buts qu’elle poursuit n’inspire guère de prime abord une identification ou un courant de sympathie à son égard, d’autant plus qu’elle refuse de considérer qu’il existe une autre conscience pensante qu’elle-même, à l’exception de Sartre, mais elle refuse la contradiction en considérant que Sartre et elle-même ne font qu’un !
Toutefois plusieurs éléments ont concouru à m’attacher progressivement à ce destin : De Beauvoir et Sartre poursuivent leurs voyages, leurs rencontres et leurs projets littéraires sous la menace de plus en plus pesante de la guerre, menace qu’elle a longtemps refusé de prendre en considération.
Les deux écrivains éprouvent la même soif de connaître l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, la Grèce, le Maroc et toutes les régions de France, en particulier la Provence et le Sud-Ouest. Le couple part à l’aventure sans autres préparatifs que quelques affaires, deux billets de train, et bien sûr les vélos sur lesquels ils parcourent des distances considérables.
De Beauvoir et Sartre écrivent beaucoup mais de Beauvoir parviendra finalement à se faire publier en 1941. Pendant ce temps un cercle rapproché d’amis se constitue progressivement autour du couple : Olga l’étudiante fantasque en rupture avec sa famille, Marco un enseignant et chanteur homosexuel, Bost un jeune étudiant brillant et attachant et Pagniez un intellectuel bourgeois et protestant.
De Beauvoir nous dépeint les aventures de nombreux autres copains et connaissances passés au crible par les deux écrivains. Toutefois après les réjouissances et l’euphorie du Front populaire, la guerre d’Espagne annonce l’imminence de la Seconde Guerre mondiale. Alors toutes les belles découvertes et rencontres faites par le couple ressemblent de plus à en plus à des sursis avant une grande catastrophe, et je commence à entrevoir une angoisse et un certain isolement que de Beauvoir combat avec une résolution admirable.
La dernière partie poignante évoque la débâcle, l’occupation puis la libération. Simone de Beauvoir se bat pour continuer de vivre, de travailler et d’écrire malgré la faim, le froid, les malveillances petites ou grandes des collaborateurs, les amis arrêtés, emprisonnés, déportés outués.
De Beauvoir sent se briser sa conception individualiste de l’existence. Sartre et de Beauvoir, indomptés, préparent l’idéologie du « monde d’après » et vivent enfin l’exaltation de la libération de Paris.
La Force de l’Âge nous offre alors deux grands moments de littérature. La rencontre avec Jean Genet alors jeune écrivain : un aventurier à la fois sauvage et sophistiqué.
Et enfin, la description de la représentation de la première pièce d’Albert Camus dans Paris encore occupé. Les critiques collaborateurs dénigrent la pièce avec arrogance pendant l’entracte, mais la romancière sent qu’il s’agit là d’une dernière bravade avant que ces journalistes disparaissent définitivement de la scène de l’histoire.
Le lecteur de ce livre découvrira également un style d’écriture marqué par son époque : résolument clair, très accessible, dépourvu des ellipses ou des audaces propres à notre époque.
Ce que j’appellerais un style d’airain, solidement charpenté, impressionnant comme une colonne gothique mais tout à fait adapté pour décrire un bon repas ou une nuit de camping sous un immense ciel agité.
Le style littéraire d’une romancière qui assume un projet littéraire, historique, culturel, humain, ambitieux, de grande ampleur, et l’entreprend de la seule façon qui lui convienne : elle s’assied derrière son bureau, réfléchit, commence à écrire, poursuit, achève et réussit indiscutablement.
LA BLESSURE, LA VRAIE de François Bégaudeau (Éditions Verticales,2011)
Été 1986. Pendant que je célébrais ma réussite au bac à Nantes, « le Nantais », probable surnom de François Bégaudeau à 15 ans, essayait par tous les moyens de perdre sa virginité pendant ses vacances dans un petit village sur la côte bretonne.
Comme tous les orateurs ou écrivains dont la virtuosité s’associe à une forte tendance ludique, l’auteur cherche souvent la formule choc mais un peu creuse et le bon mot qui égratigne avec désinvolture.
Ce sens du raccourci, de la métaphore, s’allie toutefois à un parfum presque imperceptible d’affection et même de nostalgie pour la bande hétéroclite d’adolescents dont fait partie le narrateur.
Bégaudeau dessine chacun à grands traits, comme photographié dans ses attitudes préférées : les manies et les tics du joueur de babyfoot obsessionnel, le roi du râteau dans les soirées et le Nantais : communiste précoce, amateur de tennis et de visages de filles.
Au début je croyais qu’il en faisait trop avec ses nombreux rappels de l’actualité, des musiques et des modes de cet été 86, mais par ce biais il finit par reconstruire cette espèce de substrat de phantasmes rock, sportifs et amoureux où nous étions nombreux à chercher nos dérivatifs dans la France des années80.
Toutes ces figures gravitent autour de quelques lieux ; le café « Chez Gaga », la plage où il ne se passe pas grand-chose, l’église du père Jean et du simple d’esprit Tipaul et surtout la fête foraine et ses autos tamponneuses qui donnent aux garçons les moins dégrossis l’occasion de percuter l’auto tamponneuse des filles de leurs rêves.
Un peu comme dans Entre les Murs, le quatrième livre de François Bégaudeau, l’écheveau de l’intrigue échappe finalement des mains du romancier et se dévide follement dans le dernier quart du livre. L’écriture se précipite en saccades, l’intrigue bascule vers le fait divers et dans l’onirique et la cohérence de la narration se délite.
Les formules et jeux de mots s’éparpillent dans une dispersion centripète avant que le narrateur ne soit brusquement happé par la voiture familiale de retour vers Nantes.
Je ne sais pas quelle est la blessure mentionnée dans le titre, si ce n’est peut-être celle d’avoir grandi.
EXTINCTION de Thomas Bernhard (Gallimard,1986)
Pour ce dernier livre écrit avant sa mort, le romancier autrichien empoigne la part la plus difficile et la plus douloureuse de son œuvre autobiographique : une forme de liquidation, dans tous les sens du terme, de sa famille qui lui a toujours empoisonné l’existence.
Bernhard renonce en grande partie aux formes littéraires originales qu’il employait jusque-là, en particulier le ressassement continuel par un narrateur qui ajoute soudainement une information qui modifie toute la perspective à propos du sujet abordé.
Ici le narrateur, exilé heureux à Rome, apprend que ses parents et de son frère aîné ont trouvé la mort lors d’un accident de voiture.
Il doit précipitamment faire ses valises pour l’Autriche afin de s’occuper des funérailles, de la succession ainsi que de ses deux sœurs Caecilia et Amalia.
Il doit surtout renouer avec Wolfsegg, l’immense domaine familial, à la fois magnifique et sinistre, dont l’entretien et la gestion constituaient une obsession pour sa famille. Pour le narrateur Wolfsegg incarne surtout la source des souvenirs affreux venus de son enfance et de son adolescence.
Les plaisirs habituels si particuliers aux livres de Thomas Bernhard restent présents : l’analyse au cordeau qui dévoile progressivement, d’une façon implacable et comique, toute la fausseté, la prétention et l’absurdité des comportements des personnages dominants de la vie politique, économique et intellectuelle de l’Autriche de l’après-guerre.
Le lecteur peut encore s’étonner des idées tout à fait originales, brillantes, qui flirtent parfois avec la maniaquerie et la folie, d’un intellectuel, obligé par sa santé et une incompatibilité quasi totale avec la mentalité de ses contemporains, de trouver des habitudes uniques et d’une grande rigueur pour affronter le quotidien.
Toutefois, avec Extinction, l’auteur se confronte sans échappatoire avec toute une éducation contre laquelle il s’est toujours révolté et les souvenirs presque toujours douloureux de ses années de jeunesse. Le narrateur doit également faire face à la nécessité de trouver malgré tout une place dans sa vie aux figures à la fois aimées et détestées de la mère, du père, des sœurs et du frère.
Extinction constitue un règlement de compte titanesque, un travail de réflexion et d’introspection immense pour tenter de comprendre comment et contre quoi prend forme une personnalité.
Les funérailles sont également le lieu d’une déception amicale pour le narrateur. Très habilement, l’auteur nous a décrit pendant les deux tiers du livre le cardinal Spadolini comme un homme d’exception. Le narrateur et le lecteur finissent par attendre l’arrivée à Wolfsegg de l’ecclésiastique comme l’occasion d’une consolation essentielle dans ces circonstances d’une tristesse écrasante.
Le cardinal fascine en effet l’assemblée par son intelligence et son élégance, mais ses mots de consolation ne sont que des banalités et le portrait qu’il brosse des défunts se révèle si édulcoré qu’il en devient mensonger.
Le narrateur déçu, reste seul avec ses souvenirs, accompagné par son cousin, le seul esprit libre qui lui soit proche et se comporte sincèrement en ces circonstances.
Le ton, l’impression donnée par le tout que forme ce livre sont extrêmement puissants et particuliers alors que le style perd en virtuosité, se fait sobre et grave comme une symphonie de Beethoven.
Extinction constitue le point final indispensable, inattendu, sombre et magnifique, de l’œuvre de Thomas Bernhard.
LA PERCÉE de Jean Bernier (ed. Agone,1920)
Barbusse, Dorgeles, Genevoix, Junger et même Remarque, je n’avais jusqu’ici lu aucun de ces romans écrits par des vétérans de la Grande Guerre. Quelquefois je retarde mon entrée au seuil de certains livres, articles de journaux, films, que je pressens être trop intenses pour mon état d’esprit du moment.
Et puis il y a deux mois, dans une petite librairie à République, je tombe sur ce beau livre à la couverture sobre, d’une couleur indéfinissable entre la terre battue et le sang.
Sur la couverture, le titre en lettres noires : La Percée puis en sous-titre : Roman d’un fantassin 1914-1915.
Les livres d’histoire sont indispensables, mais je crois que ce récit constitue un témoignage crucial pour comprendre, à hauteur d’homme, la réalité d’un cataclysme qui a façonné bien des aspects de nos vies à désormais plus d’un siècle de distance.
Je rejoins l’avis de nombreux historiens qui considèrent la Première Guerre mondiale comme le déclencheur de cette ère dans laquelle nous vivons. Une guerre à l’échelle industrielle, globale, lors de laquelle la technologie souveraine des canons et des mitrailleuses décime les masses immenses et interchangeables de soldats. Le début de l’obsession des statistiques, des chiffres, avec le fameux « je les grignote » du maréchal Joffre. Une forme totalitaire d’embrigadement de la société effectuée à l’aide de la désinformation omniprésente émise par les mass médias. Enfin, l’écart immense entre les conditions de survie misérables des soldats et l’opulence de certains dont les affaires prospèrent malgré ou grâce au conflit.
Sergent frais émoulu versé au front peu après la bataille de la Marne et la « Course à la Mer » qui suivit, le très jeune narrateur Jean Favigny brûle de participer au triomphe annoncé bien que saisi d’une peur écrasante qui resurgit souvent et de doutes nés de son inexpérience. Favigny doit également composer avec l’absence d’un ami ou d’un proche à qui il pourrait confier toutes ses ambivalences.
Favigny incarne une personnalité aux contradictions probablement très répandues à l’époque.Déjà perce le bientôt vétéran marqué par le froid, la boue, les explosions des « marmites », l’attente et l’incertitude interminables avant de sortir de la tranchée attaquer les positions allemandes.
Et pourtant, des pensées d’un lyrisme enflammé resurgissent régulièrement dans sa conscience de jeune homme, comme si toute une jeunesse exaltée élevée au clairon d’idéaux trop grands pour quiconque refusait encore de mourir.
Jean Bernier écrit avec le style de l’époque encore imprégné de l’élégance un peu empesée du classicisme mais également imagé, populaire, avec un talent particulier pour restituer la faconde parfois comique du parler paysan ou argotique de « ses hommes », ses hommes qui avaient commencé par le mépriser secrètement.
Bernier décrit la beauté surnaturelle d’un paysage de nuit illuminé par les fusées éclairantes mais le lecteur ne trouvera dans La Percée quasiment aucune description des terribles combats dont on ne devine l’intensité que par la disparition « des copains ».
Juste à la fin du livre, Favigny et les copains vont participer à la grande offensive de Champagne de 1915, plus il approche des lignes de départ de l’attaque, plus il constate que la bataille qui devait provoquer la fameuse « percée » dont rêve l’État-Major a mal commencé. Bernier décrit les premiers instants terribles hors de la tranchée, et le récit se termine sur ce point d’exclamation rouge, comme une blessure soudainement cautérisée.
MA VIE ENTRE LES LIGNES, d’Antoine Blondin (1943-1982, Folio)
Cela fait au moins trente ans qu’Antoine Blondin fait partie des écrivains continuellement cités en référence par la critique littéraire française.
C’est vrai que beaucoup de facettes du personnage peuvent séduire : l’écrivain d’Un Singe en Hiver, de l’Humeur Vagabonde, le mouvement littéraire des Hussards, sa désinvolture et ses frasques dans le St Germain des Prés de l’après-guerre, ses fameuses chroniques consacrées au cyclisme dans l’Équipe…
Mais en dehors des milieux littéraires, qui l’alu ?
En tout cas pas moi jusque-là. Alors j’ai entamé Ma Vie Entre les Lignes, un recueil de chroniques sélectionnées par l’auteur et l’éditeur parmi environ 1500 textes publiés.
Blondin déboule sur la scène littéraire en habit de jeune homme insolent, désinvolte et flamboyant, essentiellement intéressé par la politique. Cependant ses premiers textes travaillés à l’extrême, l’écriture contournée et gorgée de figures de style apprises rappellent beaucoup trop à mon goût l’élève brillant qu’il aété.
Deux chroniques à propos des séances du Parlement se révèlent plus intéressantes.
Des descriptions sans commentaires expliquent suffisamment combien toute une mise en scène de l’institution tente de magnifier des hommes qui n’ont rien d’admirable, en tout cas à première vue.
Les choses vraiment sérieuses commencent avec les chroniques littéraires à propos de Marcel Aymé, Jean Giraudoux, Claude Mauriac, Paul Claudel. Blondin décrit avec précision toutes ces figures pour moi à demi oubliées, souvent partagées entre la religion et la sensualité, les habitudes tranquilles d’un mode de vie bourgeois et l’engagement politique et intellectuel.
C’est ici que le style de Blondin brille par sa vitalité, sa vitesse, la précision du trait du caricaturiste qui rencontre ses sujets dans les cafés ou dans les soirées littéraires parisiennes des années50.
C’est ici aussi que pour moi tout s’est gâté. Blondin s’entiche des écrivains collaborateurs : Brasillac, Rebatet et le sergent Labat.
Il faut un estomac que je ne peux pas et ne veux pas avoir pour digérer, entre autres, cette chronique à propos du livre du sergent Labat, engagé volontaire dans la Légion des Volontaires Français, parti combattre en URSS au côté des nazis.
Blondin appelle « brigands » les résistants russes (qui s’appelaient eux-mêmes les partisans) qui harcelaient l’armée allemande derrière les lignes de front, et affirme que l’engagement des volontaires de la LVF contre les russes participe du même « esprit français » que celui montré par les français engagés dans les armées britanniques et américaines.
À partir de là, il n’est pas difficile de trouver Mes Petits Papiers, un recueil de chroniques publié à titre posthume dans lequel figure une chronique fielleuse, aux métaphores antisémites, écrite contre le speaker français de Radio Londres.
Ma Vie Entre les Lignes, le titre de ce recueil prend finalement tout son sens, parce qu’entre les lignes affleurent progressivement les idées d’extrême droite de l’auteur.
Ce qui m’interroge, c’est moins Antoine Blondin qui était finalement assez franc, il collaborait à plusieurs journaux d’extrême droite comme Rivarol, que son éloge continuel par les milieux littéraires français qui affichent généralement des idéaux de tolérance et d’universalité.
LES DÉTECTIVES SAUVAGES de Roberto Bolano (Folio Poche, 1998)
Les Détectives Sauvages appartient à cette espèce rare de « livres-mondes » qui paraissent contenir toutes les couleurs, les extrêmes et les contradictions d’une géographie et d’une époque.
En l’occurrence les 200 premières pages nous plongent dans l’odyssée d’un jeune étudiant en droit à Mexico, Garcia Madero, qui s’éprend de poésie et du mouvement des « réal-viscéralistes » pour ensuite fuir la mégapole en compagnie d’une jeune prostituée.
Ensuite la narration se fragmente entre une quinzaine (!) de personnages témoins, acteurs, passants d’une aventure déstructurée et flamboyante.
Flamboyant, brillant, fracassant, vertigineux mais complètement maîtrisé, ce roman ressemble en partie à ce que David Lynch a essayé de réaliser au cinéma avec Sailor et Lula, sans parvenir à ses fins à monavis.
J’ai été ébloui par le talent de narrateur et le style original de Roberto Bolano, réaliste, foisonnant et parcouru d’échappées fantastiques.
SIX PROBLÈMES POUR DON ISIDRO PARODI de Jorge Luis Borges et Alfredo Bioy Casares (1942, Denoël)
Il y a très longtemps j’ai essayé sans succès de lire un recueil de nouvelles de Jorge Luis Borges. Ce livre distant, tarabiscoté, indéchiffrable m’avait paru incarner exactement tout ce que je craignais à l’avance. L’écrivain argentin utilisait sa culture encyclopédique pour dresser une barrière entre lui et moi, comme s’il gardait toujours un atout dans sa manche qu’il refusait obstinément de jouer. Par caprice ? Par orgueil ? Agaçant.
Quelle est la part de Borges et celle de Bioy Casares dans ce recueil de nouvelles policières ? Impossible de le savoir.
En tous cas ce livre part d’une idée remarquable et l’exploite tout aussi remarquablement.
Don Isidro croupit dans une geôle de Buenos Aires.Il a déplu à quelqu’un de haut placé, même la police sait qu’il est innocent.
D’ailleurs les inspecteurs, tout comme certains membres de la haute société, se relayent dans sa cellule pour l’écouter analyser et résoudre les énigmes policières tirées de faits divers du moment.
Le premier meurtre se produit lors de l’initiation du nouveau membre d’une société secrète. Une autre énigme se déroule dans un train et révèle une intrigue d’espionnage international. Un autre meurtre se produit bientôt dans un hôtel meublé sordide situé dans les bas-fonds de Buenos Aires.
Peu importe le lieu et le milieu social des personnes concernées, Isidro Parodi fin connaisseur de l’âme humaine démêle tout à partir de bribes de conversations, de détails vestimentaires et des rumeurs à propos des intérêts sentimentaux et financiers des uns et des autres.
Le style foisonnant et touffu de Borges et Casares surprend de prime abord. Qui du narrateur ou des deux écrivains fait de l’humour et de l’ironie ?
Chaque lecteur reste livré à ses propres interprétations, mais cela n’empêche en rien d’être ébloui par ce feu d’artifice d’idées et par des descriptions d’une précision et d’une invention fantastiques.
On comprend tout de même que l’humour qui se manifeste au travers de cette folle faconde provient du plus profond de l’âme argentine : à la fois d’une fierté, d’un chauvinisme sans bornes, et accablée d’un complexe d’infériorité monumental envers la longue histoire culturelle des pays européens.
Bioy Casares et Borges signent un livre fascinant et complètement original qui constitue une lettre d’amour dissimulée à leur pays. Presque tous les personnages sont plus ou moins fous, l’injustice et le hasard règnent en maîtres, mais de ce foisonnement naît une telle vitalité qu’aucun des personnages ne songe un instant à prendre un billet de train pour s’en évader.
LE MONSTRE DES HAWKLINE de Richard Brautigan (Christian Bourgeois,1974)
Les grandes tendances artistiques dominantes de ce début du 21e siècle m’affligent et me consternent.
Le mélodrame revient : tous les héros ont été abusés et persécutés dans leur enfance ou dans leur adolescence, puis se retrouvent pris dans les situations les plus extrêmes et les plus morbides possibles.
Les ressorts dramatiques sont soulignés, surlignés, stabilotés par une musique pseudoclassique assourdissante.
C’est le grand retour du pittoresque aussi. L’héroïne sera forcément une japo-indienne transsexuelle persécutée par ses parents eskimos dans son enfance.
Son périple libérateur sur les routes des États-Unis lui permettra de rencontrer Abraham Lincoln et Sigmund Freud. Cela ne peut pas faire de mal aux ventes de raccrocher son wagon aux grands personnages historiques locomotives.
Un remède à tout cela ; lire ou relire les grands romanciers beatniks excentriques américains : Kerouac, Miller, Steinbeck, Bukowski, Fante, Harrison et bien sûr Richard Brautigan.
Sa façon de faire demeure bien sûr un mystère. Son stylo pinceau pointilliste nous fait revivre tous les dégradés des impressions de la vraie vie, à partir d’un récit et de situations apparemment simples.