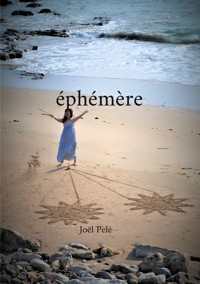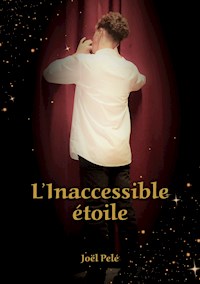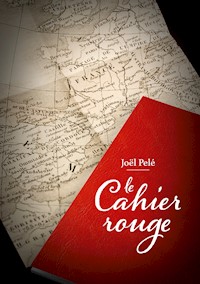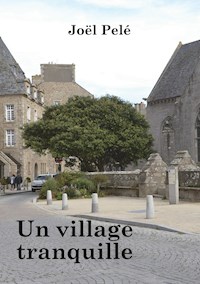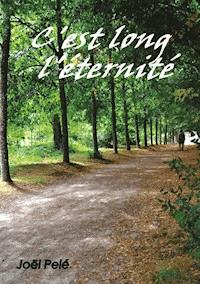Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Verdier est le maire d'une petite ville coupée en deux. D'un côté la vieille cité médiévale avec ses maisons à colombages qui attirent des touristes du monde entier. De l'autre la ville neuve, sans cachet réel, ressemblant à des millions de villes dans le monde. Elles sont séparées par la propriété d'un vieux noble, le comte de Baulois. Lorsque ce dernier meurt, la ville entreprend de racheter son domaine pour y créer un jardin public qui permettrait aux deux entités de se rencontrer. Cela ne se fait pas dans la simplicité, mais la ténacité de l'édile, son désir de partager, d'informer, d'associer la population au projet l'emporte en définitif. Hélas, trois jours après son inauguration, en grandes pompes survient, nuitamment, un incident qui pourrait paraitre mineur mais qui, compte tenu du travail commun effectué, prend une ampleur demesurée. Qui est le coupable et pourquoi a-t-il agi ainsi?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Du même auteur :
Des jours presque ordinaires - Editions les 2 encres (2012)
Aux confluents de la vie - Editions les 2 encres (2013)
Je t’attends - Editions Baudelaire (2016) - BoD (2018)
C’est long l’éternité - BoD (2018)
Un village tranquille - BoD (2019)
L’homme qui voulait imiter Zorro - BoD (2020)
Le cahier rouge - BoD (2021)
L’inaccessible étoile – BoD (2022)
Ephémère - BoD (2023)
Et maintenant… - BoD (2024)
Contact auteur : [email protected]
A mon épouse Denise qui m’a accompagné et guidé par ses précieuses critiques dans l’écriture de ce roman.
A ma famille, enfants, conjoints et petits enfants.
A mes amis :
Dominique Bertemont et Guy Fribault
Brigitte et Gérard Lefebvre
Louis-Marie Loiseau
Eliane et Jacques Moret
Catherine et Jean-Marie Raimbault…
Qui ont su, comme à chacun de mes romans, corriger mes fautes de frappe…et les autres, me témoignant leur ineffable amitié.
A tous ceux, les amis et les autres qui m’interrogent sur le déroulement de mes écrits et attendent leur parution.
A tous ceux que j’aime.
La vengeance est un plat qui se mange froid.
Pierre Choderlos de Laclos
La beauté n’est que la promesse du bonheur
Stendhal
Enfin !
Seule une oreille fine ou informée peut percevoir le mot prononcé par Éric Vernier, maire de la commune, tant il est murmuré. C’est un véritable soulagement. Il lui en a fallu de la patience. Il a connu tant de vives controverses, d’âpres tractations pour arriver à ses fins. La satisfaction du devoir accompli n’en est que plus délicieuse. En homme averti, il cache son euphorie. Il n’a nul besoin de montrer à ses collègues du conseil municipal la joie qu’il éprouve à cet instant précis. Pas la peine d’en rajouter. Cette victoire lui fait chaud au cœur. Il a tant œuvré pour y parvenir.
L’idée lui est venue, il y a au moins trois ans. Il passait matins et soirs devant la propriété d’un vieil aristocrate désargenté. Elle était composée d’un château en piteux état et d’un terrain laissé à l’abandon depuis déjà quelques années. Il imaginait qu’un jour la commune pourrait se porter acquéreuse de ce domaine qui divisait sa ville en deux parties très distinctes.
La première était un véritable joyau que les touristes du monde entier appréciaient à sa juste valeur avec ses étroites rues pavées, ses maisons à colombages aux vitres colorées, et aux toits multicolores. Un patrimoine exceptionnel. Un lieu touristique hors du commun. Et puis de l’autre côté, la ville nouvelle qui, si elle n’avait pas la laideur de certaines cités bâties à la va-vite, ne pouvait en rien rivaliser avec son ancêtre. Tout le monde reconnaissait que les populations des deux parties de l’agglomération ne se côtoyaient pas vraiment. La seconde prétendait que la première n’abritait que des commerces parfois juteux ou des propriétaires argentés, souvent prétentieux. La première ne disait rien mais, comme dit l’adage, n’en pensait pas moins. A plusieurs reprises, il en a parlé au conseil municipal constitué d’habitants des deux bords, mais l’enthousiasme n’était pas au rendez-vous.
Et puis un jour, il s’est décidé à rendre visite au propriétaire du château.
Le mur d’enceinte s’effondrait par endroits, devenant dangereux pour les passants. Le parc était envahi d’herbes si hautes qu’elles rendaient l’endroit impénétrable. Une véritable jungle. L’état du bâtiment était en piteux état. La toiture avait perdu un certain nombre d’ardoises, ce qui laissait penser que la pluie devait, sans difficulté, pénétrer dans la bâtisse. Les façades en tuffeau souffraient d’une sorte de lèpre. Quelques carreaux étaient cassés. Les vitres, qui avaient résisté à l’usure du temps, étaient maculées de chiures d’oiseaux ou de salissures indéterminées. Toute la population savait que le propriétaire, qui avoisinait les quatrevingt-quinze ans, y vivait seul. C’était un vieil homme devenu aussi pauvre que Job. Il n’occupait que trois pièces au rez-de-chaussée qu’il n’arrivait même plus à chauffer. Il ne sortait jamais de sa demeure et ne se sustentait que grâce à une association charitable venant lui apporter chaque jour ce qu’il lui fallait de nourriture pour ne pas dépérir.
Vernier, sans prendre vraiment rendez-vous, avait décidé de le rencontrer. Le maire avait dû frapper plusieurs fois à la porte avant que celle-ci s’ouvre, laissant apparaitre un petit homme rabougri. A l’intérieur, il faisait froid. Très froid. Presque aussi froid que dehors. Le vieillard était couvert de plusieurs épaisseurs tant il était gelé. Il se déplaçait avec difficultés, chaussé de pantoufles éculées raclant le sol. Un bonnet de laine d’un autre âge recouvrait son front et son crâne apparemment chauve. Il portait des gants de laine d’une couleur qui, jadis, avait dû être bleue. Enfin, le rasoir était certainement resté dans un tiroir depuis un temps indéterminé tant son visage était recouvert de poils gris désordonnés plus ou moins longs. Un chevalier à la triste figure. Un pauvre hère qui vivotait tant bien que mal dans un univers qu’il avait sûrement connu plus somptueux avant de dépérir petit à petit, faute de moyens financiers. La vente de tous ses autres biens n’avait pas suffi à lui éviter la faillite.
L’hôte des lieux avait reçu l’édile avec une pointe de suspicion :
- Monsieur le maire ! Quelle surprise ! Il y a bien longtemps que je ne vous ai vu. Quel bon vent vous amène ?
Vernier ne s’était pas offusqué de cet accueil mitigé. Il connaissait le personnage. Il savait que la discussion ne serait pas simple. Il avait donc opté pour une attitude de compréhension :
- Vous avez raison, monsieur de Baulois. Ma charge de maire me prend de plus en plus de temps, si bien que j’en viens, et je le regrette, à négliger certains de mes administrés. Tout d’abord comment allez-vous ?
L’autre ne s’était pas laissé abuser. Si le premier magistrat de la ville venait le rencontrer, c’est qu’il avait quelque chose à lui demander. Il se doutait un peu des raisons de la démarche. Ce n’est pas à un vieux singe que l’on apprend à faire des grimaces. Il avait répondu à la question posée par une mimique qui prouvait, sans conteste, qu’il n’était pas dupe :
- Je vais comme un vieux monsieur dépassé par les us actuels. Mais je ne me plains nullement. Il y a dans ce bas monde des gens encore plus malheureux et maltraités que moi. Mais, je vous en prie, asseyez-vous. Alors quel est le but de votre visite chez moi ?
Le maire s’était assis sur la chaise que lui désignait le vieil homme. L’ancien était malin et rusé. Tous ceux qui l’avaient fréquenté le savaient pertinemment. Ce dernier avait lui-même, avec une certaine lenteur, occupé la chaise de l’autre côté de la table de la cuisine. Son regard bleu délavé avait plongé dans celui de son visiteur avec la prétention de vouloir l’impressionner. La partie s’annonçait ardue. Vernier ne voulant pas faire croire qu’il n’était pas très à l’aise dans ce contexte particulier, s’était penché vers le presque centenaire, dévoilant enfin ses intentions :
- Je passe régulièrement devant votre propriété et je me rends compte que vous avez bien du mal à l’entretenir…
De Baulois semblait très attentif aux propos du maire. Son visage ne laissait rien deviner de ses pensées. L’édile poursuivit donc son discours :
- Je me suis dit que la commune pouvait peut-être vous aider…
- M’aider ? Pourquoi m’aider ?
- Je veux dire vous permettre de vivre mieux… Enfin dans un décor plus… Plus épanouissant. Ce serait avec plaisir que nous nous porterions acquéreur de votre domaine qui, il faut le dire… se dégrade terriblement. Nous pourrions vous en offrir un montant respectable… Et vous aider à acheter vous-même un logement plus… décent.
Le vieil homme s’était contenté de rajuster ses lunettes qui glissaient sur son nez. Le maire se sentant de plus en plus mal à l’aise avait repris son hasardeuse plaidoirie :
- Je propose de soumettre ce dossier au conseil municipal et peux vous certifier que…
- Que rien du tout.
La réponse avait jailli dans cette pièce haute de plafond. Les quelques mots prononcés semblaient rebondir sur la voute et s’amplifier augmentant, s’il en était besoin, la révolte du propriétaire des lieux. Vernier, surpris ne put qu’articuler :
- Je… Je ne comprends pas.
- C’est pourtant clair.
De Baulois, fixant à s’en crever les yeux l’édile sidéré par la violence de la courte réplique, avait répété :
- C’est pourtant clair. Je lis dans votre jeu comme dans un grand livre ouvert. L’état de ma propriété vous fait honte, ou du moins fait tache dans votre environnement communal. Je sais, et ce n’est pas d’hier, que c’est une commune réputée pour son patrimoine, surtout en ce qui concerne la vieille ville. Mon antique demeure est comme une verrue poussée sur le bout du nez d’une jeune et jolie fille. Alors vous voulez l’éliminer et vous y mettez le prix. C’est en tout cas ce que vous m’avez laissé entendre. Sachez monsieur le maire que je ne vendrai jamais ma propriété. Je suis né ici. J’ai vécu ici. J’ai aimé ici. Je mourrai ici. Ce château a presque 400 ans. Il me parle de mes ancêtres. Il me raconte leurs vies, leurs amours, leurs emmerdes. Ça me rappelle une chanson de Charles Aznavour. Un vrai chanteur celui-là, avec des vraies paroles, des mots qui avaient un sens. Une voix. Pas des hurlements comme certains d’aujourd’hui. Bref, ces murs qui suscitent chez vous plus horreur que pitié me parlent des jours heureux, de mes parents, des rires de mes deux filles lorsqu’elles jouaient dans le parc, des tours de poney qu’elles effectuaient en se prenant pour des amazones. Ces murs-là monsieur le maire possèdent une âme. Je suppose que vous ne pouvez pas comprendre. Ces murs transmis, de générations en générations au fils ainé de la famille, sont ma vie. Je sais, je ne suis pas encore sénile, qu’à ma mort mes deux filles chercheront sans doute à le vendre. Je n’ai pas eu de fils. Mon épouse est décédée trop tôt. Bien trop tôt. Mon nom va s’éteindre avec moi… Le château aussi. Mais je ne suis pas dans le tombeau. Attendez encore un peu. Oui, l’hiver j’ai froid. Oui je ne peux plus entretenir ce qui a été une fierté familiale. Les choses ont bien changé. Mais jamais un de Baulois, sans doute le dernier de la dynastie, ne fera l’affront à ses ancêtres de vendre notre domaine. J’ai l’impression que les portraits de mes ascendants, décorant le grand salon me le reprocheraient pour l’éternité. Vous allez devoir me supporter encore quelque temps.
Le maire avait tenté une ultime approche :
- C’est que, vous devez me comprendre. Nous recevons des milliers de visiteurs et…
- Et comme vous, ils attendront que je disparaisse. Pas le choix. Et puis vous me proposez de m’indemniser… confortablement. L’argent ne fait pas le bonheur. Croyez-moi. Je sais, vous allez répliquer que ce ne sont là que des paroles. Par pour moi. Je vous assure que je ne suis pas malheureux. Il y a pire que moi. Ici, je vis. L’été, des milliers d’oiseaux viennent nicher dans mes arbres centenaires. Je profite de leurs pépiements. Je leur donne un peu de pain ou quelques-uns de mes restes alimentaires. Ils viennent autour de moi, parfois même, me suivent. Je n’entends guère les bruits de la ville. Et vous, que venez-vous me proposer ? D’habiter ailleurs, dans une maison plus confortable. Je me fiche de votre confort. Je vous assure que c’est vrai. Si j’achète, grâce à vos largesses, une maison dans la vieille ville, j’aurai toujours quelqu’un en vis à vis. Mes fenêtres donneront obligatoirement sur une autre fenêtre, située à moins de cinq mètres de la mienne. Le soir, fort tard, j’entendrai les fêtards sortir joyeusement, mais bruyamment, des nombreux cafés et restaurants de la cité. Dans la journée les touristes, dont vous êtes si fiers, passeront devant ma fenêtre. Jadis, j’en ai surpris à essayer de voir ce qu’il y avait derrière les rideaux. Vous imaginez ? Pas moi ! Et les murs qui ne me connaitront pas, ne me raconteront rien de mon histoire et de la leur. Vraiment, non merci. Si je loge dans la ville nouvelle ce sont les voisins que j’entendrai. Là-bas, les murs ont des oreilles. Je ne vous parle pas des gamins qui joueront au football sur les terrains de jeux. Qu’y-a-t-il de plus bruyant qu’un enfant qui joue ? Moi, voyez-vous, j’aime le silence. J’aime la nature, mes arbres, mes herbes folles. Je suis ruiné, c’est vrai, mais je vis en harmonie avec mon environnement. La proposition que vous me faites, est probablement pleine de sympathie, à moins que ce soit de la compassion, ou de l’intérêt. Peu importe. C’est gentil quand même. Mais, voyez-vous, je préfère ma vie actuelle à celle que vous me prévoyez. Ne m’en veuillez pas. Et puis, vous pourrez, lorsque je ne serai plus là, acheter la propriété à mes filles. Elles ne seront, j’en suis certain, pas opposées à cette transaction. Elles ne sont pas comme moi attachées à cette demeure, à ces vieilles pierres qui me parlent d’hier autant que d’aujourd’hui. Les jeunes sont maintenant très différents de leurs parents. Ils aiment vivre dans le bruit, le mouvement. Ils appellent cela la vie. Enfin, vous n’allez pas avoir besoin d’attendre trop longtemps. Je ne suis pas éternel. J’arrive à l’âge auquel il faut se préparer à quitter ce monde. Je suis prêt. Cela ne m’empêche pas de vouloir vivre mes ultimes années dans un milieu qui a toujours été le mien. Excusez-moi pour ce long monologue. J’ai voulu vous faire comprendre qui je suis et comment j’ai décidé de finir ma vie, sur cette terre. Cette vie, je l’ai choisie, il y a bien longtemps.
Au fur et à mesure du discours du vieil homme, Vernier avait perdu de son assurance. Ce vieillard le troublait. Il n’était pas l’acariâtre que tout le monde voulait bien décrire. Il pouvait être sensible, respectueux de tout ce qui se dégageait de son environnement. Fidèle à ses ancêtres, il désirait faire encore partie, de cette race de seigneurs… avec ses moyens actuels, ce qui n’était pas une sinécure. Il agissait avec une grandeur d’âme que l’édile ne soupçonnait pas jusqu’à ce jour. Les certitudes du maire s’écroulaient une à une. Son désir de conclure, coûte que coûte, un accord avec le vieillard s’effritait. Il serait injuste, voire inconvenant de s’entêter. Il n’en avait plus aucune envie. Il s’était penché vers son interlocuteur :
- Je saurai attendre, monsieur de Baulois. Vous m’avez convaincu. Je vous ai compris.
Cette affirmation, rappelant celle du général de Gaulle prononcée le 4 juin 1958 à Alger, était nettement moins politique que celle du chef de l’Etat. Elle était le reflet d’un sentiment sincère et ne serait pas démentie par les faits, contrairement à celle de son illustre prédécesseur. L’édile avait poursuivi son discours pacificateur :
- Vous n’aurez plus jamais d’interventions de ma part sur le sujet. Je vous le promets.
Un large sourire de satisfaction avait germé aux lèvres du plaideur. Ses yeux étaient devenus pétillants. Son sourire, qui se voulait pourtant discret, témoignait de sa joie intérieure. Il avait senti l’émotion le saisir !
- Je suis peut-être trop curieux, mais j’aimerais savoir ce que vous voulez en faire de ma propriété… quand la vie m’aura quitté.
L’édile ne s’était pas fait prier. Avec une certaine verve, il avait exposé quelques idées qui lui trottaient dans la tête depuis plusieurs mois. Le propriétaire des lieux semblait s’intéresser à ce qui allait, peut-être un jour, devenir un lieu de repos pour la population. Il était amplement satisfait. Sa propriété allait revivre. Des hommes, des femmes, des enfants pourraient y passer d’agréables moments.
- Je vous remercie monsieur le maire. Votre projet me plait. J’avoue bien volontiers que lorsque je tente d’imaginer l’avenir de mon domaine, il m’arrive de déprimer. C’est triste à dire, mais aujourd’hui seule la rentabilité compte. Cela me fait mal de penser que l’on va construire des HLM sur un terrain qui a fait la joie des générations d’enfants plein d’insouciance. Il y en a eu des fêtes mondaines dans ce jardin, des parties de cachecache, et même, mon âge m’autorise à l’avouer, quelques parties fines dans les fourrés, si vous voyez ce que je veux dire. J’aurai plaisir à sceller notre discussion en vous offrant un alcool, mais il y a bien longtemps que ce genre de boisson n’existe plus chez moi. Je ne peux vous offrir que de l’eau… du robinet.
Le maire avait souri tout en précisant :
- Mais c’est avec plaisir que je partagerai cette boisson avec vous.
En s’appuyant sur l’assise de la chaise, le vieux monsieur s’était levé lentement. Il avait ouvert avec difficultés une porte vitrée d’un placard mural pour en sortir deux verres. Il les avait posés sur la table avant de saisir une carafe qu’il était allé quêter sous le robinet de l’évier avant de les remplir.
- A vôtre santé, monsieur le maire.
- A la vôtre monsieur le comte.
Monsieur de Baulois, décéda huit mois plus tard.
C’est la personne chargée de lui livrer sa nourriture qui l’avait découvert.
Lorsqu’elle avait sonné à la porte d’entrée, personne n’était, contrairement à l’habitude, venu lui ouvrir. Possédant un passe-partout, elle avait ouvert celle donnant dans le hall. Pas un bruit. Le silence complet. Elle s’était inquiétée. Le plus discrètement du monde, elle avait ouvert la porte de la chambre. C’est là qu’elle l’avait vu, couché en chien de fusil, les yeux clos. Ne voulant pas croire à un drame, elle avait toussoté dans l’espoir de le réveiller. En vain. Au bord de la panique, elle avait prononcé, à plusieurs reprises, son nom à voix basse d’abord, puis de plus en plus fort. L’évidence l’avait saisie d’effroi. Jamais elle n’avait constaté la mort d’un homme. Elle s’était empressée de refermer la porte et d’informer, grâce à son téléphone portable, la responsable du service.
Une demi-heure plus tard, monsieur le maire, suivi comme son ombre (conformément à la loi) par un gendarme et par la cheffe de service de l’association charitable, étaient au chevet de défunt. Ils avaient officiellement constaté la mort de monsieur le comte de Baulois. Un léger sourire plissait les commissures de ses lèvres, laissant penser que ce départ vers l’au-delà, avait provoqué chez lui un soulagement. Peut-être même avait-il imaginé la transformation de sa propriété. Il s’était enfui vers un univers où n’existent ni la souffrance, ni le froid, ni le déshonneur. En guise d’épitaphe, la responsable du service avait déclaré :
- Il s’est éteint comme une bougie complétement consumée, à moins qu’il ait refusé de connaitre un autre hiver.
La dame, chargée de lui apporter sa nourriture pour la journée, avait hoché la tête en guise d’assentiment tout en ajoutant :
- C’est vrai que c’était une saison qu’il n’aimait pas.
Les autres présents n’avaient pas jugé nécessaire de commenter le propos.
Vernier avait seulement demandé si l‘une ou l’autre possédait les adresses des deux filles. La cheffe de service avait répondu affirmativement arguant que c’était elles qui défrayaient discrètement le coût mensuel du service que l’association rendait à leur père en lui portant ses repas. L’édile avait fait savoir qu’il joindrait luimême ces deux personnes. C’était une tâche qu’il n’aimait guère, mais à laquelle il ne se dérobait jamais lorsqu’elle s’imposait à lui. La responsable du service s’était proposée de prévenir monsieur le curé. Vernier l’en avait dissuadé prétextant que l’on ignorait ce que souhaitaient les descendantes. Il avait connu des parentés qui avaient refusé l’office religieux. Cela avait déplu à la cheffe de service. Un enterrement sans prêtre n’était pas imaginable sur notre terre natale. Le premier magistrat avait répondu, d’un ton assez sec, que ce n’était certainement pas à eux de prendre une telle décision, mais à la famille du défunt. Il avait promis qu’il poserait la question lui-même lors de la funeste annonce et qu’il la tiendrait informée.
Vernier avait pianoté sur son portable le premier des numéros qu’on lui avait fournis. La voix suave de l’ainée des filles de monsieur de Baulois lui avait offert un oui inquiet. Pas très à l’aise, le maire avait annoncé la mort du père. Son interlocutrice n’avait pas eu l’air surprise. Elle l’avait informé qu’elle s’attendait à cette triste nouvelle. En effet, sa sœur et elle étaient venues la veille et avaient trouvé leur géniteur si affaibli qu’elles lui avaient suggéré de l’emmener à l’hôpital. Ce dernier avait refusé obstinément. S’il devait mourir c’était ici, chez lui. Et certainement pas dans une chambre inhospitalière, dans un lit médicalisé, le corps perforé de toutes parts pour lui administrer des produits qui ne feraient que ralentir l’issue fatale. Non merci. Et puis qu’est-ce que cela signifie de vouloir gagner deux ou trois jours lorsque l’on sait pertinemment comment cela va se terminer. Elle avait précisé qu’elle allait elle-même mettre sa sœur au courant et qu’elles se rendraient aussitôt, ensemble, au chevet du défunt. Elle avait ajouté qu’à partir de maintenant, elles s’occuperaient de tout : la chambre funéraire, le fleuriste, les petites plaques traditionnelles et le fossoyeur. Son père reposerait dans la petite chapelle située au cimetière, où gisaient déjà quelques membres de la famille, dont sa mère. Vernier avait alors mentionné qu’elle devait également prévenir le curé de la paroisse pour la messe, enfin, si la famille désirait un office religieux. Elle avait précisé qu’elle discuterait de cela avec sa sœur car elles n’étaient, à ce sujet, pas tout à fait du même avis. Alors que le maire lui, présentait ses sincères condoléances, elle avait souhaité le rencontrer en fin d’après-midi. Ils avaient conclu conjointement que dix-huit heures leur convenaient à l’un et à l’autre, au funérarium. Enfin pour clôturer l’entretien téléphonique, elle avait sollicité une faveur : Quelqu’un pouvait-il, pendant les deux prochaines heures, rester auprès de son parent ? Le premier magistrat de la commune avait répondu qu’il se chargeait de trouver une personne compétente. Ils s’étaient quittés sur cette promesse formelle.
La femme qui avait découvert le corps sans vie, se sentait incapable de rester seule avec un mort. La responsable du service, après avoir haussé les épaules et offert une moue significative, presque méprisante, avait accepté au grand soulagement de l’édile.
A dix-huit heures précises Vernier avait franchi discrètement la porte sur laquelle il pouvait lire le nom du comte de Baulois. Cinq personnes étaient assises sur les chaises longeant le défunt. L’un des côtés était occupé par deux hommes, le second par trois femmes dont l’une était nettement plus âgée que les deux autres. Cette dernière, vêtue de noir, marmonnait, tête baissée, quelques prières insaisissables en égrenant un chapelet. Il s’était dirigé vers le visage du disparu. Il avait esquissé un rapide signe de croix. Les deux femmes s’étaient levées de conserve pour le rejoindre. Il avait, à voix basse, présenté ses sincères condoléances. Elles l’en avaient remercié sur un ton identique. Les deux messieurs s’étaient également levés pour rejoindre le trio. L’une des filles du comte, vraisemblablement l’ainée, avait procédé aux présentations, sans se soucier de la vielle dame en prières :
- Céline, ma sœur cadette… Son mari Mathieu Lebrais … Mon mari Rodolphe Marmond.
Les trois nommés avaient, chacun leur tour, serré silencieusement, en offrant un faible sourire de circonstance, la main de l’édile. Elle avait poursuivi :
- Quant à moi, je m’appelle Clotilde.
Elle avait alors proposé de se rendre dans la pièce adjacente afin de pouvoir discuter.
C’était un endroit offrant, à la fois, les fonctions de petite cuisine, salle à manger et de salon. Le trio s’était installé dans des fauteuils en cuir pour le moins confortables. C’est l’ainée qui avait pris la parole en premier :
- Tout d’abord tous nos remerciements pour ce que vous avez fait pour nous.
Le maire l’avait stoppé d’un geste discret :
- Je n’ai rien fait d’extraordinaire.
- Admettons, mais ce que nous pouvons vous dire, ma sœur et moi, c’est qu’il y a quelques mois, vous avez rasséréné notre père. Depuis, il vous avait en haute estime. Ce n’était pas un homme de complaisance. Il avait des idées bien arrêtées. Même avec nous, ses propres filles. Mais c’était un être d’une droiture exemplaire. Nous sommes, comme je vous l’ai dit ce matin au téléphone, venues, ma sœur et moi, le voir hier. Il nous a remis son testament. Ce document écrit et paraphé de sa main mentionne sans contestation possible, que le domaine actuel doit être vendu à la ville. Nous partageons entièrement son choix. Il semblerait que vous ayez fait état d’un jardin public, ce qui eut l’air de lui plaire énormément.
- C’est exact. Mais pour l’instant, seuls les adjoints de la majorité m’ont donné leur aval. Nous sommes certains que les conseillers minoritaires vont contester notre choix. Je vous demande donc d’être très discrètes sur le sujet. Je précise toutefois que nous sommes largement majoritaires mais il serait souhaitable que rien ne soit dévoilé avant la réunion du conseil municipal au cours de laquelle nous en débattrons. C’est un projet important et urgent. La situation actuelle ne peut plus perdurer longtemps. Il nous faut désengorger la ville ancienne. Nous prévoyons donc de construire, sous une partie d’un jardin d’agrément, un parking. La circulation et le stationnement sont devenus invivables pour la population de la vieille ville. Nous espérons ainsi joindre l’utile à l’agréable.
Le maire avait fait savoir qu’il pourrait, si elles le désiraient, leur envoyer chaque mois un compte rendu des travaux, quelques photos à l’appui. L’ainée souriante l’en avait remercié tout en précisant que le défunt avait noté qu’il aimerait que l’espace, qui à ce jour lui appartenait, porte son nom. Une façon comme une autre qu’il ne tombe pas dans l’oubli. L’édile avait affirmé qu’il en serait ainsi. C’était une promesse formelle. Qui plus est, si elles le désiraient, il la confirmerait également par écrit.
Les deux sœurs n’en demandaient pas tant. Elles lui faisaient confiance. Le projet leur paraissait très… enthousiasmant.
Vernier avait eu bien du mal à dissimuler sa satisfaction. Son rêve allait enfin se réaliser. Il n’avait plus aucun doute à ce sujet et c’était pour lui un grand soulagement. Il avait acquiescé s’engageant personnellement à respecter le souhait de monsieur le comte. Cette affaire étant réglée, il avait interrogé les descendantes du bienfaiteur :
- Et pour l’office religieux, vous avez contacté monsieur le curé ?
Cette fois, ce fut la cadette qui prit la parole :
- Oui. Nous avons coupé la poire en deux, si je peux m’exprimer ainsi. Clotilde ne voulait pas d’office religieux. Juste un petit rassemblement au cimetière pour les intimes afin de leur parler de notre père. Moi, je tenais particulièrement à une messe. Nous avons fini par opter pour une simple bénédiction, à l’église, par le prêtre de la paroisse. Il faut vous dire, monsieur, que la pratique de la religion est notre seul point de divergence. Ma mère est décédée peu de jours après ma naissance. L’affliction de mon père a été immense, nous pouvons même la qualifier d’incommensurable. Ma mère avait la réputation d’être une sainte femme, discrète, gaie, disponible aux autres. Il ne pouvait pas comprendre que le Dieu qui siège là-haut puisse la rappeler à lui. C’étaient les termes mêmes des curés de l’époque. Notre mère était une femme, encore très jeune, coupable de rien. Pour lui, Dieu privait ses deux filles d’une mère aimante et lui d’une femme qu’il chérissait. Il avait décidé de ne plus mettre les pieds dans une église, ni même de formuler la moindre prière.
Clotilde avait pris le relais :
- Cela va bien plus loin. Mon père avait banni Dieu de sa vie. Il n’allait plus à la messe, ne recevait plus le curé à déjeuner comme il en avait l’habitude, une fois par mois. Pas un seul centime n’était versé au bénéfice des œuvres de la paroisse. Ma grand-mère maternelle était venue à la maison pour s’occuper de nous, ma sœur et moi. La brave femme, pétrie de chagrin allait toutefois à la messe le dimanche, mais dans le fond de l’église. Elle arrivait après tout le monde et repartait avant la fin de l’office pour ne rencontrer personne. Elle nous emmenait à l’école presque en catimini de peur d’être apostrophée par un bien-pensant qui ne comprenait pas l’attitude de notre clan. Nous n’étions pas la seule famille à connaitre un décès. La mort d’un proche ne pouvait quand même pas remettre en cause la réalité du Christ mort sur la croix… pour nous. Pour la majorité des gens de la paroisse, enfin, des pratiquants, nous étions devenus fous. Mon père s’était-il révolté lorsque les Archambaud avaient perdu leurs jumeaux ? Non, mille fois non. Alors pourquoi maintenant ? Beaucoup se détournaient de nous. Seuls quelques anti-cathos, qui nous ignoraient la veille, nous soutenaient alors.
Céline était intervenue à nouveau :
- Vous devez vous demander pourquoi moi, aujourd’hui, je suis croyante.
Vernier avait haussé les épaules en laissant échapper de ses lèvres un oui famélique. La cadette avait poursuivi son discours.
– Je devais avoir une douzaine d’années, j’étais en cinquième… Oui c’est cela. J’ai côtoyé quelques camarades qui resplendissaient de vie. Elles m’ont fait savoir leur attachement à la religion, celle qui, théoriquement rend heureux les croyants. J’ai résisté un peu, puis j’ai eu envie de les rejoindre dans cette conviction qui semblait donner un sens à leur vie. J’ai alors, moi-même, été plus sereine. Plus forte pour combattre mon chagrin. Je remercie mon père et ma sœur de ne pas m’avoir empêchée de suivre cette voie, tout en restant discrète. Je ne sais pas encore aujourd’hui pourquoi je me suis remise à croire en la puissance divine. C’est un mystère. Y compris pour moi. Je ne me sens coupable de rien, enfin je veux dire, de ne pas épouser complètement les idées de ma parenté. Chacun cherche son chemin et je l’espère, le trouve
Clotilde avait repris le flambeau :
- Nous avons, mon père et moi, constaté le changement survenu chez ma sœur. Nous avions trop de respect les uns pour les autres pour nous immiscer dans son cheminement. Elle pensait différemment. C’était un fait. Qui pouvions nous ? Moi, j’ai conservé ma position. Les événements passés et présents ne se prêtent pas à me faire changer d’opinion. Dieu a-t-il empêché Hitler d’être l’un de plus grands criminels de notre histoire ? Non ! Pourquoi a-t-il permis à un subalterne de déplacer, quelques minutes avant l’explosion, le cartable contenant une bombe qui devait mettre fin à la vie d’un fou ? Il aurait permis de sauver des millions de gens. Je peux également citer Franco soutenu par une grande partie du clergé qui aurait peut-être pu trouver un compromis évitant ainsi le carnage ibérique. Il me faut aussi parler de Salazar au Portugal, de Mussolini en Italie, des colonels grecs. Combien de morts évitées si ces salopards avaient péri plus tôt ? Et aujourd’hui encore Poutine, Bachar el Assad. Il me reste toujours en travers de la gorge la mort de ma mère, si jeune, si belle, si aimante, si innocente. Notre père s’est merveilleusement occupé de nous, jusqu’à nos mariages respectifs. Il nous a laissé libres de partir vivre ailleurs avec nos conjoints. Il s’est alors refermé sur lui-même. Il est devenu taciturne, délaissant ses affaires, vendant ses biens annexes, refusant, sans appel, les aides que nous lui proposions, se complaisant dans une chute inéluctable. Mais tout cela ne concerne que nous. Cessons de vous ennuyer avec nos discours. J’ai téléphoné tout à l’heure à notre notaire Maitre Lonneraie. Il se tient à notre disposition pour instruire le dossier de la liquidation de succession avant que nous procédions à la vente de notre propriété. Quand seriez-vous disponible ?
Vernier avait un peu freiné l’ardeur des deux sœurs. Il lui fallait d’abord convoquer le conseil municipal pour obtenir un vote favorable qui officialiserait l’accord de l’achat. Il allait organiser une réunion exceptionnelle dans la quinzaine à venir.
Les deux héritières avaient compris cette obligation et assuré le maire qu’elles attendraient. Il n’y avait pas le feu. Dans un mimétisme parfait, elles lui avaient fait le don d’un sourire complice.
Tout se déroulait donc de façon remarquable. Vernier était certain que son rêve allait, enfin, devenir réalité. Son égo vivait un moment d’extrême félicité Qui pourrait s’opposer à ce projet ? L’opposition… Peu importait, elle était largement minoritaire. Il était sûr de ses troupes. Il allait marquer cette journée d’une pierre blanche.
Tout le monde s’était quitté satisfait. Ils avaient trouvé les uns et les autres, leur bonheur. Les poignées de mains échangées attestaient que chacun était ravi de cette rencontre.
A peine revenu chez lui, le maire avait ressenti l’irrépressible envie d’informer ses collègues adjoints de ce qu’il venait d’obtenir. Il avait conscience qu’il s’agissait là d’un péché d’orgueil. Il avait également le sentiment que s’il ne communiquait pas cette information à ceux qui le secondaient, il serait jugé coupable de rétention de nouvelles importantes pour la commune. Il n’ignorait pas que les mails étaient devenus des moyens de communication peu fiables, objets d’incessants piratages. Ces malversations venaient quasiment toujours de gens qui voulaient nuire à l’harmonie de la commune. Il avait donc décidé de prendre le risque, mais un risque calculé. En libellant son message de façon un peu énigmatique, il augmentait considérablement l’incompréhension de ses écrits. Seuls les destinataires, bien informés de la chose décrite, pourraient en comprendre le sens. Il s’était appliqué à écrire un message truffé de sous-entendus :
Mes chers amis.
J’ai rencontré aujourd’hui celle dont je vous ai parlé lundi dernier.
On peut noter au passage qu’il avait utilisé le singulier pour parler de ses deux interlocutrices, persuadé que les éventuels pirates tomberaient dans le panneau. Ils ne pourraient pas imaginer qu’il s’agissait des deux filles du comte de Baulois. Satisfait de cette entrée en matière, il avait poursuivi ses écrits :
- Ce fut un entretien très constructif et nous sommes arrivés à la conclusion que nous espérions tous. Je souhaite bien évidemment vous tenir officiellement au courant. Je vous propose donc d’inscrire à l’ordre du jour de notre prochaine réunion du conseil municipal ce point supplémentaire. Le seul objectif est que nous puissions prendre une décision éclairée et… définitive, si possible, bien entendu.
Certains destinataires avaient haussé les épaules. Vernier avait décidément le goût du mystère, quand bien même il s’agissait d’un secret de polichinelle. Il avait apparemment réussi son coup et c’était bien là le principal. D’autres avaient approuvé cette ruse du premier magistrat de la ville. L’opposition ne doit pas toujours être au courant des tractations préalables à une décision. Le reste des destinataires n’avait même pas relevé la ruse de l’édile. Tout le monde n’est pas sur la même longueur d’ondes dans une équipe municipale. C’est ce qui contribue à sa compétence et à son efficacité.
Vernier avait lu et relu le court message. Il était rassuré. Les opposants en nombre restreint, il faut le redire, s’ils avaient vent de l’info n’en comprendraient sans doute pas l’importance. En guise d’auto-suffisance, il s’était offert un verre de son excellent whisky.
Il n’y a pas de mal à se faire du bien.
Les deux journalistes locaux s’étaient empressés de communiquer la funèbre information.