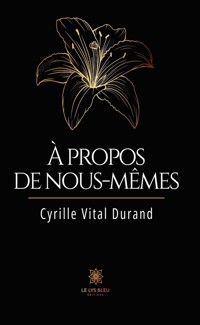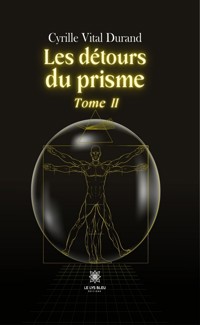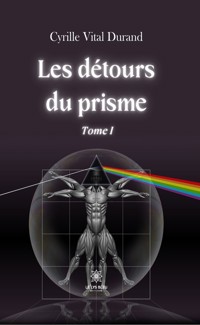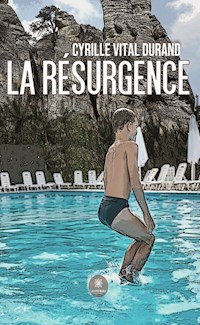Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
"Le couloir de la vie" est un récit à la frontière entre le roman et l’autobiographie, où un élève revisite les années marquantes de 1989 à 1997. À travers le prisme de son quotidien, l’auteur livre une analyse empreinte d’humour et de réflexion, dressant une critique subtile de la société et de l’époque. Chaque année devient une page du sablier du temps où la subjectivité du narrateur s’épanouit en parallèle des événements marquants de l’actualité, minutieusement décortiqués et questionnés, souvent avec un regard positif mais sans concession. Ce texte se construit comme une mosaïque d’expériences personnelles et sociales, dévoilant un individu en pleine maturation et une époque en mutation. Quels souvenirs ou événements marquants résonneront avec vos propres expériences ? Jusqu’où la critique de l’époque dévoilée ici trouve-t-elle un écho dans notre société actuelle ? À vous de découvrir !
À PROPOS DE L'AUTEUR
Diplômé en philosophie et histoire à l’université de Lyon, voyageur à travers l’Europe et passionné de musique,
Cyrille Vital Durand explore, entre poésie et roman, les liens entre création et quête de soi. Cet ouvrage, à la fois essai stylistique et bilan existentiel, reflète une profonde introspection de l’auteur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cyrille Vital Durand
Le couloir de la vie
© Lys Bleu Éditions – Cyrille Vital Durand
ISBN : 979-10-422-6265-5
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
À mon grand-père, Henri
1
Les choses s’aggravèrent en septembre de l’année mille neuf cent quatre-vingt-neuf. Cela faisait cinq années que j’avais coulé des jours idylliques dans la petite école « de la déserte », lovée dans un coin charmant des monts du Lyonnais, à côté duquel font pâles figures les vastes Alpes. Cinq années de réussite et de rêves, aux abords de Courzieu, son parc, ses aigles planants, et tous les autres membres de la famille des rapaces, ses loups… Je devais à présent redescendre du nuage de Vaugneray jusqu’aux horizons tassilunois plus horizontaux et gris de pollution anonyme et affairée, et la redescente fut autant réelle que métaphorique. Mais je n’avais pas le temps de sonder ce qu’est l’essence d’un traumatisme, et bien que mes parents aient en ce temps fait pour moi tous les choix que j’aurais effectués volontiers, bien qu’ils m’envoyassent à une dizaine de kilomètres plus près du centre-ville lyonnais, dans la grisaille et derrière une barrière agressive de herses vertes, je n’avais que le temps de leur adresser un sourire de gratitude torturée. La messe était dite.
Je me dirigeais comme les aiguilles d’une boussole affolée, de gauche à droite, en bas, en haut. J’étais groggy comme à la fin d’un combat, et déjà me proposait-on le suivant. Début septembre. Tout était de chaos dans les vastes cours de ma nouvelle école, par ce mois de septembre mille neuf cent quatre-vingt-neuf, dans la région préurbaine de Lyon. Une société brillante pépiait comme une nuée de moineaux autour des indications de classes écrites sur de grands papiers punaisés à des tableaux de bois. Je me demande encore comment l’on pouvait y comprendre quoi que ce soit. J’étais avec mon père en cette journée d’ouverture et de présentation de l’école à ses prochains élèves. J’étais perdu, à la fois plein de ressources, pour lesquelles j’avais été admis sans doute (des résultats personnels et sans doute un nom), et en même temps la confusion montait en moi : Je n’avais pas le choix, il me fallait me lancer, et je mesurais que je serais là pour quelque temps. Nous relevions toutes ces petites informations et déjà la nuée de moineaux se dispersait, chacun rentrant chez soi dans l’assurance que lui donnait la possession de ses affaires neuves, la certitude d’une nouvelle situation et la douleur au ventre d’un futur incertain.
Après deux jours de congé final, nous étions de retour en classe. Dans le tumulte du rassemblement de dizaines de petites personnes toutes étrangères les unes aux autres, je cherchais à évaluer la place qui devait être la mienne. J’avais repéré sur les papiers d’entrée le nom de quelques connaissances, mais elles n’avaient pas été placées dans la même classe que la mienne. Nous étions dans le bâtiment central de l’école, construit pendant la vague d’art déco des années mille neuf cent trente, un colosse assez étrange. Atmosphère limpide, studieuse. Rigidité de la forme, du carcan. J’avais vraiment le sentiment de franchir un palier scolaire où les choses sérieuses commençaient, et où mon futur allait se préciser. Repérant la classe qui devait être la mienne, j’empruntais le couloir studieux qui menait à elle et je m’installais au fond, au dernier rang. Puisque je ne connaissais personne ici, c’était un mouvement naturel en moi qui me commandait de me faire discret. Je m’installais sur le banc, au fond à gauche.
Je suis retourné à Chambéry… non en fait je n’y suis jamais allé vraiment, mais j’y suis allé pour retrouver, d’une certaine manière, des camarades d’école que je côtoyais il y a un peu plus de trente ans, et que j’aimais beaucoup : Ceux-là étaient des comtes de la région de Chambéry. Inutile de préciser que je ne sais pas ce qu’ils sont « vraiment » devenus, puisque c’était à la toute fin des années mille neuf cent quatre-vingt, mais je crois en l’immortalité de l’âme… Des « œufs », voilà comment on pourrait les appeler, avec respect toutefois, des œufs, tant ils se caractérisaient par la blonde chevelure coupée au bol. Le grand roi des œufs, pure légende de l’école, était un grand guerrier très puissant d’un mètre quatre-vingts. Nous étions en sixième. Il portait l’or étincelant dans sa chevelure d’une raideur parfaite. Il était déjà en amour avec une jeune Franco-Anglaise brillante, beauté du lieu, dont la blondeur était un peu plus laiteuse que la sienne. Brillants et précoces, ils étaient deux amis contrariés et nobles. C’est le genre d’êtres, de personnes, qui me réjouissent le cœur, tant je vois bien qu’avec eux la vie pourra toujours s’épanouir, notamment quand je ne serai plus là pour manifester cette dette envers elle par laquelle je dois la soutenir. Il y avait également celui que j’appellerai « Lamore », un être pour moi encore très sympathique, sorte de géant ibérique aux cheveux de nuit, et qui était l’adversaire principal du jeune comte C. de Chambéry.
Je m’installais donc au dernier banc au fond de la classe, sur la place d’extrême gauche, par correction. En effet, j’avais jugé que le fait de me rapprocher du bureau du professeur serait la marque d’une certaine prétention déplacée, que me mettre aux avant-postes serait prétentieux, puisque d’autres élèves étaient là depuis les petites classes, c’est-à-dire jusqu’à huit ans avant moi. Une flopée d’enfants préadolescents, garçons et filles, investissait déjà le lieu dans une ambiance anarchique, certains riants, d’autres sérieux, certains sages, d’autres jouant les gros bras. Et alors que sur ce dernier ban j’attendais silencieux et immobile, en attente de la suite, vînt s’installer devant moi un trio de garçons qui jouaient quelque peu les cadors. L’un se retourne et me propose déjà de changer de place, pour une raison dont je ne me souviens pas la teneur. Je refuse sèchement, mais presque sans émettre un son, et voici que le garçon, d’une tête de plus que moi, émet une phrase « Laisse tomber » et une deuxième, « C’est un fils de pute ». Piqué au vif et ayant déjà reçu ce genre de remarque, je lui décoche une gifle fantastique qui envoie sa tête rougeaude de plusieurs centimètres à l’arrière de son corps. De lourds flots de colère ruissellent déjà sur son visage et il dit dans ces larmes que cela va se régler avec le directeur de niveau, c’est-à-dire le chef des surveillants. Sûr d’être dans mon bon droit, j’attends la sentence qui ne se fait pas attendre, et je reçois un bel avertissement sur mon carnet de correspondance tout neuf : L’année scolaire est bien partie !
Je trouvais là un public de jeunes génies, une école d’élite en fait où l’on concentrait les talents sans le dire. Mais, et bien que je rencontrasse un ensemble de sympathiques camarades, qui très souvent étaient bien plus brillants que moi, au fond je n’en avais cure, considérant que ma quête, et que l’or que je pourrai recueillir dans le creux de mes mains, consistait d’abord en la sauvegarde sacrée de mon humilité, dans ce fait de préserver toute ma concentration autour de la pureté de ma modestie. En d’autres termes, j’aspirais à travailler dans la moyenne, fondamentalement, et à réussir d’abord l’œuvre à mes yeux suprême de ma furtivité. Cette étrange quête ne m’empêchait pas de m’entourer d’agréables et cordiaux génies.
C’est ainsi qu’un mercredi après-midi, ce temps de relâche, je pouvais inviter un certain Rick, et nous nous installions en discutant sur le perron du petit pavillon avec jardin qu’occupait en ce temps ma famille dans le cœur du quartier de Francheville Bel-Air. Mon ami Rick, sans doute le premier d’une classe déjà naturellement douée, m’impressionnait dans la discussion par la fluidité lumineuse de ses arguments. On aurait dit que ses cheveux d’or ruisselaient en tout instant des lumières bénies de la raison. Il brillait en tout. Et dans cet instant d’automne – nous devions alors être à la toute fin du mois de septembre ou dans le mois d’octobre – je n’étais pas insensible, dans le même temps que nous discutions, à la caresse sur mon esprit d’un très doux été indien rempli d’orangés, et je ressentais que cet été indien, orange se prosternant devant la suprématie de l’or, signait autant ma défaite intellectuelle comparativement à Rick, qu’une promesse simultanée de noblesse et de renouveau. Quant à la noblesse, je la possédais par mes familles de façon secrète, et n’en faisais pas étalage. Mais pour le renouveau, j’avais le sentiment très puissant que c’était là la garantie, agréable et contraignante, que je serai présent plusieurs années à ma place dans cette école ; tandis que ce chevalier d’or de Rick, dans toute sa puissance, était peut-être voué à disparaître sous d’autres horizons dans un temps pas tellement éloigné. Et j’en ressentais à la fois une certaine tristesse et la conscience bienfaisante qu’il y avait là une leçon de vie belle et nécessaire. Et en effet, après quelques saisons, cet ami a disparu totalement, pris sans doute dans des établissements encore plus élitistes et spécialisés ; et je vis un jour que le porche de sa maison ne portait plus la plaque de son nom de famille installée ici au moins depuis les années mille neuf cent quatre-vingt. J’aimais bien cet ami, dans toute l’appréciation objective qu’il faut chaque fois respecter quand on parle de nature humaine, c’est-à-dire nuancée, avec le bon et le mauvais ; j’aimais bien cet ami ; Rick le génie, Rick le malin.
Je repensais à cette situation tellement mythique sur ce terrain de foot tellement unique. Le surveillant à midi vient ouvrir le portail d’entrée de l’école à cette petite bande d’une vingtaine d’asticots qui s’adonne quotidiennement à ce sport puis libère les portes d’entrée du terrain de foot sis en face et toute cette équipée de joyeux lurons déferle sur l’herbe verte. On fait deux groupes de dix personnes environ. Moi je commence à intimider Vieuxchar qui me remet immédiatement à ma place en me faisant savoir qu’il ne me craint pas : Il obtient sur moi une petite victoire psychologique. Ailleurs, un Durand se fait courser par le puissant Bergeton dont il s’est moqué de la forme, et alors nous commençons à constituer les équipes. Les deux plus forts, c’est de Clare et Marlin, qui, lorsqu’ils se battent, impressionnent l’assemblée et suscitent de nombreux commentaires émerveillés et enthousiastes : Bref, c’est une ambiance pour le moins spéciale. Le surveillant, doctorant en notariat et féru de droit, est lui-même une sorte de gaillard qui aime bien ce groupe de jeunes, qui font parfois penser à des loups : C’est qu’on a là pour les classes de sixième et peut-être de cinquième le rassemblement d’une sorte d’élite guerrière du lieu. La partie commence et on la voit équilibrée entre deux équipes de force équivalente. Vieuxchar est un as du ballon, qu’il place régulièrement au fond du filet. Carminiano et Dufay sont ses acolytes qui débordent de commentaires sur son talent et de boutades joyeuses, tout en récitant les leçons d’Histoire du jour qu’ils ont retenues par cœur dans leur mémoire. Je suis impressionné. Un nouveau que je connais de Francheville, Tois, fait remarquer sa présence sur le terrain auprès des autres en ponctuant ses commentaires de l’expression de « trou de bite », ce qui déconcerte un peu l’assemblée. Je nourris des craintes grandissantes à l’égard de ce drôle de personnage, je crains notamment qu’il fasse à mon encontre des commentaires à l’égard de ma famille qu’il connaît puisque nous sommes voisins à Francheville. D’ailleurs, il me sourit de manière inquiétante, ce me semble. Alors je décide d’entamer une procédure de domination sur lui, et je lui fonce dedans pour lui pratiquer une belle prise de judo qui soumettra son comportement caractérisé de débordements… mais pourquoi a-t-il donc fallu que cet oiseau-là vienne étudier précisément dans la même école que moi ? Je ressens la crainte, parce que j’en ai déjà matériellement vérifié l’issue, de me faire traiter de fils de pute… je ne sais pas pourquoi. Cependant, ledit Tois ne semble pas du tout disposé à tolérer ce geste de domination de ma part, et me déclenche plutôt une formidable gifle qui cuit ma joue en un instant. Comment, il a osé ? Je n’en reviens pas, je pensais que l’affaire se conclurait net par sa soumission… Je me relève et refonce dedans… nouvelle gifle, puis une troisième, et je perds en route une partie de ma dévotion pour Jésus Christ tandis que se gondolent déjà mes lunettes. Finalement, près des cages, je reçois une dizaine de gifles et j’abandonne mon projet de domination de Tois, rouge, pleurant et écumant ; mes lunettes sont détruites. Nous quittons le terrain dans une sombre atmosphère, une ambiance lourde traverse le groupe. Tois est renvoyé de l’école après deux semaines tandis que le groupe présent pense avoir assisté à une simple bagarre, mis en présence avec un nœud de problèmes que personne n’a vraiment pu résoudre…
Je vivais là cependant un ensemble de temps que l’on eut pu qualifier de largement insouciant. Nous nous en donnions à cœur joie lors d’une partie de football sur la pelouse immense de l’école et j’écoutais un certain Durand, cousin éloigné sans doute, m’expliquer comme par défi qu’il avait roulé un patin à la belle Ja… qui était dans sa classe, un superbe petit bout de femme pimpante en effet. Je l’aimais bien ce Durand, une petite fleur bleue à sa manière plutôt qu’un grand guerrier victorieux, une âme romantique. À Vaugneray, sa sœur jumelle m’avait administré une gifle suivie d’une verte engueulade un jour que j’avais effectué un exercice de domination militaire strict sur son frère qui m’avait provoqué… encore une personne que j’aimais bien… oui, j’aimais bien tout ce petit monde-là, pépiant et aimant, largement insouciant, plein de bonne volonté à sa manière. Au niveau des notes, je m’en sortais bien, réalisant un bon premier trimestre. Mais j’étais assez consterné de voir que le petit groupe de copains avec qui je frayais prenait déjà la tangente scolaire. Ce groupe c’était Bl… Ko… Ha… et deux chiques filles qu’ils aimaient bien et avec lesquelles ils fricotaient presque un peu… des gens pleins d’histoires et de complications, mais sympas au fond. Bl… me parlait de ses baskets Boris Becker dans lesquelles il ne mettrait jamais plus de trois cents francs, car c’était comme ça, et de sa passion pour le golf où les meilleurs joueurs pouvaient taper le drive jusqu’à trois cents mètres… pratiquant de ce sport plus de trente ans après ces entrefaites je peux dire que rien n’a vraiment changé. Il était lui-même d’origine anglaise et largement empreint de culture britannique, et d’ailleurs simplement le meilleur élève en langue anglaise de la classe, ce qui ne lui attirait bien logiquement aucune jalousie. Ko… lui était d’origine allemande et il nous parla de son cousin lors de l’édition mille neuf cent quatre-vingt-dix du mondial de football que l’Allemagne remporta d’ailleurs, et qui déchaînait les passions de toute la classe. Certains évoquaient Maradona et la « main de Dieu » avec des étoiles dans le regard.
Aujourd’hui, je distribue une huitaine de cartons d’invitation à quelques camarades que j’ai sélectionné pour les inviter à la maison à l’occasion de mon anniversaire. Je suis allongé sur mon lit et j’entends les pas lourds et bruyants de l’un d’entre eux résonner dans l’escalier tandis qu’il se rapproche de ma chambre. Justement, c’est celui que j’ai giflé lors d’une dispute quelques mois plus tôt… je pensais que nous étions réconciliés. « Alors pourquoi tu m’as invité Vital ? » me dit-il comme ça… la vérité c’est que je l’ai invité pour faire plaisir à un autre camarade, mais je lui dis calmement « Je ne sais pas, je pensais que ce serait sympathique ». L’autre dit « Fallait pas ». Alors nous nous dirigeons vers la camionnette bleu foncé de ma mère, un Toyota Lite ace, et nous prenons tous la route, six à huit personnes, vers les monts du Lyonnais. Direction la piscine. Une fois sur place nous nous amusons beaucoup, mais le camarade revanchard continue de faire du mauvais esprit, des remarques acerbes et blessantes à la fois. Formalité d’anniversaire effectuée, je prends congé d’eux et les retrouve à l’école le lendemain. Je porte un tout nouveau blouson en jean de marque Buffalo que ma mère m’offre à l’occasion de mon anniversaire. L’un me dit « Alors c’est nouveau cela ? » désignant mon vêtement en jean. Je lui dis « Oui, du Buffalo s’il vous plaît » et il me répond « Et alors Buffalo n’est pas une marque tellement extraordinaire. Regarde le mien c’est un Levis… encore mieux, en plus ton modèle il est trop court pour toi ! ». Je ne vois rien à redire puisque j’ai fait exactement la même remarque à ma mère tandis qu’elle me l’offrait, cependant cette réflexion de trop ne me plaît pas du tout.
Mais nous sommes déjà dans le vestiaire de sport où nous enfilons rapidement nos survêtements pour aller courir ou faire du saut en longueur. C’est là que j’engage un exercice de lutte avec un certain Bart… faut pas traîner quand on se change, mais le reste du temps quand nous ne sommes pas en exercice, on a tout le temps de se battre… Alors j’attrape Bart par le cou et je lui fais une clé de bras qui lui plie la nuque et l’immobilise, puis l’oblige à s’affaisser contre le sol. Comme il résiste, je maintiens la pression, mais du coup je sens que sa nuque commence à céder sous mon bras. Je crois que je vais l’étrangler, malheureusement. Cette fois, pris de panique, je relâche la pression et il me dit : « C’est bon, tu as gagné ». Bart c’est l’athlète de l’école, le meilleur. Il met au sprint tout le monde dans le vent, mais carrément, et il fait cinq mètres au saut en longueur alors que nous sommes des chenapans de douze treize ans. Mais c’est comme ça en sport, il est plus fort que tout le monde… Cependant l’après-midi, assez furieux, je pense, il se retourne sur son bureau de bois ; il est juste devant moi. « Vital, je t’attrape au bras de fer ». Il a des muscles des bras bien dessinés le Bart, un peu comme des cuisses écrues de poulet avec les fibres saillantes, mais en plus gros, un peu à la manière des culturistes. Il est très fier de la forme de ses muscles ; notamment celle des muscles de ses jambes, tellement développés qu’ils descendent presque sur ses genoux. Moi, de mon côté, j’ai les bras tout ronds, pas dessinés pour deux sous, des bras ronds et blancs tout banals. Il n’y a pas la veine qui court sur le bras de Bart. Alors je lui dis « D’accord, si tu veux, pour le bras de fer ». Donc on se met en face, on se concentre une fraction de seconde, et là « Schlack ! » je lui dévisse le bras et je le plie en trois secondes, écrasant la face supérieure de sa main contre le bois du bureau. Bart n’en revient pas, éberlué, il veut remettre ça, je le bats une seconde fois… je suis presque gêné… On change de main, cette fois-ci c’est la gauche ; je ne fais pas de quartier et l’écrase de la même manière… ça me fait un peu mal au cœur tout de même pour Bart qui est la gloire sportive de l’école… certains lui parlent parfois de la classe de sa musculature tandis qu’il leur répond d’un ton savant sur ce que sont les données biomécaniques… Il était la gloire de l’école… sportivement parlant… En cours de dessin, toutefois, il était quand même moins en forme…
Je discutais sur un des bancs de pierre de l’école avec un pote, Bergeton ; une excellente personne roublarde et maline, mais pas fanatique des cours tout de même. Je l’avais déjà un peu chambré gentiment sur le terrain de foot et, comme il était costaud, il avait coursé le nabot que j’étais à l’époque, qui du coup était rapide à la course… du bonheur drôle pour ainsi dire. Il avait un petit côté ours noir qui l’autorisait à répondre même au grand roi des œufs, de Clare, et à remettre tout le monde à sa place. « Oui, monsieur de Clare, bien monsieur de Clare », lui répondait-il lorsque celui-ci lui intimait l’ordre de « la fermer Bergeton ». C’était vraiment très drôle. Seul un Durand, un nain comme moi, vis-à-vis de ces colosses, lui disait « Gros cul, mais petite bite Bergeton ». Il laissait filer. Il avait, ce Bergeton, administré une raclée à un certain Vieuxchar, assez costaud également, qui en avait les larmes aux yeux. Un guerrier de première classe à dire vrai Bergeton. Sur la pelouse verte quasi fluorescente, c’est l’étudiant en doctorat de droit qui surveillait la marmaille sympathique. Ou du moins était-il censé la surveiller. En fait, il laissait faire sur ce terrain toutes les bagarres et toutes les séances d’humour et d’insultes les plus insolites, le cœur réjoui. Avec tous ces jeunes, il prenait un grand bol d’air. Je voyais encore les explications sérieuses, duels de chefs, entre les grands Simonor et de Clare se dérouler en marge du match de foot, chacun essayant, par des bousculades semblables aux combats des mouflons, de l’emporter sur l’autre, dans de bruyants « non, pitié de Clare, pitié j’ai peur », venant d’un grand Simonor qui n’avait certainement peur de personne, ni de de Clare ni de qui que ce soit ; ni de l’Institution ou d’un système quelconque ; et ils évaluaient ainsi leur quotient de liberté respective à côté d’un quidam Carminiano qui tentait de répéter la leçon d’Histoire qu’il avait apprise par cœur quelques heures auparavant… j’étais donc dans une discussion avec Bergeton qui cherchait à m’enseigner certaines choses de base de la vie. Il me disait comme ça « Si si je t’assure Cyrille les femmes elles se mettent le tampon dans le cul… c’est comme ça que fait ma copine elle se le met dans le cul le Tampax ».
« Ah bon… ». « Ça, c’est mon cuir, le blouson que m’a donné mon père… il a pu faire mon père, il fera bien moi »… je hochais quand même la tête d’un air sceptique sans doute, mais surtout en essayant de ne pas le contrarier. Je ne voulais pas apporter de contradictions dans des situations aussi drôles. Alors on regardait en souriant le grand Marlin, un autre caïd, probablement le plus endurci de l’école, mais quelqu’un de vraiment gentil lorsqu’on employait avec lui les formes du respect. À l’autre bout de la cour de récréation, Marlin, assis à côté de sa copine, une brune, superbe, l’enlaçait discrètement par la taille… je pense qu’il devait s’inquiéter tout de même qu’aucun pion ne le repère. Il y avait quand même un pion, une sorte de terreur à sa manière, du nom de Raisonner B., qui se disputait souvent avec la jeunesse turbulente de l’école. Quant à moi, j’en avais le souvenir amer suivant : Alors que j’attendais dans la file d’attente de la cantine ; une sorte de fantôme brun avait surgi de nulle part, furieux, un type que je n’avais jamais vu auparavant, aux yeux fous. Il me hurla dessus « Sale fils de pute » en me décochant une gifle magistrale… Je reste stupéfait de la situation, mais une fraction de seconde passée, je m’avance vers lui vers lui qui est cette fois-ci rentré dans la salle de cantine pour lui administrer un pain formidable. Au moment où mon bras s’élève, une main par-derrière se saisit de mon poignet tandis qu’une autre, puissante et invincible, m’agrippe par l’épaule et met en échec ma contre-offensive. Cette puissance me retourne et je vois Raisonner B. qui me demande de me calmer sur un ton autoritaire. Écœuré, je lui explique la situation et il me dit : « Oui, mais celui-là il est fou ». Je rentre dans le réfectoire calmement et vais m’asseoir en silence… À la fin du repas, composé au dessert de vache qui rit, ces petits fromages commencent à pleuvoir de partout et se fixent aux murs et au plafond… tout le monde rit et crie et Raisonner B., puissant surveillant du collège, haut de plus d’un mètre quatre-vingts, commence à se disputer et menacer de Clare, cette légende, qui est déjà aussi haut que lui… toutes les bonnes vies de ce collège l’admiraient et l’aimaient bien… Mais à la fin de l’année, il sera renvoyé, Marlin partira, et le jeune inconnu aux yeux fous aura bien fait trois jours de plus après cet événement, puis aura disparu dans la nuit à jamais.
Alors voilà je fus déçu par ces mecs que j’appellerai les Francs ; et qui avaient peut-être leurs raisons que ma raison ignore… on devait être vers la fin du mois de mai ou de juin et ça sentait déjà bon les vacances. Je me souviens d’un ciel bleu. Je devais en être à un stade où je contemplais mes rêves, assis solitaire sur un banc de récréation, lorsqu’un cri déchirant de désespoir vînt percer mes oreilles. On aurait dit une de ces meutes d’étourneaux qui envahissent à l’automne les jardins pour les dévaliser… une bande de barbares… un pogrom… un lynchage… c’était là le pauvre Ricard, qui avait déjà perdu la moitié d’un œil, et qui était en train de se faire tabasser par les costauds du collège… lamentable. Mon cœur en quelques secondes était comme un automne d’enfer, et le bleu disparaissait tandis qu’un petit vent divin et circulaire se positionnait au milieu de la cour dans le tumulte de ce tourbillon barbare. Un tabassage… voilà qui allait réveiller les surveillants et les proviseurs pour longtemps et faire reculer les francs pour plusieurs décennies… voilà à quelle chute finale aboutissaient les ultimes marches d’une liberté concédée à de beaux jeunes gens avec trop de prodigalité : La formation d’une petite délinquance. Alors on voyait Ricard bousculé dans tous les sens comme un moineau entre les serres et les becs de rapaces, psalmodiant des « Non de Clare, là tu vas trop loin de Clare… » Mon cœur saignait déjà comme une source consécutive à ce départ de feu, à ce passage à tabac débutant, mais pour plusieurs raisons, et parce qu’ils m’avaient émerveillé du halo enthousiasmant de leur grande liberté, je n’intervenais pas, je ne prenais pas cette posture de justicier qu’un pion des environs aurait dû assumer. Mais j’observais la scène, le cœur navré. L’année se conclut… et ils furent tous virés.
On était là ce matin à huit heures vingt-cinq réunis en rang et au rez-de-chaussée devant la classe du professeur de dessin Mr Tas. Ça bourrait dans les rangs. Certains disaient « Bourrez pas dans les rangs ! ». Je m’étais moi-même à l’instant battu avec Savignol à qui j’avais plié le cou dans les rangs : Il avait reconnu sa défaite. Mais en fait, on se marrait bien, et l’on était presque ami. Il me faisait découvrir des revues intéressantes pour adolescents sur la science et la chimie… marrant Savignol, d’ailleurs sa mère surveillait aux heures de cantine. Un tel lui avait dit qu’elle ressemblait à un caniche… je crois qu’il s’est fait un peu casser la gueule par la suite. Bon alors le professeur Tas arrive et nous ouvre la porte d’un air rêveur, absent, pas antipathique, mais distant et supérieur. Paraît qu’il avait une ou des maîtresses ce Tas, aux dires de Yelle… je pensais que ça faisait un peu incongru parmi tout ce beau linge assez franc et moraliste, comme une pointe d’hypocrisie empoisonnée en quelque sorte… enfin cela n’était pas mon problème, parce qu’instinctivement nous étions en compétition artistique ou esthétique Tas et moi, je le savais. Alors on s’assoit sur les tables écrues et plastifiées de la salle et Tas nous sort un grand bac plein de prismes translucides de plastique ou de verre… il doit y en avoir une bonne vingtaine… Jamais compris vraiment ce qu’il foutait avec ses prismes… mais il nous a expliqué vaguement à quoi ça servait, et l’affaire en est restée là : Mystère ! Bon pour ma part j’étais quand même assez fasciné par ces objets pyramidaux, par leur secret, par leur beauté… on sort du cours et on se rue devant la classe de Melle Pignol qui en mille neuf cent quatre-vingt-dix devait avoir près de soixante-ans, une brave servante de l’église qui donnait les leçons de flûte à bec. Assez gentille au fond, elle devait avoir dans les quinze ans à la fin de la guerre et peut-être avait-elle travaillé toute sa vie dans l’Institution des sœurs de Saint-Joseph… presque un monument Melle Pignol. « Bourrez pas dans les rangs ! »… Dans les rangs, j’étais à côté de Blanc, cet anglais athlétique assez sympathique, mais avec qui j’étais en compétition pour le titre officieux d’étoile de la classe… Ce blond clair et métallique me faisait sentir qu’il devait avoir au moins deux centimètres de plus que moi en taille… ça sentait la compétition… on fait donc la classe de flûte à bec, et on se retrouve en salle Don Bosco pour une classe de sport qui doit durer deux heures… moi je commence à me battre avec Blanc que j’agrippe par le cou et que je fais plier… il laisse tomber, mais au fond c’est un bon camarade ce Blanc et il ne m’en voudra pas tellement pour le menu reste de l’année finissante. C’est un peu pour moi une reconnaissance de leadership symbolique, mais peu importe et de toute manière il aura toujours des qualités naturelles lui attirant honneur de la part des professeurs et petites amies : C’est qu’il est très brillant. Il faut le concéder.
Bon alors aujourd’hui en fin de matinée, pour un quart d’heure, j’ai rendez-vous avec mes parents dans le bureau, au lycée, de l’aimable et sérieuse Melle Richart, une sœur de Saint-Joseph, la proviseure de l’école je pense. C’est un mystère encore pour moi que l’encadrement parental soit si pointilleux sur ma personne qu’il m’invite de temps à autre à aller rendre quelques comptes de mes états devant un tiers. Melle Richart échange un peu assez gentiment avec mes parents, je sens mêlée de sa part à mon égard un mélange de bienveillances dans un œil investi de surveillance et de police : Ce n’est pas moi le maître de l’école, ce dont je conviens. Cela dit, c’est l’entente cordiale, voir un soupçon d’alliance secrète. Tout va à peu près bien… Alors ils me relâchent et je rejoins ma bande de compères avec laquelle je fraye entre midi et la reprise des classes de l’après-midi : Ce sont Blanc, Kohler, Hénault. Le chef c’est Hénault, mais d’un autre côté nous sommes une équipe de leaders et il n’y a pas réellement de reconnaissance définitive de l’état d’un chef. Comme les portes sont encore ouvertes à cette heure pour ceux qui retournent manger chez leurs parents, nous en profitons pour nous ruer chez Valette, le buraliste du coin où nous achetons un paquet de Chipsters blondes et parfumées, et tels des étourneaux affamés, nous revenons nous l’arracher dans la cour en attendant la suite. Kohler, son père est serrurier… et son cousin joueur de foot dans l’équipe d’Allemagne qui va gagner la coupe du monde à la fin de l’année scolaire…
Nous sommes donc en mai ou en juin mille neuf cent quatre-vingt-dix. Avec deux classes, nous montons dans les bus que nous a dépêchés l’institution qui offre une sortie aux élèves jusqu’à la Cathédrale Saint-Jean. Je suis dans le fond du bus, esseulé… Que s’est-il passé ? Je fais la gueule aux membres de ma bande et réciproquement. Je pense que chacun dans ce groupe est fait pour être le chef de quelque chose et au fond de moi-même je ne veux pas de Hénault pour être le mien… donc « je fais la gueule ». Voici qui entraîne toute une foule de considérations personnelles et de commentaires chez les enfants que nous sommes :
Cyrille essaierait-il de renverser le chef ? Bref, nous arrivons à Saint-Jean, je me passionne déjà plus pour les lieux que pour ces passions sociales, un petit tour et voilà, nous sommes déjà de retour vers les bus garés place Saint-Jean face à la cathédrale. Hénault jubile et farandole sur ces quelques mètres nous séparant des bus, il tourbillonne d’une joie étrange sans faire vraiment attention où il met les pieds, sans faire attention devant lui. Et alors qu’il gesticule dans tous les sens en riant, dans un demi-trot, il vient du genou percuter une grosse borne de béton de soixante-dix centimètres de haut, reliée par une lourde chaîne d’acier à une semblable. Un gros bruit mou et cartilagineux vient s’éclater sur la jambe de l’ado qui hurle en même temps et se met à pleurer. La blessure est vilaine et saigne un peu, mais surtout, elle a frappé juste sur la rotule, au plus mauvais endroit. On rentre vers l’école dans le bus et Hénault, détruit, pleure à chaudes larmes. Arrivé sur place, une ambulance l’emmène directement à l’hôpital. Il doit rester un peu plus d’un mois de cours et Hénault ne reparaîtra en classe qu’à la toute fin de l’année. Je suis quand même désolé pour lui. Ils vont le faire redoubler dans une autre école et l’exclure sans trop de ménagement. Toute l’année, c’est sûr, il avait été dur pour l’Institution dans ses commentaires… étrange parcours.
Sept heures et demie à l’horloge ce matin-là. Je me réveille dans les vapes et je me dirige vers la petite salle de bain de la maison de Francheville Bel-Air où je fais ma toilette et me brosse les dents. Petit déjeuner, puis le minibus bleu marine Lite ace de Toyota m’amène à l’école avec ma mère pour chauffeur. Nous sommes en juin mille neuf cent quatre-vingt-dix et cela sent bon les grandes vacances d’été. Cet été, fin juillet et août, nous filons directement au Liechtenstein, puis en Allemagne, en Autriche et enfin en Suisse pour des vacances de quatre semaines en immersion dans le monde germanique. Les classes plus calmes commencent à rentrer en sommeil, chacun est déjà fixé sur son sort pour l’année prochaine et peut déjà songer à penser à autre chose. Je croise Hénault qui me parle de l’actualité nationale, de politique entre les États-Unis de Georges Bush et l’URSS de Mickaïl Gorbatchev et m’explique qu’à son avis l’URSS n’a aucune chance face aux US. « Pourquoi ? » lui réponds-je ; « Parce que les États-Unis emploient une part moindre de leur PIB à la défense nationale que l’URSS et pourtant cela représente une somme plus colossale que l’argent russe… donc ils n’ont aucune chance de gagner, les russes… ». « Ah ! ». Au jeu de la guerre et de la défiance, je ne suis pas moi-même convaincu de savoir qui peut l’emporter. Nous avons classe de français et, cette fois-ci, la professeure a donné quelque chose comme un beau dix-huit à Blanc pour une copie qu’elle juge superbe, ce qu’elle ne manque pas de faire savoir au reste de la classe. Je dois avoir moi-même quelque chose comme seize. Puis c’est la classe d’anglais, et Blanc ne manque pas de faire savoir dans le plus bel anglais à la professeure Mme M. qu’il n’a pas eu le temps d’apprendre sa leçon. Il emploie les formes et le respect, et d’ailleurs il est le premier de la classe en langue anglaise, et la professeure lui répond que ce n’est pas grave et qu’il peut aller se rasseoir. Quant à moi, je discute un peu avec Kohler qui refile à qui le veut des marteaux brise vitre qu’il a récupérés dans le train… j’essaye de me concentrer aussi sur le tableau, mais je n’y parviens pas ; ma vue s’est brouillée ces derniers temps, une tendance antécédente à la myopie s’est accélérée et j’aurai très bientôt une belle paire de lunettes, ce qui va faire sourire les copains et rire les camarades.
Dans la cour où nous nous retrouvons, Blanc, Kohler, Hénault et moi, Kohler, pour des raisons que je n’ai pas comprises – je pense qu’il a « rebellé » – se fait bousculer par de Clare et Marlin. Un proviseur intervient et leur dit de s’arrêter parce que lui aussi peut « les plier », dit-il. Ces deux-là seront renvoyés à la fin de l’année, nouvelle que j’accueille avec un sentiment ambigu. Hénault, Blanc, et Kohler eux aussi vont nous faire leurs aux-revoirs… Moi je reste par ce que je me dis que vu le niveau de complication de la vie en perspective ce n’est peut-être pas la meilleure solution d’aller tenter l’aventure ailleurs. Je me fais rabrouer pas une petite Leblanc et sa copine parce que j’ai un peu dragué la première ; et je lui réponds que je l’ai dragué pour ennuyer Kohler qui la convoitait également… De toute manière à cet âge-là, les activités amoureuses ne peuvent pas vraiment s’incarner dans quelque chose de plus précis… Le jour s’écoule et finalement les bulletins sont remis avec les appréciations annuelles ; Blanc et Kohler passent, mais ailleurs, Hénault redouble, Marlin passe, mais est renvoyé, je passe et je reste… et ainsi de suite pour tous les autres. Soulagé en quelque sorte, je referme la porte de l’école derrière moi sans la regarder et ouvre déjà celle des vacances.
Alors nous faisons nos sacs et nous nous enfournons dans le minibus Toyota bleu foncé maternel et prenons la direction du Nord-Est. Nous avalions les belles forêts vert foncé francomtoises et nous trouvions déjà au pied de l’Alsace. Nous visitions quelques villes alsaciennes telles Colmar, la petite Venise, où nous faisions du camping, puis parvenions à Strasbourg, où nous visitions le musée des blindés de la ville. Auparavant, nous passions par le château du Haut-Koenigsbourg, cette forteresse médiévale restaurée par Guillaume Deux avant la Première Guerre mondiale. Ensuite, nous nous dirigions vers La Sarre et le Luxembourg pittoresque où nous faisions du camping et où ma mère faisait cuire dans des casseroles d’eau bouillante de gros morceaux de cervelas délicieux à la peau rouge ou orange : Quel savoir-vivre ces Allemands et quelle charcuterie délicieuse ! Alors, toujours par l’autoroute, où précisait mon père, « il n’y a pas de limite de vitesse ici », nous rejoignions la ville, fort belle à mon goût, de Cologne, une ville très neuve, car rebâtie après la guerre. Nous redescendions par l’autoroute jusqu’à Mannheim où nous nous installions quelque temps dans un magnifique camping allemand. Je jouais au ping-pong avec de jeunes Allemands, avec lesquels nous essayions d’échanger quelques bribes de langage, mais j’avais douze ans et de fait, nous restions totalement étrangers les uns aux autres. Nous avions là de jeunes panthères lestes et blondes et remplies de feu. Assez sympathique.
Alors nous allions dans le sud-est de l’Allemagne et nous y visitions les châteaux de bavières, ces grandes constructions baroques qui me laissaient un sentiment mitigé, puisque tout aussi bien on aurait cru pouvoir y planter ses crocs ainsi que dans telle pâtisserie opulente rouge et bleue ! Prenant la direction désormais de l’Ouest, nous parvenions aux rives du grand lac de Constance, le Bodensee aux eaux pures et bleutées et là nous nous baignions. Dans le soleil, je me faisais une jeune amie allemande, et si je n’avais pas à cette date encore été un enfant j’aurai volontiers été plus loin avec elle, dont je lorgnais les rondeurs et le poil blond. Mais il nous manquait encore le temps, et le pouvoir matériel sur soi. Donc je plongeais aussi à trois mètres de profondeur pour récupérer les lunettes de mon frère, que vers les embarcadères, ce dernier avait maladroitement laissé tomber au fond de l’eau, puis nous empruntions un téléférique gravissant les hauteurs escarpées du lac. Alors nous atteignions le petit état du Liechtenstein, après quelques jours de camping ponctués de repas de charcuterie, et nous y visitions les formidables petites cités médiévales contrastées de ces riches commerces où l’on trouvait des articles touristiques et modernes. Je contemplais notamment les chocolats ou les couteaux suisses noirs, que je voulais posséder tandis que j’en avais moi-même un rouge dans ma poche, de plus de vingt-cinq lames. Puis nous allions en Autriche par cette grande route principale qui parcourt d’ouest en est presque une moitié du pays. Il nous sembla probablement que l’intérêt majeur dans ce pays tenait à la beauté et à la pureté des paysages fleuris, car assez rapidement, aux alentours d’Innsbruck je pense, nous faisions demi-tour. Retournant vers l’Ouest, nous entrions en Suisse allemande que nous traversions assez rapidement. En fait, mes parents, après trois bonnes semaines de vacances, commençaient à être vraiment fatigués. Cependant, nous achetâmes plusieurs tablettes de chocolat chacun sur un col alémanique, visitions un peu Berne, puis filions jusqu’à Lyon sans presque plus nous retourner : La première partie de nos vacances d’été était dite.