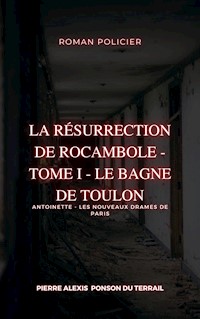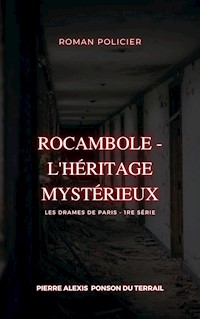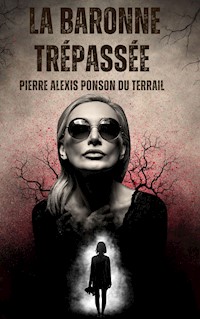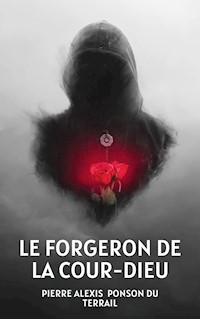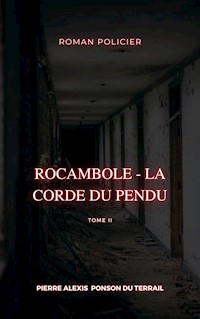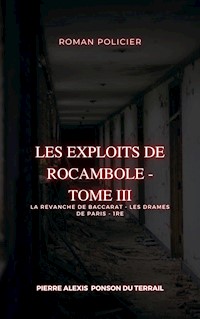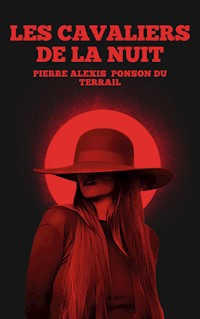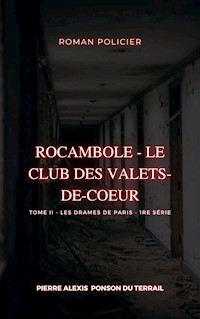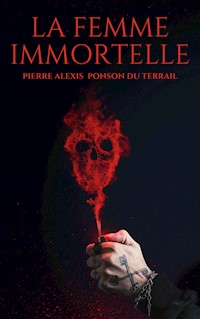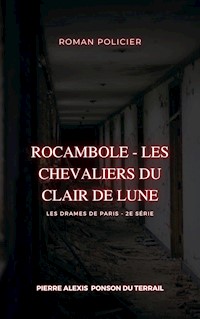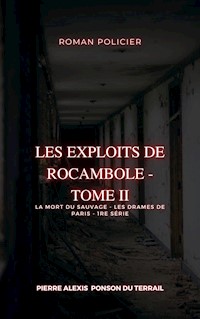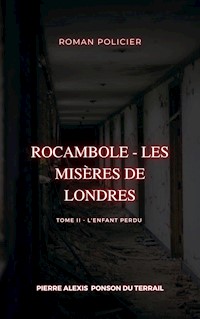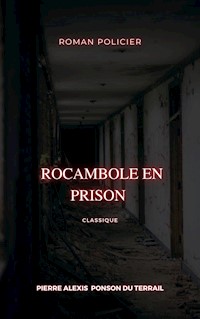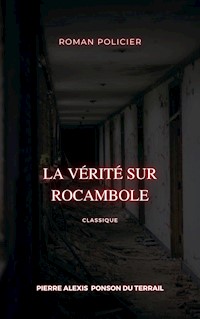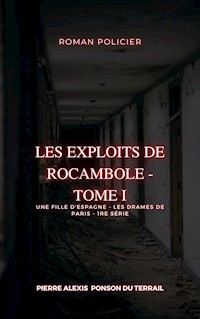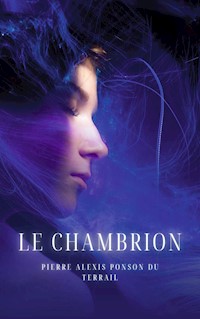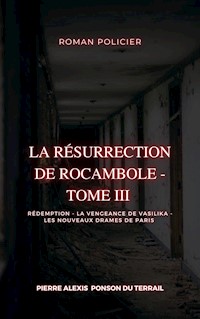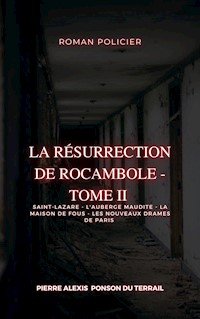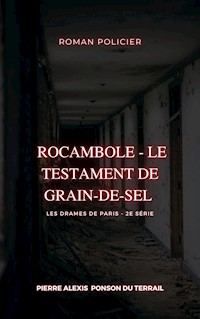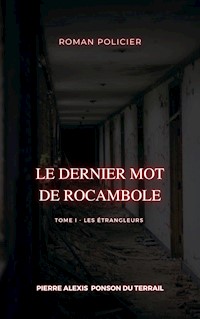
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Résumé de l'histoire dans le synopsis des aventures de Rocambole.
Das E-Book Le Dernier Mot de Rocambole wird angeboten von Books on Demand und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
littérature française, Classique, AVENTURES, roman policier, Mystères
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 525
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pierre Alexis Ponson du Terrail
LE DERNIER MOT DE ROCAMBOLETome ILES ÉTRANGLEURS
La Petite Presse – 21 août 1866 au 8 août 1867350 épisodes
E. Dentu Le Dernier Mot de Rocambole
(5 volumes) 1866 – 1867
Table des matières
PREMIÈRE PARTIE LES RAVAGEURS
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV
DEUXIÈME PARTIE LES ÉTRANGLEURS
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV
XLVI
Mentions légales
PREMIÈRE PARTIELES RAVAGEURS
I
Paris a des nuits effrayantes de silence et d’obscurité. Le brouillard estompe les toits, une pluie fine rend le pavé glissant, le vent courbe la flamme des réverbères, et la Seine coule silencieuse entre ses deux rives de pierres.
Nul passant sur les quais, nulle voiture sur les ponts.
La grande ville se tait, les honnêtes gens ont fermé leurs portes, le monde des voleurs respire et s’apprête à ses expéditions ténébreuses.
Qu’importe que le boulevard vive encore à une heure du matin, tout resplendissant des lumières de sa guirlande de cafés bruyants ?
De ce côté-ci, au bord de l’eau, le silence est si grand qu’on dirait une nécropole.
Il est un endroit sinistre où un des bras de la Seine étranglé entre deux hautes murailles, passe avec des tentations vertigineuses pour ceux qui songent au suicide.
Canal plutôt que fleuve, eau dormante qui bouillonnait en amont et reprendra son cours rapide en aval, la Seine semble s’arrêter noire, profonde, mystérieuse, avec des secrets de mort étranges, entre les deux bâtiments de l’Hôtel-Dieu.
Accoudez-vous un peu sur le parapet du pont de la Cité ou du pont de l’Archevêché ; regardez-la couler entre ces deux asiles de souffrance, cette eau qui redeviendra limpide et bleue, là-bas, au delà des coteaux de Sèvres et de Saint-Cloud, et sa tranquillité sombre vous donnera le frisson.
Vous qui cherchez l’oubli dans la mort, venez là : vous qui hésitez à quitter la vie, venez encore. La folie du suicide vous montera au cerveau, après dix minutes de contemplation.
Or, par une de ces nuits dont nous parlions tout à l’heure, un immense radeau, un train de bois, comme on dit, passait au fil de l’eau entre ces deux arches funestes, du pont de la Cité et du pont de l’Archevêché.
Trois hommes assis à l’avant causaient tout bas.
Un quatrième, à l’arrière du train, manœuvrait un gouvernail primitif fait avec une longue poutre.
– Quel temps de chien ! disait un des flotteurs, en se frottant vigoureusement les bras et les mains pour se réchauffer.
– Ma peau de bique est traversée, dit le second.
– Et dire, murmura le troisième, que nous ne serons pas au cabaret de la mère Camarde, à l’enseigne de l’Arlequin, avant deux heures du matin ! J’ai une soif d’enfer.
– Qui t’empêche de boire un coup ? dit le premier en riant. La grande tasse est pleine… et c’est de l’eau douce, encore.
– Merci ! je n’en use pas. Je n’ai bu de l’eau qu’une fois, et ce n’était pas de bonne volonté, camarade.
– Et quand donc ça, le Notaire ? demanda le premier flotteur.
– Quand j’étais là-bas…
Et il souligna le mot.
– Ah ! oui, au pré de Toulon ?
– Justement, nous avions tenté de nous sauver à la nage, un soir, mon camarade et moi : il s’est noyé et moi on m’a repris.
– Ce qui ne t’a pas empêché de filer un peu plus tard.
– Naturellement.
Celui des flotteurs qui s’était plaint que sa peau de bique était toute mouillée, et qui, à l’accent frais et sonore de sa voix, paraissait être un jeune homme, dit avec un certain enthousiasme :
– C’est égal, je ne craindrais pas le bagne, moi !
– Ça vaut mieux que la Centrale toujours ; j’y ai fait deux ans, je sais ce que c’est, dit le second.
Celui qui venait de Toulon reprit :
– Tu es jeune toi, Marmouset : quêque t’as ?
– Dix-neuf ans.
– Tu as le temps de voir ça et de comparer.
Et l’ex-forçat se mit à rire.
Mais le premier des trois flotteurs, celui qui disait avoir fait deux ans de Centrale, ne partagea pas cette hilarité.
Il avait les yeux en l’air et regardait le pont de la Cité dont le radeau approchait lentement.
L’arche gigantesque se détachait aussi noire que de l’encre de Chine sur le ciel déjà noir.
Au-dessus et au milieu, comme un clocheton sur la toiture d’une église, on voyait une silhouette d’une parfaite immobilité.
Était-ce un homme ? était-ce un poteau ?
Voilà ce qu’il était impossible de dire.
– Qu’est-ce que tu regardes donc, la Mort-des-braves ? demanda le flotteur qui avait connu la vie du bagne.
Celui qui répondait à ce singulier nom étendit la main vers l’arche du pont.
– Je crois bien, dit-il, que voilà un homme.
– Je parierais pour un réverbère qui s’est éteint, dit Marmouset, car on avait ainsi surnommé le gamin.
– Imbécile ! dit le forçat, tu ne connais donc pas mieux ton Paris que ça ?
– Plaît-il ? fit le gamin piqué.
– Où sommes-nous ?
– En Seine donc !
– Oui, mais à quel endroit ?
– Auprès de Notre-Dame et de l’Hôtel-Dieu.
– Eh bien ! tu devrais savoir qu’il n’y a pas de réverbère au milieu du pont de la Cité.
De plus en plus piqué, Marmouset répondit :
– Comme vous le dites, j’ai le temps d’apprendre.
La Mort-des-braves regardait toujours cette silhouette immobile.
– J’ai idée, dit-il, que c’est un homme qui veut casser sa pipe et dévisser son billard.
Dans ce langage pittoresque du peuple de Paris, ces deux images équivalent au verbe mourir.
– Si le cœur lui en dit, fit Marmouset froidement. Peut-être que c’est pour un chagrin d’amour.
– À moins, ricana le forçat, que ce ne soit quelque banquier qui a mangé la grenouille de ses actionnaires.
– Ohé ! monsieur ! cria Marmouset, faut pas vous gêner… l’eau est bonne…
Mais comme le gamin parlait, et avant sans doute que sa voix ne fût parvenue en haut du pont, la silhouette avait fait un mouvement assez semblable à celui de la cheminée d’un bateau à vapeur passant sous un pont.
Puis quelque chose de noir avait tourbillonné dans l’air.
Puis encore l’eau tranquille avait été frappée par quelque chose qui tombait, et s’était entr’ouverte, gouffre perfide, pour engloutir sa victime.
– Ça y est, Marmouset, monsieur est servi.
Et il se mit à rire.
Mais le quatrième flotteur, celui qui était à l’arrière et qui ne s’était point mêlé à la conversation, jeta un cri, abandonna la barre et tomba à l’eau.
– Bon ! dit la Mort-des-braves, qu’est-ce qu’il va donc faire celui-là ?
– Il va le repêcher donc !
– L’imbécile ! dit l’ex-forçat.
Marmouset fit un porte-voix de ses deux mains et cria :
– Hé ! l’Étourneau, si tu le repêches vivant, tu n’auras que quinze francs ; noie-le, c’est dix francs de plus.
Le flotteur à qui on venait de donner l’épithète de l’Étourneau était un vigoureux jeune homme de vingt-sept à vingt-huit ans, nageur intrépide, pour qui la Marne n’avait ni trahisons, ni mystères.
Il fendit l’eau, et se dirigea avec le calme et la précision d’un chien de Terre-Neuve vers l’endroit qu’il ne voyait pas, tant la nuit était sombre, mais où il entendait un sourd clapotement.
L’homme qui s’était volontairement jeté à l’eau avait été au fond tout d’abord.
Mais la nature avait repris ses droits.
Instinctivement, cet homme, qui savait nager, était remonté à la surface.
Et alors une lutte s’était engagée.
Une lutte terrible, acharnée, féroce entre l’âme qui voulait quitter la vie, et le corps qui ne voulait pas mourir.
Pendant ce temps, le flotteur l’Étourneau arrivait et saisissait le noyé par les cheveux.
Le noyé commençait à disparaître : – l’âme avait vaincu le corps.
Et Marmouset criait toujours.
– Mais noie-le donc, imbécile ! c’est dix francs de plus.
Le radeau qui suivait le fil de l’eau, fort calme en cet endroit, était encore à vingt brasses du pont.
Le flotteur, qui s’était bravement dévoué pour sauver la vie à un de ses semblables, l’avait donc dépassé de toute la vitesse que peut déployer un vigoureux nageur.
Ceux qui étaient restés sur le radeau, c’est-à-dire Marmouset, la Mort-des-braves et le forçat ne voyaient rien ; mais ils entendaient le bruit d’une lutte.
C’était maintenant contre son sauveur que se débattait le noyé.
– Ma foi ! dit la Mort-des-braves, ça vaut la peine d’être vu, ça. On peut bien rallumer le fanal ; pour deux liards de chandelle, on n’en mourra pas.
Il y avait à l’avant du train de bois une lanterne que les flotteurs n’allumaient que sur les canaux et lorsqu’ils arrivaient aux écluses ; hors de là, ils aimaient mieux suivre le courant dans les ténèbres.
Les ténèbres convenaient mieux à leurs mœurs et à leurs habitudes.
La Mort-des-braves battit le briquet, alluma la lanterne, et la lanterne projeta sa lueur en avant du train de bois.
Alors les trois flotteurs aperçurent leur compagnon qui essayait de se débarrasser des terribles étreintes de l’homme qui se noyait, et de le repêcher sans se noyer lui-même.
Et soudain, l’homme qui avait été au bagne poussa un cri :
– C’est LUI !
Puis il se jeta à l’eau, comme avait fait l’Étourneau pour aller au secours de l’homme qui se noyait…
II
Marmouset et la Mort-des-braves avaient été un moment frappés de stupeur en voyant leur camarade le Notaire se jeter à l’eau à son tour pour aider le flotteur l’Étourneau à repêcher le noyé.
– C’est donc quelque prince russe ? murmura Marmouset avec son accent railleur et cynique.
– C’est toujours une connaissance, pour que le Notaire s’en soit mêlé. Il n’est pas comme cet imbécile de l’Étourneau qui est honnête comme un caniche et pleure quand un chat a mal à la patte.
Et la Mort-des-braves haussa les épaules avec un certain dédain.
Pendant ce temps le radeau continuait sa marche lente et s’approchait peu à peu de l’endroit où ces trois hommes formaient un groupe étrange se débattant à la surface de l’eau.
Celui qui s’était jeté du haut du pont et voulait mourir était un homme d’une force herculéenne, et l’Étourneau, si habile nageur qu’il fût, ne parvenait point à se dégager de son étreinte.
De temps en temps, le noyé reparaissait à la surface et disait :
– Laissez-moi mourir, vous !
L’Étourneau tenait bon et cherchait à le saisir par les cheveux.
Enfin le Notaire était arrivé.
Celui-là aussi était un solide gaillard et entre ces deux hommes, le noyé ne put faire aucune résistance.
Et comme le radeau arrivait, ils le prirent tous deux sous les aisselles et le jetèrent dessus.
Le noyé avait épuisé ses forces, mais il n’avait point perdu connaissance.
Et il promenait autour de lui un regard hébété, grâce au fanal dont la lueur se projetait sur le visage des flotteurs.
– Je te connais, toi, murmura-t-il, en regardant le Notaire.
– Moi aussi, répondit ce dernier, je te connais… sans cela est-ce que j’aurais pris un bain ? Les affaires des autres ne me regardent pas, je ne me mêle que des camarades.
Le noyé était un homme de haute taille, de large stature, à la figure bestiale, aux cheveux presque blancs.
Il était plus près de soixante ans que de cinquante.
Marmouset et la Mort-des-braves le regardaient avec curiosité.
Quant au Notaire et à l’Étourneau, ils le tenaient toujours par le bras, de peur que la fantaisie ne lui prît de se précipiter à l’eau de nouveau.
Mais la lutte qu’il avait soutenue en épuisant ses forces avait éteint sa volonté.
En proie à une véritable prostration, il regardait attentivement ces hommes qui lui étaient inconnus, et le forçat qu’il reconnaissait :
– Tu étais là-bas, toi ? dit-il enfin.
– Pardieu ! répondit le forçat.
– On t’appelait le Notaire…
– C’est toujours mon nom. Et toi tu étais Jean-le-boucher.
– Jean-le-bourreau, fit le noyé d’une voix sourde.
– C’est bien çà. Seulement tu as joliment fait la paix avec les camarades le jour du Bonnet-vert.
Jean-le-boucher ou Jean-le-bourreau, comme on le nommait au bagne, – car c’était bien lui, – eut un sourire de désespoir :
– J’ai trahi mon maître, murmura-t-il.
Les quelques mots échangés entre lui et l’ex-forçat le Notaire avaient éveillé au plus haut degré la curiosité de Marmouset et de la Mort-des-braves.
L’Étourneau, le brave homme qui n’était allé ni à Toulon, ni à Poissy et pleurait quand on écrasait la patte d’un chat, ne comprenant rien à l’argot de ses compagnons, s’en était retourné à l’arrière du train de bois, reprendre son gouvernail, avec la satisfaction calme que procure le sentiment du devoir accompli.
– Qu’est-ce que vous dégoisez là, vous autres ? demanda la Mort-des-braves.
– Ça m’intrigue tout de même, fit Marmouset à son tour.
Jean-le-bourreau les regardait avec défiance.
– Tu peux parler devant eux, dit le Notaire, ce sont des amis.
En argot, le mot ami signifie voleur.
Et pour lui donner l’exemple, le Notaire continua :
– Ce gaillard-là, tel que vous le voyez, c’est l’ancien bourreau du bagne de Toulon.
La Mort-des-braves fit la grimace.
Marmouset, qui n’avait pas d’expérience encore, comme disait le Notaire, ne put se défendre d’un léger frisson.
– Mais, reprit l’ex-forçat, il s’est joliment réhabilité, allez !
Et s’il retournait au pré, on le recevrait comme Rocambole lui-même.
– Rocambole ? fit Marmouset, un drôle de nom ! C’est-y un fameux ?
– J’en ai souvent entendu parler à la Centrale, dit la Mort-des-braves.
– Le maître !… murmura Jean-le-bourreau, qui prit sa tête à deux mains et parut s’abîmer dans un sombre désespoir.
Le radeau, en ce moment, après avoir passé le pont de la Cité, filait entre le quai des Orfèvres et celui de la Vallée et prenait une allure plus rapide, car la Seine retrouvait, en cet endroit, son courant rapide.
Et comme Jean-le-bourreau paraissait étreint par quelque terrible souvenir et ne prêtait plus aucune attention à ce que disaient les trois flotteurs, le Notaire continua :
– Rocambole ! c’est le Dieu du bagne, l’homme qui a toujours enfoncé tous les curieux et tous les marchands de lacets. Un jour, il lui a pris fantaisie de s’en aller, et les portes se sont ouvertes. On allait guillotiner un camarade, il a arrêté en chemin le couteau de la guillotine.
– C’est fameux, ça ! dit la Mort-des-braves.
– J’irai au pré rien que pour le voir, dit Marmouset avec enthousiasme.
Alors le Notaire raconta dans tous ses détails à ses deux compagnons l’histoire étonnante de Rocambole et son évasion au bagne, sept ou huit mois auparavant.
– Ah ! dit la Mort-des-braves, si nous avions un pareil chef au lieu du Pâtissier, qui est un feignant, nous ferions de rudes affaires.
– Peut-être…
En ce moment, Jean-le-boucher releva la tête.
– Vous ne le retrouverez pas, murmura-t-il.
– Pourquoi ?
– On l’a repris.
– Bah ! il se sauvera de nouveau.
– Et comment l’a-t-on repris ? demanda Marmouset, qui tenait à s’instruire.
– C’est moi qui l’ai vendu, dit Jean-le-bourreau avec désespoir.
– Toi ? fit le Notaire en fronçant le sourcil.
– Oh ! je ne l’ai pas fait à dessein, va ! Mais je suis une brute… le curieux m’a fait jaser et m’a enfoncé.
Aussi, continua Jean, sur le visage bestial duquel coulèrent deux grosses larmes, c’est pour cela que je voulais me périr tout à l’heure. On m’avait repris, moi aussi. On m’avait ferré. J’étais en route pour Toulon. J’ai fait un trou au wagon cellulaire, et je me suis laissé tomber sur la voie. Je croyais que le train m’écraserait. Quand il a été passé tout entier sur moi sans m’atteindre, je me suis relevé sain et sauf. Alors, je suis revenu à Paris… et…
Le Notaire interrompit Jean-le-bourreau, en jetant un nouveau cri et disant :
– Bon ! encore un homme à l’eau !
Le train de bois, pendant le récit du Notaire, avait fait du chemin ; il était maintenant au-dessous du pont de Grenelle.
Les trois flotteurs n’avaient pas songé à éteindre leur fanal et sa lueur se projetait à vingt ou trente mètres en avant.
Or, à cette distance, le Notaire venait d’apercevoir un cadavre qui flottait sur l’eau, les bras crispés autour d’une planche.
– Faut le repêcher ! dit Marmouset. C’est vingt-cinq francs de trouvés !
III
Faisons maintenant connaissance avec la mère Camarde et son cabaret à l’enseigne de l’Arlequin.
Dans le langage imagé du peuple de Paris, on appelle un arlequin l’assemblage de toutes sortes de viandes et de restes que les restaurants vendent aux cabarets de bas étage.
Quand vous traversez le pont de Suresnes, vous avez devant vous les coteaux de Puteaux et de Courbevoie, derrière vous le bois de Boulogne.
Sur la rive gauche de la Seine, un peu après Puteaux, à un quart de lieue avant Courbevoie, il y a une maisonnette bâtie de torchis, dont les fenêtres et les portes sont peintes en rouge.
C’est le cabaret de l’Arlequin.
Ni à gauche, ni à droite aucune maison.
Le cabaret est isolé.
Le canotier joyeux que le dimanche arrache à son magasin ou à son atelier et rend à sa youle ou à son youyou, ne songe jamais à se rafraîchir au Cabaret de l’Arlequin.
Les bourgeois qui viennent en promenade sur la berge n’y entrent pas davantage.
La maison est d’aspect sinistre.
L’hôtesse qu’on voit constamment assise sur sa porte, attendant de rares chalands, est une grande femme, sèche, nerveuse au nez busqué, aux yeux noirs, qui a dû être d’une beauté hardie et fatale dans sa jeunesse et dont le regard a quelque chose de sinistre.
Au surnom qu’elle porte, on dirait une femme tout autre.
Quelque ogresse petite et trapue, avec des épaules larges et un nez épaté, il n’en est rien.
Ce nom de Camarde a une origine plus terrible.
Elle est la veuve d’un supplicié.
C’est pour cela que les bourgeois craintifs et les canotiers joyeux passent sans s’arrêter devant cette maison peinte en rouge, comme le sinistre instrument de mort sur lequel est monté, voilà dix ans, son propriétaire.
Pourtant la veuve ne se plaint pas.
Elle ne dit pas d’injures aux passants qui détournent la tête.
Elle ne salue pas avec des imprécations les canots qui filent à toute voile, emportant un rieur équipage de calicots et de grisettes.
Que lui importe de ne rien vendre le jour !
Ce n’est pas à la lumière du soleil que la Camarde fait ses affaires.
Mais vienne la nuit !
Alors une lumière blafarde tremblote derrière les carreaux de papier huilé qui garnissent les fenêtres, un filet de fumée monte au-dessus du toit.
Les pratiques arrivent, isolées ou deux par deux, échangeant de mystérieux coups de sifflets, en chantant des couplets étranges des bagnes et des maisons centrales qu’on appelle l’argot.
Un train de bois s’est arrêté, juste en face du cabaret.
Une barque s’est détachée de cette île toute verdoyante qui vient finir au pont de Courbevoie.
D’amont et d’aval arrivent un à un des hommes à mine suspecte ; les uns en bourgerons bleus, les autres couverts de ce vêtement des rouliers et des flotteurs qu’on appelle une peau de bique.
Et avec eux des femmes étranges, les unes vieilles et hideuses, les autres jeunes et d’une beauté hardie.
Et le cabaret de la Camarde s’emplit peu à peu, et l’eau-de-vie à un sou le poison distille son venin et brûle ces gosiers blasés.
Et ce sont des rires et des chants obscènes, ou de mystérieux conciliabules.
Le cabaret de la Camarde est le rendez-vous de cette piraterie de la Seine qu’on appelle le Ravage.
Jadis, elle se réunissait à Asnières, dans l’île à laquelle elle avait donné son nom.
Mais Asnières est devenu depuis six ans un pays de villégiature et de high-life.
Les marchands de nouveautés y ont ouvert des magasins splendides, les restaurants y sont nombreux, les cafés plus nombreux encore, et le parc, trois fois par semaine, projette ses illuminations sur la petite île que Eugène Sue a chantée dans les Mystères de Paris.
Les Ravageurs ont besoin de plus de silence et d’obscurité, il leur faut un endroit désert, un cabaret éloigné de tout autre demeure.
Quand la Camarde est devenue veuve, le vide s’est fait autour d’elle.
Alors les Ravageurs sont venus.
Le forçat en rupture de ban qui n’ose rentrer dans Paris vient puiser du courage à l’enseigne de l’Arlequin.
C’est là que trône le Pâtissier.
Le Pâtissier est un chef de bande. Les Ravageurs l’ont proclamé roi.
C’est un petit homme sec et maigre qui est d’une force peu commune.
Ancien couvreur, il est d’une agilité remarquable et perche comme un chat sur les gouttières de la maison où il a résolu de commettre un vol.
Il a été condamné à dix ans de réclusion ; il a fait son temps. La loi n’a plus rien à réclamer.
Le jour, le Pâtissier est un brave homme qui pêche honnêtement du barbillon et du goujon.
La Camarde l’a pris en pension.
Au temps du frai, quand la pêche est interdite, le Pâtissier raccommode ses filets et radoube ses canots.
Pas plus que la Camarde, il ne se plaint de la dureté des temps.
Quelquefois cependant il disparaît pendant plusieurs jours, et même plusieurs semaines.
– Il est à la campagne, dit la Camarde.
Les initiés savent ce que cela veut dire.
La bande du Pâtissier a des ramifications avec les quatre ou cinq départements qui sont en relation avec Paris par la Seine, la Marne et les canaux.
Le monde de rivière, comme on dit, se courbe tout entier sous sa loi.
Les flotteurs qui descendent de Clamecy apportent souvent des renseignements précieux.
Alors le Pâtissier part avec eux.
Quelques jours plus tard on apprend qu’une maison de campagne isolée, au bord de l’Yonne ou de la Seine, a été dévalisée.
Quelquefois même les habitants ont été assassinés.
Mais quand la justice est saisie, le Pâtissier est fort tranquillement assis au seuil de maman Camarde, comme l’appellent les flotteurs, ou dans l’île Verte, sa ligne à la main.
Or, cette nuit-là même où la Mort-des-braves, le Notaire et leurs deux compagnons avaient repêché Jean-le-bourreau, et une heure après avoir découvert un cadavre dont les bras s’étaient crispés à l’entour d’une planche, les habitués ordinaires du cabaret étaient réunis.
Le Pâtissier disait :
– J’attends nos amis de Clamecy.
– Y a-t-il un bon coup à faire ? demanda une belle fille au regard effronté et couverte de haillons, qu’on appelait la Pie-borgne.
– C’est possible, dit le Pâtissier. Le dernier train de bois m’a fait savoir que la Mort-des-braves nous apporterait du nouveau.
– Silence ! exclama la Camarde, qui était assise au comptoir.
On entendit des pas au dehors.
Les Ravageurs se turent un moment.
– Bah ! dit le Pâtissier, ce ne peut être que des amis.
En ce moment, la porte s’ouvrit et deux hommes entrèrent portant sur les épaules un homme inanimé.
Cet homme était celui que les flotteurs avaient aperçu à l’avant du train de bois et qu’ils avaient pris pour un cadavre.
Cet homme, Jean-le-bourreau l’avait reconnu et s’était écrié :
– C’est le maître !
Cet homme, c’était ROCAMBOLE !
IV
C’était le Notaire et Jean-le-bourreau qui portaient le corps inanimé de Rocambole.
La Mort-des-braves et Marmouset suivaient et l’enfant disait, faisant allusion à Jean-le-bourreau :
– Je crois bien que le pauvre vieux se trompe : il est bien mort.
– Sans compter, disait la Mort-des-braves, qu’il a une jolie boutonnière au beau milieu de la poitrine et qu’il a dû perdre joliment du sang.
La chose n’était pas rare de voir arriver des noyés au cabaret de la Camarde.
Entre Sèvres et Saint-Cloud surtout, les flotteurs en trouvaient souvent dans les herbes.
On les chargeait alors sur le train et on les conduisait au cabaret de l’Arlequin.
Là on avertissait le commissaire, et toutes les formalités d’usage étaient remplies, en vue de la prime bien entendu.
On déposa donc Rocambole au milieu du cabaret.
– Mon pauvre vieux, reprenait le Notaire, je crois qu’il est mort.
– Non, ce n’est pas possible, s’écriait Jean-le-bourreau, qui s’arrachait les cheveux.
Le corps était crispé ; la face livide, toutes les apparences de la mort existaient.
– Je vais vous dire ça, fit la Camarde.
Les habitués de l’Arlequin avaient fait un cercle autour de ce corps qui était peut-être bien un cadavre.
– Un beau garçon ! murmura la Pie-borgne.
– Il aura joué du couteau, dit un autre.
– Vous vous trompez, fit un vieux ravageur, cette boutonnière-là n’a pas été faite avec un couteau.
– Avec quoi donc ? demanda la Pie-borgne.
– C’est un coup d’épée.
– Quel chic ! s’écria Marmouset. Un coup d’épée, c’est un luxe qui est fait pour les bourgeois et les gens de la haute pègre.
Jean-le-bourreau lui montra le poing avec colère.
Pendant ce temps, la Camarde s’était penchée sur Rocambole.
Elle avait appuyé son oreille sur le cœur.
Le cœur ne battait plus.
Elle avait pris les deux bras l’un après l’autre et les avait secoués.
Les bras avaient cette élasticité molle qui suit la mort.
Elle eut recours à une épreuve suprême.
Elle alla prendre un petit miroir devant lequel le Pâtissier se faisait la barbe et qui était suspendu au mur.
Quand on la vit revenir vers le cadavre, ce miroir à la main, il y eut un moment de silence presque solennel.
Jean-le-bourreau avait de grosses larmes sur les joues.
Le Notaire lui-même, dont l’impassibilité était bien connue, témoignait une si vive anxiété, que le Pâtissier s’écria :
– Mais quel est donc cet homme, que vous avez si grand’peur qu’il soit mort ?
Le Notaire et Jean ne répondirent pas.
La Camarde s’était agenouillée auprès du corps : ensuite elle avait avec ses mains desserré la mâchoire ; puis elle en avait approché le miroir.
Deux minutes s’écoulèrent.
La Camarde retira la glace et Jean-le-bourreau jeta un grand cri.
La glace était ternie…
Donc un souffle était sorti de la poitrine, – donc le noyé n’était pas mort.
– Mes enfants, dit alors l’Ogresse, il n’est pas mort, mais nous aurons du mal à le réchapper. Il faut allumer un grand feu et l’envelopper dans des couvertures. En même temps, nous allons le frictionner.
– Un homme de plus ou de moins, voilà-t-y pas une belle affaire ? grommela le Pâtissier.
– Parle pour toi, Pâtissier, dit la Pie-borgne, tu es assez vieux et assez laid… tandis que lui…
Le chef des Ravageurs ne répondit pas à cette insolence. La Pie-borgne avait avec lui son franc-parler.
Jean-le-bourreau s’était levé en disant :
– Il faut le sauver !
– Je crois bien, avait répondu le Notaire, avec un enthousiasme fort rare chez lui.
– Mais qui est-ce donc ? demanda le Pâtissier, animé d’une fureur croissante.
– Un homme, auprès de qui tu n’es qu’un feignant, dit le Notaire.
– Tu m’insultes ! hurla le Pâtissier.
Les autres Ravageurs murmuraient sourdement.
– Il paraît, dit Marmouset, que ce monsieur-là c’est Rocambole.
À ce nom, la colère du Pâtissier s’éteignit comme une torche qu’on tremperait dans l’eau.
– Lui, lui ! balbutia-t-il.
Pendant ce temps, les deux femmes s’étaient mises à la besogne, elles avaient pris ce corps inanimé et l’avaient porté auprès du feu, dans lequel Marmouset avait jeté une falourde tout entière.
Puis la Camarde avait arraché les couvertures du lit qui se trouvait dans un coin du cabaret, en même temps que la Pie-borgne, qui avait le poignet solide, commençait des frictions sur la poitrine du noyé.
Et le Pâtissier lui-même s’était mis à l’œuvre.
Il avait pris une burette dans laquelle il y avait du vinaigre, et il frottait les tempes, les lèvres et les narines de Rocambole.
De temps en temps, la Camarde appuyait son oreille sur la poitrine.
Tout à coup, un éclair brilla dans ses yeux :
– Le cœur bat, dit-elle.
– Oh ! s’écria Jean, je savais bien qu’il n’était pas mort.
– Est-ce que Rocambole peut mourir ? dit le Notaire avec un accent de triomphe.
Le cœur en effet s’était remis à battre, et un souffle imperceptible passait au travers des lèvres.
Tant qu’on avait douté de la vie, toutes les poitrines avaient été anxieuses, les haleines suspendues.
Mais quand la Camarde, qui était une femme d’expérience, eut annoncé qu’elle répondait du retour à la vie, ce fut une véritable explosion de joie, un flux de paroles, un tumulte indescriptible.
– C’est qu’il paraît que c’est un fameux, celui-là, disait Marmouset.
– Je le crois bien, dit un Ravageur, silencieux jusque-là. Il nous a donné du fil à retordre, il y a trois mois.
– À toi ? dit le Notaire étonné.
– Oui, j’étais de la bande de Timoléon.
– Alors tu le connais, toi aussi, fit le Pâtissier.
– Je le connais sans le connaître, répondit le Ravageur, attendu que Rocambole change de visage comme nous changeons de blouse, nous autres.
– On appelle ça se faire une tête, dit encore Marmouset.
– Tais-toi, môme, fit la Camarde.
Le cœur battait maintenant avec violence, et quelques soupirs s’échappaient de la poitrine du noyé.
– Je crois bien qu’il va ouvrir un œil, dit la Camarde.
La Pie-borgne continuait ses frictions.
– S’il en réchappe, reprit le Notaire, nous en ferons notre chef.
Le Pâtissier haussa les épaules avec un geste d’humeur.
– Faudra te résigner, mon bonhomme. Là où est Rocambole, il commande.
Le Pâtissier n’eut pas le temps de répondre, car Jean-le-boucher poussa un nouveau cri…
Un cri de joie suprême, un cri de délire enthousiaste…
Rocambole venait de rouvrir les yeux…
V
Vingt-quatre heures se sont écoulées.
Rocambole est au lit, mais il a retrouvé la vie et avec elle la présence d’esprit.
La mort n’a pu trouver place dans ce corps d’acier ; la folie ne saurait entamer cette haute intelligence si mal employée jadis et que, depuis longtemps, le repentir a touchée.
Le cabaret de la Camarde a un rez-de-chaussée et un étage unique.
En bas, c’est le rendez-vous des Ravageurs ; en haut, c’est une vaste pièce dans laquelle on a transporté Rocambole.
Un seul homme est auprès de lui, – Jean-le-boucher, – le bourreau, comme on l’appelait au bagne.
Cet homme veille le Maître avec la sollicitude d’une mère ; – il lui sert à la fois de garde-malade et de médecin.
La nuit précédente, les flotteurs et les Ravageurs se sont séparés avec les premiers rayons de l’aube.
Pendant tout le jour, le cabaret de l’Arlequin est rentré dans son morne silence accoutumé.
Les canotiers ont passé sans s’arrêter ; le bourgeois a détourné la tête en voyant la terrible hôtesse assise sur son seuil.
Le Pâtissier est retourné à ses lignes de fond et à ses filets.
Quand la nuit est revenue, Jean-le-boucher est descendu dans le cabaret, et il a dit à la Camarde :
– Le Maître est bien faible encore, là-haut. Si on fait du train cette nuit, comme on en fait habituellement, je descends et je casse bras et jambes aux tapageurs.
– Sois tranquille, mon camarade, a répondu la Camarde, on ne fait de train chez moi que lorsque je le permets, et je ne le permettrai pas. Quand on a l’honneur d’avoir chez soi un homme comme mossieu Rocambole, on veille au grain.
La Camarde a tenu parole.
D’ailleurs le Notaire et la Mort-des-braves sont là pour lui prêter main-forte.
Les Ravageurs sont venus comme à l’ordinaire, mais on aurait dit des ombres, et l’on a bu sans choquer les verres, on a causé tout bas.
De temps en temps, le Notaire et la Mort-des-braves montent sur la pointe du pied et viennent savoir comment va le blessé.
Puis ils redescendent, et les Ravageurs se disent :
– Nous aurons bientôt un fameux chef !
Le Pâtissier qui, naguère, faisait trembler tous ces hommes, a perdu en quelques heures son autorité.
Il est détrôné par avance. Le prestige de Rocambole a suffi.
La mère Camarde elle-même paraît ne plus subir l’ascendant du Pâtissier.
Elle serait fière si Rocambole daignait lever les yeux sur elle.
Celui-ci, faible encore, car il a perdu beaucoup de sang, cause avec Jean-le-boucher.
– Où m’avez-vous repêché ? demande-t-il.
– Au delà du pont de Grenelle, maître.
Un souvenir traverse l’esprit de Rocambole.
– Oui, dit-il, c’est par là que j’ai dû perdre connaissance. Tout mon sang s’en allait, à mesure que je nageais. J’ai voulu traverser la Seine, ce qui, sans ma blessure, eût été un jeu pour moi ; mais le courant m’a entraîné. J’ai lutté vainement, mes forces me trahissaient. J’ai saisi une planche qui flottait devant moi, et mes yeux se sont fermés.
– C’est cette planche qui vous a sauvé, maître.
– Je le crois.
– Mais… cette blessure, où l’avez-vous reçue ?
À cette question, Rocambole tressaille. Puis il regarde attentivement Jean-le-boucher.
Celui-ci murmure en tremblant :
– Maître, je ne veux pas pénétrer vos secrets s’il ne vous convient pas de parler.
– Réponds-moi d’abord, dit Rocambole, où sommes-nous !
– Chez la Camarde.
– Qu’est-ce que cela ?
– L’hôtesse d’un cabaret fréquenté par des Ravageurs, des repris de prison et un tas de mauvais monde.
– C’est cette femme qui m’a apporté du bouillon tout à l’heure ?
– Oui ; maître.
– Comment es-tu avec ces gens-là ?
– Ils m’ont repêché, moi aussi.
– Tu te noyais donc ?
– Je voulais me périr de désespoir de vous avoir trahi.
Rocambole regarde cet homme, et il lit dans ses yeux un tel dévouement, une telle fidélité, qu’il lui tend la main.
– Mais tu étais en prison, comme moi, la dernière fois que je t’ai vu ?
– Oui, maître.
– Tu t’es évadé ?
– Oh ! j’avais si grand’peur de retourner au bagne et d’être forcé d’y reprendre mon ancien métier !
Et Jean raconte à Rocambole les incidents de son évasion.
– Écoute-moi à ton tour, dit le maître, je suis mort pour tous ceux qui m’ont connu.
– Vous !
– Excepté pour toi…
Et comme l’étonnement de Jean-le-boucher redouble :
– Non par crainte de la police, dit Rocambole. Elle a promis de me laisser tranquille. Et puisque tu t’es évadé, elle ne te reprendra pas, je te le promets.
Un sourire homérique éclaire alors le visage bestial de l’ancien bourreau.
– Vrai ? dit-il.
– Veux-tu être mon unique compagnon ?
– Oh ! maître, si je le veux !
– J’avais une tâche à remplir. Elle est accomplie. Si j’avais été lâche, je me serais tué. Mais on n’a pas le droit de se détruire. Je ne veux pas revoir les gens que j’ai connus et que j’ai aimés. Ils me croiront mort et vivront heureux. Mais, peut-être ai-je encore une œuvre à mener à bien en ce monde. Je sens que Dieu ne m’a pas encore pardonné !
Il dit cela d’une voix grave, émue, presque solennelle, cet homme dont les Ravageurs souhaitaient la guérison pour en faire leur chef.
Et Jean porta avec respect la main de Rocambole à ses lèvres et lui dit :
– Maître, parlez, ordonnez ! vous savez bien que tout mon sang vous appartient…
– Écoute, reprit Rocambole. L’autre nuit, je me suis battu, battu à outrance…
– Avec Timoléon ?
– Non, avec une femme qui tire l’épée comme un maître d’armes. La vie de cet enfant que tu m’as surpris, un soir, contemplant à travers les arbres de ce grand jardin sur lequel donnait la fenêtre de ma mansarde…
– Rue de la Ville-l’Évêque ?
– Oui. La vie de cet enfant était l’enjeu du combat. Cette femme m’a frappé ; mais, en me frappant, elle s’est enferrée sur mon épée.
– Oh ! je sais qui c’est… c’est la Russe.
– Oui.
– Et elle est morte, n’est-ce pas ?
– Je n’en sais rien, mais j’ai pris l’enfant dans mes bras, et je me suis sauvé par le jardin. Quand j’ai été sur le quai, j’ai déposé l’enfant évanoui sur le sol, pensant bien que mes compagnons le retrouveraient.
Puis je suis descendu sur la berge et je me suis jeté à l’eau.
D’abord j’ai songé à me noyer ; puis je me suis dit que je n’avais pas le droit de quitter la vie ; et alors j’ai voulu traverser la Seine tout en faisant croire à ma mort, car je laissais derrière moi une large trace de sang. Tu sais le reste.
– Eh bien ? dit Jean.
– Eh bien ! je voudrais savoir si l’enfant a été retrouvé par Milon et par Vanda, et s’ils l’ont rendu à sa mère. Va à Paris, et sois prudent.
– Mais si je les vois, que leur dirai-je ?
– Rien.
– Et s’ils vous pleurent… comme mort ?
– Tu les laisseras pleurer. Je veux savoir où est l’enfant, voilà tout.
– Mais, maître, dit Jean-le-boucher, quand vous serez guéri…
– Eh bien ?
– Vous n’allez pas rester parmi ces bandits ?
– Peut-être… dit Rocambole. Qui sait ? là peut-être est la nouvelle tâche qui m’est réservée…
Comme il murmurait ces mots, le Notaire entra suivi de la Mort-des-braves.
VI
La Mort-des-braves tournait et retournait son bonnet de marinier dans ses doigts, avec une gaucherie respectueuse.
Le Notaire avait un peu plus d’aplomb.
Néanmoins, on sentait que Rocambole lui en imposait, et qu’il reconnaissait en lui un homme supérieur.
– Que voulez-vous, mes amis ? demanda Rocambole de cette voix sympathique et mystérieusement caressante qui lui gagnait tous les cœurs.
– Voici la chose, dit le Notaire, c’est les camarades qui nous envoient… en députation.
– En députation, répéta la Mort-des-braves comme un écho.
– Voyons ? dit Rocambole.
– D’abord, nous venons savoir comment vous allez…
– Je vais mieux, mes amis, mais je suis au lit pour une quinzaine de jours au moins.
– C’est bien ce que je leur disais…
– Moi aussi, dit la Mort-des-braves.
Le Notaire se grattait l’oreille :
– Ça ne vous empêchera toujours pas, dit-il, de nous donner un bon conseil.
– De quoi s’agit-il ?
– Je vais vous le dire en deux mots, reprit le Notaire. Quand on ne peut pas travailler dans le grand comme vous, on travaille dans le petit. Quand je me suis évadé de là-bas, je suis venu à Pantin comme tous les camarades et j’ai cherché de la besogne.
Mais je n’avais pas un radis, la rousse est doublée, l’ouvrage ne va pas. J’ai été bien heureux de rencontrer le Pâtissier.
– Qu’est-ce que le Pâtissier ?
– C’est le chef des Ravageurs.
– Ah !
– Il m’a embauché. Nous avons fait quelques jolis coups, mais il n’y a pas gras. Je remonte les rivières et les canaux, je vais à la découverte.
Puis je redescends avec les trains de bois. Quand j’ai trouvé quelque chose, j’avertis les camarades, dont le rendez-vous est ici, et nous partons.
– Bien, fit Rocambole d’un signe de tête.
– Ça allait comme ça depuis quelque temps, lorsque nous avons eu l’honneur de vous repêcher. Mais voilà que depuis hier nous sommes tout en désordre.
– Pourquoi ?
– Le Pâtissier, qui n’est qu’un feignant, voudrait rester notre chef.
– Eh bien !
– Vous pensez, maître, dit respectueusement le Notaire, que le Pâtissier n’est pas de force auprès de vous.
– Ah !
Et un sourire glissa sur le pâle visage de Rocambole.
– Sur quinze que nous sommes dans la bande, il y en a dix qui crient déjà : Vive Rocambole !
– Vraiment ?
– Il y en a quatre qui veulent rester avec le Pâtissier. Mais c’est par peur qu’ils disent cela ! Ça ne sera pas difficile de les décider.
Rocambole eut un sourire dédaigneux.
– Quels sont les états de service du Pâtissier ?
– Il est allé à Brest.
– Est-ce un grinche ?
– Il a chouriné aussi, mais… pas souvent.
– Eh bien ! dit Rocambole, quand je serai sur pied, nous verrons ; et, d’un geste, il voulut congédier le Notaire et la Mort-des-braves, qui ne soufflait mot.
Mais le Notaire ne bougea pas.
– C’est que, dit-il, j’apportais un joli renseignement aux camarades.
– Ah ! Ah !
– Un beau coup à faire.
Rocambole prit un air attentif.
– Le Pâtissier dit, poursuivit l’ex-forçat, que puisque vous êtes malade, on doit faire le coup sans vous.
– C’est bon, dit Rocambole en tressaillant. Si l’affaire me plaît, j’entends la garder.
Et il eut un accent d’autorité qui remplit d’enthousiasme la Mort-des-braves et le Notaire.
– Seulement, reprit Rocambole, vous pensez bien, mes enfants, qu’avant de manquer me noyer, j’avais d’autres affaires en train.
– Oh ! ça va sans dire, dit la Mort-des-braves, qui triompha de sa timidité. Un homme comme vous n’a jamais les bras croisés.
– J’ai laissé quelques affaires en suspens à Pantin, poursuivit Rocambole, et je vais envoyer Jean aux renseignements. Quelle heure est-il ?
– Quatre heures du matin.
– Va, dit Rocambole à Jean-le-boucher. Tu passeras la barrière au petit jour. Tu sais ce que je t’ai dit ?
– Oui, maître.
– Eh bien ! en route et ne flâne pas.
Jean se dirigea vers la porte et sortit.
– Maintenant, dit Rocambole au Notaire, assieds-toi là, compagnon, et jase un brin.
– Touchant la chose en question ?
– Naturellement.
Et Rocambole se mit sur son séant et parut être tout oreilles.
Le Notaire dit alors :
– Un peu au-dessus de Charenton, la Seine fait un coude et laisse des collines à droite.
– Ce sont les coteaux de Villeneuve-Saint-Georges.
– C’est ça même.
– Il y a là à mi-côte, une maison isolée, entourée d’un grand jardin. Les gens qui l’habitent sont huppés, à ce qu’il paraît, c’est un vieux monsieur et une jeune dame.
– Le père et la fille sans doute ?
– On ne sait pas. Les uns disent oui, les autres prétendent que c’est la femme et le mari ; ils ne sortent jamais. On ne les a pas vus trois fois en deux ans, sur les routes des environs. La femme est toujours en deuil.
Ils n’ont que deux domestiques, une vieille servante et un vieux jardinier. Il n’y a même pas un chien de garde dans la cour.
– C’est bien cela, observa Rocambole.
– Plusieurs fois, en remontant la Seine, j’avais remarqué cette maison. J’ai pris des renseignements, c’est Marmouset qui a flâné par là.
– Qu’a-t-il appris ?
– Il s’est caché une partie de la nuit, il y a trois jours, dans le jardin.
Les deux domestiques couchent dans un pavillon.
Le vieux monsieur et la jeune dame s’enferment en face d’une fenêtre éclairée.
Quoiqu’ils soient à la campagne toute l’année, le vieux monsieur et la jeune dame se couchent tard et ils n’ont pas l’air de faire bon ménage.
– Ah ?
– Marmouset les a entendus se disputer, le monsieur parlait haut, il criait comme un roulier, la dame pleurait et se tordait les mains de désespoir ; mais comme les vitres étaient fermées, Marmouset n’a pu entendre ce qu’ils disaient.
– Tout cela est fort bien, dit Rocambole, mais ont-ils de l’argent ?
– Le vieux monsieur est sorti de la chambre de la dame en colère et fermant la porte très fort.
Puis peu après, une autre fenêtre s’est éclairée, alors Marmouset s’est laissé glisser à terre ; puis il a grimpé sur un autre arbre qui était en face de cette autre fenêtre.
– Et qu’y a-t-il vu ?
– Le monsieur qui ouvrait un coffre-fort et qui comptait des masses de billets de banque et des sébilles pleines d’or.
– Oh ! Oh !
– Vous pensez si toute la bande est allumée, et si le Pâtissier est pressé…
– Oui, dit Rocambole, mais ils m’attendront…
Et regardant le Notaire froidement :
– Tu vas descendre et tu leur diras que je défends qu’on fasse rien sans moi.
– Enfoncé le Pâtissier ! murmura la Mort-des-braves.
Et tous deux sortirent en courant de la chambre de Rocambole.
Maintenant transportons-nous à Villeneuve-Saint-Georges et faisons connaissance avec les hôtes mystérieux de la maison isolée.
VII
La description de la maison isolée faite à Rocambole par le Notaire était assez exacte.
Il y avait un grand parc touffu qui descendait jusqu’à la rivière.
La maison était petite, mais élégante d’aspect, de construction récente, et avait dû s’élever sur les ruines de quelque habitation seigneuriale.
Elle avait été longtemps à vendre, et il n’y avait pas plus de six mois que les hôtes mystérieux dont parlait le Notaire s’en étaient rendus acquéreurs.
Un soir, une voiture fermée s’était arrêtée à Villeneuve, chez Me ***, notaire.
Un homme enveloppé d’une pelisse fourrée, – on était en hiver alors – coiffé d’un bonnet d’astrakan, et ayant toute l’apparence et la physionomie d’un étranger, en était descendu.
Cependant il avait demandé à voir le notaire en fort bon français et sans le moindre accent.
L’inconnu avait dit au notaire :
– Vous êtes chargé de vendre une maison qui se trouve sur la droite, à mi-côte, en retournant à Paris ?
– Oui, monsieur, avait répondu le notaire.
– À qui cette maison appartient-elle ?
– À des gens de province qui ont hérité récemment. Une vieille dame y est morte l’année dernière.
L’inconnu n’avait pas sourcillé.
Il n’avait même pas demandé le nom de la vieille dame. Il avait accédé sans débats au prix d’acquisition.
La maison était toute meublée.
Comme elle n’était grevée d’aucune hypothèque, l’inconnu tira de sa poche un portefeuille gonflé de billets de banque et paya sur-le-champ, disant qu’il désirait entrer en jouissance immédiate.
Le lendemain, en effet, les gens de Villeneuve virent arriver un vieux domestique et une servante entre deux âges qui prirent possession de la maison, ouvrirent portes et fenêtres, lavèrent, nettoyèrent les appartements, ratissèrent les allées du jardin et s’installèrent ensuite dans le petit pavillon qui se trouvait au fond du parc.
Quelques jours s’écoulèrent.
On est curieux à Villeneuve, presque autant que dans une ville de la vraie province.
Les domestiques avaient une tournure étrangère.
Ils s’exprimaient parfaitement en français, mais entre eux ils parlaient une autre langue que personne ne comprenait à Villeneuve.
On les avait questionnés vainement chez le boucher et l’épicier.
Personne n’avait pu savoir le nom de leur maître, ni de quel pays ils venaient.
Le notaire *** lui-même avait gardé un silence prudent sur le nom, les titres et les qualités de son nouveau client.
Au bout de huit jours l’étranger arriva.
Mais il n’était pas seul, une jeune dame l’accompagnait.
Ils traversèrent Villeneuve au grand trot de deux mecklembourgeois qui traînaient une voiture de voyage.
On n’eut pas le temps de les voir.
À peine put-on soupçonner que l’homme était vieux et la femme jeune.
Cette dernière était toute vêtue de noir.
Des semaines entières, puis de longs mois s’écoulèrent avant qu’on ne les revît.
Cependant ils habitaient la maison.
Bien souvent les bourgeois de Villeneuve s’en étaient allés rôder autour du parc, mais inutilement.
Cette maison avait l’air d’un tombeau.
Seuls, les domestiques sortaient, venaient faire leurs provisions au village et ne parlaient à personne.
Marmouset, le petit bandit que les Ravageurs avaient envoyé en éclaireur, était donc plus heureux que les gens de Villeneuve, puisque, grimpé sur un arbre, il avait vu du même coup le vieux monsieur et la jeune dame, ensemble d’abord, et paraissant se quereller.
Et c’est à cette scène, que Marmouset devinait plutôt qu’il ne l’entendait, que nous allons assister.
La jeune dame était assise dans une bergère, au coin du feu.
Une seule lampe, placée sur la cheminée, éclairait la pièce qui était une chambre à coucher.
Mais ses rayons tombaient verticalement sur la jeune femme et permettaient de remarquer sa beauté pâle, fiévreuse, maladive.
Grande, amaigrie par quelque mystérieuse souffrance, elle avait des mains blanches et transparentes comme de la cire, de grands yeux noirs bordés d’un cercle de bistre et des lèvres pâles au coin desquelles la douleur avait creusé son pli.
Peut-être n’avait-elle que vingt ans, peut-être en avait-elle trente.
Le type de sa physionomie rappelait les races orientales du Nord, telles que la race caucasienne ou la race slave.
– Voici bien longtemps déjà que nous sommes ici, mon père, poursuivit-elle, bien longtemps que vous m’avez arrachée, une nuit, à l’aide d’un narcotique, à mon enfant qui venait de naître, comme vous m’aviez arrachée déjà à l’homme qui était mon époux devant Dieu. Mon père, ne mettrez-vous point un terme à mon martyre ?…
Le vieillard se taisait toujours.
– Ne me rendrez-vous pas mon enfant ? supplia la jeune femme.
– C’est l’enfant du crime.
– Oh ! fit-elle.
Et soudain ses joues s’empourprèrent après avoir pâli, un éclair s’alluma dans ses yeux.
Et, se dressant tout d’une pièce, elle eut un geste de colère, elle prit l’attitude qu’ont tout à coup ceux qui, longtemps courbés sous une volonté de fer, se révoltent enfin.
Et elle vint se placer devant le vieillard, stupéfait d’une pareille audace.
– Je veux savoir, dit-elle…
– Savoir quoi ? fit-il d’une voix glacée.
– Savoir ce qu’est devenu Constantin.
– Il est en Russie et n’a pas quitté son régiment.
Mais la jeune femme ne crut point à cette réponse.
– Oh ! dit-elle, vous mentez !
Tout en elle annonçait une douleur morne et profonde, un affaissement physique et moral qui semblait tenir du désespoir.
L’homme, au contraire, le vieux, comme disait Marmouset, formait avec cette femme un contraste étrange.
C’était un homme assez robuste, en dépit d’une forêt de cheveux blancs et d’un collier de barbe grise, mais qui pouvait bien avoir dépassé la soixantaine.
Coiffé de ce bonnet d’astrakan qui avait révolutionné les gens de Villeneuve, la polonaise à brandebourgs militairement boutonnée, il allait et venait par la chambre, les mains croisées derrière le dos, le regard farouche, le pas inégal et brusque.
La jeune femme disait :
– Mon père, ne mettrez-vous pas un terme à mes longues souffrances ?… ne me rendrez-vous pas mon enfant ?
Le vieillard haussait les épaules et ne répondait pas.
– Mon père, reprit-elle en joignant les mains, serez-vous donc sans pitié ? et les haines de famille, ces vieilles haines ridicules en notre siècle, vous aveugleront-elles à ce point ?
Le vieillard continua sa promenade.
– Ma fille !
– Je ne suis plus votre fille. Je suis votre victime et vous êtes mon bourreau.
– Prenez garde !
Mais elle, toujours révoltée, s’écria :
– Où est Constantin ?
– Vous ne le saurez pas.
– Qu’avez-vous fait de mon enfant ?
– Il est mort.
– Oh ! vous mentez encore, dit-elle.
Le vieillard haussa de nouveau les épaules.
– Vous avez mal aux nerfs, dit-il. Vous ferez bien de prendre une infusion de thé et de vous mettre au lit.
Et il s’en alla, tirant violemment la porte après lui.
Quelques minutes s’écoulèrent.
La jeune femme s’était laissé retomber sur la bergère, et elle fondait en larmes, se tordant les mains de désespoir.
La porte se rouvrit. Mais ce ne fut pas le vieillard qui entra.
Ce fut un homme d’environ quarante ans, de mine louche et presque sinistre.
C’était un des mystérieux domestiques amenés par les hôtes mystérieux de la villa.
Il apportait du thé sur un plateau.
La jeune femme le regarda, et soudain un éclair illumina son cerveau, et elle murmura :
– Oh ! il faudra bien qu’il parle, celui-là !
VIII
Le valet posa le plateau sur un guéridon devant la jeune femme.
Mais comme il allait se retirer, elle lui ordonna de rester, d’un geste mystérieux.
Par les quelques mots que nous avons vu échanger entre la jeune femme et le vieillard, il a été facile de comprendre qu’ils étaient étrangers et appartenaient soit à l’aristocratie russe, soit à l’aristocratie polonaise.
Le valet s’était arrêté au milieu de la chambre, avec cette docilité servile des paysans du Nord qui n’ont jamais songé à discuter un ordre reçu, tant ils sont pliés sous le knout, de génération en génération.
Il était là, muet, attentif et comme tremblant.
– Nicheld, lui dit la jeune femme, ouvre ce bahut.
Et elle lui désignait un meuble qui se trouvait entre les deux croisées.
Nicheld obéit.
– Ne vois-tu pas une boîte oblique en cuir rouge sur la première tablette ? continua-t-elle.
– Oui, maîtresse.
– Donne-la moi.
Tout en parlant, elle s’était levée et était allée se placer devant la porte.
Le valet lui apporta là boîte.
– Attends, dit-elle, en la prenant et en la posant sur un guéridon.
Cette boîte, qui pouvait avoir un demi-pied de longueur, était en maroquin rouge.
Un nom était écrit dessus :
Nadéïa.
La jeune femme l’ouvrit, et le valet vit avec quelque étonnement apparaître la crosse en ivoire de deux mignons pistolets, comme presque toutes les grandes dames du Nord en ont en voyage, lorsqu’elles traversent en traîneau et presque sans escorte les immenses solitudes des steppes.
Accoutumé à l’obéissance passive, celui qu’elle avait appelé Nicheld demeurait debout devant Nadéïa et semblait demander ce qu’elle allait faire.
Nadéïa prit un des pistolets et l’arma.
Puis dirigeant le canon sur Nicheld, elle lui dit :
– Si tu pousses un cri, si tu appelles au secours, tu es mort.
Nicheld frissonna, mais il se tut.
Le paysan russe, le moujik comme on dit, sait bien que sa vie est peu de chose et que son seigneur peut toujours en disposer.
Or, Nicheld était né sur les terres du père de Nadéïa, et il savait que Nadéïa était la maîtresse.
Seulement il se mit en garde et prit une attitude suppliante.
Nadéïa lui dit :
– Mon père est monté dans sa chambre ; avant que tes cris soient arrivés jusqu’à lui, avant que ses pas aient retenti dans le corridor, avant qu’il ait même eu la pensée de te porter secours, ma balle t’aura frappé au cœur.
– Que voulez-vous donc de moi, maîtresse ? demanda le moujik d’une voix affolée de terreur.
– Je veux savoir.
Il se prit à trembler plus fort.
– Maîtresse, dit-il, si je parle, le général me tuera.
– Et si tu ne parles pas, je te tue à l’instant.
– Grâce ! maîtresse, grâce ! balbutia le moujik.
Nadéïa continua :
– Tu étais au service de mon père, à Varsovie. Tu sais ce qui s’est passé…
– Je vous jure, maîtresse…
– Ne jure pas, tu ferais un faux serment.
En même temps, Nadéïa regarda la pendule qui se trouvait sur la cheminée.
– Écoute-moi bien, dit-elle.
Et dans son geste, dans son regard, dans toute son attitude, il y avait quelque chose de si fatalement désespéré, que le moujik Nichdel comprit qu’il n’avait aucune miséricorde à attendre d’elle, s’il essayait de la tromper.
– Maîtresse, dit-il, si je parle, vous ne me tuerez pas ?…
– Non.
– Mais il me tuera, lui.
– Je te protégerai.
– Vous, maîtresse ?
– Oui, dit la jeune femme, car, à moins que mon père ne me tue sur l’heure, j’aurai bien le temps de me placer sous la protection française.
Nous sommes en France, vois-tu, poursuivit-elle, et en France, le bon plaisir d’un grand seigneur russe ou polonais ne peut plus rien.
Le moujik écoutait, comme si une langue inconnue eût résonné pour la première fois à son oreille.
Nadéïa continua.
– Tu étais au service de mon père, tu sais ce qui est arrivé… parle… je te donne deux minutes pour réfléchir : si tu te tais, je fais feu.
Le moujik hésita une seconde encore.
Puis il dit d’une voix sourde :
– Mourir pour mourir, j’aime autant dire ce qui est juste… et ce qui est la vérité… et confondre les traîtres.
– De qui donc parles-tu ? demanda Nadéïa avec un léger frissonnement dans la voix.
– De… votre… père… balbutia-t-il.
– Parle ! fit-elle.
Et pâle, les narines dilatées, l’œil en feu, Nadéïa attendit :
– Maîtresse, dit le moujik, votre père le général Komistroï a trahi la Pologne.
À ces mots, Nadéïa fit un pas en arrière et jeta un cri.
Un cri d’étonnement, de stupeur.
On eût dit que la foudre du ciel tombait sur elle.
– Oh !… dit-elle… ce n’est pas… possible… ce n’est pas vrai… tu mens !
– Tuez-moi alors, dit le moujik avec calme.
– Mais parle donc, misérable ! dit-elle.
Et elle fit un pas vers lui, son pistolet braqué, et prête à faire feu.
Le moujik avait retrouvé son calme :
– Maîtresse, dit-il, j’ai avoué la vérité, le général Komistroï, votre père, a trahi la Pologne.
Nadéïa sentait ses cheveux se hérisser, tant cette accusation inattendue lui paraissait foudroyante.
– Mais, s’écria-t-elle, cela ne peut être, cela est impossible !
– Cela est, dit Nicheld.
– Ah ! fit-elle, qu’a-t-il donc au fond de l’âme, cet homme que j’appelle mon père, puisqu’il m’a séparée de Constantin, le soldat du czar, ne voulant pas, disait-il, que la fille d’un Polonais fidèle, épousât un serviteur de l’oppresseur ?
Un sourire passa sur les lèvres de Nicheld.
Ce sourire était si plein de mépris à l’adresse de celui que Nicheld appelait le général Komistroï, que Nadéïa comprit bien que cet homme disait la vérité.
– Oh ! maîtresse, reprit-il, il faudrait bien des heures pour vous tout dire.
– Sur qui ?
– Sur votre père.
– J’ai de la patience, dit Nadéïa, je t’écouterai ; mais d’abord où est Constantin ? Mon père dit qu’il n’a pas quitté son régiment.
– Votre père ment.
– Ah !
Et Nadéïa regardait cet homme, aussi tremblante que le coupable qui regarde le juge prêt à prononcer son arrêt de mort.
– Le lieutenant Constantin, dit Nicheld, a été arrêté un soir à Varsovie, sous l’accusation de complicité avec les insurgés.
– Est-ce possible, grand Dieu ?
– Des lettres compromettantes placées dans un portefeuille ont été trouvées chez lui.
– Ciel ! dit Nadéïa, il a été condamné !…
– Et déporté en Sibérie.
Nadéïa couvrit son front de ses deux mains, laissant retomber le pistolet sur la table.
Mais Nicheld était disposé à parler.
– Quant à votre enfant, reprit-il, si votre père dit qu’il est mort, il ment !
Nadéïa jeta un cri…
Un cri si puissant, si inattendu, qu’un bruit se fit au dehors…
C’était le vieillard qui accourait.
Nadéïa se précipita sur la lampe et l’éteignit.
En même temps, elle poussa le verrou de la porte.
– Ne bougeons pas, maîtresse, murmura Nicheld, ou nous sommes perdus !
IX
Le pas du vieillard retentissait dans le corridor comme une menace.
Il s’arrêta à la porte de la chambre.
En même temps, Nadéïa et Nicheld entendirent la clé qui était restée dans la serrure et qu’on tournait violemment.
Le cœur de Nicheld battait à outrance. Nadéïa se taisait.
– Nadéïa ! cria la voix du général Komistroï, qui ronflait comme un tonnerre.
La jeune femme eut du sang-froid.
Elle parut s’éveiller en sursaut et répondit :
– Mon père ! que voulez-vous ?
– Qu’avez-vous ? que vous arrive-t-il ? demanda le général à travers la porte qu’il essayait toujours d’ouvrir.
– Rien, mon père, je dormais et j’avais le cauchemar.
– Ah ! dit-il, d’un air de doute.
Puis il ajouta :
– Je croyais que vous n’étiez pas seule…
– Avec qui donc voulez-vous que je sois ? demanda Nadéïa, qui eut le courage d’accompagner ces paroles d’un petit rire sec et moqueur qui parvint jusqu’au général.
– C’est bien, dit celui-ci.
Et il s’en alla.
Nicheld, de plus en plus tremblant, entendit les pas s’éloigner dans le corridor, puis la porte de la chambre se refermer.
Nadéïa s’était approchée de la fenêtre et elle regardait maintenant la lumière qui partait de la chambre de son père et se projetait sur le feuillage des arbres du parc.
Une silhouette allait et venait au milieu de cette lumière tremblante.
Nadéïa comprit que le général faisait ses préparatifs pour se coucher.
Puis la silhouette disparut et, peu après, la lumière s’éteignit.
– Mon père est au lit, dit Nadéïa, maintenant tu peux parler.
Mais Nicheld continuait à trembler.
– J’ai peur, dit-il…
– Parle ! dit-elle tout bas, mais avec un accent impérieux.
Qu’est devenu mon enfant ?
– Je ne sais pas.
– Tu m’as pourtant dit tout à l’heure qu’il n’était pas mort.
– Je vous le répète.
– Eh bien ! qu’est-il devenu ? qu’en a-t-on fait ?
– Madame, dit Nicheld, vous ne pouvez pas comprendre ce qui s’est passé : depuis combien de temps croyez-vous avoir été séparée de monsieur Constantin ?
– Mais depuis un an environ, dit Nadéïa.
– Vous vous trompez, madame, il y a cinq années passées.
– Oh !
Et Nadéïa, en laissant échapper cette exclamation, porta les deux mains à son front et murmura :
– Suis-je donc folle ?
– Vous l’avez été, madame.
– Que dis-tu ?
– La vérité. À la suite de vos couches et des événements dramatiques qui les ont entourées, vous avez été prise de folie. Pendant quatre années, vous avez été confiée à un médecin français.
– Je n’ai nul souvenir de cela.
– C’est possible, dit Nicheld, mais je vous dis la vérité : il n’y a pas un an que vous avez quitté Varsovie ; il y en a cinq.
– En quelle année sommes-nous donc ?
– En 186…
Nadéïa étouffa un nouveau cri.
Puis, revenant à son idée fixe :
– Et tu dis que mon enfant n’est pas mort ?
– Je puis vous l’affirmer, car c’est moi qui…
– Toi !…
Et dans ce mot, Nadéïa fit passer un ouragan de colère.
– Madame, dit humblement Nicheld, vous me croirez après, si bon vous semble ; mais laissez-moi tout vous dire.
– Parle.
– Êtes-vous certaine d’être la fille du général ?
Cette question si brusquement faite, fut pour Nadéïa comme un coup de foudre.
– Mais… pourquoi me demandes-tu cela ?… dis… balbutia-t-elle.
– Avez-vous souvenir de votre enfance ? reprit Nicheld.
– Sans doute ; j’avais trois ans que déjà le général m’appelait sa fille.
– Oui… c’est vrai… mais, votre mère ?
– Ma mère est morte en me donnant le jour, tu le sais bien, dit Nadéïa.
Nicheld parut vaincre en lui un dernier scrupule.
– Madame, dit-il, si je vous fais une pareille question, c’est que je suis résolu à ne pas servir plus longtemps de complice au général.
– Mais explique-toi donc, malheureux.