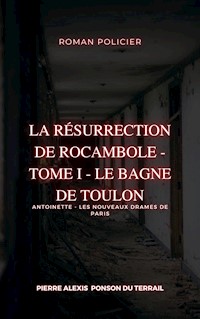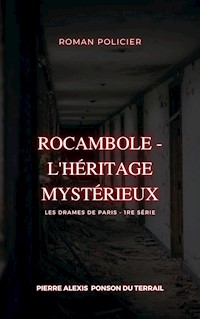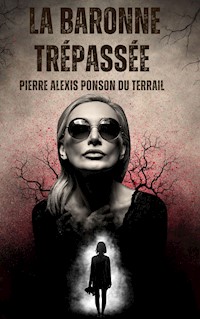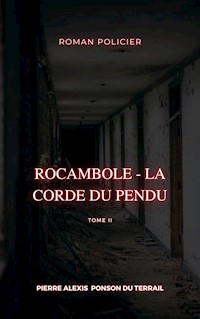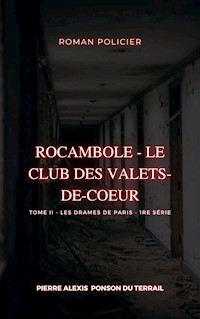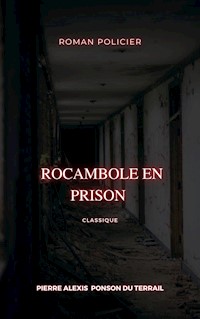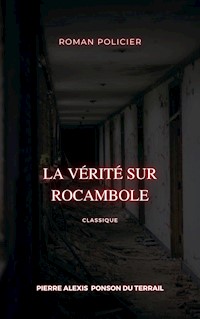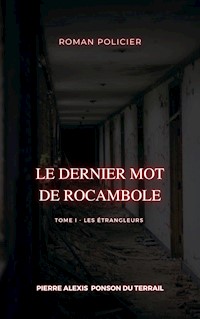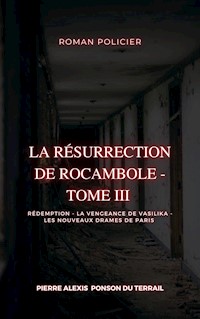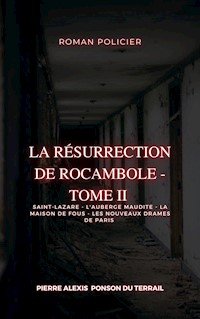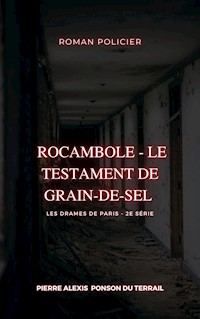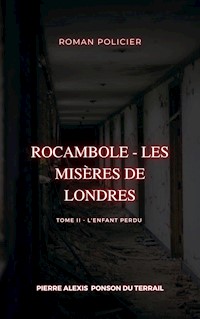
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Résumé de l'histoire dans le synopsis des aventures de Rocambole.
Das E-Book Rocambole - Les Misères de Londres wird angeboten von Books on Demand und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
littérature française, Classique, AVENTURES, roman policier, Mystères
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pierre Alexis Ponson du Terrail
ROCAMBOLELES MISÈRES DE LONDRESTome IIL’ENFANT PERDU
E. Dentu – 1868Première publication en journal : La Petite Presse – Les Misères de Londres – 9 novembre 1867 au 2 juillet 1868 – 237 épisodes
Table des matières
PREMIÈRE PARTIE L’ENFANT PERDU LE QUARTIER DES VOLEURS
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
DEUXIÈME PARTIE LE MOULIN SANS EAU
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
Mentions légales
PREMIÈRE PARTIEL’ENFANT PERDULE QUARTIER DES VOLEURS
I
L’homme gris avait dit vrai. Ni lui, ni Shoking, ni l’Irlandais en guenilles n’avaient pu retrouver Ralph.
Qu’était donc devenu le petit Irlandais ?
L’enfant, après avoir sauté dans le jardin, n’avait pas hésité une minute.
Il avait couru à cet arbre qui, durant toute la journée, avait été l’objet de sa préoccupation et qui montait au long du mur ; puis il s’était mis à grimper autour du tronc jusqu’à ce qu’il fût parvenu aux branches.
Là, il s’était arrêté un moment pour s’orienter.
Il voyait par-dessus le mur.
De l’autre côté de ce mur, il y avait un terrain vague entouré d’une palissade en planches.
À gauche et à droite, il y avait des toits de maisons.
Montant d’une branche dans l’autre, l’enfant gagna le mur et s’y établit à califourchon.
Puis il mesura le saut qu’il avait à faire pour arriver dans le terrain vague.
Le mur était élevé à une vingtaine de pieds du sol, et de l’autre côté, il n’y avait ni arbre ni rien qui put lui permettre d’amortir sa chute.
Ralph eut un moment de désespoir. Lui faudrait-il donc reprendre le chemin qu’il avait déjà pris, et rentrer dans sa prison ?
Tout à coup, il entendit du bruit. Son effroi redoubla.
De l’endroit où il était, il voyait par-dessus le toit de mistress Fanoche, et, par conséquent, le devant du jardin.
Malgré l’obscurité, Ralph aperçut trois hommes qui entraient par la grille. Il en vit deux qui renversaient le troisième à terre, et ce spectacle, on le pense bien, n’était pas de nature à calmer sa frayeur.
C’étaient l’homme gris et son complice qui appliquaient un masque de poix sur le visage de lord Palmure et se débarrassaient de lui.
Ralph eut envie de sauter dans le terrain vague ; mais l’instinct du danger l’en empêcha encore.
Le couronnement du mur était à plat. L’enfant se dressa et se mit à marcher dessus. Il arriva ainsi à l’un des deux toits.
Un saltimbanque ne se fût pas mieux tiré de ce périlleux voyage.
Parvenu au bout du mur, il monta sur le toit.
Mais ses yeux ne perdaient pas de vue la maison de mistress Fanoche dans laquelle les deux hommes étaient entrés.
À force de rôder sur le toit, il découvrit une ouverture. C’était une de ces croisées dites à tabatière qu’on perce dans les mansardes.
Il eut bonne envie de se glisser par cette fenêtre et de pénétrer dans la maison ; mais la peur d’être découvert, arrêté par les habitants et reconduit à mistress Fanoche le fit hésiter encore.
Soudain un nouveau bruit se fit dans le jardin de cette dernière ; en même temps une lumière apparut à la fenêtre de la chambre que Ralph venait d’abandonner et l’enfant entendit des cris auxquels se mêlait la voix aigre de mistress Fanoche.
On venait de s’apercevoir de sa fuite.
Cette fois le petit Irlandais n’hésita plus et il se laissa couler par la croisée de la mansarde.
Il se trouva alors dans une étroite chambrette, dépourvue de tous meubles et dont la porte était ouverte.
Ralph franchit le seuil de cette porte et trouva un escalier. Ses petites mains s’accrochaient à la rampe et il descendit.
Où allait-il ? peu lui importait, pourvu qu’il échappât à mistress Fanoche et à la terrible Écossaise.
La maison paraissait déserte.
On n’y voyait pas de lumière, on n’entendait aucun bruit.
L’enfant descendait avec une telle précipitation qu’il fit un faux pas et se heurta à la rampe.
C’était faire assez de bruit pour amener dans l’escalier les hôtes de la maison.
Ralph s’arrêta tout tremblant et durant quelques minutes, il n’osa bouger.
Mais personne ne vint.
Hampsteadt, nous l’avons dit déjà, est peuplé de maisons de campagne qui demeurent inhabitées en hiver.
Celle-là était de ce nombre.
Rassuré, l’enfant continua à descendre dans l’obscurité.
Quand il fut au bout de l’escalier, il devina plutôt qu’il ne vit, un vestibule, et au bout de ce vestibule une porte sous laquelle passait un rayon de clarté blafarde.
Il alla vers cette porte ; mais elle était fermée.
Alors l’enfant se mit à tourner dans tous les sens ; ses yeux s’habituaient peu à peu aux ténèbres, et il voyait assez distinctement les objets qui l’entouraient.
Après la porte, il trouva une croisée.
La terreur qu’il éprouvait en pensant que mistress Fanoche et des hommes qu’il ne connaissait pas étaient à sa recherche, doubla sa force et son énergie.
Après bien des efforts et des tâtonnements, il parvint à ouvrir la croisée.
Elle donnait sur une petite cour.
Cette cour était fermée par une grille ; mais cette grille n’était pas élevée, et Ralph, ayant sauté dans la cour, résolut de l’escalader.
De l’autre côté de la grille, il y avait une rue.
L’enfant se mit à grimper le long des barreaux qui se terminaient en fer de lance. Il parvint au couronnement, non sans se blesser et sans ensanglanter ses petites mains.
Il prononça le nom de sa mère pour se donner du courage, et sauta dans la rue.
Il tomba sur les genoux et se meurtrit.
Mais que lui faisait maintenant la douleur ? Il était libre !
Et il se mit à courir droit devant lui.
Désert ou non, un faubourg de Londres est éclairé au gaz avec une rare munificence.
De six heures du soir au matin, c’est la fête de l’hydrogène qui tient ses assises sur un parcours de vingt-cinq lieues carrées.
On avait amené Ralph endormi à Hampsteadt. Il lui était donc impossible de savoir qu’il se trouvait à plus de trois milles de distance de cette maison dans Dudley street où Shoking l’avait conduit avec sa mère.
Au bout de la rue qu’il venait de suivre, il trouva une grande artère qu’il crut reconnaître pour une de celles qu’il avait parcourues avec elle.
À Londres, toutes les rues se ressemblent.
Il enfila donc cette grande voie où les passants et les voitures étaient plus rares que les becs de gaz.
C’était Hampsteadt road.
Il marcha longtemps, sans s’apercevoir que ses mains et ses genoux saignaient.
Au bout d’une heure, il crut voir sur sa gauche une rue qui ressemblait à Dudley street, et il y entra.
Celle-là était plus étroite que Hampsteadt road, mais elle était plus éclairée, plus animée et il y avait une longue file de boutiques.
Comme l’enfant ne savait pas le nom de la rue où on l’avait conduit avec sa mère, il ne pouvait pas demander son chemin.
À la morne solitude d’Hampsteadt road avait peu à peu succédé la vie bruyante de Londres.
Maintenant il était sur Kings street, Camdentown.
Il marcha encore, il marcha toujours, tantôt mourant sur ses pieds, tantôt ayant une lueur d’espoir et croyant reconnaître le square Saint-Gilles ou la place des Sept-Cadrans ; puis entrant dans les rues adjacentes, à droite et à gauche, et tournant souvent sur lui-même.
Cela dura quatre heures.
Au bout de ce temps, le pauvre enfant n’était pas plus avancé qu’au moment où il avait quitté le jardin de mistress Fanoche.
Alors le désespoir le prit et vint en aide à la lassitude.
Il s’assit sur la marche d’une porte à demi-perdue dans l’ombre et se mit à pleurer.
La foule est indifférente partout, mais plus encore à Londres.
Cent personnes passèrent devant ce petit malheureux qui sanglotait et ne le regardèrent même pas.
Cependant une femme passa à son tour.
Elle s’arrêta, contempla Ralph, lui mit la main sur l’épaule et lui dit :
– Qu’as-tu donc, mon cher mignon ?
L’enfant leva la tête et envisagea celle qui lui adressait la parole d’une voix douce et compatissante.
Elle était jeune ; elle était mise simplement, comme une fille du peuple. Elle était belle, et il sembla à l’enfant qu’elle ressemblait à sa mère.
Il redoubla ses sanglots.
– Tu es perdu, n’est-ce pas ? dit-elle.
– Je cherche maman, dit l’enfant.
– Comment s’appelle-t-elle, ta mère ?
– Jenny.
– Tu es Irlandais ?
– Oui, madame.
Et l’enfant pleurait toujours.
– Moi aussi, dit-elle, et je me nomme Suzannah.
– Veux-tu venir avec moi, je t’aiderai à retrouver ta mère ?
Il la regarda encore, et son œil exprimait une certaine défiance.
– Viens donc, mon mignon, reprit-elle ; il ne sera pas dit que Suzannah l’Irlandaise, la plus belle fille de Broke street, aura laissé un enfant de sa nation mourir de froid et peut-être de faim.
Et elle prit l’enfant par la main avec une douce insistance.
II
Il n’y a pas de fortifications à Londres comme à Paris, pas de portes, pas de grilles affectées à l’octroi.
L’octroi n’existe pas.
Londres ne finit pas, comme disent les gens du peuple. À part la cité proprement dite, tout le reste est ce qu’on appelle l’agglomération.
Cela explique comment le petit Irlandais avait quitté Hampsteadt et était revenu dans Londres sans s’en douter.
Après avoir erré dans Kings street, il avait fini par tomber dans Niegh street, et c’était sous le porche d’une maison de Gloucester place que l’Irlandaise Suzannah l’avait trouvé.
Il fit bien un peu de résistance, tout d’abord ; mais la jeune femme le regardait avec des yeux si doux, elle lui parlait d’un ton si affectueux, qu’il finit par céder.
– Vrai, dit-il ? vous êtes Irlandaise ?
– Je suis née à Cork, mon mignon.
– Et vous m’aiderez à retrouver ma mère ?
– Si elle est Irlandaise, ce sera facile…
– Ah ! fit-il en la regardant encore.
Elle eut un sourire triste.
– Tous les Irlandais sont malheureux, dit-elle, et, même à Londres, tous les malheureux se connaissent.
– Bien sûr, madame, vous ne me trompez pas ?
– Non, mon enfant.
Et elle l’embrassa ; puis elle lui dit encore :
– Mais où demeure-t-elle, ta mère ? dans quelle rue ?
L’enfant n’avait retenu qu’un nom Saint-Gilles.
– Ce n’est pas une rue, dit-elle, c’est une église.
– C’est toujours par là, dit Ralph.
– Eh bien ! nous irons à Saint-Gilles ; si tu cherches ta mère, dit-elle, il est probable que ta mère te cherche aussi.
Cette pensée illumina l’esprit de l’enfant.
– Oh ! oui, dit-il.
– Et, poursuivit Suzannah, elle ira demain à Saint-Gilles.
– Demain ? fit l’enfant, pourquoi pas ce soir ?
– Mais, mon mignon, dit Suzannah, parce que les églises sont fermées à cette heure.
Les enfants raisonnent avec une logique rigoureuse, ce que lui disait cette femme lui parut juste.
Il essuya ses larmes, mais il poussa un profond soupir en murmurant :
– Demain… comme c’est long !
– Mais non, dit-elle en souriant, tu ne sais donc pas qu’il est minuit ?
Tout en parlant, ils avaient fait un bout de chemin, se dirigeant toujours vers le Sud.
Les rues devenaient plus éclairées, plus bruyantes.
Dans certains quartiers excentriques, Londres est plus animé la nuit que le jour.
Suzannah marchait doucement pour ménager les petites jambes de Ralph.
Arrivée devant un marchand de comestibles, elle lui dit :
– As-tu faim ? veux-tu manger ?
– Non, dit l’enfant.
Ils continuèrent leur route.
Ils étaient maintenant dans une large rue qu’on nomme Graysam road.
La foule nocturne devenait plus compacte.
Plusieurs hommes abordèrent Suzannah et lui tinrent des propos que l’enfant ne comprit pas.
Elle les repoussa.
Un autre lui dit :
– Tu fais bien la fière, aujourd’hui.
Suzannah répondit :
– Aujourd’hui je suis mère de famille.
Et elle continua son chemin.
Quelques pas plus loin, elle fut abordée par un autre, un homme d’assez mauvaise mine, qui l’appela par son nom.
– Quoi de nouveau, Suzannah ? lui dit-il.
– Rien.
– Comment va Bulton ?
– Je ne sais pas… voici deux jours que je ne l’ai vu, dit-elle.
Et sa voix subit une légère altération.
– Serait-il bloqué ?
– Je ne sais pas… mais j’en tremble.
– Tiens ! qu’est-ce que ce mioche ?
– Un pauvre enfant perdu qui pleurait sous une porte.
L’homme regarda Ralph, et Ralph éprouva un sentiment de répulsion instinctive.
– Il est gentil, dit cet homme, une jolie graine de pick-pocket.
– Merci, dit Suzannah ; j’espère bien que ça ne lui arrivera pas.
– Et pourquoi donc ?
– Parce que demain je le ramènerai à sa mère.
L’homme haussa les épaules.
– Tu serais joliment battue, si Bulton t’entendait parler comme ça, dit-il. Bonsoir, Suzannah.
– Bonsoir, Craven.
– Oh ! madame, dit Ralph, comme ils s’éloignaient, quel vilain homme ! et comme il a l’air méchant !
Suzannah ne lui répondit pas.
Ils marchèrent encore et arrivèrent ainsi au bout de Graysiens lane, qui est perpendiculaire à une autre grande artère appelée Holborne, qui n’est elle-même que la continuation d’Oxford street.
Là, Suzannah s’arrêta un moment.
Elle paraissait inquiète et jetait autour d’elle des regards furtifs.
On eût dit qu’elle cherchait quelqu’un.
Enfin un homme, qu’elle reconnut sans doute, vint à passer.
Suzannah, tenant toujours l’enfant par la main, s’avança vivement vers lui.
– Tiens, dit celui-ci en s’arrêtant, c’est toi, Suzannah ?
– Oui. As-tu vu Bulton ? Voici trois jours et trois nuits que je suis sans nouvelles.
– Il a nourri une bonne affaire, et je crois que c’est pour cette nuit.
– Ah ! dit la jeune femme. Alors il n’est pas pris ?
– Il ne l’était pas ce matin, toujours.
Suzannah respira.
– Merci, William, dit-elle. Bonsoir !
– Tu rentres ?
– Oui.
– Les affaires sont-elles bonnes ?
– Comme ça, dit Suzannah. Les gentlemen font coudre leurs poches maintenant.
– Tiens, tu as donc un mioche, à présent ?
– C’est un petit Irlandais qui ne sait où coucher. Je l’emmène chez moi et je le rendrai demain à sa mère.
Ces derniers mots rassurèrent Ralph.
Il ne résista pas à la douce pression de la main de Suzannah qui continua son chemin en l’entraînant.
Après avoir fait quelques pas dans Holborne, Suzannah prit tout à coup à gauche et entra dans une rue étroite, bordée de misérables maisons et qui était encombrée d’une foule de gens à mine patibulaire.
Mais l’enfant tombait de fatigue et de lassitude et il ne remarqua plus rien à partir de ce moment.
Sa conductrice s’arrêta devant une des plus chétives maisons de la rue, tira une clef de sa poche, ouvrit la porte et l’enfant se vit au seuil d’une allée noire.
– N’aie pas peur, lui dit Suzannah, et viens avec moi.
Au bout de l’allée, ils trouvèrent un escalier, montèrent au second et Suzannah ouvrit une nouvelle porte.
Puis elle se procura de la lumière.
Alors Ralph vit un réduit assez misérable dans lequel il n’y avait que deux chaises et un lit.
Sur une table, il y avait une assiette, couverte encore des débris d’un jambonneau, auprès d’un morceau de pain et d’une carafe dans laquelle se trouvait un reste de bière brune.
– Vrai ? dit Suzannah, tu n’as pas faim.
– Non, madame.
– Veux-tu dormir ?
– Je veux bien, répondit-il, si vous me promettez que demain vous me reconduirez à ma mère.
– Je te le promets.
Alors l’enfant s’étendit de lui-même sur le lit et s’endormit.
Mais si profond que fût son sommeil, il en fut tout à coup tiré par un grand bruit.
Un pas lourd, aviné, s’était fait entendre sur l’escalier, puis la porte s’était ouverte et Suzannah avait jeté un cri de joie.
Alors, à la lueur de la chandelle qui brûlait toujours sur la table, l’enfant éveillé en sursaut vit Suzannah se jeter au cou d’un homme de haute taille portant une barbe épaisse.
– Ah ! te voilà, disait-elle, te voilà, mon bien-aimé ! je t’ai cru mort…
L’homme eut un rire sinistre et embrassa Suzannah.
En même temps, le petit Irlandais se prit à frissonner, car il s’aperçut que cet homme avait les bras nus et que l’un de ses bras était couvert de sang.
III
L’homme aux bras rouges de sang n’avait pas encore aperçu Ralph.
Quant à Suzannah, elle paraissait l’avoir complétement oublié.
L’enfant tout tremblant, n’osait bouger et retenait son haleine.
– Mon Dieu ! disait Suzannah, comme j’ai eu peur pour toi, mon bien-aimé !
Bulton, car c’était bien l’homme dont la jeune femme avait parlé dans la soirée, Bulton s’essuya le front.
– Ah ! dit-il, l’affaire a été rude. Un moment nous avons failli être pincés, et je me suis dit : « Je ne reverrai plus ma petite Suzannah. »
Mais ce n’a été qu’une alerte.
– Et le coup a réussi ?
– Regarde.
En même temps, cet homme tira de sa poche un gros sac, qu’il jeta sur la table et qui s’ouvrit en tombant.
Une profusion de pièces d’or s’en échappa.
– Oh ! que de guinées ! dit Suzannah.
Puis, tout à coup, elle pâlit et étouffa un cri.
– Du sang ! dit-elle, du sang !
– J’en ai plein ma veste et ma chemise, répondit tranquillement Bulton.
– Vous avez assassiné le vieillard, malheureux ! fit Suzannah avec une expression d’horreur.
– Non, dit Bulton. Je t’avais promis de ne pas verser de sang, et quand je promets quelque chose à ma petite Suzannah, je tiens toujours ma parole, sauf le cas de force majeure, bien entendu.
Et Bulton embrassa de nouveau Suzannah.
– Mais quel est donc ce sang ? demanda-t-elle toute frissonnante.
– Voici ce qui s’est passé, répondit Bulton. La maison que nous avons dévalisée est, comme tu le sais, au milieu des champs. Nous avions garrotté le vieux qui y vit seul, après lui avoir mis le bonnet de laine, afin qu’il ne pût pas nous reconnaître. Nous avions trouvé l’or et nous le partagions tranquillement, lorsque nous entendons du bruit.
C’était une ronde de police.
Tandis qu’elle arrivait par la cour, nous avons pris la porte du côté du jardin.
J’ai escaladé le mur le dernier.
En ce moment, je me suis senti saisi par les jambes et il m’a fallu retomber dans le jardin.
Un policeman plus grand et plus fort que les autres avait devancé ses camarades, et il me serrait au cou en criant :
– À moi ! à moi ! j’en tiens un !
Il fallait être pris ou verser du sang. Les autres policemen arrivaient.
Je lui ai planté mon couteau dans la poitrine, il est tombé, et je me suis sauvé.
Ralph, frémissant d’horreur, avait entendu tout cela, mais il ne comprenait que vaguement.
Seulement, l’aspect de Bulton avait quelque chose d’effrayant pour lui.
Cet homme était jeune cependant, et d’une beauté mâle et farouche ; on comprenait qu’il eût subjugué le cœur d’une femme tombée comme l’Irlandaise Suzannah.
Mais, pour cet enfant de dix ans, avec sa barbe inculte, son œil féroce, sa voix retentissante, il était réellement effrayant.
Ralph eut si peur même, qu’il regretta le fouet de Mary l’Écossaise et la maison de mistress Fanoche.
Suzannah regardait Bulton et, tout en le regardant, elle comptait l’or répandu sur la table.
Tout à coup le bandit se retourna, vit l’enfant sur le lit et s’écria :
– Tonnerre ! qu’est-ce que c’est que ça ?
L’épouvante de Ralph était si grande qu’il ferma les yeux et fut assez maître de lui-même pour faire semblant de dormir.
– Ça, dit Suzannah, qui eut tout à coup un accent suppliant, c’est un pauvre enfant que j’ai trouvé dans la rue.
– Ah ! ah !
– Il avait froid, il pleurait…
– Et tu l’as embauché ? ricana Bulton.
– C’est un petit Irlandais, je suis Irlandaise aussi, moi, et j’ai eu pitié de lui.
– En vérité ! tu es une fille de cœur, ma chère, ricana Bulton.
Et il fit un pas vers le lit.
Suzannah le prit par le bras :
– Ne lui fais pas de mal, dit-elle. Vois comme il est gentil… Il dort…
– Il est gentil, en effet, dit le bandit ; et qu’en comptes-tu faire ?
– Je l’emmènerai demain avec moi dans le quartier irlandais, aux environs de Saint-Gilles.
– Bon !
– Et nous tâcherons de retrouver sa mère.
– Ah ! fit encore Bulton.
Suzannah respira. Elle avait craint sans doute d’être battue, car elle sauta de nouveau au cou du bandit et lui dit :
– Oh ! tu es bon ! vois-tu, et je t’aime…
– Mais nous n’allons pas dormir tous les trois dans le même lit, dit Bulton.
– Non, certes, répondit Suzannah ; et il va falloir réveiller le pauvre petit.
Elle s’approcha du lit et toucha Ralph.
Ralph ne dormait pas. Cependant il avait un peu moins peur depuis que Bulton n’avait point paru s’opposer à ce que Suzannah le reconduisit à sa mère.
Il ouvrit les yeux et fit semblant de s’éveiller.
– Ce monsieur que tu vois là, dit Suzannah, est mon mari ; il ne te fera pas de mal ; n’aie pas peur, mon enfant.
Ralph leva ses grands yeux sur Bulton.
– Il est gentil, en effet, ce môme-là, dit le bandit. Et tu veux le reconduire à sa mère ?
– Certainement.
– Nous ferions bien mieux de le garder.
L’enfant frissonna des pieds à la tête.
– Non, non, dit Suzannah avec énergie, il doit être honnête, il ne sera pas dit que ce sera moi qui l’aurai jeté dans la fange où nous sommes.
Bulton eut un éclat de rire.
– Tu es vertueuse ce soir, Suzannah, dit-il.
Elle baissa les yeux et ne répondit pas.
– Pourtant, continua Bulton, ce petit-là pourrait nous rendre de fameux services.
– Jamais ! dit Suzannah.
Une colère subite s’empara du bandit.
– Ah ! tu me résistes ! dit-il.
– Oui, répéta Suzannah.
– Tu me résistes, malheureuse ?
Et il leva la main.
– Bats-moi, dit Suzannah, si cela te plaît, mais je ne veux pas faire de cet enfant un homme comme toi.
Bulton eut un ricanement de bête fauve.
– Par saint George ! dit-il, je crois qu’elle ose me mépriser.
Il se passa alors une chose inattendue.
Comme le bandit allait frapper Suzannah, Ralph, qui se tenait immobile et tremblant au pied du lit, qu’il avait quitté sur un signe de l’Irlandaise, Ralph vint se placer résolument devant elle, et la couvrit de son corps.
Le sang du lion avait parlé ; l’enfant s’était senti subitement le courage d’un homme.
Or, le courage aura toujours une action directe, exercera toujours un prestige instantané sur les natures à demi-sauvages.
En présence de cet enfant qui osait le regarder en face, Bulton se calma tout à coup.
– Par saint George ! exclama-t-il, voilà un hardi petit compagnon ; tu es gentil, mon mignon, et je ne battrai pas Suzannah, puisque tu veux la défendre.
En même temps, il voulut embrasser l’enfant qui recula.
– Il est fier, dit Bulton en riant, c’est bien ça…
Puis il embrassa Suzannah.
La jeune femme le regarda avec cet œil soumis et passionné de la créature qui redoute son maître.
– Tu te fais toujours plus méchant que tu n’es, dit-elle.
– Mon mignon, dit Bulton qui passa ses doigts robustes dans les cheveux blonds de Ralph, nous ferons ce que tu veux et ce que veut Suzannah, nous te ramènerons demain à ta mère.
Et la voix du bandit était devenue presque caressante.
L’enfant le regarda avec défiance.
– Je te le promets, moi, dit Suzannah.
Puis elle retira un matelas de son lit et le porta dans un coin de la chambre.
– Viens te coucher là, dit-elle.
. . . . . . . . . . . . . . .
Quand l’enfant fut endormi, Bulton dit à Suzannah, en lui parlant à l’oreille :
– C’est le diable qui nous envoie cet enfant.
– Que veux-tu dire ? fit-elle.
– Grâce à lui, demain, à pareille heure, nous aurons dix fois plus d’or que tu n’en as eu ce soir.
– Bulton, Bulton, dit Suzannah d’un ton de reproche, je t’ai dit que je ne voulais pas perdre cet enfant…
– Ne te fâche pas, dit le bandit, et écoute-moi… tu verras…
Cette fois, Ralph dormait tout de bon, et le bandit put à loisir faire ses confidences à Suzannah l’Irlandaise.
IV
Bulton colla ses lèvres à l’oreille de Suzannah.
Ils étaient côte à côte et l’obscurité la plus profonde régnait dans la chambre.
On n’entendait que le bruit paisible et régulier de la respiration du petit Irlandais qui dormait.
– Vois-tu, dit alors Bulton, j’ai idée d’en finir d’un coup.
– Que veux-tu dire ?
– Un jour ou l’autre on me prendra et j’irai danser les pieds dans le vide devant Newgate ou devant Clarkenweid.
– Tais-toi, ne parle pas ainsi… tu me fais mourir par avance, murmura Suzannah qui l’étreignit avec passion.
– Cela arrivera tôt ou tard, te dis-je.
– Tais-toi !… au nom du ciel !
Le bandit eut un ricanement.
– C’est précisément parce que le ciel existe que cela arrivera, te dis-je. Cependant si nous avions seulement mille livres sterling…
– Eh bien ?
– Peut-être échapperais-je à mon sort, peut être pourrions-nous être heureux ?
– Heureux ! murmura Suzannah avec extase.
– Tu ne ferais plus ton honteux métier, tu ne volerais plus, et nous quitterions l’Angleterre.
– Où irions-nous ?
– En France. Nous nous marierions et je tâcherais de vivre honnêtement.
Suzannah pressa Bulton dans ses bras.
– Tu ferais cela ? dit-elle.
– Oui.
Elle soupira.
– Mais, hélas ! fit-elle, nous n’aurons jamais mille livres.
– Qui sait ?
Et, comme elle attendait qu’il s’expliquât :
– Cet enfant, poursuivit-il, pourrait nous rendre un grand service.
– Oh ! Bulton ! Bulton ! mon bien-aimé, dit Suzannah d’un ton de reproche, pourquoi veux-tu faire de ce malheureux enfant un voleur ? N’as-tu pas vu comme il était beau… comme il ressemblait à un petit ange ?… ne frissonnes-tu donc pas en pensant que nous pourrions envoyer au moulin cette innocente créature ?
Le bandit eut un rire moqueur :
– Tu es vraiment émouvante, ma chère, quand tu parles ainsi. Cependant, je ne veux pas te faire de peine, ma Suzannah, et je te promets que je ne m’opposerai pas à ce que tu le ramènes à sa mère, mais quand il nous aura rendu le service dont j’ai besoin.
– Quel est donc ce service ? demanda Suzannah.
– Écoute-moi bien.
Et Bulton baissa la voix plus encore.
– Je nourris une affaire depuis longtemps, dit-il, une affaire superbe.
– Ah !
– Je n’en ai parlé à aucun des camarades, car il faudrait partager, et ce n’est pas mille livres, c’est deux mille, peut-être trois ou quatre que nous aurions.
– Quatre mille livres ! murmura Suzannah. Et à qui donc veux-tu voler ça ?
– À un homme qui a volé tout le monde, les pauvres et les riches, dont le nom est exécré dans Londres, et qui, lorsqu’il passe dans une rue, est poursuivi par les malédictions du peuple.
– Quel est donc cet homme ?
– On l’appelle Thomas Elgin.
– L’usurier ?
– Justement.
– Et c’est cet homme que tu veux voler toi ?
– Mon plan est fait. J’ai l’empreinte de toutes les serrures, depuis celle de la grille de son petit jardin sur le square jusqu’à celle de son bureau où est sa caisse. Ayant les empreintes, j’ai fabriqué les clefs.
– Mais où demeure-t-il, ce Thomas Elgin ?
– Dans Kilburne square, tout auprès de la station de Western-Railway, il vit seul et n’a même pas de servante. Il prend ses repas dans un boarding de la Cité et ne rentre chez lui que le soir assez tard.
– Mais, dit Suzannah, il n’a probablement jamais d’argent chez lui.
– Dans la semaine, jamais. Il a tout son argent à la Banque. Mais Thomas Elgin n’est pas homme à perdre un jour par semaine, et il estime qu’on doit travailler le dimanche aussi bien que les autres jours.
– Ah ! fit Suzannah.
– Il y a des gens qui ont besoin d’argent le dimanche tout aussi bien que dans la semaine, et c’est même ce jour-là qu’il fait les meilleures affaires.
Donc, continua Bulton, le samedi, Thomas Elgin passe à la Banque et y prend quelquefois mille, quelquefois deux et même quatre mille, livres en or et en bank-notes, et il les emporte chez lui.
– Ah ! fit Suzannah.
– Il a une caisse chez lui, une caisse qui est un chef-d’œuvre et que personne que moi ne saurait forcer. Mais j’ai trouvé le secret, moi.
– Comment ?
– Avant d’être voleur, j’ai tenu une boutique, poursuivit Bulton. Nous ne nous connaissions pas alors, ma Suzannah, et j’avais une femme légitime. C’est Thomas Elgin qui m’a ruiné, et ma femme en est morte de chagrin.
– Continue, dit Suzannah avec émotion.
– Thomas Elgin m’a prêté, à trois cents pour cent, douze livres pour lesquelles il m’a envoyé à White-cross, et c’est un dimanche qu’il m’a remis cette somme.
La caisse de l’usurier est dans une petite salle qui n’a qu’une porte.
Dans le milieu de cette porte est percé un judas qui a deux pouces carrés de largeur.
Quand un homme à qui Thomas Elgin a affaire se présente, il regarde par ce guichet avant d’ouvrir.
Si j’avais pu passer la main, il y a longtemps que j’aurais dévalisé l’usurier.
– Tu n’as donc pas l’empreinte de la serrure.
– Si, mais si j’essayais d’ouvrir cette porte, je serais mort.
– Comment cela ?
– C’est un homme ingénieux que M. Thomas Elgin, poursuivit Bulton.
– Qu’a-t-il donc imaginé ?
– Il y a derrière la porte un pistolet disposé de telle manière que la porte, en s’ouvrant, le ferait partir et qu’il tuerait celui qui voudrait entrer.
– Mais enfin, dit Suzannah, quand M. Thomas Elgin entre chez lui et qu’il ouvre cette porte, comment fait-il pour empêcher le pistolet de partir.
– Voilà, dit Bulton, la seule chose que je n’aie pu trouver. Je me suis bien cassé la tête, mais je n’ai pu y parvenir.
– Alors, le vol est impossible.
– Oui et non.
– Comment cela ?
– Suppose un moment que le guichet est assez large pour que j’y puisse passer le bras.
– Bon.
– Je promène ma main le long de la porte, en dedans, jusqu’à ce que j’aie trouvé une corde.
– Qu’est-ce que cette corde ?
– Celle qui, tirée violemment par une poulie, si la porte s’ouvrait, et attachée à la détente du pistolet qui est placé sur un affût, le ferait partir.
– Après ? dit Suzannah.
– La corde est lâche, comme tu le penses bien il faut que la porte s’ouvre à moitié pour qu’elle se tende et pèse sur la détente, sans cela la balle, chassée trop vite, rencontrerait la porte et non le corps du voleur.
– Je comprends.
– Ma main rencontre donc la corde et comme elle est munie d’une paire de ciseaux, elle la coupe.
– Ah ! j’y suis.
– Mais, dit Bulton, j’ai la main trop grosse, et toi aussi ; et il n’y a qu’une main d’enfant, celle du petit, par exemple, qui puisse…
– Écoute, dit Suzannah, si tu me jures que, ce vol accompli, nous rendrons l’enfant à sa mère, je ne m’opposerai pas à ton projet.
– Je te le promets.
– Mais, dit encore Suzannah, probablement en rentrant chez lui avec de l’argent, le samedi soir, M. Thomas Elgin ne sort plus.
– Au contraire. Quand il a refermé sa caisse, disposé son pistolet et pris toutes ses précautions, il s’en retourne passer sa soirée à Londres, tantôt dans les galeries de l’Alhambra, dans Leicester square, tantôt à Argyll-Rooms, ou bien encore au théâtre du Lycéum. C’est donc entre neuf et dix heures du soir qu’il faudrait faire le coup, car c’est demain samedi.
– Mais que ferons-nous de l’enfant, d’ici-là ?
– Je me charge de le faire patienter, dit Bulton.
– Tu le battras ? demanda Suzannah d’une voix tremblante.
– Pas du tout.
– Tu me le promets ?
– Je te le jure.
– Mais comment feras-tu ?
– Tu le verras…
Et le bandit et la femme perdue s’endormirent à leur tour.
V
Un de ces pâles rayons de jour, qui se dégageait péniblement du brouillard, pénétrait dans la chambre de Suzannah l’Irlandaise, lorsqu’elle s’éveilla.
Bulton était déjà levé.
L’enfant dormait encore, brisé qu’il était par la fatigue de la veille.
Bulton était assis auprès de la fenêtre et paraissait fort occupé.
Son occupation consistait à limer et à polir un trousseau de clefs, dont chacune portait une petite ficelle de couleur différente, étiquettes mystérieuses, intelligibles pour lui seul.
Malgré le grincement de la lime, Ralph était immobile sur son lit improvisé.
– Pauvre petit ! dit Suzannah en le regardant.
Et elle avisa ses chaussures, couvertes de cette boue noire qui est particulière à Londres.
– Comme il a dû marcher ! dit-elle.
Bulton se mit à rire.
– Tu serais une bien bonne mère de famille, ma chère, dit-il.
– Et toi, répondit Suzannah, qui vint entourer de ses bras blancs le cou musculeux du bandit, tu es meilleur que tu n’en as l’air. Je parie que tu prendrais cet enfant en affection.
– La preuve en est, répondit Bulton, que je voudrais le garder.
– Oh ! non, répondit Suzannah, il ne faut pas faire cela… D’ailleurs, tu me l’a promis, n’est-ce pas ?
– Je te le promets encore, mais quand il aura coupé la corde.
– Soit, dit Suzannah. Cependant j’ai envie de faire une chose.
– Laquelle ?
– De m’en aller errer, toute seule, aux environs de Saint-Gilles.
– Pourquoi faire ?
– Et de m’enquérir adroitement si on n’a pas perdu un enfant… si on ne connaît pas quelque pauvre mère en pleurs… si…
– Il sera toujours temps de faire cela demain.
– Pourquoi pas aujourd’hui ?
– Je te le répète, parce que nous avons besoin de l’enfant ce soir. Ensuite, suppose qu’en ton absence il s’éveille…
– Bon !
– Ne te voyant plus, il se mettra à pleurer et voudra s’en aller. Tu sais que je ne suis pas patient.
– Non, certes, répondit Suzannah, et tu le battras. Oui, tu as raison, il vaut mieux que je reste, mais comment le faire patienter jusqu’à demain ?
– Quand il s’éveillera, il aura faim.
– Soit.
– Il aura soif…
– Eh bien ?
– Tu sais bien que lorsque, nous autres voleurs, nous voulons griser et endormir les gens, c’est très-facile : deux gouttes de gin mélangé de bitter dans un pot de bière brune, et le tour est fait.
– Tais-toi, dit Suzannah.
Et elle jeta un regard rapide sur Ralph, qui venait de s’agiter légèrement.
En effet peu après, l’enfant ouvrit les yeux et prononça un mot : « Maman. »
Suzannah s’approcha de lui et le prit dans ses bras.
– Ta mère, mon enfant, dit-elle, je t’ai promis que nous la chercherions.
– Tout de suite, n’est-ce pas ? dit-il.
Il se leva et, ayant aperçu Bulton, il éprouva un nouveau mouvement d’effroi.
Mais le bandit lui sourit, adoucit sa voix et son regard et lui dit :
– N’aie donc pas peur de moi, mon chérubin, je suis le mari de madame et je ne veux pas te faire du mal.
– Cela est bien vrai, fit Suzannah qui embrassa le petit Irlandais.
Celui-ci était déjà prêt à partir, mais il aperçut sur la table les restes du souper de Suzannah, et son regard trahit le vide de son estomac.
– Tu as faim, n’est-ce pas ? dit-elle.
L’enfant ne répondit rien, mais il rougit.
Il mourait de faim en effet.
– C’est loin d’ici l’église Saint-Gilles, poursuivit Suzannah et il te faudra beaucoup marcher encore. Par conséquent il faut que tu aies de la force. Allons, mange, mange, mon mignon, nous allons déjeûner.
– Je vais aller chercher du jambon et de la bière, dit Bulton, qui se leva à son tour et sortit.
Son départ fit sur Ralph un effet tout semblable à celui qui se produirait pour une personne oppressée, si une fenêtre venait à s’ouvrir et laissait pénétrer une bouffée de grand air.
Il lui sembla qu’il était plus en sûreté, et que Suzannah lui parlait avec plus de douceur.
Alors celle-ci se mit, pour tromper son impatience, à lui faire mille questions sur sa mère, sur l’endroit où il l’avait laissée et sur ce qui lui était arrivé.
Ralph se souvenait exactement des différentes circonstances de son arrivée à Londres, de son entrée chez mistress Fanoche.
Il parla des petites filles qui lui avaient prédit qu’il serait battu ; et comme il en était au milieu de son récit, Bulton revint avec des provisions et un pot de bière.
L’enfant voulut s’arrêter encore, mais Suzannah lui dit :
– Puisque monsieur est mon mari, pourquoi ne parles-tu pas devant lui ?
Ralph s’enhardit ; et il répéta devant le bandit ce qu’il avait dit déjà.
Un fait se dégagea, pour ce dernier et pour Suzannah, des paroles de l’enfant, c’est qu’il n’avait que des souvenirs très-vagues du quartier où on l’avait conduit et que par conséquent, on pourrait, sous prétexte de le mener à Saint-Gilles, l’entraîner dans un autre quartier de Londres sans qu’il s’en aperçut.
Les voleurs de Londres, tout comme ceux de Paris, ont un argot, une sorte de langue verte qui n’est compréhensible que d’eux seuls.
Bulton se mit à parler cette langue et il dit à Suzannah :
– Je renonce à griser l’enfant.
– Ah !
– Tu vas t’en aller avec lui, tous les squares se ressemblent, à Londres, et en place de le mener à Saint-Gilles, tu le mèneras à Kilburn square.
– Bon !
– Tu le promèneras dans tous les environs jusqu’à ce qu’il soit rompu de fatigue. Il n’aura pas à soupçonner la vérité et à mettre en doute ta bonne foi, et quand il sera bien las, tu entreras dans un public-house qui est dans le Kursalt Pince Lane, à l’angle d’Edward road, et tu m’y attendras, cela vaut mieux.
– Je préfère cela aussi, dit Suzannah.
– J’aurai les clefs toutes prêtes, je serai mis comme un gentleman, et j’arriverai en cab : fie-t’en à moi pour le reste.
– C’est bien, dit Suzannah.
Ralph mangea avec avidité, et on lui donna à boire de la bière sans addition de gin et de bitter. Puis Suzannah prit son châle et son chapeau et lui dit :
– Maintenant, allons chercher ta mère.
Et l’enfant partit avec elle, plein de confiance et consentit à embrasser Bulton.
Le programme de ce dernier fut suivi à la lettre.
Suzannah tenait l’enfant par la main, descendit le Brok street et tourna dans le Holborne.
Un des nombreux omnibus qui vont à Regent’s parck passait en ce moment.
Suzannah fit signe au cocher qui s’arrêta.
Ralph ne fit aucune difficulté de monter avec l’Irlandaise, et une demi-heure après, ils descendaient dans Albert road.
Alors Suzannah se mit à lui faire parcourir les rues environnantes, en lui disant :
– Regarde-bien, est-ce là ?
– Non, disait l’enfant.
Et ils se remettaient en route.
Elle le traîna ainsi tout le jour, avec une patience qui acheva de lui gagner la confiance du pauvre enfant.
Et la nuit vint, et Ralph n’avait ni reconnu la rue de mistress Fanoche, ni retrouvé sa mère.
Il était si las que Suzannah le prit dans ses bras et le porta.
Elle le porta jusqu’à ce public-house dont avait parlé Bulton.
Et l’enfant, docile désormais, consentit à s’asseoir et à souper avec l’Irlandaise.
La nuit était venue.
– Nous allons nous en retourner chez nous, dit Suzannah, et demain nous chercherons encore…
L’enfant était triste, mais il avait cessé de pleurer.
L’âme d’un homme était en lui.
Tout à coup la porte du public-house s’ouvrit et Bulton entra.
– Je crois bien, dit-il, que j’ai retrouvé ta mère.
L’enfant jeta un cri de joie et tendit les bras au bandit.
VI
Suzannah regarda Bulton, au cou de qui sautait l’enfant.
Bulton lui fit un signe imperceptible qui voulait dire :
– Tais-toi donc, c’est pour qu’il fasse ce que nous voudrons.
Le bandit avait arrangé une petite histoire propre à frapper l’imagination de Ralph, et il en avait pris les premiers éléments dans le récit même du pauvre enfant.
Au cri de joie poussé par le petit Irlandais, quelques personnes qui se trouvaient dans le public-house s’étaient retournées.
– Ne fais pas de bruit, lui dit Bulton, ne crie pas, et écoute-moi bien.
Il avait su trouver une voix sympathique et se faire un visage affectueux.