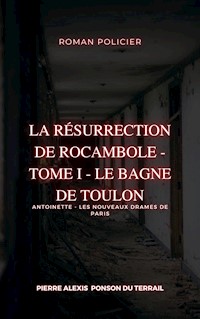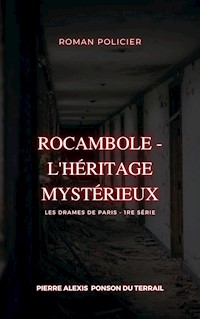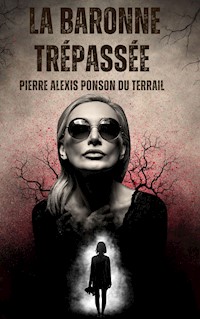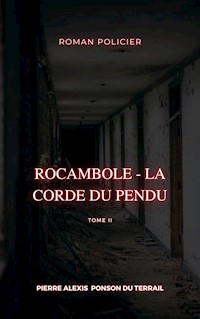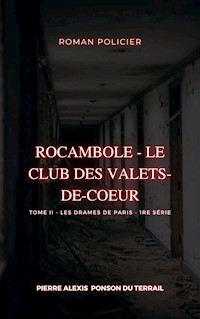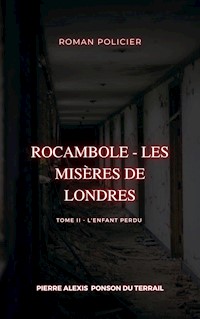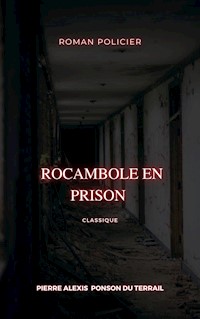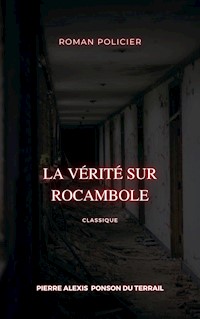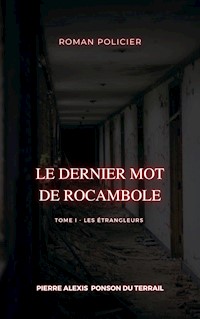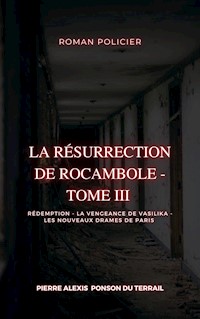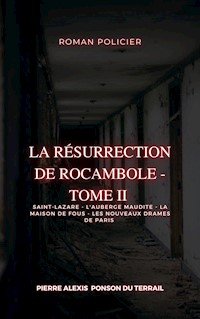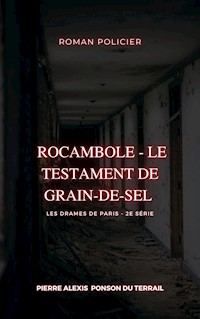Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Französisch
Les aventures «rocambolesques» de Dagobert, forgeron du couvent de la Cour-Dieu, pendant la Révolution française.
Das E-Book Le Forgeron de la Cour-Dieu wird angeboten von Books on Demand und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
littérature française, Classique, AVENTURES, roman policier, Mystères
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pierre Alexis Ponson du Terrail
LE FORGERON DE LA COUR-DIEUTome II
(1869)
Table des matières
DEUXIÈME PARTIE LES AMOURS D’AURORE
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV
XLVI
XLVII
XLVIII
XLIX
L
LI
LII
LIII
LIV
LV
LVI
LVII
LVIII
LIX
LX
LXI
LXII
LXIII
LXIV
LXV
LXVI
LXVII
LXVIII
LXIX
LXX
LXXI
LXXII
LXXIII
LXXIV
LXXV
ÉPILOGUE
Mentions légales
DEUXIÈME PARTIELES AMOURS D’AURORE
I
Tandis que ces événements se passaient à Paris, à la Billardière, la vie avait suivi son cours. Le chevalier des Mazures s’était peu à peu rétabli. Un jour, il monta à cheval ; c’était le jour où la comtesse des Mazures et Toinon rentraient de Paris. Depuis ce jour, le chevalier fit de fréquentes incursions du côté de Beaurepaire.
À cette époque, il y avait peu de journaux, seuls les nobles et quelques gens, gros commerçants recevaient le « Mercure de France ». Le chevalier était l’un des privilégiés qui le recevait. L’affaire de la rue de l’Abbaye, était contée tout au long. Ce fut pour lui un éclair. La Comtesse avait été à Paris et s’était emparée de la cassette. Le lendemain, sa promenade l’amena comme par hasard du côté de Beaurepaire. Il y rencontra le jardinier, qui se trouvait justement être la créature dévouée à Toinon. Par lui, il apprit le retour de Toinon et de sa maîtresse et pas mal d’autres choses. Il le chargea donc, de donner un rendez-vous à Toinon.
– Part à deux, comtesse, se dit-il quand il fut seul.
Que se passa-t-il entre le chevalier des Mazures et Toinon, rien ne pourra jamais nous le dire. Toujours est-il que quatre jours après, vers deux heures du matin, Toinon montée dans le petit panier qui lui avait déjà servi à se rendre à la Cour-Dieu courait à fond de train sur la route de Pithiviers, emportant la fortune de Jeanne. Le chevalier des Mazures avait assassiné sa belle-sœur pour le seul profit de Toinon.
Que devinrent-ils et que devinrent les autres héros de cette histoire ? C’est ce que nous vous dirons, en vous transportant au milieu de cette sinistre époque qui a nom la Terreur.
II
Le soir approchait.
Un soir de janvier, triste, brumeux et froid.
Un homme et deux femmes cheminaient cependant sur la route d’Étampes à Paris, et, après avoir dépassé Montléry, depuis longtemps étaient tout à l’heure aux portes d’Antony.
L’homme était un tout jeune homme.
Les deux femmes, deux jeunes femmes, ou même deux jeunes filles.
Tous trois cheminaient gaillardement, chaussés de bons sabots, vêtus comme les paysans, le visage bleui par le froid.
Pourtant ils avaient fait une longue route et marchaient sans doute depuis plusieurs jours, à voir la poussière qui couvrait leurs vêtements.
Plusieurs fois dans la journée, le jeune homme avait jeté sur ses deux compagnes un regard plein de tendresse respectueuse et de compassion.
Plusieurs fois, quand un village apparaissait dans le lointain ou qu’une maison blanchissait sur la route, leur avait-il dit :
– Nous allons nous arrêter ici.
Mais le village atteint, au seuil de la maison, voyant de mauvais visages, des gens à l’œil soupçonneux, il ajoutait :
– Marchons encore !
Et tous trois continuaient leur chemin, lui soupirant, elles pleines de courage et de vaillance.
Ah ! c’est qu’on était alors en un rude temps.
Le frère ne se fiait pas à son frère ; l’ami ne croyait plus à l’amitié, et le père se défiait de son fils.
L’orage qui, au début de ce récit, grondait au lointain, avait éclaté maintenant, et le ciel était plein d’éclairs, la tempête de 93 était dans toute sa véhémence.
Noblesse, clergé, haute bourgeoisie avaient été emportés dans la tourmente comme ces feuilles d’automne que roule l’aile du vent.
On avait brûlé les châteaux, guillotiné les châtelains, guillotiné les prêtres aussi, et fermé les églises.
Du pieux couvent de la Cour-Dieu il ne restait que des ruines, et du château de Beaurepaire et de la maison de chasse, où jadis trônait la belle Aurore, des ruines aussi. De ces trois voyageurs qui bravaient la froidure, la longueur de la marche et les privations du voyage, l’un, vous l’avez deviné peut-être, était cet enfant plein de courage qu’on appelait Benoît le bossu.
Les deux femmes qui le suivaient se nommaient Aurore et Jeanne.
D’abord le chevalier des Mazures avait disparu, cette même nuit où Toinon se sauvait, emportant le coffret qui renfermait toute la fortune de la fille de Gretchen.
Qu’était-il devenu ?
Nul ne le savait, pas même sa fille Aurore.
En revanche, on savait comment la comtesse des Mazures avait fini.
Le lendemain de la fuite de Toinon, on avait trouvé la comtesse dans son lit, percée de cinq coups de poignard et baignant dans une mare de sang.
Elle était morte sans avoir poussé un cri ou du moins sans avoir été entendue.
Comme on avait retrouvé le poignard qui avait servi à l’accomplissement du crime et que ce poignard appartenait à la comtesse, qu’en outre du coffret, Toinon ne s’était nullement privée de faire main basse sur les diamants et tout l’argent qu’elle avait pu trouver, ce ne fut un doute pour personne qu’elle avait assassiné sa maîtresse.
Mais nul ne songea à lui donner le chevalier pour complice.
L’année suivante, l’orage éclata, et la monarchie constitutionnelle remplaça la monarchie absolue.
Cependant Aurore et Jeanne vivaient tranquilles, dans leur petit manoir, sous la protection du vieux dom Jérôme.
Quand le peuple se porta à la Cour-Dieu et ouvrit les portes du couvent, les bons moines s’en allèrent en pleurant, et chacun d’eux se réfugia, qui chez un parent, qui chez un ami. Dom Jérôme était allé se réfugier chez Aurore.
Un autre personnage encore avait abandonné ses dieux lares et la maison où il était né.
Mais ce n’était pas la peur de la Révolution qui le menait, celui-là.
Enfant du peuple, qu’avait-il à craindre de la colère du peuple ?
Peut-être avait-il obéi à quelque terrible et pesant chagrin.
Peut-être s’était-il donné quelque tâche mystérieuse à accomplir.
Celui-là, c’était Dagobert le forgeron.
Au premier bruit du clairon, quand on avait proclamé « la patrie en danger », Dagobert était allé s’enrôler sous les drapeaux de la République, disant :
– Je mourrai ou je serai général un jour !
Enfin la tempête était devenue si forte, qu’il n’y avait plus de sûreté, même pour ce vieux prêtre qui vivait auprès des deux jeunes filles, dont il était maintenant le seul protecteur.
Une nuit, les municipaux se présentèrent ; ils venaient chercher dom Jérôme.
Avant de les suivre, le vieillard donna sa bénédiction aux deux jeunes filles ; mais, avisant, auprès d’elles, Benoît le bossu qui pleurait, il lui dit :
– Tu es un pauvre être chétif et dépourvu d’instruction, mais tu es un brave cœur, dévoué ; défends-les et meurs pour elles au besoin…
* *
*
Et c’était pour cela que le lendemain du jour où on avait emmené le vieux prêtre, Benoît et les deux jeunes filles étaient partis.
Ils venaient donc d’arriver aux portes d’Antony quand Benoît s’arrêta.
– Voilà, dit-il, un pays qui ne me convient guère.
– Jeanne est pourtant bien lasse, dit Aurore.
– Oh ! je marcherai encore, répondit Jeanne.
– Si nous passions à côté ? dit Benoît.
– Et puis, fit Aurore, ne faudra-t-il pas toujours nous arrêter ?
– Je crois bien, murmura alors Benoît, que voilà notre affaire, demoiselles.
Et il étendait la main et montrait une petite maison nette blanche, au bord du chemin.
Au-dessus de la porte, la bise secouait la traditionnelle branche de houx.
Une vieille femme à l’air avenant était assise sur le seuil et paraissait se soucier fort peu du froid.
Benoît prit son air le plus naïf.
– Hé ! bonne mère, dit-il, ça coûte-t-il bien cher pour manger une écuelle de soupe et boire un coup chez vous ?
La vieille regarda le brave garçon et les deux jeunes filles.
– Vous n’avez pas l’air lotis d’argent, mes agneaux ! dit-elle.
– Le fait est, répondit Benoît, que nous n’en avons pas beaucoup, mes sœurs et moi.
– Ah ! ce sont tes sœurs, ces jolies petites chattes ? dit la vieille.
– Oui, bonne mère.
– Pauvres mignonnes ! Elles ont l’air transi, et, de fait, il ne fait pas chaud. Entrez donc, mes enfants, vous mangerez, vous vous chaufferez, et vous donnerez ce que vous pourrez…
– Vous êtes une brave citoyenne, dit Benoît.
La vieille se mit à rire.
– C’est pourtant vrai, dit-elle, que maintenant que tout est changé, on m’appelle citoyenne. C’est mon homme qui le veut comme ça… il est un peu fou, mon homme !
III
Le Rendez-vous des bons patriotes était bien le plus modeste de tous les cabarets.
On y buvait de ce mauvais vin sans couleur que produisent les coteaux de Suresnes, d’Argenteuil et de Rueil ; on y mangeait de la viande coriace, et le voyageur qui y passait la nuit dormait sur un lit plus dur qu’un sac de noix.
Tout cela n’empêchait pas l’établissement d’être très fréquenté, surtout les jours de décadi, et c’était bien un pur hasard que Benoît le bossu et ses deux compagnes n’y trouvassent personne. Il est vrai que le maître de l’établissement était absent, et quand le citoyen Horace Coclès, qui se nommait autrefois Jean Bournel, n’était pas chez lui, les patriotes passaient leur chemin en murmurant que la citoyenne Coclès était une aristocrate.
La citoyenne Coclès haussait les épaules quand on lui disait cela et paraissait fort tranquille.
Et, de fait, le citoyen Coclès, son mari, avait souvent montré le poing, en disant :
– Ma femme n’est pas aussi bonne patriote que moi, c’est vrai, mais elle a d’autres qualités, et je défends qu’on y touche !
Coclès, du reste, était la terreur du pays. Il allait à Paris tous les quatre ou cinq jours, ramenait avec lui des frères et amis qui faisaient grand tapage, chantaient le « Ça ira ! » et « la Marseillaise » et avaient répandu une terreur profonde dans les villages environnants.
Comment cette femme qui regrettait tout haut la puissance royale et les aristocrates et cet homme, qui voulait exterminer tout ce qui de près ou de loin avait touché l’ancien régime, s’entendaient-ils ?
C’était là un mystère !
Le fait est qu’ils s’entendaient à merveille, et même on disait que Madeleine, – c’était le nom de Mme Coclès, – était plus maîtresse que son mari.
Donc, à cette heure, le Rendez-vous des bons patriotes était désert. Un maigre feu brûlait dans l’âtre, et sur ce feu chantait une petite marmite.
– Chauffez-vous donc, mes enfants, dit Mme Coclès d’un ton affectueux. Si vous voulez seulement attendre un quart d’heure, la soupe sera cuite.
Aurore et Jeanne s’étaient approchées du feu avec avidité et exposaient à la flamme leurs mains bleuies par le froid.
Le front soucieux de Benoît s’était déridé.
Depuis qu’ils étaient en route, ils n’avaient pas encore rencontré un visage plus avenant, ni une maison qui eût l’air plus honnête.
– Vous venez de loin ? demanda Mme Coclès, qui causait volontiers.
– De vingt-cinq lieues d’ici, en tirant sur Pithiviers, répondit Benoît.
– Et vous allez à Paris ?
– Il faut bien gagner sa vie.
Mme Coclès secoua la tête.
– Prenez garde, mes mignonnes, dit-elle, d’aller faire à Paris tout autre chose.
– Quoi que vous dites, la mère ? fit Benoît, qui prit son accent le plus naïf.
– On ne trouve guère de besogne à Paris. Depuis que le peuple est roi, il se sert lui-même, grommela Mme Coclès.
Benoît la regarda d’un air ébahi.
– C’est donc tes sœurs, ces deux jolies petites ? continua Mme Coclès.
– Oui, la mère.
– Et que comptez-vous faire à Paris ? demanda encore l’hôtesse du Rendez-vous des bons patriotes.
– Moi, dit Aurore, je n’ai pas d’état. Je me ferai servante.
– Oh ! oh !
– Mais ma sœur est couturière, et elle trouvera sans doute de l’ouvrage.
– Ouais ! fit Mme Coclès qui les regarda toutes deux du coin de l’œil, vous avez les mains bien petites, mes poulettes, et bien blanches pour faire de gros ouvrages.
Benoît tressaillit, et quelques gouttes de sueur perlaient à son front.
Tout en causant, Mme Coclès avait dressé la table, posé dessus des assiettes et des cuillers d’étain ; puis elle avait décroché la marmite.
Mais Aurore et Jeanne n’avaient plus faim ; la remarque faite par la bonne femme les avait quelque peu bouleversées.
La marmite renfermait des choux et un morceau de lard.
– Quand vous aurez mangé ça, mes enfants, reprit Mme Coclès, vous aurez du cœur à l’estomac, et vous ferez d’un pas gaillard les quatre petites lieues qui vous séparent encore de Paris.
Benoît regarda tristement les deux jeunes filles d’abord, qui paraissaient exténuées ; puis l’hôtesse, et il dit à cette dernière :
– Vous ne logez donc pas les voyageurs ?
– Ça dépend, dit Mme Coclès d’un ton de mystère.
– Mes sœurs sont bien lasses, reprit Benoît.
– Pauvres petites !
– Et quatre lieues, c’est long, savez-vous, la bonne mère !
Mme Coclès les regardait pareillement tour à tour.
– C’est que, dit-elle, avec un certain embarras, je n’ai qu’une chambre en haut et qu’un lit à donner.
– Ne vous inquiétez pas de moi, répondit Benoît, je coucherai bien sur cette chaise, moi.
– Et puis, dit encore Mme Coclès, le citoyen Coclès, mon mari, est à Paris… Mais il reviendra cette nuit, et peut-être, bien qu’il ne sera pas seul.
En parlant ainsi, la bonne femme jetait un regard furtif sur l’horloge de cuivre à fourneau de sapin, qui faisait tic tac auprès de la porte.
Il était à peine sept heures du soir.
Alors elle parut avoir trouvé une solution à ce mystérieux problème qu’elle s’était posée quelques secondes auparavant.
– Écoute-moi, mon garçon, dit-elle à Benoît, quand vous aurez soupé, je vous conduirai tous les trois là-haut. Tu t’arrangeras d’une chaise et tes sœurs coucheront sur le même lit. Mais, si vous m’en croyez, quand vous aurez dormi trois ou quatre heures, c’est-à-dire un peu avant minuit, vous vous en irez.
– Ah ! fit Benoît qui était redevenu soucieux.
– Mon mari n’est pas un méchant homme, poursuivit Mme Coclès ; mais quand il est allé à Paris, il revient en pleine nuit, et presque toujours un peu chaviré. La moitié du temps il n’est pas seul, et il a un tas de tapageurs avec lui qui ne sont pas plus à jeun.
Mais il n’y avait, pas dix minutes que Mme Coclès avait versé la soupe dans les assiettes, qu’une rumeur lointaine se fit entendre sur la route.
Des voix avinées se faisaient entendre, chantant en chœur ce refrain :
Ça ira ! ça ira !
Les aristocrat’s à la lanterne !
Ça ira ! ça ira !
Les aristocrat’s on les pendra !
– Bon ! dit Mme Coclès, je n’ai pas de chance aujourd’hui. Il n’y a donc plus de vin à boire à Paris, que Coclès revient d’aussi bonne heure, et en belle compagnie encore ! Et elle jeta sur les deux jeunes filles et sur Benoît le bossu un regard plein d’inquiétude.
IV
Mais l’inquiétude de Mme Coclès eut la durée d’un éclair.
– Soupez donc tranquillement, mes enfants, dit-elle.
Mon mari est un braillard, c’est vrai, et quand il a bu il fait grand tapage ; mais c’est un bonhomme au fond.
Comme elle disait cela, le « Ça ira ! » se fit entendre à la porte, et la bande avinée fit irruption dans l’auberge.
Le citoyen Coclès était accompagné de trois personnages.
Les deux Verduron s’étaient affublés de noms romains, ni plus ni moins que Coclès ; l’aîné, qui pouvait avoir vingt-cinq ans, se faisait appeler Brutus ; le second, un pâle voyou de barrière, s’intitulait Scævola. Il n’y avait que Polyte qui avait gardé son nom faubourien.
Coclès aurait pu être leur père à tous trois, et on pouvait même jusqu’à un certain point s’étonner de l’intimité qui existait entre le quinquagénaire et ces jeunes gens.
Mais Coclès, dans son ardent amour de la République, proclamait que la jeunesse seule était généreuse, et que la nation ne pouvait s’appuyer que sur elle.
Dans un rayon de trois ou quatre lieues autour de Paris, Polyte et les deux Verduron répandaient une salutaire terreur.
Tels étaient les personnages qui venaient d’entrer bruyamment dans le cabaret des « bons patriotes ».
La citoyenne Coclès n’avait eu que le temps de changer la chandelle de place. Elle l’avait ôtée de dessus la table pour la mettre sur la cheminée, dont le manteau était assez élevé. De cette façon, ses trois hôtes se trouvaient moins éclairés, et la beauté des jeunes filles n’attirait pas les regards tout d’abord.
– Oh ! oh ! fit Coclès qui entra le premier, il y a de la compagnie chez moi.
Benoît porta gauchement la main à son bonnet.
– C’est des pauvres enfants qui mouraient de faim et de froid, dit Mme Coclès, qui se sont arrêtés pour manger un morceau.
– Eh ! eh ! ricana Polyte, je crois bien que le citoyen est bossu.
– Et une jolie bosse encore, exclamèrent Brutus et Scævola Verduron.
Et tous trois se mirent à rire bruyamment.
Benoît ne se fâcha point.
– Excusez-moi, dit-il, il n’y a pas de ma faute, et si je m’étais fait moi-même, je ne me serais rien épargné.
Cette réponse lui valut une nouvelle hilarité et presque une ovation. En même temps, il regarda Aurore et Jeanne.
– Eh ! dit-il, voilà deux citoyennes qui ne sont pas déchirées !
Jeanne rougit jusqu’au blanc des yeux. Aurore demeura impassible.
– Un beau brin de fille ! dit l’aîné des Verduron.
– Vous n’êtes pas des aristocrates, au moins ! s’écria Scævola, car je vous dénoncerais.
Benoît le bossu se mit à rire.
– Des aristocrates, nous ! tiens, citoyen, regarde-moi ça !
Et il retroussa les manches de sa blouse et montra son bras nu dont le cuir était tanné par le hâle des champs, et sa main énorme et calleuse.
– C’est-y des mains de marquis, ça, fit-il encore.
– À la bonne heure, camarade, dit Polyte, qui attachait sur Aurore un regard naïvement cynique, tu es un patriote, ça se voit.
– Je m’en vante, dit Benoît.
– Et d’où viens-tu ?
– Oh ! nous venons de loin, mes sœurs et moi.
– Ah ! ces jolies citoyennes sont tes sœurs ?
– Oui, dit Benoît.
– Oui, répétèrent Aurore et Jeanne.
– Alors, dit Brutus Verduron, vous n’êtes pas du même père, car tu ne me feras jamais croire mon gaillard, que la citoyenne, ta mère, après avoir pondu un monstre comme toi, ait mis au monde ces deux jolies filles.
– On me l’a souvent dit, dit humblement Benoît, mais pourtant ce que je vous dis est la vérité.
– Et vous allez à Paris ? dit Polyte.
– Oui. Je tâcherai de me placer comme homme de peine.
Et tes sœurs ?
– Il y en a une qui est couturière.
– Et l’autre ?
– Elle fera des ménages.
Sur cette réponse, Benoît avala un verre de vin ; puis il dit à Mme Coclès :
– Hé ! citoyenne, combien qu’on vous doit ?
En même temps il tira de sa poche une méchante bourse en cuir dans laquelle il y avait une poignée de gros sous.
– Rien du tout, répondit Coclès qui avait le vin généreux : tu as l’air d’un bon patriote, mon garçon ; garde ton argent et file !
– Bah ! dit Polyte, tu ne vas pas t’en aller ce soir, bossu de mon cœur.
– Pourquoi donc ça ? fit Benoît, qui avait hâte d’être, avec les deux jeunes filles, hors de cette maison.
– Mais parce qu’il est nuit.
– Bon ! ça me connaît. J’y vois comme les chats, moi.
– Et puis, il fait froid.
– Nous marcherons d’un bon pas.
– Et puis, vous ne pourrez pas entrer dans Paris. On n’ouvre les barrières que le matin.
– Mais non, dit Mme Coclès, on ouvre toute la nuit.
– Ça dépend comme les municipaux sont tournés, dit Coclès à son tour. Mais pourquoi ne coucheraient-ils pas ici, ces enfants ?
Et il regarda sa femme dont le visage exprima de nouveau l’inquiétude.
Quant à Benoît, il regardait Jeanne qui s’était levée et ne se soutenait qu’avec peine sur ses pauvres pieds endoloris.
V
Aurore fit comme Benoît, elle regarda Jeanne, dont la lassitude était extrême.
– Couchez donc ici, mes enfants, dit Coclès de sa voix la plus engageante.
Mais Benoît hésitait encore et semblait avoir pris la résolution de porter Jeanne sur ses épaules au besoin.
La voix de Coclès avait sans doute des intonations mystérieuses dont sa femme avait la clé, car la citoyenne, inquiète une seconde auparavant, se décida soudain et dit aux jeunes filles :
– Mon mari a raison, mes enfants. Montez vous coucher dans la pièce dont je vous ai parlé, et dormez bien jusqu’à demain sans vous faire la moindre bile.
* *
*
En bas, Coclès versait à boire à Polyte et aux deux Verduron. Mais ces derniers seuls lui faisaient raison.
Polyte trempait à peine ses lèvres dans son verre, et il était devenu tout songeur.
– Ça serait des aristocrates que ça ne m’étonnerait pas.
Polyte haussait les épaules et ne disait rien.
– Faudra que j’aille en couler deux mots à la gendarmerie d’Antony, reprit Scævola
– Si tu veux que je t’assomme, dit Coclès, tu n’as qu’à faire ce coup-là.
– De quoi ? dit Brutus, l’aîné des Verduron, voilà que tu défends les aristocrates, maintenant ?
– Non pas, dit Coclès, je suis un bon patriote, moi.
– Alors, laisse-moi aller chercher les gendarmes.
– Il faudra qu’on te porte en-ce cas, dit Polyte, car tu es ivre.
– Je marcherai bien jusque-là.
Et Scævola se leva et essaya de se tenir sur ses jambes.
– Va donc te coucher, dit brutalement Coclès. Est-ce que tu vas me faire avoir des raisons avec les gendarmes, maintenant ?
– Mais puisque c’est des aristocrates.
– Je te dis que non, moi, et les gendarmes le verront bien… Et ça fera du tort à mon cabaret… Allons, tiens-toi tranquille, et bois !
– Coclès a raison, dit Polyte.
Brutus Verduron avala un nouveau verre de vin.
– Y a-t-il de la paille dans l’écurie ? dit-il.
– Pardieu ! fit Mme Coclès.
– Eh bien ! je vais y dormir un brin…
– Moi aussi, dit Polyte.
– Alors, balbutia le jeune Verduron, vous ne voulez pas que j’aille chercher les gendarmes ?
– Non, dit son frère.
– Viens cuver ton vin, imbécile ! ajouta Polyte.
Et il le prit par le bras.
Coclès alluma sa lanterne.
– Et prenez garde de vous coucher sous mon âne, dit-il.
– Il n’est pas ivre, lui, il se rangera, répondit Brutus Verduron avec un gros rire.
Coclès ouvrit la porte et Polyte et l’aîné Verduron soutinrent le citoyen Scævola qui était incapable de marcher tout seul.
Quand ils furent partis, la citoyenne Coclès respira.
– Pauvres enfants ! murmura-t-elle en songeant aux deux jeunes filles.
Quelques minutes après, Coclès rentra.
Il était sombre et soucieux.
– Ah ! dit-il, tu me fais faire des bêtises, femme.
– Qu’est-ce qu’il y a ? demanda-t-elle.
– Je suis borgne, reprit Coclès, mais l’œil qui me reste est bon.
– Qu’est-ce que ça prouve ?
– Que j’y vois clair.
– Tant mieux pour toi, mon homme.
– Non, tant pis pour nous ; car je ne m’y suis pas trompé. Encore des aristocrates que tu loges. Tu verras que nous finirons par aller à la guillotine, nous aussi.
– Poltron, va !
– Je tiens à ma tête, grommela Coclès, et si tu m’en crois, demain, avant que les autres soient réveillés, nous ferons filer ces demoiselles et leur conducteur.
Comme le citoyen Coclès disait cela, on frappa à la porte, et comme la porte n’était fermée qu’au loquet, elle s’ouvrit. C’était Polyte, le petit faubourien, qui revenait.
– Les autres dorment déjà, dit-il, que le canon ne les réveillerait pas ; mais moi, je n’ai pas sommeil et je viens fumer ma pipe et jaser un peu.
Il avait un mauvais sourire en parlant ainsi, et Coclès et sa femme se prirent à frissonner.
VI
Quelques mots échappés à la citoyenne Coclès ont dû édifier le lecteur sur le civisme du citoyen Coclès, son mari.
C’était la peur qui l’avait rendu bon patriote.
Quand il chantait le « Ça ira », il avait des coliques sourdes, et lorsque ses amis l’entraînaient à la place de la Révolution pour voir les galanteries du citoyen bourreau jonglant avec les têtes d’aristocrates, il en revenait aussi pâle qu’une galette mal cuite.
Cependant au fond, tout au fond du cœur, il avait un penchant pour ceux qu’il avait servis jadis, et quand il était seul avec sa femme, celle-ci parvenait à lui faire momentanément honte de sa couardise.
Les deux jeunes filles dont il avait deviné la naissance l’avaient-elles intéressé fortement ; était-ce simplement pour plaire à sa femme ?
Voilà ce qui est difficile de déterminer. Mais Coclès avait fait le serment. « in petto » de les protéger, et s’il eut un frisson en voyant revenir Polyte, ce frisson ne dura pas et le courage lui revint.
– Ah ! tu n’as pas sommeil ? dit-il à Polyte.
– Non, répondit le voyou.
– Tu veux jaser ?
– Dame !
– Et boirais-tu bien encore un coup ?
– Peuh ! dit Polyte, ce n’est pas la soif qui me tient.
– Comment ! reprit Coclès, tu n’as plus soif ?
– Non.
– T’aurais soif tout de suite, si je disais un mot.
– Hein ? fit Polyte.
– J’ai du cidre doux de Normandie que mon frère m’a envoyé. C’est ça qui vaut mieux que le vin.
Et Coclès fit un signe à sa femme.
– Je vas en chercher une bouteille, dit-elle.
– Comme vous voudrez, fit Polyte avec indifférence.
Mme Coclès souleva la trappe de la cave, alluma sa lanterne et descendit.
Alors Polyte vint s’asseoir en face de Coclès et mit les coudes sur la table.
– Dis donc, citoyen, fit-il, je voudrais te causer sérieusement.
– De quoi donc ? fit Coclès qui parut étonné.
– Des intérêts de la République.
– Vive la République, dit Coclès.
– Oui, certes, reprit Polyte ; mais les paroles ne sont rien…
– Ah !
– Les actions sont tout.
– Que veux-tu dire ?
– Minute ! dit Polyte, je n’aime pas causer avec les femmes.
La citoyenne Coclès revenait, apportant non point une bouteille de cidre, mais deux.
– Femme, lui dit Coclès, il est tard. Faut que tu te lèves matin demain ; va te coucher.
Et il eut un regard significatif que Polyte ne comprit point et qui voulait dire : Sois tranquille, je m’en charge !
– Prends garde de te buter dans l’escalier, ajouta-t-il.
– Ah ! oui, dit Mme Coclès ; mais j’ai fait venir le maçon tantôt et il a replacé la marche qui était en mauvais état.
Polyte ne fit nulle attention à ces mots bizarres échangés entre le mari et la femme. Tout entier à l’idée qui lui travaillait le cerveau, il paraissait attendre avec impatience que la citoyenne Coclès s’en allât.
Celle-ci prit la lanterne, et se dirigeant vers l’escalier :
– Bonsoir, Polyte, dit-elle.
– Bonsoir, citoyenne, répondit-il.
Coclès lui versait à boire en ce moment.
– Bon ! dit alors le voyou, nous voilà seuls et nous allons jaser.
– Jasons, fit Coclès avec indifférence.
– Citoyen, reprit Polyte brusquement et sans préambule, tu trahis la République.
– Moi ! fit Coclès.
Et il prit un air étonné.
– Tu abrites des aristocrates.
– Ah ! par exemple !
– Ne fais donc pas le malin avec moi, poursuivit Polyte. Je t’ai rendu un fier service, tout à l’heure, en empêchant nos camarades d’aller prévenir les gendarmes.
– Mais pour quoi faire ? dit Coclès qui jouait toujours l’étonnement.
– Pour arrêter les petites.
– Les sœurs du bossu ?
Polyte haussa les épaules.
– Le bossu est un domestique, et les petites sont des filles de ci-devant.
– Ah ! je ne savais pas ça, fit Coclès.
Polyte cligna de l’œil.
– Farceur ! dit-il, tu le sais aussi bien que moi. Seulement, tu veux faire plaisir à ta femme.
– Allons donc !
– Et puis les petites te plaisent.
– Quelle bêtise !
– Et à moi aussi, dit froidement Polyte. Une surtout, celle qui a de grands yeux bleus et des cheveux noirs. Et je me suis fait un raisonnement tout à l’heure.
– Lequel ? demanda Coclès.
– Les femmes sont ce qu’on les fait, reprit Polyte.
– Comment cela ?
– Et on peut faire une patriote d’une aristocrate.
Coclès ne sourcillait pas.
– Alors, poursuivit Polyte, je me suis dit : Si demain je laisse faire Scævola et Brutus, ils vont chercher les gendarmes et, dans trois jours, les deux petites sont fauchées.
– Ah ! tu t’es dit cela ? fit Coclès.
– Oui, mais j’ai réfléchi… tu vas voir…
– Voyons ?
– Il y en a une qui me plaît, et j’en veux faire Mme Polyte.
– Vraiment ? fit le cabaretier.
– Tu me donnes un coup de main.
– Comment ?
– Nous montons là-haut.
– Bon !
– Nous entrons dans la chambre où elles sont.
– Fort bien.
– Nous jetons le bossu par la fenêtre.
– Et puis ?
– Et puis, dame ! tu sauveras la petite blonde comme tu l’entendras… moi, je me charge de la brune… elle me plaît…
Et le cynique visage de Polyte rayonna de concupiscence.
– Mais si ce ne sont pas des aristocrates, pourtant, dit Coclès.
– Je te dis que c’en est.
– Prouve-le moi.
– Tu n’as donc pas vu qu’elles avaient des petites mains longues et blanches ?
– Ça ne dit rien, ça.
– Pour moi, ça dit tout. Et puis, aristocrates ou non, la brunette me plaît, et, je te le répète, j’en veux faire Mme Polyte et une bonne patriote.
Coclès paraissait hésiter.
– Tu es un camarade, dit-il enfin, et je ne voudrais pas me fâcher avec toi.
– Je le pense bien, dit Polyte, qui avait deviné depuis longtemps la peur de Coclès et l’exploitait à son profit.
– Mais je voudrais que tu fisses tes affaires toi-même.
– Comment ça ?
– Ce bossu est gros comme deux liards de beurre. Tu n’as pas besoin de moi pour le jeter par la fenêtre.
– Tu ne veux donc pas me donner un coup de main ?
– Non ; mais tu n’as qu’à monter ; je ne me mêlerai de rien, et tu peux faire tout le train que tu voudras, je serai sourd.
– Soit !… Mais ta femme ?
– Ma femme ne dira rien non plus.
Polyte prit un couteau sur la table.
– Voilà pour le bossu, dit-il.
– Eh bien ! va mon gaillard…
Polyte, ivre de cynisme et d’amour, jugea inutile de se munir d’une lumière.
Il se dirigea d’un pas aviné vers l’escalier et en gravit lentement les marches.
Coclès, anxieux, prêtait l’oreille.
Les pas de Polyte retentirent d’abord dans l’escalier, puis sur le plancher de l’étage au-dessus.
Et tout à coup un grand cri, un cri d’épouvante et d’angoisse, suivi d’un bruit sourd, pareil à la chute d’un corps, parvint à l’oreille du cabaretier.
Alors le front assombri de Coclès se dérida.
– Ça y est, murmura-t-il, ma femme avait compris !…
VII
Qu’était-il donc arrivé ? Quel était ce cri qui venait de retentir ?
Polyte avait donné tête baissée dans un piège.
Ce piège était à la fois tout ce qu’il y avait de plus ingénieux et de plus simple.
L’escalier qui tournait en colimaçon, passait au-dessus d’une sorte d’oubliette percée jusqu’à la cave. L’oubliette s’ouvrait par une trappe qui, étant fixe ou mobile, offrait une résistance ou basculait comme le plancher d’une potence, selon qu’on tirait un verrou qui lui servait de clavette et qui était dissimulé sous la dernière marche de l’escalier. La citoyenne avait échangé, on s’en souvient, un regard d’intelligence avec son mari et avait tiré la clavette.
Coclès avait dit à sa femme ces mots significatifs :
– Prends garde de te cogner dans l’escalier.
À quoi Mme Coclès avait répondu :
– J’ai fait réparer la marche qui ne tenait pas.
Et avant de s’enfermer dans sa chambre, elle avait tiré la clavette. On sait ce qui était arrivé.
* *
*
Coclès entra dans l’écurie.
Les deux Verduron ronflaient comme des orgues de cathédrale. Le canon ne les eût pas réveillés, comme avait dit Polyte.
Coclès donna une poignée d’avoine à son âne, le harnacha pendant qu’il la mangeait, puis il l’emmena sous le hangar, où il l’attacha à une de ces petites carrioles que les maraîchers des environs de Paris ont appelées des tapissières.
Pendant ce temps, Mme Coclès disait aux deux jeunes filles :
– Vous sentez bien, mes chères demoiselles, que je sais que vous allez vous cacher à Paris. Mais il faut noircir vos mains. Et puis vous avez encore trop l’air de ce que vous êtes. Connaissez-vous quelqu’un, au moins ?
– Non, dit Benoît.
Mme Coclès parut réfléchir.
– Écoutez, dit-elle, j’ai une sœur qui est une brave femme, et qui, pas plus que moi, n’aime la Révolution, quoique son mari fasse comme nous et crie à tue-tête : « Vive la République ! » Voulez-vous aller chez elle ?
Aurore et Jeanne se consultèrent du regard.
– Oui, dit enfin Aurore, j’ai confiance en vous.
– Et moi aussi, dit Benoît.
On entendit un coup de sifflet.
– C’est mon mari qui dit que la carriole est prête, dit Mme Coclès, venez.
Tous les quatre descendirent.
– Jean, dit Mme Coclès à son mari, tu mèneras ces demoiselles rue du Petit-Carreau.
– Chez ta sœur ?
– Oui.
– Ça va, dit Coclès.
Et il fit monter les deux jeunes filles dans la tapissière.
– Allons, mon garçon, dit-il à Benoît, il y a de la place pour toi.
– Oh ! non, répondit Benoît, j’aime mieux marcher, et j’irai toujours aussi vite que votre âne.
Coclès s’assit sur le brancard, prit les rênes, fit claquer son fouet, et la tapissière partit au trot du petit âne, qui était une robuste bête pleine de cœur.
– Pauvres enfants ! répéta la bonne citoyenne Coclès en rentrant, les larmes aux yeux, dans sa maison.
VIII
Le lendemain, vers deux heures de l’après-midi, le bourricaud et la tapissière apparurent dans l’éloignement.
Mme Coclès courut au-devant de son mari.
Celui-ci avait le visage calme et l’air souriant d’un homme qui a sa conscience en repos. Il avait sa tapissière pleine de légumes, car à cette époque les habitants de la banlieue de Paris allaient s’approvisionner aux halles.
– Eh bien ! lui demanda anxieusement la bonne femme.
– Tout va bien, répondit-il.
Puis, après un silence et comme son mari conduisait l’âne sous le hangar :
– J’ai eu une jolie peur qu’il ne nous vint des chalands toute la journée.
– Pourquoi donc ça ?
– Il aurait fallu descendre à la cave.
– Ah ! oui, dit Coclès, je comprends. Tu n’as rien entendu après mon départ ?
– Rien.
– Il se sera tué sur le coup ; mais il faut le faire disparaître, et le plus tôt sera le meilleur.
– Eh bien ! vas-y, dit Mme Coclès, je me charge de débarrasser l’âne de son harnais.
– Non, il faut que tu viennes avec moi pour m’éclairer.
Tous deux descendirent l’un après l’autre l’échelle de meunier qui conduisait à la cave. Cette cave était divisée en deux compartiments, mais la porte qui les séparait était ouverte. C’était dans le second caveau que donnait l’oubliette. C’était là qu’on devait trouver Polyte la tête et les membres brisés.
Coclès eut bien, lui aussi, un moment d’hésitation.
Mais il se donna du courage et entra, projetant en avant la réverbération de sa lanterne.
Soudain il jeta un cri.
Un cri terrible, plein d’étonnement et d’angoisse.
Le caveau était vide.
Un jour de souffrance pratiqué dans la voûte et grillé de deux barreaux de fer portait les traces de l’évasion de Polyte.
Polyte n’était pas mort, Polyte s’était sauvé en arrachant les barreaux de fer.
Et Coclès épouvanté s’écria :
– Femme ! femme ! il ne fait plus bon pour nous ici, il faut fuir… et fuir au plus vite !…
IX
Donc Polyte n’était pas mort.
Cependant il était tombé de vingt-cinq pieds de haut au moins. Mais Polyte était grand, mince, et dans cette chute au milieu des ténèbres, il avait eu la présence d’esprit de serrer ses coudes au corps, ce qui fait qu’il était tombé sur ses pieds d’abord, ce qui avait singulièrement amorti la secousse.
Néanmoins Polyte s’était évanoui. La tête avait porté après coup sur l’angle d’une poutre destinée à supporter des futailles, et il s’était meurtri le front.
L’évanouissement avait duré deux heures environ.
Mais il faisait froid dans la cave, et la bise aiguë qui soufflait à travers le soupirail finit par ranimer le vaurien.
Il se trouvait dans les ténèbres et ne savait où il était. Mais, chose, assez bizarre, avant d’avoir fait un mouvement, il avait retrouvé toute sa présence d’esprit. Son corps gisait encore inerte sur le sol humide de la cave, que sa mémoire se reportait au moment même de la catastrophe.
Il se rappelait parfaitement que Coclès lui avait dit : « Si le cœur t’en dit de monter chez les petites et de jeter le bossu par la fenêtre, ne te gêne pas ; mais tu peux y aller seul. »
Et Polyte était monté. Tout à coup le pied lui avait manqué, et il s’était senti tomber dans un abîme inconnu.
S’étant remémoré tout cela, maître Polyte essaya de se mettre sur ses jambes. Mais il éprouva une douleur si vive qu’un cri lui échappa.
Ce cri, Mme Coclès, enfermée dans sa chambre ne put l’entendre, bien qu’elle ne dormît pas.
Polyte comprit qu’il s’était, sinon cassé, au moins foulé quelque chose. Il s’était tordu le pied.
En même temps il porta la main à son front et la retira mouillée. Il avait le front ensanglanté.
Mais Polyte était un garçon de sang-froid. Il avait poussé un premier cri de douleur, mais il n’était pas homme à en laisser échapper un second.
Avec cette clarté d’intelligence que le gamin de Paris possède à un si haut degré, Polyte venait de faire le raisonnement suivant :
– Coclès a voulu se débarrasser de moi et il me croit mort. Si je crie, si je fais le moindre bruit, il trouvera bien le moyen de m’achever, et ce n’est pas mes deux amis qui me viendront en aide, car ils sont ivres-morts. Il faut donc que je me tire d’affaire tout seul, que je tâche de sortir d’ici, de prendre le large, et alors ce sera une petite partie que nous continuerons, le citoyen Coclès, son épouse et moi.
Polyte était vindicatif et il venait de faire le serment de mettre Coclès et sa femme au pied de l’échafaud. Le faubourien eut donc le courage stoïque de se soulever de nouveau en domptant l’atroce douleur qui l’étreignait.
Et comme il ne pouvait se tenir sur son pied foulé, il se traîna sur les genoux, tendant les mains devant lui, l’une après l’autre, afin de reconnaître le lieu où il était.
Alors Polyte fut fixé.
– Je suis dans la cave, se dit-il.
En même temps il lui sembla que ses yeux se faisaient à l’obscurité, et qu’une sorte de lueur blafarde le frappait au visage.
À force de regarder, Polyte finit par reconnaître le soupirail, garni de deux barreaux de fer, et, quoique la nuit fût noire au dehors, les ténèbres s’y trouvaient moins épaisses qu’à l’intérieur de la cave.
Souffrant horriblement, mais gardant un silence stoïque, Polyte se traîna jusqu’au-dessous du soupirail.
Puis il se hissa sur un tonneau. Et du tonneau par un effort désespéré et non sans une douleur atroce, il parvint à saisir les barreaux du soupirail.
La maison était vieille, les murailles humides, les barres de fer ne tenaient que pour la forme, et Polyte se mit à les secouer tant et si bien que la pierre qui formait l’entablement de la lucarne se détacha.
Ce fut un jeu pour lui d’arracher les deux barres de fer l’une après l’autre.
Quelques minutes après, sanglant, meurtri, épuisé, il se trouva hors de la cave et en plein air.
Alors, comme ses forces étaient épuisées, il se coucha un moment sur le dos, et tint de nouveau conseil avec lui-même.
Tout à coup sa main se posa sur quelque chose qui était dur et froid au toucher et qui gisait au bord de la route, à trois pas du hangar. D’abord il crut que c’était une pièce de monnaie, un écu de six livres par exemple, car cet objet était rond. Puis, l’examinant avec plus d’attention, il lui sembla que ce pouvait être un médaillon, une peinture entourée d’un petit cadre d’or.
Polyte glissa dans sa poche cet objet que l’obscurité l’empêchait de bien définir et continua à s’éloigner de la maison. Il fit ainsi trois ou quatre cents pas en une heure.
La route était bordée d’arbres et de haies.
Quoiqu’il fût épuisé, Polyte parvint à franchir le fossé et à se blottir sous des broussailles.
Là, ses forces le trahirent et il s’évanouit de nouveau.
Mais le froid piquant de la nuit l’eut bientôt ranimé.
L’eau qui remplissait le fossé apaisa sa soif ardente qui le tourmentait, et il se remit en marche.
Et comme il se traînait toujours droit devant lui, à la façon d’un reptile, car il lui était impossible de se tenir debout ; un bruit se fit dans le lointain, du côté de Paris, puis une lueur brilla, et Polyte finit, par distinguer les deux lanternes d’une voiture qui arrivait bon train vers lui.
Un premier mouvement de crainte fit songer à se ranger au bord du fossé ; mais la précipitation qu’il mit à exécuter cette manœuvre lui arracha un cri de douleur, et il tomba sur son pied si malheureusement qu’il faillit, s’évanouir encore.
La voiture arrivait au grand trot de deux robustes chevaux.
– Gare ! cria le cocher en voyant un homme étendu au milieu de la route.
Et comme l’homme ne se dérangeait pas assez vite, il fut obligé de rassembler ses chevaux qui se cabrèrent. Le cocher lâcha un juron. Une femme mit la tête à la portière et dit avec effroi.
– Qu’y a-t-il donc ?
– C’est un ivrogne, répondit le cocher.
Polyte jeta un cri déchirant.
– C’est un homme blessé, dit la femme, arrêtez donc !
Le cocher avait fini par maîtriser ses chevaux.
La femme qui se trouvait dans la voiture mit alors pied à terre et s’approcha de Polyte.
– Ah ! citoyenne dit celui-ci d’un ton lamentable, prenez pitié d’un pauvre patriote qui s’est cassé la jambe.
Une autre femme était également descendue de la voiture. À en juger par son costume, c’était « l’officieuse » de la première.
La République avait supprimé les domestiques, mais elle permettait les « officieux », ce qui était absolument la même chose.
Les deux femmes prirent donc Polyte à bras-le-corps et le transportèrent dans la voiture.
Le cocher grommelait, pendant ce temps, sur son siège.
– Qu’allons-nous en faire ? demanda l’officieuse.
– Le transporter à la maison d’abord, répondit l’autre femme.
– Vous êtes de bonnes patriotes, répétait Polyte.
En même temps, comme la clarté des lanternes se projetait de la voiture, Polyte tira de sa poche l’objet qu’il avait trouvé sur la route.
Or, cet objet n’était autre qu’un médaillon.
Et ce médaillon, c’était le portrait de sa mère Gretchen, qu’Aurore portait au cou et qui s’était détaché comme elle montait dans la tapissière auprès de Coclès.
Et Polyte, stupéfait, crut reconnaître en ce médaillon Jeanne, la plus jeune des deux aristocrates.
– Qu’est-ce que cela ? dit la femme qui venait de le prendre dans sa voiture.
Elle lui arracha le médaillon des mains, et à son tour y jetant les yeux, elle étouffa un cri d’étonnement et regarda Polyte avec une anxieuse curiosité.
X
Qu’était-ce que cette femme qui osait voyager en carrosse au mois de février 1793, un mois après la mort du roi, alors que la France entière tremblait et que chacun avait peur d’être dénoncé comme aristocrate ? Car ce n’était pas une vulgaire voiture de place, mais bien un carrosse à deux chevaux qui avait failli écraser Polyte.
Le cocher ne portait pas de livrée apparente.
Mais il avait ses vêtements taillés comme le sont ceux des domestiques de bonne maison.
Les chevaux étaient fringants, bien harnachés, et on se demandait comment un tel équipage avait osé traverser Paris et en sortir.
Cependant la personne qui avait recueilli Polyte et l’avait fait placer sur les coussins du devant de la voiture ne paraissait nullement inquiète.
C’était une femme entre deux âges, plus près de quarante cinq ans que trente, petite, un peu contournée et le visage aussi brun qu’une olive. Elle avait de grands yeux noirs qui achevaient de donner un reflet étrange à sa physionomie, mélange de dureté et de douceur, de calme et d’hypocrisie. Elle avait de gros diamants aux oreilles, des bagues de prix à tous les doigts, et sa robe de soie aux couleurs voyantes semblait un défi porté à tous ceux qui dénonçaient les aristocrates.
Mais ceux qui se fussent trouvés à la barrière d’Enfer au moment où le carrosse s’y était présenté pour sortir eussent été bien plus étonnés encore que ne l’était Polyte, en présence de ce luxe tapageur et de mauvais goût.
Le cocher avait demandé la porte d’un ton insolent.
Un officier de municipaux était sorti du poste, le sourcil froncé à la vue de ce carrosse, et il avait voulu gourmander l’automédon, fouiller la voiture et faire subir un interrogatoire à la dame qui s’y trouvait.
Celle-ci lui avait ri au nez :
– Citoyen capitaine, lui avait-elle dit, on voit bien que vous ne savez pas à qui vous avez affaire, et vraiment c’est là votre excuse, car vos façons avec moi pourraient vous coûter cher.
Sur ces mots, elle avait tiré de son sein un papier qu’elle avait mis sous les yeux du municipal stupéfait.
Celui-ci s’était confondu en excuses, avait supplié la citoyenne de lui pardonner, fait ouvrir la porte à deux battants et poussé la civilité et la complaisance jusqu’à offrir une escorte à cette mystérieuse et puissante personne.
Celle-ci avait répondu à cette offre par un nouvel éclat de rire :
– Non, non, citoyen capitaine, avait-elle dit, je ne crains absolument rien. D’ailleurs je vais à trois lieues d’ici à Palaiseau, dans ma maison de campagne. Bonsoir, rentrez dans votre poste et prenez garde de vous enrhumer.
La mystérieuse personne avait donc continué son chemin en compagnie de son officieuse, une jolie soubrette non moins insolemment vêtue que sa maîtresse, jusqu’à l’endroit où nous l’avons vue recueillir le faubourien Polyte.
Donc, celui-ci, à peine installé dans le carrosse, avait tiré de sa poche un médaillon qui représentait la mère d’Aurore et de Jeanne.
On se souviendra, si on se reporte à la première partie de cette histoire, que Jeanne était la vivante image de sa mère, et qu’Aurore, en trouvant ce médaillon dans la cassette qui renfermait le testament de Gretchen, n’avait pas hésité à reconnaître sa sœur dans la jeune fille élevée par le forgeron de la Cour-Dieu.
Or donc, tandis que Polyte, en vrai gamin de Paris qui se soucie des convenances aussi médiocrement que possible, oubliait de remercier la dame inconnue pour tirer le médaillon de sa poche et savoir ce que c’était, celle-ci le lui prenait des mains, y jetait les yeux et manifestait une subite émotion.
– Qu’est-ce que cela ? dit-elle.
– Ça, dit Polyte, je viens de le trouver sur la route.
– Ah !
– Mais je sais d’où ça vient.
Et il reprit le médaillon et se mit à l’examiner sans façon.
– Ah ! vous savez d’où ça vient ? reprit la dame toujours émue.
– Pardieu ! c’est le portrait d’une des petites.
La dame tressaillit encore.
– Qu’est-ce cela, les petites ? fit-elle.
– C’est les deux jeunes filles que Coclès a sauvées ; mais il ne les sauvera pas longtemps. Ah ! ah ! Polyte est là, citoyenne, soyez tranquille.
La dame inconnue avait sans doute une grande connaissance du cœur humain, car elle tira une bourse de sa poche, y prit deux pièces d’or à l’effigie de l’ex-tyran et les tendit à Polyte :
– Mon ami, lui dit-elle, vous me paraissez savoir des choses qui m’intéressent jusqu’à un certain point. Prenez cela et parlez.
Polyte ne se le fit pas répéter. Il tendit la main et les deux pièces d’or disparurent dans la poche de côté de son bourgeron bleu.
– Tiens ! tiens ! dit-il, est-ce que vous connaîtriez ces deux particulières ?
– J’en connais une toujours, dit la dame, celle qui ressemble à ce portrait. Comment donc est l’autre ?