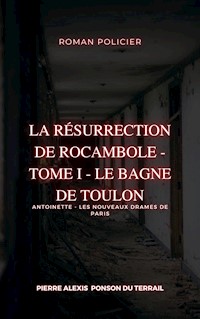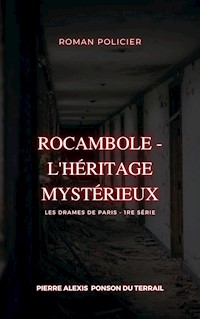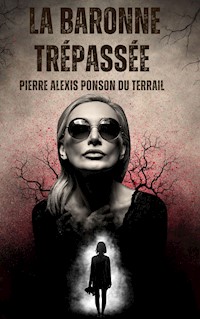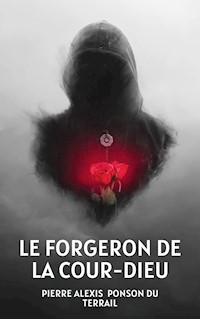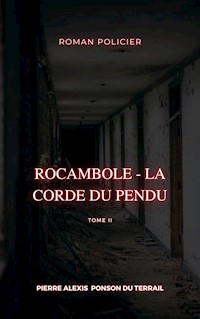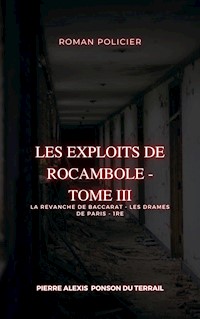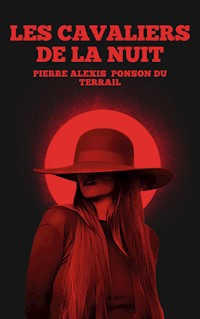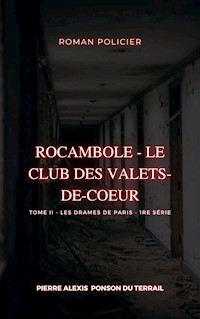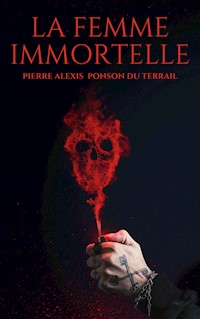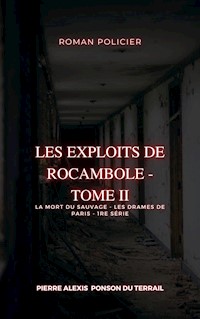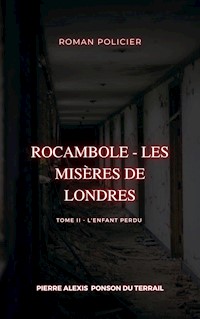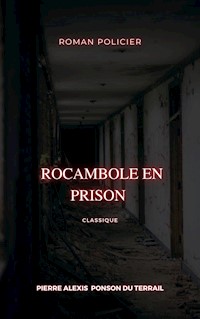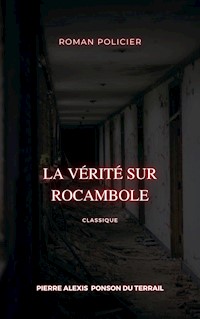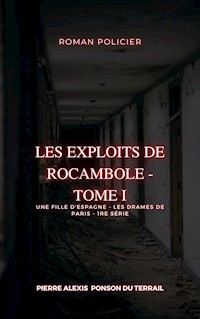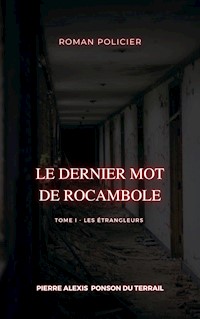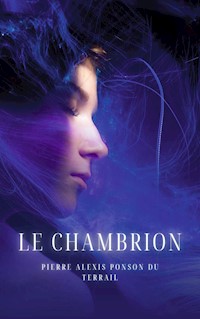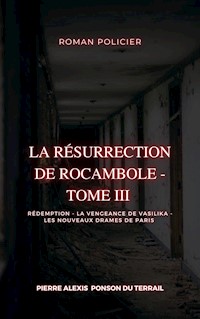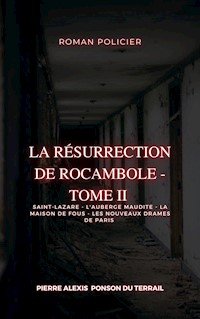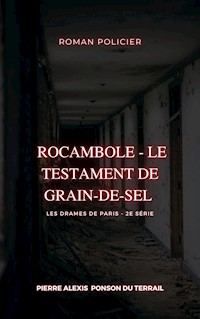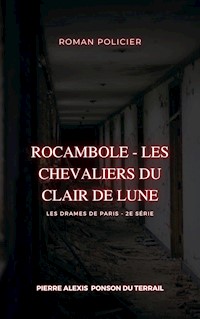
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Résumé de l'histoire dans le synopsis des aventures de Rocambole.
Das E-Book Rocambole - Les Chevaliers du Clair de Lune wird angeboten von Books on Demand und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
littérature française, Classique, AVENTURES, roman policier, Mystères
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 684
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pierre Alexis Ponson du Terrail
LES CHEVALIERS DU CLAIR DE LUNE
La Patrie – 17 avril au 7 octobre 1860 – 58 épisodes
J. Rouff – Volume II – 1884
Table des matières
LE MANUSCRIT DU DOMINO
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
LA DERNIÈRE INCARNATION DE ROCAMBOLE
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
Mentions légales
LE MANUSCRIT DU DOMINO
I
Minuit venait de sonner à toutes les horloges du boulevard des Italiens.
C’était en janvier 1853, un samedi, jour de bal à l’Opéra. Il faisait un froid sec, le ciel était pur, la lune brillait de tout son éclat.
Le boulevard était peuplé comme en plein soleil, les équipages se croisaient au grand trot, les piétons encombraient les trottoirs, les dominos et les masques de toute espèce circulaient joyeusement à travers la foule.
C’était l’heure où l’Opéra, couronné d’une guirlande de feu, ouvrait ses portes, l’heure où l’orchestre aux cent voix de Musard faisait entendre son premier coup d’archet.
Assis devant le café Riche, au coin de la rue Le Peletier, deux jeunes gens causaient, chaudement enveloppés dans leur vitchoura doublé de martre zibeline, à deux pas de leur poney-chaise, dont le magnifique trotteur irlandais était maintenu à grand-peine par un groom haut de trois pieds et demi, vêtu d’un pardessus bleu de ciel à large collet de renard, et chaussé de petites bottes plissées à revers blancs.
– Mon cher Gontran, disait l’un des jeunes gens, tu as une singulière fantaisie de vouloir m’entraîner au bal de l’Opéra, un véritable mauvais lieu où on ne va plus depuis quinze ans au moins, et où on ne rencontre que des femmes qui ne sont plus du monde, ou qui n’en ont jamais été.
– Mon cher Arthur, répondit l’autre, as-tu lu beaucoup de romans ?
– Pas mal.
– Tous les romans commencent au bal de l’Opéra : ceux qu’on écrit et qu’on invente, d’abord ; ceux qui se déroulent à travers la vie réelle, ensuite.
– La théorie est singulière !
– Elle est vraie.
– Est-ce que tu comptes nouer le premier chapitre d’une histoire de ce genre, ce soir ?
– Peut-être.
– Tu as un rendez-vous ?
– Oui.
– Avec qui ?
– Je ne sais pas. Lis plutôt.
Celui à qui son ami donnait le nom de Gontran tira de sa poche un petit portefeuille en maroquin couleur jonquille, et, de ce portefeuille, une lettre assez volumineuse et sans signature qu’il tendit à son ami le vicomte Arthur de Chenevières.
Celui-ci la déplia lentement, se fit apporter une bougie, et, avant de lire, il fit cette réflexion :
– L’écriture a son esprit ni plus ni moins que les hommes. Telle ronde ferme et pleine dénote le caractère d’un homme froid, calme, résolu. Une cursive allongée, un peu tremblante, trahit généralement une main de femme légèrement émue. La femme qui écrit à sa modiste ou à son homme d’affaires a une écriture toute différente si elle donne un premier rendez-vous à l’homme qu’elle aime…
– Ceci est vrai, mon ami.
– Or, poursuivit Arthur de Chenevières, la main qui a tracé cette lettre est évidemment une main de femme.
– Parbleu !
– Mais elle ne tremblait pas.
– En effet.
– Donc, tu n’es pas aimé.
Le baron Gontran de Neubourg se prit à sourire.
– Lis, dit-il, et tu verras qu’il n’est nullement question d’amour entre mon correspondant anonyme et moi.
Arthur lut à mi-voix :
« Un soir du mois de décembre de l’année dernière, c’est-à-dire il y a six semaines environ, le baron Gontran de Neubourg rencontra sur le boulevard, en face du café Anglais, trois de ses amis qui fumaient leur cigare au clair de lune, en sortant de leur club, où ils avaient joué gros jeu.
« Ces trois amis étaient M. le vicomte Arthur de Chenevières, lord Blakstone et le marquis Albert de Verne. »
– Bon ! s’interrompit Arthur, ceci est assez bizarre, et ce début m’a tout l’air d’un premier chapitre de feuilleton.
– Continue, dit le baron.
M. de Chenevières poursuivit :
« Le baron Gontran de Neubourg s’en allait seul et rêveur, et si ses amis ne l’eussent abordé, nul doute qu’il eût passé sans les voir.
« – Où vas-tu, baron ? dit le vicomte.
« – Nulle part.
« – Mais encore ?
« – Je me promène.
« – Sans but ?
« – Je rêve… c’est beaucoup. Bonsoir, messieurs ; d’où venez-vous ?
« – Du club.
« – Où allez-vous ?
« – Nous nous promenons. Seulement, au lieu de rêver, nous causons.
« – De quoi causez-vous ?
« – Lord Blakstone prétend qu’il a le spleen.
« – Lord Blakstone a raison : il est Anglais, le ciel est clair. Un Anglais sans brouillard est un corps sans âme.
« – De Verne, poursuivit le vicomte, s’ennuie. Il se contente de traduire le mot.
« – Et toi ? demanda le baron.
« – Je fais comme de Verne.
« – Messieurs, dit alors le baron, le plus vieux d’entre nous a trente ans, c’est moi ; le plus jeune vingt-quatre, c’est Arthur ; le plus pauvre a cent mille livres de rente, c’est moi ; le plus riche cent cinquante mille livres sterling de revenus, c’est lord Blakstone.
« – Exact ! fit l’Anglais avec flegme.
« – Or, reprit le baron, nous avons la même existence, et l’on peut établir ainsi la mesure de chacune de nos journées :
« Nous nous levons à onze heures, nous déjeunons à midi. À deux heures on nous voit au Bois, moi et toi à cheval, lord Blakstone dans son poney-chaise, de Verne dans son phaéton. À cinq heures nous jouons au whist ; de neuf à onze heures du soir, on nous rencontre à l’Opéra ; de onze heures à minuit dans deux ou trois salons du faubourg Saint-Germain ou de la rue d’Anjou-Saint-Honoré, et nous allons finir notre nuit au club, pour recommencer le lendemain.
« – Et les jours suivants, dit le marquis de Verne, qui s’était tu jusqu’alors.
« – Or, reprit Gontran, de Verne est le fils de ce brillant général de cavalerie qui s’immortalisa pendant la retraite de Russie ; toi, vicomte, tu comptes des aïeux aux croisades, et lord Blakstone est le descendant d’un chef de clan écossais qui tint Robert Bruce et toute son armée en échec dans son vieux manoir des monts Cheviot, avec une garnison de bergers et de laboureurs.
« – Et toi, ajouta le vicomte, toi, mon cher Neubourg, tu es de race palatine, et ton bisaïeul s’est établi en France à la suite de la fameuse guerre de Trente ans. Un de tes ancêtres est entré seul, le heaume en tête et l’épée au poing, dans la ville de Mayence, où il a cloué son gant sur la porte du prince Frédéric de Prusse.
« – C’est vrai, dit simplement le baron. »
Le vicomte de Chenevières interrompit sa lecture une seconde fois et dit au baron Gontran de Neubourg :
– Ton correspondant anonyme est une femme de tes amies, mon cher, et tu lui auras donné tous ces détails qui sont, du reste, d’une rigoureuse exactitude.
– Je n’ai parlé à qui que ce soit de notre conversation, et je te jure, répondit M. de Neubourg, que l’écriture de cette lettre m’est complètement inconnue.
– Poursuis donc.
Le vicomte reprit :
« Les quatre jeunes gens se regardèrent silencieusement pendant quelques minutes.
« – Messieurs, dit enfin le baron Gontran de Neubourg, savez-vous que je me trouve fort mal à l’aise en mes habits étriqués, qui ressemblent si peu à la cuirasse de nos ancêtres, que j’étouffe en ce siècle d’argent et d’égoïsme où nous vivons, et que je regrette sincèrement la Table-Ronde et ses douze chevaliers ?
« – Moi aussi, dit le marquis de Verne.
« – Je pense comme vous, ajouta le vicomte de Chenevières.
« – Et moi, dit lord Blakstone, je crois à de certains moments que je suis mon propre ancêtre, et que c’est moi qui ai défendu le manoir de Galwy contre Robert Bruce.
« – Hélas ! messieurs, continua le baron, que vous dirai-je ! le temps des chevaliers errants est passé. Si les paladins du Moyen Âge, les Renaud, les Olivier, les Roland revenaient en ce monde, ils verraient que la police correctionnelle s’est chargée de punir les méchants, et que les avocats ont la prétention de défendre la veuve et l’orphelin.
« Qu’en faut-il conclure ?
« Une simple chose : c’est que des gens comme nous, jeunes, riches, braves, de bonne race, qui, en un siècle moins ingrat, eussent fort bien utilisé leur intelligence, leur fortune, leur noblesse et leur bravoure, sont condamnés à perpétuité au whist à un louis la fiche, et à la promenade à cheval au Bois.
« Et cependant, messieurs…
« Ici le baron de Neubourg s’arrêta et parut réfléchir profondément.
« Puis, regardant le vicomte :
« – As-tu lu l’Histoire des treize ?
« – Parbleu !
« – Les treize, poursuivit le baron, sortirent armés de pied en cap du cerveau de M. de Balzac, et ils se répandirent à travers le monde, unis par un serment qui se résumait en un mot : S’entraider. Après Balzac on a imaginé, plus ou moins ingénieusement, une foule d’associations. Mais tous ces gens-là étaient des bandits, ils volaient, ils tuaient, ils assassinaient…
« – Où diable veut-il en venir ? demanda lord Galwy.
« – Eh bien ! messieurs, reprit Gontran de Neubourg, il me vient une fort belle idée.
« – Voyons !
« – Nous sommes quatre, quatre amis, quatre hommes d’honneur, dont le seul crime est de s’ennuyer profondément ; je vous propose de fonder à nous quatre l’association des nouveaux chevaliers de la Table Ronde. Nous serons, en plein dix-neuvième siècle, de mystérieux redresseurs de torts, de pieux chevaliers de l’infortune, d’implacables ennemis de l’injustice. Cherchons une victime intéressante, un de ces êtres, homme ou femme, dépossédés, dépouillés, foulés aux pieds, et relevons-le.
« – Baron, dit lord Blakstone avec son flegme habituel, je suis de votre avis, et vous me voyez tout prêt à entrer dans votre association. Mais…
« Le mais de lord Blakstone était gros d’objections.
« – Voyons ? fit M. de Neubourg.
« – Mais le jour seulement où vous aurez trouvé de la besogne à cette association…
« – Je chercherai, et, comme dit l’Écriture, je trouverai !
« Le jour naissait. Les quatre jeunes gens, qui s’étaient longtemps arrêtés à la même place et n’avaient point pris garde à un homme couché de tout son long sur un banc, échangèrent une poignée de main et se séparèrent.
« Maintenant, si M. de Neubourg veut savoir pourquoi on lui rappelle ces détails, qu’il aille ce soir samedi au bal de l’Opéra. Peut-être y trouvera-t-il l’être victime qu’il cherche.
« Dans ce cas, il écrira à ses trois amis, le marquis de Verne, lord Blakstone et le vicomte de Chenevières. »
La lettre s’arrêtait là, et n’avait pas de signature.
– Tu as raison, dit le vicomte en riant, voilà le premier chapitre d’un roman.
– En effet…
– As-tu écrit à de Verne ?
– Sans doute.
– Et tu lui as donné rendez-vous ?
– Au foyer, à une heure du matin, ainsi qu’à lord Blakstone.
– Parfait.
– Eh bien ! allons, en ce cas.
– Soit, allons !
M. de Neubourg renvoya son poney-chaise et prit le bras du vicomte.
Comme les deux jeunes gens avaient dîné ensemble, le baron avait dit simplement au vicomte Arthur de Chenevières :
– Ne dispose point de ta soirée, j’ai besoin de toi.
La salle de l’Opéra avait été envahie depuis une demi-heure environ par cette cohorte bariolée, hurlante, en délire, qui fait trembler sa voûte et frémir son vaste plancher à chaque bal du samedi.
M. de Neubourg et le vicomte se glissèrent à travers la foule, se donnant le bras pour ne point se perdre, et ils gagnèrent ainsi le foyer.
– Ah çà, dit le vicomte, il me semble que ton correspondant anonyme ne t’indique aucun endroit de rendez-vous ?
– C’est vrai.
– Et ne te donne aucun moyen de le reconnaître ?
– C’est vrai encore.
– Mais, ajouta M. de Chenevières, il te connaît, du moins il t’a vu, et vraisemblablement il t’abordera.
Comme le vicomte de Chenevières émettait cet avis, le baron se sentit frapper légèrement sur l’épaule.
M. de Neubourg allait se retourner, mais une voix de femme lui dit à l’oreille :
– Quittez votre ami, et allez attendre au foyer, sous l’horloge.
On avait parlé si bas à l’oreille de M. de Neubourg que le vicomte de Chenevières n’avait rien entendu.
– Écoute, vicomte, dit le baron, il pourrait se faire que l’on hésitât à m’aborder si nous ne nous quittions.
– Veux-tu que je te laisse ?
– Oui.
– Où nous retrouverons-nous ?
– Dans la salle, près de l’orchestre.
– C’est bien, à tantôt.
Quand le vicomte eut quitté le foyer, le baron Gontran de Neubourg se dirigea vers l’endroit qu’on venait de lui indiquer, non sans murmurer toutefois :
– Il est une chose assez bizarre, c’est que tous les rendez-vous qui se donnent à l’Opéra sont indiqués sous l’horloge.
Et le baron de Neubourg, arrivé en cet endroit du foyer, s’assit et attendit.
Il y était depuis cinq minutes environ, lorsqu’un domino s’approcha de lui et lui dit :
– Baron, voulez-vous m’offrir votre bras ?
M. de Neubourg reconnut la voix qu’il avait entendue tout à l’heure. Il se leva avec empressement et offrit son bras.
– Sortons de cette foule, dit le domino, et tâchons de trouver un lieu où nous puissions causer.
– Venez, madame, dit le baron.
M. de Neubourg conduisit l’inconnue à l’extrémité du foyer, où la foule était moins compacte. Là, elle s’assit et lui dit :
– Vous allez réunir vos amis cette nuit même.
– En quel lieu, madame ?
– Où vous voudrez, pourvu que je le sache.
– Eh bien ! dans un cabinet de la Maison-d’Or.
– Soit ! dit le domino.
Puis il tira un rouleau de papier soigneusement cacheté et noué par une faveur bleue.
– Quand vos amis seront réunis, poursuivit l’inconnue, vous ouvrirez ce manuscrit et leur en ferez la lecture.
– Après, madame ?
– Cette lecture terminée, si la femme dont ce manuscrit renferme l’histoire vous intéresse à ce point que vous la jugiez digne de vous faire ressusciter le serment et les exploits des chevaliers de la Table ronde, vous ouvrirez la fenêtre du salon où vous vous trouverez…
– Ah ! dit le baron.
– Et vous me verrez apparaître au milieu de vous quelques minutes après. Dans le cas contraire…
Le domino parut hésiter.
– J’écoute, madame, dit M. de Neubourg.
– Dans le cas contraire, ajouta-t-elle, vous jetterez le manuscrit au feu, et vous vous ferez réciproquement le serment de ne jamais rien révéler de ce que vous aurez lu.
– Je vous le jure par avance, pour eux et pour moi, madame.
– Je vous crois. Adieu, monsieur, sinon au revoir.
Le domino tendit au baron Gontran de Neubourg une petite main gantée avec soin, s’esquiva et disparut dans la foule.
Alors Gontran se mit à la recherche de ses trois amis.
Il trouva le vicomte Arthur de Chenevières dans la salle, près de l’orchestre, le marquis de Verne et lord Blakstone assis dans une loge de pourtour.
– Messieurs, dit-il, je ne vous ai donné rendez-vous ici que pour vous inviter à souper.
– Singulière idée ! murmura le marquis.
– Jolie ! ajouta lord Blakstone, qui était légèrement sensuel.
*
* *
Quelques minutes plus tard, les quatre amis étaient à table et Gontran leur disait encore :
– Messieurs, je vous ai donné rendez-vous à l’Opéra afin de vous inviter à souper ; je vous invite à souper afin de vous lire le manuscrit que voici.
Gontran tira de sa poche le rouleau de papier que lui avait remis le domino et le déplia.
– Messieurs, poursuivit-il, il y a deux jours que nous nous plaignions amèrement de vivre en un siècle prosaïque où les paladins de la Table Ronde n’auraient plus qu’à se croiser les bras.
– C’est vrai, murmura lord Blakstone.
– Eh bien ! reprit le baron, quand nous aurons pris connaissance de ce manuscrit, nous verrons peut-être que nous nous sommes trompés.
– Bah ! fit le marquis.
– Oh ! dit lord Blakstone d’un air incrédule.
– Messieurs, ajouta M. de Chenevières, avant de prendre connaissance du manuscrit, priez donc Gontran de vous lire la lettre qui lui a été adressée.
– Quelle lettre ?
– La voici.
M. de Neubourg tendit la lettre à M. de Verne, qui la lut tout bas à lord Blakstone.
– Et, dit-il lorsqu’il eut terminé, tu as vu le domino ?
– Je le quitte. Il m’a remis son manuscrit ; si vous le voulez bien, nous allons en prendre connaissance.
– Voyons ! dirent les trois jeunes gens.
M. le baron Gontran de Neubourg sonna et dit au garçon :
– Vous ne viendrez que lorsque je sonnerai.
Le garçon s’inclina et sortit.
Alors Gontran lut à haute voix les pages suivantes.
II
La pluie, fouettée par le vent du nord, tombait à torrents sur les grands bois qui s’étendent entre la Vendée et le Poitou.
C’était en 1832, après la révolution de Juillet, c’est-à-dire à la fin du mois d’octobre.
Un cavalier courait à fond de train à travers les halliers, sautant les fossés, passant au milieu des broussailles et dirigeant à travers les mille obstacles de ces vastes forêts sa petite jument bretonne pleine d’ardeur.
– Hop ! hop ! hop ! ma belle Clorinde, disait-il, tu connais le chemin, tu l’as fait bien souvent déjà ; mais il faut arriver, arriver le plus tôt possible…
Malgré la pluie, malgré le vent, malgré la nuit qui était sombre, Clorinde galopait avec furie.
Clorinde était une belle petite pouliche à la robe blanche, à la crinière ardoisée, – chose rare ! – dont le sabot vaillant et dur résonnait sur la lande comme une baguette de tambour. Clorinde avait une petite tête fine, intelligente, avec de grands yeux pleins d’ardeur et des naseaux fumants.
Clorinde avait des jambes fines comme le fuseau d’une vieille femme, flexibles comme l’osier des marais, dures et fortes comme du fer.
Le cavalier qui la montait et qui pressait ses flancs avec une fébrile impatience était un jeune homme de vingt-sept à vingt-huit ans, dont le visage rosé et les mains blanches eussent trahi, au premier regard, des habitudes féminines, si son œil noir plein de feu et la crosse luisante des pistolets passés à sa ceinture n’eussent dit éloquemment qu’il avait l’âme d’un homme et le cœur d’un soldat.
En outre, il portait au flanc un sabre de cavalerie, et sa selle était munie d’un talon dans lequel s’emboîtait un fusil de chasse à deux coups.
Cependant, ce jeune homme, en dépit de cet appareil guerrier, ne portait aucun uniforme.
Sa tête était entourée d’un mouchoir blanc, jaspé çà et là de quelques gouttes de sang ; une veste rouge, comme en portaient les paysans vendéens, des braies bleues et une paire de grandes bottes à l’écuyère complétaient son costume.
– Hop ! Clorinde, hop ! ma belle fille, répétait-il, nous sommes loin encore du château de Bellombre… et la nuit s’avance… Et Diane m’attend !
Clorinde, comme si elle eût compris la voix de son maître, précipitait son galop et passait comme un rêve sous la futaie.
Tout à coup un bruit étrange se fit entendre : c’était un cri glapissant, comme le houhoulement d’un oiseau de nuit.
Le cavalier rassembla sa vaillante bête, et Clorinde s’arrêta court.
Puis il prêta l’oreille.
Le houhoulement se reproduisit.
Alors le jeune homme appuya les deux doigts sur sa bouche et fit entendre un coup de sifflet modulé d’une façon particulière.
Un coup de sifflet identique lui répondit dans le lointain.
On eût dit un écho perdu dans les bois.
Le cavalier rendit la main à Clorinde, qui se précipita d’elle-même dans la direction du second coup de sifflet.
Elle courut environ dix minutes ; puis, soudain, le houhoulement fut répété.
Clorinde s’arrêta de nouveau.
On vit alors se dresser une forme noire du milieu des broussailles ; puis cette forme, homme ou fantôme, fit deux pas en avant :
– Est-ce vous, monsieur Hector ? dit une voix.
– Est-ce toi, Grain-de-Sel ?
– C’est moi, monsieur Hector.
Et la forme noire s’approcha et posa la main sur la bride de Clorinde.
Le cavalier put alors distinguer, malgré l’obscurité, un jeune garçon d’environ quinze ans, à peu près vêtu comme lui, avec cette différence qu’il portait la braie blanche et la veste bleue, et qu’au lieu d’un mouchoir il avait sur la tête un large chapeau de feutre noir, de la coiffe ronde duquel s’échappait une longue chevelure brune en désordre.
– Bonjour, monsieur Hector, dit-il.
– Bah ! mon pauvre Grain-de-Sel, répliqua celui-ci, tu pourrais dire bonsoir.
– Pardon, monsieur le comte…
– Veux-tu te taire, imbécile !
– Excusez-moi, pardon, monsieur Hector, il est une heure du matin.
– Déjà ?
– Les heures vont vite quand on est pressé, répondit avec mélancolie le jeune paysan poitevin.
– En ce cas, bonjour, Grain-de-Sel, mon ami.
– Bonjour, monsieur Hector.
– Je m’attendais presque à te trouver en chemin.
– Ah ! fit le jeune paysan ; tant mieux alors, monsieur Hector.
– Pourquoi tant mieux ?
– Parce que vous savez la nouvelle, sans doute ?
– Quelle nouvelle ?
– Les bleus sont à trois lieues d’ici, murmura Grain-de-Sel avec une mélancolie nuancée d’une sourde irritation.
– Je ne le savais pas, répondit le cavalier d’un ton calme, mais je m’y attendais. On veut nous envelopper. Où sont-ils ?
– À Bellefontaine, le prochain village.
– Très bien !
– Et c’est pour cela que madame Diane m’a envoyé vers vous, monsieur Hector. On dit que les bleus lèveront le camp cette nuit et qu’ils seront à Bellombre avant le jour. Madame Diane a peur…
– Peur de quoi ?
– Mais, monsieur Hector, dit Grain-de-Sel, vous savez bien que si les bleus vous trouvaient…
Le cavalier eut un fin sourire dans sa moustache blonde et caressa de la main le pommeau de ses pistolets.
– Tu ne vois donc pas mes bassets ? dit-il.
– Oh ! je les vois bien, monsieur Hector.
– Ils ne donnent qu’un coup de voix, ajouta le jeune homme, continuant la comparaison cynégétique, mais il est sûr.
– C’est égal, monsieur Hector, fit Grain-de-Sel, à votre place, je me méfierais et je tournerais bride… et je retournerais vers Pouzauges.
Le cavalier haussa les épaules.
– Mon pauvre Grain-de-Sel, dit-il, tu n’as que quinze ans et tu n’as pas encore un amour au cœur. Tiens, vois-tu, la nuit est sombre, n’est-ce pas ?…
– Comme un four, monsieur Hector.
– Eh bien ! je vois là-bas, à travers les ténèbres, un filet de fumée qui monte dans le ciel noir et qui est encore plus noir que lui. C’est la fumée de Bellombre… et mon cœur bat. Comprends-tu ?
– Oh ! monsieur Hector, dit le jeune paysan poitevin, si vous aviez vu pleurer madame Diane… Si vous saviez… comme elle a peur !
– Elle est femme, dit simplement Hector, ça se comprend.
– C’est vrai tout de même, ce que vous dites là, monsieur Hector ; mais…
– Mais, Grain-de-Sel, mon ami, répliqua le jeune cavalier d’un accent affectueux et triste, si tu n’as jamais aimé d’amour une femme, au moins tu aimes ta mère ?
– Si je l’aime ! s’écria Grain-de-Sel.
– Eh bien ! suppose que tu es à ma place, monté sur Clorinde, et que ta mère est à Bellombre tandis que les bleus sont à Bellefontaine, et que les bleus te fusilleront s’ils te prennent… est-ce que tu n’irais pas à Bellombre ?
– Ah ! mais si, j’irais !… s’écria l’enfant, dont l’œil brilla comme un charbon ardent.
– Eh bien ! acheva Hector, je n’ai plus ni père ni mère, et madame Diane a remplacé tout cela pour moi. Comprends-tu ?
– Je comprends, dit Grain-de-Sel pensif.
– Donc, poursuivit Hector, en route ! Quand nous aurons atteint la clôture du parc, tu garderas Clorinde.
– Allons ! dit Grain-de-Sel.
– Saute-moi en croupe. Clorinde a les reins solides, elle nous portera bien tous les deux.
– Oh ! ce n’est pas la peine, monsieur Hector, je cours aussi vite qu’elle. Hop ! Clorinde.
Et, tandis que le cavalier poussait sa monture et reprenait sa course à travers les taillis, Grain-de-Sel se mit à bondir à côté d’elle avec la légèreté d’un chevreuil, et le cavalier et le piéton, dévorant l’espace, continuèrent à causer.
– Les bleus s’imaginent, disait Hector, qu’ils vont entrer dans le Bocage comme ils sont entrés en Touraine et en Poitou. Mais le Bocage est couvert de bois, coupé de rivières, semé d’étangs ; il y a un canon de fusil derrière chaque broussaille, et les deux régiments qui sont venus du côté de Nantes seront tout à l’heure anéantis.
– Il paraît qu’ils sont nombreux du côté de Bellefontaine.
– Combien sont-ils ?
– Il y a trois escadrons de chasseurs et un de hussards.
À ce dernier mot, le jeune cavalier tressaillit.
– Es-tu sûr de ce que tu dis là, Grain-de-Sel ?
– Oui, monsieur Hector. Il y a aussi un régiment d’infanterie.
– Mais ces hussards, sais-tu leur numéro ? sais-tu d’où ils viennent ?
– Ce sont ceux qui étaient à Poitiers l’année dernière. C’est le général, le père de madame Diane qui l’a dit.
Hector poussa un cri de douleur.
– Mon ancien régiment ! murmura-t-il ; vais-je donc faire le coup de pistolet avec mes pauvres camarades !
Et il donna un furieux coup d’éperon à Clorinde, dont les naseaux fumaient et dont les flancs ruisselaient de pluie et de sueur.
Tout à coup Clorinde s’arrêta.
Elle venait d’arriver à la lisière de la forêt. Grain-de-Sel et le cavalier avaient devant eux, à deux portées de fusil, un petit monticule surmonté d’un vieil édifice à tournure féodale.
Un parc planté de grands arbres séculaires et ceint d’une haie vive à hauteur d’homme l’entourait.
Malgré l’heure avancée de la nuit, malgré la tempête qui régnait, une lumière brillait discrète et tremblante sur la sombre façade du château.
Hector attacha son regard surcette lumière et sentit battre son cœur.
– Tu le vois, dit il à Grain-de-Sel, elle t’a envoyé pour me dire de rebrousser chemin, n’est-ce pas ? mais elle a bien pensé que je n’en ferais rien, et elle m’attend.
– C’est vrai tout de même ! murmura Grain-de-Sel, c’est vrai.
Hector mit pied à terre.
– Range ma pauvre Clorinde sous un arbre, dit-il, tâche de trouver une poignée de feuilles mortes ou d’herbes sèches dans un vieux tronc, et bouchonne-la, s’il y a moyen, et puis mets-toi à l’abri, mon pauvre Grain-de-Sel.
– Oh ! ne vous inquiétez pas de moi ni de Clorinde, monsieur Hector ; nous nous connaissons de longue main, et nous n’avons pas peur de la pluie… Mais c’est égal, ne restez pas trop longtemps à Bellombre… Les bleus…
– Bah ! il pleut, les bleus n’ont pas quitté Bellefontaine. Rassure-toi, mon petit Grain-de-Sel.
Hector prit le fusil placé à l’arçon de sa selle et le passa en bandoulière.
– Ah ! mon Dieu ! murmura Grain-de-Sel, qui, pour la première fois, remarqua le mouchoir ensanglanté que le jeune homme avait autour de la tête, vous êtes blessé…
– Ce n’est rien… une égratignure… une balle qui m’a entamé le cuir chevelu… Ce n’est rien… Adieu, Grain-de-Sel… je te recommande Clorinde…
En parlant ainsi, le jeune homme courut à la clôture du parc, et sans hésiter, il trouva une brèche assez semblable à celles où les braconniers placent leur panneau.
Il se glissa par cette brèche dans le parc et reprit sa course vers le château, l’œil toujours fixé sur cette lumière mystérieuse qui brillait comme un phare sur la mer sombre. Arrivé tout près du château, il s’arrêta un moment et prêta l’oreille.
Notre héros connaissait sans doute fort bien les aîtres, car il suivit, sans hésiter, un petit sentier qui aboutissait à un escalier de deux pieds de large, et qui conduisait par une trentaine de marches jusque sous une terrasse qui jadis avait porté le nom beaucoup plus pompeux de plate-forme.
La dernière marche de l’escalier aboutissait à une petite porte.
Cette porte était fermée ; mais il y avait auprès un énorme cep de vigne, pour le moins centenaire, et qui avait l’épaisseur du bras.
Hector répéta, mais beaucoup plus bas et de façon à lui donner une intonation lointaine, ce houhoulement de la chouette que Grain-de-Sel avait fait entendre une heure auparavant ; et le cri de l’oiseau nocturne était si bien imité, qu’on eût juré, à l’intérieur du château, qu’il venait de la forêt voisine.
Tout aussitôt la fenêtre où brillait la lumière et qui, ouvrant sur la terrasse de plain-pied, se trouvait verticalement au-dessus du jeune homme, cette fenêtre s’entrouvrit discrètement. Hector se cramponna au cep de vigne et grimpa comme un écureuil, puis il s’élança lestement sur la terrasse.
Alors une silhouette de femme se dessina dans le rayon lumineux de la croisée, qui s’ouvrit tout à fait, et deux bras se jetèrent au cou du jeune homme et l’enlacèrent.
– Oh ! l’imprudent ! murmura une voix charmante et douce comme un soupir de vent de nuit dans les bois.
La croisée se referma derrière Hector, et il se trouva dans un joli boudoir coquettement meublé et arrangé, et qu’on eût cru appartenir à quelque élégant hôtel de Paris.
Hector avait devant lui une femme d’environ vingt-cinq ans, toute vêtue de noir, et si belle sous ses vêtements de deuil, que celui qui l’eût vue pour la première fois eût jeté un cri d’admiration.
C’était cette madame Diane qui attendait Hector, et dont Grain-de-Sel avait parlé ; madame Diane de Morfontaine, veuve du baron Rupert, colonel de l’Empire.
Diane était une de ces belles femmes de l’Ouest, dont le front blanc, aux veines bleues, est couronné d’une luxuriante chevelure noire, dont l’œil a l’azur profond du ciel, et dont la taille svelte et souple a la majesté d’un lis.
Elle prit Hector par la main, le conduisit auprès de la cheminée, où flambait un grand feu, et le fit asseoir.
– Imprudent ! répéta-t-elle.
Mais tout à coup elle aperçut le mouchoir jaspé de sang et étouffa un cri.
– Mon Dieu ! vous êtes blessé !…
– Ce n’est rien, ma chère Diane, rien, je vous jure… dit le jeune homme en lui souriant et lui baisant les mains avec transport.
– Ah ! cher ami, cher époux du ciel !… murmurait la jeune femme tout émue… blessé ! grièvement peut-être… mon Dieu !
– Je vous jure, ma Diane adorée, que c’est une égratignure, répéta le jeune homme, qui souriait toujours et la contemplait avec amour.
– Oh ! je veux voir cela, disait-elle, je veux voir ta blessure… je m’y connais… tu verras. Je vais te panser.
Et la jeune femme courut prendre une aiguière, et y versa de l’eau tiède que contenait une bouilloire placée devant le feu.
Puis, avec ses belles mains blanches, elle détacha le mouchoir ensanglanté, écarta ses cheveux avec précaution, trempa le mouchoir dans l’eau tiède et lava la plaie.
Hector avait dit vrai ; ce n’était qu’une égratignure, la balle des Bleus avait à peine effleuré sa tête.
Et, tout en le lavant, tout en le pansant, elle disait :
– Ah ! je savais bien, quelque danger qu’il y eût, tu viendrais… je le savais, cher Hector.
Elle déchira un mouchoir de batiste garni de valenciennes et tout imprégné d’un parfum discret, elle le mit en lambeaux pour en faire de la charpie.
– Mais tu ne sais donc pas, ami, continua-t-elle, que les bleus sont ici, à deux lieues à peine, et que demain il nous faudra loger sans doute quelque officier, un général ou un colonel ?…
– Eh bien ! répondit le jeune homme en riant, ce sera fort agréable pour le général, lui qui est bleu comme eux.
Il y avait une légère ironie dans la voix du jeune homme.
– Ah ! tais-toi, Hector, tais-toi, ami, fit la jeune femme avec effroi… Si tu savais combien j’ai prié hier pour toi, combien j’ai pleuré !
Hector osa lui prendre un baiser.
– Prie, dit-il, mais ne pleure pas… Les filles de Vendée doivent être comme leurs mères, avoir une âme romaine.
– Mais, malheureux, oublies-tu donc que tu es… déserteur ?… que si tu tombes en leur pouvoir, tu seras fusillé ?…
– Déserteur ? fit le jeune homme en relevant fièrement la tête ; tu te trompes, Diane, ce n’est pas moi, ce sont eux ! Je sers les rois de mes pères, je suis Vendéen, je ne suis pas déserteur…
– Ils le disent du moins.
– Oh ! je le sais bien, qu’ils me traitent de déserteur, parce que le jour où Madame est débarquée en Vendée j’ai remis le commandement de mon escadron à mon colonel, et que, seul, mon épée sous le bras, sans dire un mot, sans vouloir entraîner personne à ma suite, je suis allé m’enrôler comme simple soldat parmi les miens, parmi ceux qui défendent la bonne cause. Et ils osent appeler cela de la désertion !
– Ils le disent, murmura la jeune femme, dont la voix tremblait ; et si tu étais pris, tu ne subirais point la loi commune des prisonniers de guerre…
Le jeune homme avait toujours son fier sourire aux lèvres, il caressait de la main gauche le pommeau de ses pistolets.
– Pris ? dit-il, allons donc ! On ne prend pas vivants des hommes comme moi…
– Tu as l’âme d’un lion, mon Hector, murmura la jeune femme, qui le regardait avec admiration.
Et tandis qu’ils causaient ainsi, la pluie et le vent continuaient à fouetter les vitres de la croisée et à battre les ardoises.
– Comme tu es mouillé ! comme tu as froid ! disait la jeune femme en l’aidant à ôter sa veste rouge et l’enveloppant dans un grand châle.
Elle lui prenait les mains et les réchauffait dans les siennes.
Puis elle courut vers un coin du boudoir, y prit une petite table qu’elle apporta près du feu et la plaça devant lui.
Sur cette table, il y avait une bouteille de vin vieux, un morceau de pâté et quelques autres aliments.
– Tu dois avoir bien faim ? disait-elle.
– Non, répondit-il, mais j’ai soif… et je vais boire à nos amours, ma pauvre Diane !
La jeune femme essaya de sourire ; mais tandis qu’elle versait à boire à son amant, une larme brilla dans ses yeux, perla au bout de ses longs cils et tomba dans le verre.
En ce moment, elle crut entendre un bruit lointain, tressaillit et se leva précipitamment.
– Écoute, dit-elle avec un accent de terreur subite, écoute !
Et elle ouvrit la croisée, qui livra passage à une bouffée de l’ouragan.
III
Il nous faut, avant d’aller plus loin, faire en quelques lignes l’histoire de Diane et d’Hector. Diane, nous l’avons dit, était la fille de M. de Morfontaine, général de brigade en retraite, et la veuve du colonel baron Rupert.
Hector se nommait de son vrai nom Charles-Louis-Enguerrand-Hector, comte de Main-Hardye.
Les Morfontaine et les Main-Hardye étaient deux vieilles familles vendéennes, dont l’origine remontait aux ténèbres du Moyen Âge.
Ils étaient aussi nobles que le roi.
Le manoir de Morfontaine ayant été rasé en 1793, ses propriétaires étaient venus habiter Bellombre, une terre qu’ils possédaient sur la frontière du Poitou.
À quatre lieues de Bellombre se dressaient les tourelles de Main-Hardye.
Main-Hardye était un édifice qui ressemblait fort au château du sire de Ravenswood, l’héroïque amant de Lucie de Lammermoor chanté par Walter Scott.
Le vent, après avoir insulté la toiture en lambeaux, y pleurait sous les portes ; l’herbe poussait verte et drue dans la cour ; les vieilles salles étaient enfumées ; l’escalier avait de larges marches de pierre usées par le talon éperonné d’une dizaine de générations.
Un pauvre domaine, composé de champs pierreux, de fermes couvertes de chaume, de prairies marécageuses et de bois rabougris, lui servait de ceinture.
Les Main-Hardye n’avaient guère plus de huit à dix mille livres de rente.
Les Morfontaine étaient plus riches. Leurs domaines couvraient plusieurs lieues de pays, et ils faisaient une certaine figure à la cour avant 1789.
La Révolution trouva les Morfontaine et les Main-Hardye dans les rangs de l’armée vendéenne.
Le marquis de Morfontaine trouva la mort à Quiberon.
Le comte de Main-Hardye fut guillotiné à Poitiers.
Le fils du marquis fut ébloui par l’étoile resplendissante du premier Consul. Il avait combattu sous Charette, Bonchamp et la Rochejaquelein, il prit du service dans les armées de l’empereur Napoléon.
Puis il arriva pour lui ce qui arriva pour tant d’autres, il se prit à aimer cet homme qui avait fait la France si grande que l’Europe se prosternait, et que le monde étonné prononçait son nom avec terreur et respect ; il l’aima avec fanatisme, avec délire, et quand 1815 arriva, l’ancien soldat de Vendée oublia le passé, il remit au fourreau l’épée du général de l’Empire.
Le fils du comte de Main-Hardye, au contraire, rentra simplement dans ses terres et se fit laboureur durant toute la période qui sépara les guerres de la Chouannerie de la Restauration.
En 1815, les rôles changèrent ; tandis que M. de Morfontaine faisait liquider sa pension de général de brigade, le comte de Main-Hardye devenait colonel d’un régiment de hussards de la garde royale.
Le comte avait un fils, Hector.
Le marquis avait une fille, Diane.
De Bellombre à Main-Hardye il y avait quatre lieues à peine. Les deux gentilshommes avaient longtemps combattu sous le même drapeau et côte à côte.
Il y avait au milieu du bois, entre les deux châteaux, une humble église qu’on appelait Notre-Dame-du-Pardon.
Aux grandes fêtes de l’année, on disait la messe à Notre-Dame.
Le colonel de Main-Hardye y venait de son château, donnant la main à son fils.
Le général de Morfontaine s’y rendait de Bellombre, tandis que sa fille s’appuyait sur son bras.
Hector pouvait bien avoir douze ou treize ans ; Diane en avait dix.
Les pères se regardaient d’un œil farouche, les enfants se souriaient.
Les pères se haïssaient, les enfants s’aimaient.
L’histoire de Roméo et Juliette n’est point une fiction ; il y a mieux, elle est une histoire banale qui se reproduit à l’infini.
Les Morfontaine et les Main-Hardye étaient les Montaigu et les Capulet de la Vendée.
Ces deux races nourrissaient une haine qui se perdait dans la nuit des temps.
Sous Charles V, disait-on, un Morfontaine avait tué un Main-Hardye ; sous François Ier, continuait la légende, c’était un Main-Hardye qui avait tué un Morfontaine.
De siècle en siècle, de règne en règne, de génération en génération, les Main-Hardye et les Morfontaine s’étaient rencontrés, et, sans trop se souvenir du motif qui les divisait, ils s’étaient battus et s’étaient entre-tués.
Le comte de Main-Hardye et le marquis de Morfontaine signèrent une trêve pendant les guerres de l’Ouest. Ils se groupèrent autour du drapeau royal et firent taire leurs rancunes particulières.
L’Empire arriva.
L’empereur Napoléon aimait le marquis, il aurait voulu que le comte de Main-Hardye servît la France. Il fit jurer au marquis de ne point chercher querelle au comte.
Puis vint la Restauration.
Le roi Louis XVIII se souvenait que M. de Morfontaine avait arrosé de son sang la terre de Vendée. Il fit jurer au comte qu’il ne se battrait point avec le marquis.
Tous deux tinrent leur serment ; mais ils se regardaient d’un œil louche, et le marquis était peut-être bien le plus malheureux, car il n’avait qu’une fille.
Cette fille, la blanche et belle Diane de Morfontaine, écoutait tous les soirs, enfant, les imprécations du vieux général de Morfontaine contre les Main-Hardye.
Le fils du comte Hector de Main-Hardye entendait chaque matin le vieux chouan dire à son réveil : « J’ai encore fort mal dormi cette nuit ; je ne dormirai bien que lorsque ce jacobin de Morfontaine sera mort. »
Diane s’en allait à la messe de Notre-Dame-du-Pardon et souriait en regardant Hector.
Hector allait braconner jusque sous les murs du château de Bellombre tout exprès pour apercevoir la jolie Diane.
Ni le marquis ni le comte ne se doutaient de la sympathie qui entraînait leurs enfants l’un vers l’autre.
Les hasards de la vie les séparèrent.
Hector entra à Saint-Cyr et en sortit sous-lieutenant de cavalerie.
Quand Diane eut atteint sa seizième année, le marquis songea qu’il lui fallait un mari.
Certes les maris ne manquaient pas.
Diane était riche et elle était belle comme les anges.
C’était plus qu’il n’en fallait.
M. de Morfontaine avait trois neveux qui, tous trois, visaient à la main de Diane.
Le premier se nommait le vicomte de Morlière, le second le chevalier de Morfontaine, le troisième le baron de Passe-Croix.
Le vicomte avait trente ans, le chevalier vingt-sept, le baron vingt-trois.
On eût dit que M. de Morfontaine n’avait qu’à choisir. M. de Morfontaine ne choisit pas, ou plutôt il fit un choix sans songer à ses neveux.
Le marquis avait eu un aide de camp nommé Joseph Rupert, un brave soldat de fortune qui avait été son propre aïeul et que l’empereur avait fait baron et colonel à trente ans pour sa belle conduite militaire.
Le marquis en fit son gendre, au grand désespoir de ses neveux.
– Diane était une enfant. Elle aimait Hector, mais elle se l’était avoué à peine ; et puis elle savait bien que jamais M. de Morfontaine vivant, elle ne pourrait l’épouser ; et puis encore elle ne savait pas résister à son père.
Diane devint la baronne Rupert.
Hélas ! le baron eut la fâcheuse idée de passer l’hiver à Paris.
On était alors vers la fin de la Restauration. Le baron Rupert menait sa jeune femme dans le monde, le jeune vicomte de Main-Hardye, lieutenant de dragons, puis de hussards, y allait aussi.
Hector et Diane se rencontrèrent de nouveau, et la pauvre Diane sentit qu’elle aimait toujours le vicomte, et le vicomte comprit sur-le-champ que sa vie entière appartenait à cette femme. Hélas ! Diane était mariée !
Un soir, le jeune officier, qui venait d’être promu au grade de capitaine, – on touchait au mois d’avril 1830, – rencontra la baronne Rupert chez le duc et la duchesse de P… L…
On dansait, il y avait foule, le baron Rupert avait laissé sa jeune femme dans la salle du bal pour gagner un boudoir où l’on jouait au whist, Hector s’approcha de Diane et l’invita à valser.
– Madame, lui dit-il, le roi a décidé l’expédition d’Alger ; je pars demain. Vous lirez probablement bientôt deux lignes nécrologiques dans le Moniteur. Alors, priez pour moi.
Diane comprit cet immense amour qui remplissait le cœur du jeune homme, et qu’elle ressentait elle-même… et elle ne répondit pas.
Hector partit pour Alger. Il fit des prodiges de valeur pendant le siège, il chercha constamment à se faire tuer et n’y put réussir. La mort semblait ne pas vouloir de lui.
Quand la Révolution de 1830 arriva, le jeune homme voulut briser son épée.
N’était-il pas Vendéen ? N’avait-il pas sucé le lait d’une femme royaliste et chrétienne ?
Mais quand la nouvelle de la chute de la branche aînée des Bourbons lui arriva, Hector était déjà loin d’Alger.
À la place du drapeau blanc il vit hisser le drapeau tricolore ; mais, quelle que soit sa couleur, l’étendard de la patrie ne fait-il pas battre le cœur quand on est en face de l’ennemi ? Quel est donc le soldat qui déserte et remet l’épée au fourreau quand le tambour de son régiment bat la charge ?
Hector demeura et fit la première campagne d’Afrique, cherchant la mort sans cesse et ne la pouvant trouver.
Un jour, il reçut une lettre de France.
Cette lettre contenait deux lignes :
« Si vous n’êtes pas mort, ne bravez plus le trépas, et « malgré la haine de nos deux familles, espérez : je suis veuve.
« Diane. »
Cette lettre arrivait à Hector en même temps que l’épaulette de chef d’escadron, le matin d’une bataille.
Le colonel baron Rupert s’était battu en duel quinze jours auparavant et il avait été tué d’une balle au front.
Diane était libre…
– La mort n’a pas voulu de moi jusqu’à présent, murmura Hector en recevant cette lettre ; mais je pourrais bien être tué aujourd’hui.
Hector se trompait ; il vit ce jour-là son épaulette neuve emportée par une balle arabe, et il rentra au camp avec un uniforme en lambeaux, mais le corps vierge d’une égratignure.
Quelques jours après, son régiment reçut l’ordre de rentrer en France.
On touchait alors à la fin de l’année 1830.
Le fils des vieux chouans songea, une fois encore, à donner sa démission ; car il ne voulait pas servir le nouveau régime. Une circonstance fortuite l’en empêcha encore…
L’ordre qui rappelait son régiment en France lui assignait Poitiers pour garnison.
Or, le général marquis de Morfontaine, auprès de qui la baronne Rupert s’était retirée, passait l’hiver à Poitiers.
L’homme politique s’effaça devant l’amoureux ; le cœur du soldat fit le reste.
Le régiment est une famille, chaque compagnon d’armes devient un frère, et puis, blanc ou tricolore, le drapeau qu’on suit n’est-il pas la patrie ?
Hector vint tenir garnison à Poitiers.
Poitiers est cette ville de province aux rues solitaires, à l’aspect morne et songeur, aux grands airs d’un gentilhomme d’autrefois ; c’est la vieille cité parlementaire où tout est calme, austère, solennel, où, bien que le couvre-feu soit aboli, on se couche de bonne heure, et où les rues sont plus désertes que les allées d’un cimetière lorsque sonne le dernier coup de minuit.
Le vieux général de Morfontaine habitait à Poitiers un hôtel entre cour et jardin, dans le quartier le plus isolé de cette ville déjà solitaire. Au bout du jardin il y avait un pavillon que la baronne Rupert avait choisi pour sa demeure particulière. Derrière le jardin et le pavillon était une ruelle tortueuse qui descendait vers la rivière.
Que se passait-il chaque soir ?
Nul n’aurait pu le dire au juste ; mais un homme enveloppé d’un manteau se glissait vers le pavillon, et une porte se refermait sur lui.
Hector ne songeait plus à donner sa démission.
Plusieurs mois s’écoulèrent ainsi.
Souvent Hector demandait un congé de quelques jours et s’en allait à Main-Hardye.
Le comte, qui s’était fait laisser pour mort dans les rues de Paris, pendant les journées de Juillet, était revenu en Vendée et y guérissait lentement ses blessures.
Toujours Vendéen dans le fond de l’âme, l’ancien chouan souffrait de voir son fils servir le nouveau régime ; mais il n’osait exiger qu’il brisât sa carrière. Les Main-Hardye étaient pauvres.
Certes, le vieux chouan eût vécu de pain noir et d’eau ; mais il était père, et l’égoïsme paternel imposait silence au cœur du partisan.
Hector avait espéré que cette haine héréditaire qui existait entre son père et celui de Diane, ravivée par les événements de 1814 et 1815, se serait affaiblie à la suite de ceux de 1830.
Quand Hector prononçait le nom de Morfontaine devant son père, le comte entrait en fureur.
Diane, de son côté, avait quelquefois hasardé le nom de Main-Hardye.
Chaque fois, le vieux général s’était écrié que l’ombre du manoir de ses voisins faisait tort à ses récoltes.
L’âge avait donné un caractère presque bouffon à la haine des deux gentilshommes.
Un jour, le général de Morfontaine avait voulu monter un cheval neuf ; le cheval s’était emporté, et, la bride s’étant rompue, il s’en allait droit à la rivière.
Le général était perdu si un jeune officier, qui revenait du champ de manœuvre avec son escadron, n’avait arrêté le cheval au péril de sa vie. Cet officier, on le devine, c’était le commandant Hector de Main-Hardye.
Quand le général avait appris le nom de son sauveur, qu’il avait jusque-là accablé de remerciements, il s’était écrié avec colère :
– Pardieu ! monsieur, je suis assez connu dans la ville ; vous auriez dû savoir qui j’étais et me laisser noyer. Il m’est fort désagréable d’être votre obligé.
Cette dernière circonstance avait achevé d’enlever aux deux amants tout espoir de rapprochement entre leurs pères. Alors Diane avait dit à Hector :
– Tu es mon époux devant Dieu, et je te jure que je serai ta femme tôt ou tard. Nos pères inclinent chaque jour vers la tombe ; attendons, et n’empoisonnons pas leurs derniers jours.
– Attendons, avait répondu Hector.
Plusieurs mois s’écoulèrent. Hector et Diane s’aimaient, et le plus profond mystère, grâce à deux serviteurs de Diane, dont nous parlerons plus tard, Grain-de-Sel et sa mère, enveloppait leur amour.
La baronne était encore en deuil de son mari. C’était pour elle une raison suffisante d’écarter les prétendants à sa main, qui revenaient à la charge plus nombreux que jamais.
Un soir, en rentrant chez lui, dans son logis de garçon, le commandant trouva un homme qui se chauffait à son feu, les pieds sur les chenets.
C’était un paysan du Bocage, en veste rouge, en braies bleues. Le paysan se nommait Pornic ; c’était un serviteur de son père. Il lui apportait un billet du comte de Main-Hardye.
Ce billet était laconique comme un ordre du jour.
« Mon fils, disait le vieux chouan, Madame est débarquée en Vendée la nuit dernière. Votre place est à mes côtés ; notre place, à tous deux, est auprès d’elle. Montez à cheval et venez. »
Hector comprit tout.
Une lutte de quelques minutes s’éleva en lui, lutte terrible entre le soldat et le fils du vieux Vendéen.
Le soldat lui disait : « Tu sers le nouveau régime, tu es officier, tu ne peux quitter ton poste. »
Le Vendéen se souvenait des légendes héroïques dont on avait bercé son enfance. Il était né sur la même terre que les La Rochejaquelein, les Cathelineau et les Bonchamp.
Si Hector avait eu huit jours devant lui, il eût envoyé sa démission au ministre de la guerre. Mais il n’avait pas un jour, il n’avait pas une heure.
Le colonel du régiment était un vieux soldat, un homme d’honneur s’il en fût.
Malgré l’heure avancée, Hector courut chez lui :
– Colonel, lui dit-il, je vous apporte ma démission.
– Je ne puis l’accepter, lui répondit le colonel ; le ministre seul… Donnez-la-moi, je l’enverrai.
– Hélas ! dit Hector, il faut que je quitte mon escadron sur l’heure.
– Ceci est impossible encore, répondit le colonel ; car j’ai reçu aujourd’hui même l’ordre de partir. Le régiment change de garnison.
– Alors, colonel, dit froidement Hector, je déserte.
– Êtes-vous fou ? s’écria le colonel.
– Non, murmura tristement le jeune homme.
Alors il demanda sa parole d’honneur au vieil officier que ce qu’il allait lui dire serait enseveli au fond de son cœur et que ce que l’homme entendrait, le colonel n’en saurait rien. Le colonel jura ; Hector lui montra le billet de son père.
– Mais, malheureux ! s’écria le colonel, c’est la mort et le déshonneur !
– La mort, peut-être ; le déshonneur, non ! Je suis Vendéen.
Le colonel comprit. Il savait que tôt ou tard, quand souffle le vent de l’Atlas, les lions retournent au désert.
– Allez, murmura-t-il, et Dieu veuille qu’un jour je ne préside point le conseil de guerre qui vous condamnera à la peine de mort.
Hector revint chez lui, et dit au Vendéen :
– Selle mes chevaux !
C’est ainsi que le vicomte Hector de Main-Hardye avait déserté.
Le lendemain, il était au milieu de cette poignée d’hommes qui étaient réunis autour de Madame, comme autour du dernier étendard de la monarchie.
Trois jours après, à la première rencontre avec les troupes du nouveau régime, le comte de Main-Hardye tombait frappé à mort dans les bras de son fils et le couvrait de sang.
*
* *
On devine à présent ce qui s’était passé depuis deux mois.
La petite armée vendéenne combattait en désespérée, ressuscitant les vieilles guerres de 1794 et 1798 ; mais l’enthousiasme n’était plus le même, et chaque jour, malgré des prodiges de valeur, les royalistes perdaient du terrain.
Hector avait succédé à son père, et continuait de mener de front la guerre et son amour. Il avait établi son quartier général dans le Bocage, près du château de Main-Hardye, à trois lieues de Bellombre.
Chaque nuit il sautait sur Clorinde et venait à Bellombre, comme naguère il se glissait dans la ruelle sombre et déserte du faubourg de Poitiers.
Et Diane l’attendait agenouillée, et comme elle avait prié pour le soldat d’Afrique, elle priait pour le Vendéen.
*
* *
Maintenant il est temps de revenir à ce moment où la veuve du baron Rupert avait entendu un bruit qui l’avait fait courir à la croisée et l’ouvrir.
Ce bruit n’était autre que le houhoulement de Grain-de-Sel, qui, répété, frappa distinctement l’oreille d’Hector.
Le jeune homme se leva, se débarrassa du châle qui enveloppait ses épaules, et, à tout hasard, remit ses pistolets à sa ceinture.
Cinq minutes après, Grain-de-Sel sauta sur la terrasse et apparut :
– Les bleus ! dit-il, les bleus viennent… il n’y a pas une minute à perdre…
Hector prit Diane dans ses bras, l’y pressa longtemps, et lui donna un dernier baiser.
– Adieu ! dit-il, à demain…
– Oh ! non… non… ne viens pas, Hector ; je t’en supplie !… s’écria la baronne éperdue.
– Tu es folle ! reprit-il. Je passerais à travers les flammes pour te voir… À demain.
Et il s’élança sur la terrasse et sauta dans le jardin, suivi par Grain-de-Sel.
IV
Le lendemain soir, il y avait nombreuse réunion dans le salon du château de Bellombre, un grand feu flambait dans la cheminée. Quatre personnes jouaient au whist, trois causaient au coin du feu, une quatrième, c’était la baronne Rupert, était assise devant un métier à tapisserie et brodait.
Les quatre whisteurs étaient le vieux général de Morfontaine, le fils de sa sœur, le vicomte de la Morlière, son autre neveu, M. de Passe-Croix, et le colonel des hussards qui se trouvaient, quelques mois auparavant, en garnison à Poitiers.
Le même colonel à qui le commandant Hector de Main-Hardye était ailé déclarer qu’il désertait.
Les trois personnes qui causaient au coin du feu étaient le curé de Bellefontaine, le village voisin, le chevalier de Morfontaine, autre neveu du général, et un jeune officier de hussards.
Ni le curé, ni le chevalier, ni le capitaine ne songèrent qu’elle écoutait leur conversation.
– Ce qu’il y a de plus terrible dans la situation d’Hector, continua le capitaine, qui ne prononça plus le nom de Main-Hardye, c’est qu’il est déserteur, et que, bien qu’il soit notre ami à tous, s’il venait malheureusement à tomber entre nos mains, nous serions forcés de le fusiller.
La baronne, qui entendit ces paroles, devint fort pâle, et sa main, qui tenait l’aiguille à broder, trembla légèrement.
Aucun des trois causeurs n’y prit garde ; mais un des whisteurs, qui levait la tête en ce moment, remarqua cette pâleur et ce tressaillement, en même temps que le mot fusiller frappa son oreille.
– Messieurs, dit le général en comptant ses levées, j’ai les honneurs.
– Mon oncle, dit le whisteur qui avait vu la baronne pâlir, nous avons gagné.
– Et j’en profite pour lever la séance, messieurs, j’ai les pieds gelés.
Le colonel se mit à rire et imita le général.
Le curé et ses deux interlocuteurs écartèrent leurs sièges, et les joueurs, quittant la table de jeu, s’approchèrent de la cheminée.
– Curé, dit le général, de quoi parliez-vous donc là tout à l’heure ?
– Nous parlions de la guerre, monsieur le marquis, répondit le jeune prêtre.
– Ah ! ah ! de la guerre d’Italie ou de la guerre d’Espagne ?
– Mais non, mon oncle, répliqua le chevalier de Morfontaine.
– De laquelle donc ?
– De celle qui se fait à notre porte.
– Ah ! fit le général avec un accent dédaigneux qui n’était pas très sincère peut-être, vous avez bien de la bonté, curé, de donner le nom de guerre à une misérable échauffourée. La Vendée est morte, messieurs, et c’est en vain que quelques fous tentent de la ressusciter. La guerre civile n’est plus dans nos mœurs.
La baronne Rupert, qui jusque-là avait gardé le silence, se mêla tout à coup à la conversation.
– Vous êtes sévère, mon père, dit-elle ; vous savez cependant, autrefois…
– Oui, oui, fit le général d’un ton bourru ; je sais ce que tu vas me dire, j’ai été Vendéen, moi aussi, mais c’était en 1793 ; nous faisions la guerre à la République. Et puis alors la monarchie avait conservé à nos yeux tout son prestige.
– Et vous avez été battu pendant deux années presque nuit et jour, mon père, ajouta la baronne avec un accent de fermeté étrange.
– Ah ! d’abord, messieurs, dit le général, s’il y a parmi vous des gens dévoués à la cause vendéenne, ils peuvent parler. Madame la baronne Rupert, bien qu’elle soit veuve d’un officier de l’Empire, ne dissimule point ses sympathies : elle a du sang de Vendéen dans les veines.
– Je suis la fille de mon père, murmura Diane avec fierté.
Le général laissa échapper une sorte de grognement assez bizarre. Était-ce de la colère ou de la satisfaction ? Nul ne le sut au juste, excepté Diane peut-être.
– Ah ! la Vendée ! la Vendée ! continua le général, elle aura toujours des cerveaux brûlés, des fous héroïques… Cette insurrection blanche qui se lève autour de Madame ne peut être sérieuse… elle perd du terrain tous les jours… Mais ceux qui ont pris les armes ne les déposeront pas, croyez-le bien, ils se feront tuer jusqu’au dernier, les fous !
Diane était pâle comme la mort.
– J’ai vu cela en 1798 et 1799, continua le général. Je me rappelle même qu’à cette époque nous avions beaucoup de déserteurs dans nos rangs.
Comme s’ils eussent été mus par la même pensée, le colonel, le capitaine et la baronne Rupert tressaillirent.
– C’étaient des enfants du pays que la conscription républicaine avait pris, qu’on avait habillés en bleus, et dont le cœur était resté blanc. Quand ils se trouvaient à deux lieues de nos lignes, ils désertaient et venaient se joindre à nous ; je me souviens même d’un pauvre diable qu’on nommait Joseph Ancel et qui fit une triste fin.
Le général paraissait en veine de conter ; ses hôtes se serraient autour de lui.
– Contez-nous donc cette histoire, mon oncle, dit le chevalier de Morfontaine.
– Volontiers, répondit le général. Joseph Ancel était le fils d’un de nos métayers ; le sergent recruteur l’avait enrôlé trois ou quatre ans avant la Révolution, et comme c’était un fort beau gars, il avait été incorporé dans les gardes-françaises. Les gardes-françaises, on le sait, passèrent les premiers dans le camp de la Révolution.
Joseph Ancel suivit le flot, il fit comme ses camarades. On l’envoya sur le Rhin, il se battit contre les Prussiens et il se conduisit fort bravement ; puis la demi-brigade à laquelle il appartenait reçut l’ordre de revenir en France, et on la dirigea sur la Vendée.