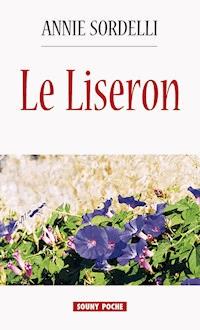
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Lucien Souny
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Promise à un si bel avenir...
Au lendemain de la guerre, Annie ouvre les yeux sur un monde neuf. Jolie, ses parents la voient déjà en actrice de cinéma ! Dans un cadre rural bucolique et enchanteur, l’éveil sensuel aux merveilles du jardin et de l’eau, les fleurs, les jeux, la complicité d’une sœur presque jumelle et de grands-parents aimants, suffiraient à son bonheur d’enfant. Mais une maladie de famille qu’on croyait éteinte a choisi de planter ses griffes sur ce jeune être qui suscitait tous les espoirs.
Depuis la naissance de Françoise, d’apparence délicate, la santé de la mère se trouve à son tour compromise. L’entourage s’attriste et le ciel se voile de noir. Endossant, bon gré mal gré, le rôle de la maîtresse de maison, entre sa sœur cadette et leur père affaibli par le deuil, Annie délaisse ses études. Apathique puis passionnée, hyperactive, elle s’échappe dans l’imaginaire et la féérie, et elle grandit, tel le liseron ardent et gracile qui fleurit sur les décombres.
Le récit touchant d'une enfance brisée, raconté à hauteur d'enfant.
EXTRAIT
Juin touchait à sa fin ; l’été dérivait. Insensible aux sursauts de chaleur tropicale et blanche qui accompagnaient les ondées, il était comme piqué au vif par l’azur électrique chargeant à la hâte d’énormes enclumes qu’il précipitait au-dessus des rivières. D’orage en orage, les cours d’eau charriaient des déluges encombrés de branchages arrachés qui s’amoncelaient en fagots grinçants, cherchant où accoster, et, finalement, s’en remettaient à l’humeur des courants. Certains reproduisaient des abris bâtis de poutres, de débris, de brindilles. D’autres, échoués entre les fourches d’arbres, avaient l’air de maisons lacustres à l’intérieur desquelles se concentraient des nichées de rats. Le gros poisson y trouvait refuge, et les libellules en venant se poser sur ces étranges faîtages arrêtaient de leurs ailes gazées de bleu le chatoiement de l’air.
CE QU’EN PENSE LA CRITIQUE
Une écriture aiguë, incisive, très féminine. Un écarquillement du regard qui est, au fond, l’enfance. –
Erik Orsenna
Un récit très attachant, surtout, par la naïveté du regard, la grandeur simple des sentiments, ce qui n’exclut ni la nuance, ni la délicatesse. –
Maurice Nadeau
À PROPOS DE L’AUTEUR
Annie Sordelli a signé un grand nombre de recueils de poésie.
Le Liseron est son premier roman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Elle a l’air d’un printemps que l’abeille et le merlevisitent. Elle se voudrait petite. Elle bâille, elle s’étire,le rire embellit sa prison. Frémissante sous la feuilleattachée, elle vit, volubile et captive.
Liseron bleu, liseron blancelle est sa propre lisière.
A. S.
ILes étés de Haute-Loire
Juin touchait à sa fin ; l’été dérivait. Insensible aux sursauts de chaleur tropicale et blanche qui accompagnaient les ondées, il était comme piqué au vif par l’azur électrique chargeant à la hâte d’énormes enclumes qu’il précipitait au-dessus des rivières. D’orage en orage, les cours d’eau charriaient des déluges encombrés de branchages arrachés qui s’amoncelaient en fagots grinçants, cherchant où accoster, et, finalement, s’en remettaient à l’humeur des courants. Certains reproduisaient des abris bâtis de poutres, de débris, de brindilles. D’autres, échoués entre les fourches d’arbres, avaient l’air de maisons lacustres à l’intérieur desquelles se concentraient des nichées de rats. Le gros poisson y trouvait refuge, et les libellules en venant se poser sur ces étranges faîtages arrêtaient de leurs ailes gazées de bleu le chatoiement de l’air.
Dans son lit de rochers adouci de chênes nains, l’Alagnon abandonnait ses tourbillons aux fins brouillards de moustiques. Il cédait à l’hésitation des araignées d’eau stationnées dans les criques arrangées par les arbres des berges. En maints endroits il s’égarait, donnant naissance à des pierres moussues qu’il détachait peu à peu du courant. Bientôt, on pourrait y passer à gué pour rejoindre les vignes sur l’autre rive, y prendre appui pour faire des ricochets, aller pieds nus dans l’eau rare devenue chaude et verte.
À Nicole et à moi, ces plaisirs simples sont inter-dits, pour des raisons que grand-mère ne précise pas. Elle aime nous avoir autour d’elle, à genoux parmi d’autres laveuses près du lavoir couvert, les mains nouées sur des torchons, des vêtements sombres qu’elle agite dans l’eau. Avec l’habitude, la pénitence devient douce. Pour moi, l’accommodement a aussi ses bonheurs.
Les autres enfants pataugent dans l’eau, s’y baignent, y font aller leurs mains, fabriquent des digues, des châteaux, s’éclaboussent. Nous la regardons faire d’une dépouille savonneuse un cordon dégouttant de clarté. Des odeurs vertes, sableuses, poissonneuses, agacent nos narines.
— Qu’ils se baignent s’ils en ont envie ! Je n’y laisse pas aller les miennes…
Pense-t-elle à des morsures de serpents, à des hydrocutions, à des insolations ?
— Gardez vos chapeaux sur la tête. Surtout, ne vous salissez pas !
La libellule, là-bas, sur un rameau de sureau. Dessous, des gouffres, des tentacules…
— Les pauvres, elles ne donnent pas de mal… Elles ressemblent tant à leur mère !
L’orgueil qui nous gonfle est un cataplasme. Fleurs prises au piège de leurs propres délices, nous tendons vers des abîmes. Quand, où, comment allons-nous exploser, enlever ce ciel à son tableau de verdure ! Envoyer des galets en direction de ces fonds noirs tant prisés des pêcheurs. Nous balancer au bord du pont déglingué, cueillir des fleurs loin d’elle…
L’après-midi, à l’heure de la sieste, il n’y a pas de lessive. C’est encore vers la rivière que notre grand-mère va nous entraîner, entre les murs des jardins et le fouillis des arbres sur l’eau. Leurs lacunes végétales ouvrent sur des fragments de miroirs qui éclatent en plein dans les yeux. Il a fallu taire ce projet d’aventure qu’elle conduit obstinée, fondue dans la demi-ombre, noire et menue sous son chignon tiré – son pliant dans la saignée du bras, son sac noir avec l’ouvrage et le goûter, sans oublier la petite bouteille d’eau rougie dont le goulot dépasse. Par dérision, elle salue sur le bord du chemin une « sentinelle » que nous avions pressentie :
— Ils ont mangé du milliard ! s’exclame-t-elle, inclinant la tête vers l’amas lié de minuscules noyaux, évocateurs d’une tarte aux cerises sauvages.
Dans un raidillon caillouteux écrasé de chaleur, elle signale la fuite d’un lézard, glissement sous des plantes de décombres. Tout va bien, nous marchons et elle rit ! Sur la route nationale, elle se félicitera de n’être pas passée devant chez sa belle-sœur. Elle parlera à la garde-barrière, puis à cette mère de famille aux nombreux enfants roux dont la maison s’accroche aux rochers, sans une cour où ils seraient en sécurité.
En file indienne, dans le remous brûlant des voitures, nous respirons le goudron pendant un bon kilomètre. Les gravillons cinglent nos mollets. Rien ne la retient d’apostropher les conducteurs :
— La roue tourne !… Bande de brelots, ils iront pas se ficher contre un arbre !
Réponse des sauterelles, de nos fous rires, de l’eau qui cascade plus bas. Mon Dieu, que cela dure !
Sur ce qu’on appelle « la Plage », une clairière dans l’herbe sèche en bordure de rivière où poussent des toiles de tente, elle nous installe près d’autres femmes venues avec pliants et enfants. Retour de la voix posée, aux nuances admiratives. Son regard par-dessus ses lunettes ramènerait n’importe quelle brebis égarée.
Du lavoir, elle nous a sommées de la rejoindre, sur un ton qui gâche le plaisir que nous prenions, ma sœur et moi. Dépitées, nous remontons la ruelle entre la double haie gris et blanc des maisons couvertes de tuiles romaines, ces maisons de Haute-Loire qui sentent un peu le Midi, avec leurs festons de génoises à la base des toits. Toutes ont les volets clos ; sous le soleil frisant, leurs murs s’embrasent d’insectes léthargiques. De temps à autre, une main fatiguée relève le rideau de passementerie de l’entrée et le laisse retomber, lourde d’attente, d’ennui.
Grand-mère distribue le goûter : du pain, du fromage. Elle promet de nous amener au Grand Pont à la nuit. Oubliant sa promesse, elle cherche une pièce de linge à repriser. Assis sous la pendule, un coude posé sur son bureau, grand-père écoute un reportage sportif. La grand-mère réagit en malmenant l’étoffe, glisse par moments dans un demi-sommeil dont elle émerge avec un soupir d’étonnement.
Sa mère Delphine vit avec nous. En attendant l’heure du dîner, elle suit le ballet des mouches au plafond. Ses doigts de moineau posés au creux de son tablier blanc, elle déglutit bruyamment. Elle fixe un point au hasard et cela peut durer des heures sans qu’elle se lasse.
Son oreille attentive vient de percevoir un bruit dans la rue déserte ; ses yeux se portent à sa rencontre, cherchant à déchiffrer la lumière. C’est le signal que l’atmosphère va se détendre le temps d’un passage, d’une causette peut-être ou d’une réflexion, qui entraîneront d’autres propos concernant le passant qu’on connaît ou dont on recherche l’identité, le but.
Grand-mère lève les yeux de son ouvrage :
— C’est la Céline…
Delphine, plus fort :
— C’est la Céline qui va laver ?
Poussive, elle conduit un chariot de linge juste sorti de l’ébullition. Ses cheveux neigeux frisottent autour de son front emperlé de sueur. Elle s’arrête pour souffler un peu avant notre maison, le temps d’éponger son visage d’un revers de son long tablier bleu couvrant sa jupe de grosse laine grise.
Martelant le bitume de ses sabots ferrés, le père Courbon revient de sa vigne, accompagné de Gaby, son petit-fils. Il marche fier, sa houe sur l’épaule, la chemise largement échancrée, la moustache et l’œil rusés. En passant, il hélera grand-père à qui il projette de conter son dernier exploit de pêcheur émérite. Il habite avec sa fille une maison au bord de l’eau et c’est à l’aube que les miracles s’opèrent : ses barbeaux, ses blancs dépassent la mesure. La diversité des appâts qui les ont perdus : mûre, raisin, grain de blé, nous ravit. Il pêcherait des sirènes les soirs de pleine lune que nous n’en serions pas surprises. Bon élève, Gaby le suit, toujours à distance. Avec ses noirs cheveux frisés, sa peau très mate illuminée d’un regard profond et doux, nous l’espérons tout au long du jour.
Sa mère, restée veuve, « lave » les hôtels, mais aussi les particuliers. Le matin de bonne heure, émergeant à peine d’un croissant de lune, les boucles de Marinette tirebouchonnent au-dessus de la rivière ; et moussent les étoffes entre ses mains usées, mousse qui file sur l’onde, tourbillonne, se perd dans le courant, longe la rive, y stationne se joignant à l’eau froide.
Nous nous asseyons sur le bord du trottoir près de Gaby, tandis que Courbon laisse glisser son outil.
Il clame, en direction de grand-père :
— Vous me croirez pas, Portal ! J’avais plus de cent pies dans ma vigne ! Elles m’ont pas touché un raisin et ç’aurait été dommage. Parce que, cet été, je mens pas : des grains comme des agates ! Hein, Gaby ?
Plus bas, comme hésitant à livrer un secret :
— Ce matin dans le béal, dites… j’ai vu une de ces anguilles ! Mon ami… comme le bras !
— Allez, père Courbon, c’était une couleuvre…
— Une anguille ! Gaby sait où elles sont, je lui ai montré l’endroit : ça fait comme un trou noir dans les racines. Nom de nom, j’arriverai bien à la crocheter, avec ce qu’il faut !
Il rit d’un grand rire coupé de hoquets, entrevoyant brièvement le prodige à venir. Puis, reprenant son outil, à Gaby qui pressent le départ, sur un ton qui ne souffre pas la discussion :
— Bon !
Docile, chaviré, Gaby se lève et nous dit bonsoir. Il emboîte sans se retourner le pas du vieux maraudeur et nous les accompagnons du regard jusqu’au tournant de la fontaine.
L’odeur des pommes de terre à l’huile nous met en appétit. Le couvert est dressé.
— S’il y avait du nouveau, le père aurait déjà prévenu…
— Il n’appellera pas maintenant, dit grand-père en prenant place au bout de la table.
— Trois enfants ! Tu vois, il me tarde que ce soit fini…
— Les enfants ne demandent pas à venir, Marie ! Il faut les prendre quand ils sont là et les aimer tous pareil.
— Denise n’était déjà pas si solide… Elle n’avait pas besoin de ça !
Grand-mère guette une rébellion. Ses yeux se lavent de fatalité. Elle laisse glisser :
— Allez ! Mangez…
Nous piquons du nez dans notre assiette.
— Leur mère n’aura pas toujours le temps de s’occuper d’elles, il faudra bien qu’elles changent. Et qu’elles aident, au lieu d’aller jouer !
Je risque :
— Si on ne peut plus jouer…
— Et ça réplique !
Grand-père avale bruyamment, il place ses mots :
— Elles sont jeunes…
— À leur âge, je marquais déjà du linge.
Assise comme à son habitude près du fourneau, son assiette de soupe posée à l’angle du bureau, la vieille Delphine se rengorge. Le soleil qui s’attarde à l’horizon illumine tout un coin du ciel. Les coteaux se dessinent en orange sur un dégradé de bleu orangé. Il y a du fauve dans l’air, de la couleur à revendre.
Bientôt l’ombre sera partout. Elle emplira chaque creux. Les chèvres de Maria, sur le retour, tenteront une dernière embuscade dans un bouquet de noise-tiers. Le tintement de leurs clochettes se répandra, montera jusqu’à nous. Ce sera l’heure de la promenade du soir, que grand-mère préfère à celle de l’après-midi parce qu’on peut y passer inaperçu. Mais je la soupçonne aussi d’aimer la nuit pour de plus poétiques raisons.
Selon son humeur, elle choisit pour nous le Grand Pont, la Croix-Saint-Giraud, la Prade, le cimetière, la route de Lanau ou, comme ce soir que je n’oublierai pas, celle d’Arvant…
Nous avions atteint la plaine, laissant derrière nous la présence rassurante des maisons. Le jour fusait par lambeaux, la nuit guettait à la naissance de l’ombre le lent déclin du soleil. La route s’ouvrait devant nous, chaude, droite, avec au bout le scintillement des lumières du bourg prochain.
Peu à peu, les fonds noircis se refermaient sur eux-mêmes. Arbres, buissons s’évaporaient, confondant chemins et ruisseaux. À une centaine de mètres, sur notre gauche, une vague maisonnette sans fenêtres venait à nous. L’un des murs reflétait une lueur cruelle et jaune, deux rectangles clairs de mêmes dimensions montrant un groupe de soldats armés, frappés de ces grosses lettres que nous connaissions bien : Diên Biên Phu… – comme « feu » !
Je n’aimais pas ces mots que je sentais lourds de conséquences. Que sait-on de la guerre, à dix ans ? Peut-être l’alarme que je lisais dans les yeux des grandes personnes, l’émotion de leur voix qui impose son silence, installe en nous l’étreinte de la crainte… La guerre, en de lointains Balkans, qu’avait connue mon grand-père. L’autre, qu’on porte en soi, pour l’avoir vécue dans le ventre de sa mère…
— Mémé, on rentre ?
— Pourquoi, tu as peur ? Et de quoi tu as peur ?
— J’ai pas peur…
— Allons, retournons si tu veux. Passe ton bras avec le mien, tu crains rien du tout avec ta mémé !
Elle me glissait un bonbon.
Dans le cadre de la fenêtre, je suivais de mon lit l’ascension de la lune. Haute, pleine, elle éclaboussait la pièce de lueurs sulfureuses. Je revoyais la lumière jaune, les affiches aux soldats, les arbres fuyants saupoudrés de brumes, les buissons prêts à l’attaque. Toutes ces images défilaient en désordre dans ma tête. J’aurais voulu être au matin pour reconnaître les promenades, leurs sentiers ourlés d’aubépines et de noisetiers remplis d’oiseaux familiers, l’herbe rare des talus où s’enhardissaient, pattes tendues, les chevrettes au front buté, avec leur queue dressée, en suspens.
— Nicole, tu dors ?
— Non… Et toi ?
Elle s’était tournée. Blottie contre moi, nous avions appelé le sommeil.
Tard dans la nuit, j’entendis ronfler grand-père, et grand-mère qui gémissait dans son rêve l’avait fait changer de côté. Dehors les chats envahissaient la rue, ils s’étaient réfugiés dans la maison abandonnée pour y clamer leurs amours. Puis, à l’aube, la grand-mère s’était levée. Elle avait fermé les volets. Sous ses pas feutrés, le plancher avait pleuré, doucement.
Lorsque nous nous étions réveillées, la matinée était déjà bien entamée. Dans la rue, des femmes s’interpellaient. Elles s’attardaient devant notre maison, bourdonnement qui montait jusqu’à nous, comme d’une ruche en effervescence. Penchée en avant, près de son lit, Delphine lissait ses cheveux. Ils lui recouvraient le visage, tombaient jusqu’à terre. Le peigne crissait dans la masse de soie, gerbe souple que ses mains malhabiles liaient serrée, ainsi qu’autrefois les tiges du sarrasin. La mèche enroulée sur un doigt était placée sur le sommet de sa tête. Arrondie, façonnée, elle prenait peu à peu la forme d’une brioche que la bisaïeule hérissait d’épingles en corne fumée.
Pour se vêtir, elle s’essoufflait, faisait celle qu’on attendait… On ne sollicitait plus ses services que pour l’épluchage des légumes, tâches qu’elle demandait qu’on lui confie, avec la confection des chaussettes : à trou-trous pour les dimanches, à côtes pour la semaine. Nous ne cessions d’espérer le moment où, parvenues au talon, ses mains tachées, tourmentées de replis que j’assimilais à la peau de mon café au lait refroidi, ralentiraient le tic-tac des aiguilles pour adapter l’ouvrage à nos mesures. Elles l’ajustaient, le moulaient exactement, massant le pied d’où dépassaient nos orteils avec tant de minutie, de tâtonnements dans ses doigts fébriles, que nous en étions électrisées de bien-être sous le rayonnement de la laine.
Elle était prête, elle se tenait debout. Son corps lourd, en équilibre sur ses deux jambes, se mettait en mouvement. Elle gagnait avec peine le coin du lit, sa main agrippant convulsivement la pomme de cuivre. Un peu plus tard, nous l’entendions glisser sur la rampe de l’escalier où elle se nouait, par endroits. Sans hâte, ses pas mal assurés décroissaient, s’accordaient un moment, reprenaient, pesants, avec les frôlements de la jupe sur les marches de bois ciré. Coquetterie, dignité ? Delphine n’avait jamais accepté de canne.
Grand-père revenait du jardin et c’était cet instant que nous choisissions pour descendre. Sa bicyclette garée le long du trottoir traînait une remorque, ses galoches tintaient sur le ciment.
Il appelait en soulevant le rideau :
— Marie… Tu es là, Marie ?
Grand-mère se présentait. Il lui offrait un panier de légumes et un bouquet de persil.
— Viens voir un peu le beau nid de merles…
Il détachait la remorque de pommes de terre : les plus volumineuses avantageusement arrangées sur le dessus.
— Toinot ! persiflait grand-mère qui préférait la production intermédiaire, nichée entre les fameux nids de merles et le résidu de gobilles.
Un civet de lapin mijotait à l’arrière du fourneau. De bonne heure, son fumet embaumait, montait jusqu’à la chambre où il nous réveillait. Sa viande fondait d’avance dans nos bouches. Les doigts, les lèvres tout poisseux, nous en sucions les os. Le pain buvait la sauce onctueuse, d’un noir très mat, que grand-père savourait à la cuillère.
— Marie, disait-il… la prochaine fois, tu y mettras des pommes de terre. C’est meilleur, avec la sauce !
— Toi !…
Il insistait, nous prenant à témoin :
— Te fâche pas, Marie, c’est pas pour te faire de la peine que je te dis ça !
Et il riait ; sa main caressant nos têtes, ses doigts accrochés à nos cheveux.
Dans l’après-midi, il avait refait le même voyage et la remorque avait rejoint la courette moussue de la maison d’en face, achetée pour être convertie en remise. On y trouvait quantité de choses ! Adossée au mur, une meule à aiguiser montée sur deux traverses de chemin de fer. Suspendus sous l’escalier aux marches incertaines, des paniers de formes et de tailles diverses. Dans un coin, à terre, un sac avec le son pour la pâtée des canards et des lapins. Dans l’autre angle, des cannes à pêche, la caisse à laver avec son coussin pour les genoux, quelquefois un tas de bûches fendues, des coins de fer, une hache affûtée, la chèvre et sa scie.
Dans le renfoncement, une épaisse porte cloutée s’ouvre sur une salle voûtée dont le sol pavé héberge tout un tas de tonneaux. Dans une autre salle éclairée d’une fenêtre à petits carreaux, on entrepose le bois de traverses, le charbon et la « vase » de poussier, pauvre, malodorant combustible.
De la première salle, on va à la cour où logent volailles et lapins. C’est par là que grand-mère est entrée pour distribuer leur nourriture et lever les œufs qu’elle dépose au creux de son tablier. Opportunément, grand-père l’a suivie, il s’est assis sur une cage vide et profite de l’harmonie du moment.
Grand-mère brasse à pleines mains la pâtée de pommes de terre et de son qu’elle répartit dans les gamelles. Sous la pluie de grains, les poules caquetantes se bousculent. Les canards piétinent carrément leur pitance et barbotent dans l’eau claire que le broc a déversée. Le chat Bibiloup qui sommeillait dans l’ombre vient se nicher dans un soupirail ; son pelage rayé roux et blanc cousine avec le soleil. Il entreprend de se lécher, cligne ses beaux yeux verts, s’interrompt pour observer les allées et venues de la basse-cour. S’intéressait-on à lui ? Il choit sur le flanc. Aux deux coins supérieurs du rectangle lumineux, les toiles d’araignées ondulent, s’enflent sous la brise…
—… C’est Jeanne qui te l’a dit ?
— Elle est venue taper au carreau.
— Brave femme ! Toujours là pour un service… Eh bien, tu vois, Marie ! a simplement dit grand-père, dans sa sérénité. Quand est-ce que tu y vas ?
— Demain. Je prendrai le train du matin, je ferai l’aller et retour. Tu t’occuperas bien des petites ?
— Tu n’as pas à t’inquiéter, je les prendrai avec moi au jardin.
Adieu la rue poussiéreuse ! Jardin… il a dit jardin !
Dans la remorque attelée à la bicyclette, sont placés à côté de nous une serfouette et deux paniers en berceau que nous avons mission de maintenir pendant le voyage. Rendu au bout de la rue, l’équipage s’élance, il tangue. Il va droit dans l’avenue. Il recueille des bonjours. Penché en avant, le béret sur la tête, grand-père pédale avec vigueur. Les paniers sautent sur la tôle. Nous nous cramponnons aux ridelles.
Les vitrines défilent sous nos yeux : la charcuterie avec son cochon hilare, le bazar, ses objets caoutchouteux et mortuaires, les cartes postales sur les tourniquets, la maison Touret. La bijouterie, la pharmacie : sa croix blanche intermittente. La bonneterie, les primeurs Chalchat…
« Peu-tain ! » Grand-père redresse la tête. Il nous offre son profil rasé de frais, plus jeune :
— Votre pépé Auguste a les reins brisés !
Sur la gauche, l’église, son clocher tout simple. Il est trois heures. À droite, comme un manège, la halle aux marchés sous son toit en poivrière. D’autres magasins, vieux, le dernier bistrot, le fumiste, un boulanger. L’amorce d’un dos-d’âne et nous accrochons un morceau de rivière. Bifurcation dans le chemin qu’elle côtoie… Paniers, passagères se bousculent, chavirent, se réinstallent. Nous retenons nos chapeaux, éblouies par l’éclat du soleil dans le courant.
Sous la voûte du moulin, l’attelage s’immobilise. La tête tourne, les pieds retrouvent la terre ferme. Avec pré-caution, grand-père s’approche de la berge d’où il nous fait signe. Cette vague forme argentée qui fond, là, entre deux eaux…
— C’est un barbeau, souffle-t-il tout bas, et pour moi, il doit y en avoir d’autres. Vous l’avez vu ? Bon sang, il faudra que je revienne !
Nous l’observons pendant qu’il roule sa cigarette. Et nous savons que, dès son retour, il se mettra en devoir de monter une ligne, taquiné par grand-mère :
— Ballot, va ! Si encore tu ramenais quelque chose…
Lui, aura l’air d’un gros chat en confiance qu’on caresse et qui ronronne.
Quittant la voûte du moulin, nous passons au grand jour. La roue, à gros bouillons, brasse l’eau du bief, méandre assez large dans l’anse duquel le flot sans hâte se répand et se renouvelle. Lentement, la nappe transparente s’amenuise jusqu’à une mince grève d’herbe sablonneuse. Là, trois laveuses se racontent parmi corbeilles et baquets. Comme fourmis en été, les mots s’activent, s’amplifient, coulent de leurs bouches intarissables, rythmés par le tap-tap sourd des battoirs. Et les murs du vieux moulin les recueillent, s’en gargarisent et les redonnent à l’eau vive qui les happe, les entraîne.
Les femmes s’agitent. Leurs mains meurtries brassent, plaquent les étoffes sur la pierre, les forcent dans le courant, les étalent, vingt fois les font aller et venir, tordues en saucissons ruisselants, entassées dans les panières. L’eau gicle, ricoche, rebondit. Les ventres des tabliers sont trempés, les yeux étincellent.
Des diminutifs affectueux nous interpellent :
— Coucou ! Nanou ! Venez…
Le chemin reprend entre la rivière et la murette des jardins. Je cueille les fruits durs de l’aulne dont les branches difformes traînent dans le courant. Ses racines délimitent un bassin de sable grouillant d’alevins de verre qui se dispersent quand j’approche…
Nous n’avions pas songé que la venue d’un enfant pût à ce point tout remettre en question et créer d’autres bouleversements que ceux qui nous poussaient à faire le décompte des jours, à lui inventer une figure, un prénom. Nous cherchions qui de nous deux aurait la chance de lui plaire, de partager ses jeux, d’être à son image. Il semblait que pour Nicole tout fût couru d’avance, même si elle dissimulait bien ses sentiments. Quant à moi, il y avait longtemps que m’avait été donné le moyen de me sauver ; étant l’aînée, je trouvais normal d’aller seule, le plus souvent, passer les vacances auprès de nos grands-parents.
Sans problème je m’adaptais à leur vie qui prenait son temps, vie simple de cheminots nourris des voyages qu’ils avaient rêvés, qu’ils s’étaient résignés à ne jamais faire, tous leurs déplacements ayant consisté à sauter d’un département à l’autre, si bien qu’à la longue l’esprit s’était plus ou moins formé à ce roulement. Ainsi grand-mère pensait-elle mourir sans avoir jamais vu la mer.
Sa famille était venue de Corrèze et elle me semblait refléter l’essence et les paysages de cette terre : modestie des bâtisses parmi les lambeaux de verdure, suavité des landes habitées de la sourde élaboration des étangs, rusticité des châtaigneraies et des terres pauvres, malaisées à exploiter, qui font l’humilité. En fait, Marie était née en Haute-Loire où elle avait connu Auguste, mon grand-père. Son père, mineur, devenu meunier puis coiffeur, s’était rendu propriétaire d’un ancien relais de poste dans ce bourg de Lempdes-sur-Alagnon. Une seule pièce au rez-de-chaussée, une à l’étage. Au-dessus, le grenier. L’ensemble avait l’air d’un grand pigeonnier ou d’un pain de sucre, avec son toit tronconique habillé de tuiles romaines.
C’est ici que nos grands-parents allaient se retirer, dans cette maison coincée au fond d’une rue qui inspirait à notre grand-mère de soudaines répulsions et envies d’ailleurs, loin de la promiscuité, de chaumières isolées ayant pour limites une voie ferrée, un jardin, une basse-cour, un grenier bien rempli. Elle réprimait difficilement la nostalgie de ses maisonnettes, ses « barrières » devenues, à force de dépendre de sa frêle personne, prolongement de son corps et de sa pensée – au point qu’à l’heure de la retraite, faute d’avoir connu d’autres fonctions, toute une partie d’elle s’était trouvée amputée.
À l’inverse, grand-père semblait avoir mûri ses lendemains. Poseur de rails promu chef d’équipe, le travail, quel qu’il soit, lui profitait toujours. L’hiver, il triait la semence, fendait le bois, aidait à la confection d’écheveaux et savait aussi réparer un panier, dégripper une serrure ou un cadenas, dont il éprouvait avec intérêt le bon fonctionnement. Il reconstituait les objets les plus irréparables, faisant de deux pièces orphelines un seul morceau utile, façon de leur redonner une chance, une nouvelle destination. Il disait le plaisir qu’il y avait à se réaliser dans une tâche, et savait se ménager du temps (« J’en prends cinq ») pour s’appuyer sur le manche d’un outil, laisser vagabonder ses idées, réfléchir sur les siens ou sur sa vie, lire et relire La Liberté. Il nous aimait sans s’imposer. Personne n’a su aussi bien nous regarder, déceler en nous la petite différence.
Le soir, il avait l’air de rêver, mi-grave mi-tendre à mesure qu’il avançait en âge. Quand on le lui demandait, il parlait de Damiette, de Salonique, avec tous les horizons marins dans son regard. Marie l’écoutait, elle voyageait avec lui, un regret très vague sur ses lèvres minces. Lui, superbe, appelait l’Orient. Son regard rivalisait avec la Perse, le bleu des mers et des fleuves, et c’était le Bosphore, les Dardanelles qui s’acheminaient en nous. Tandis qu’il s’épanchait, il toussait : souvenir de la mine, nous disait-il, où il descendait pour assister sa famille, dès avant l’âge de douze ans.
Les poissons aux ventres transparents sont revenus dans la petite flaque de soleil. Ils s’habituent à mon image au-dessus de l’eau. Grand-père, dans cet intervalle, s’est arrêté devant une poterne surmontée d’un auvent de tuiles creuses. La grosse clé, grinçant dans la serrure comme les ailes d’un moulin, a libéré le panneau de bois qui ouvre sur un large espace de cultures et de ciel.
Le jardin aux bordures fleuries le long des allées tracées au cordeau n’abrite pas une herbe ! Rien que de la terre grasse d’où jaillissent des centaines de miracles de la nature, que fièrement grand-père nous présente.
Chaque année, il sélectionne avec soin les graines dont il fera des phénomènes à force de binages, de fumures et d’arrosages. Avec de tels traitements relevés de pralinages, les poireaux (Monstrueux de Carentan) deviennent aussi gros que le bras. Les carottes sont « Nantaises », les haricots nains ont pour nom Contender, ceux à rames : Saint-Fiacre, Soissons. Les fraises Madame Moutot donnent de nombreux fruits larges et côtelés, délicieusement sucrés, que grand-mère prépare au vin ou en confitures. Mais le grand-père taquin préfère les tomates, ces enjôleuses au sauvage parfum que je compare aux morelles des haies, leurs cousines.
Il élimine sans regret les derniers rameaux. Ce n’est pas des arbres qu’il veut, qui vont couler dès les premières pluies ou courber l’échine aux premières chaleurs, au moindre coup de vent ! Il sacrifie les fruits les plus chétifs, ceux des extrémités qui alourdissent et appauvrissent la plante. Praliner, tailler, tuteurer, bassiner sont les conditions du bien-être de ces fardées qui ont droit à la meilleure exposition en plein cœur du jardin, à l’abri d’autres plantes d’aimable compagnie. Il est également bon de prévoir la visite des courtilières en préparant des pièges à la mesure de leur faim. Les petites bêtes aux mandibules broyeuses de racines ne peuvent imaginer quelle ingéniosité, quelle gymnastique des doigts nécessitent ces ouvrages de défense ! Quelques longueurs de fil électrique de récupération ; cerné par une tranchée, chaque pied reçoit un palis de bâtonnets enterrés autour desquels plusieurs fois le fil s’enroule.
— Si elles y mordent, promet grand-père, elles s’y casseront les dents !
Pauvres courtilières, heureuses tomates si choyées et qui paient bien en retour, étant aussi peu ingrates que vaniteuses…
Un seul arbre, au jardin, respectable cerisier à gros fruits blancs, à chair ferme et douce, sanguine autour du noyau. Du fait de sa situation centrale, l’ancêtre qui donne autant de racines que de ramure cause à grand-père bien du souci. Il l’élague à mort puis finit par le condamner, le jour où s’étant mis à dépérir de sa propre initiative, le gêneur bâille comme un vieux fruit sec pour offrir l’hospitalité à toutes sortes de nuisibles. Il sera facile de l’ouvrir jusqu’au pied, son bois pourri ne résistant pas au fil de la hache. Fendu, débité, séché, il régalera les veillées de douceur printanière.
Des fleurs !… Dahlias hauts comme des hommes, aux pétales finement tuyautés à l’intérieur desquels abeilles et bourdons de velours s’insinuent en oscillantes révérences. Des glaïeuls blancs, des lupins dont la hampe s’égrène, les laissant hérissés de semence vert tendre. Des reines-marguerites, toute une bordure d’œillets mignardises, des pourpiers rouges et jaunes qui rampent sur la terre comme d’énormes araignées. Et puis les rosiers qu’un hiver mon père apporta…
Grand-père va à son aise dans cet endroit qu’il a créé. Il passe près du banc où nous restons à l’abri du soleil, ayant à chaque main un arrosoir dégoulinant de l’eau du bief. Bientôt, n’y tenant plus, il nous tire de nos songes :
— Viens voir, Nanou. Viens voir les tomates, comme elles ont soif !
Nous l’accompagnons dans le labyrinthe des allées, évitant à chaque pas les petits cratères de terre des gouttes échappées. Nous longeons le carré de choux qui, nous le savons, n’ont jamais donné naissance à des bébés. Maman avait dit : « Nous l’appellerons Jean-Marc si c’est un garçon, Françoise si c’est une fille… » Ce sera Françoise !
Pour l’heure, grand-père nous emmène jusqu’au bief, afin que nous voyions l’eau s’engouffrer dans les arrosoirs immergés tour à tour ; et je vois l’abondance, je vois la vie dans ces deux ustensiles galvanisés.





























