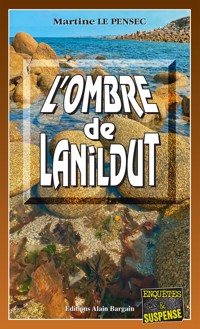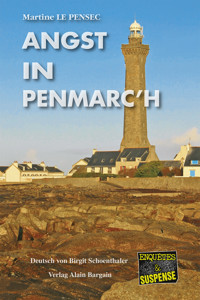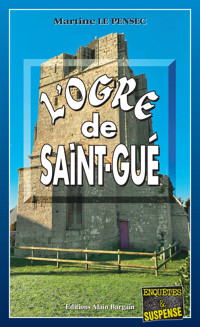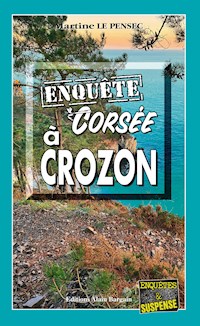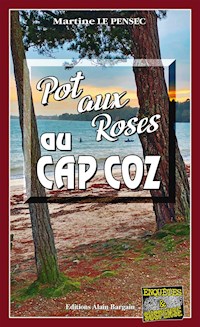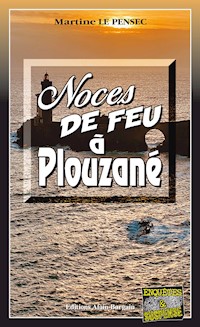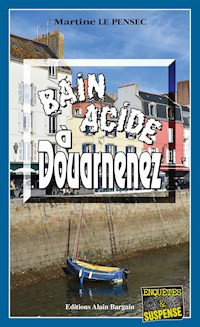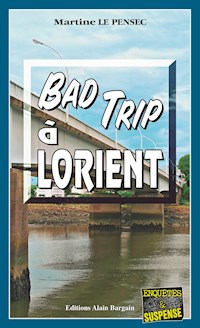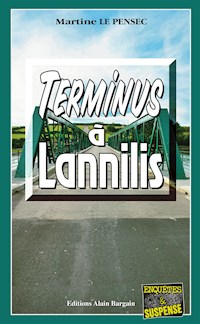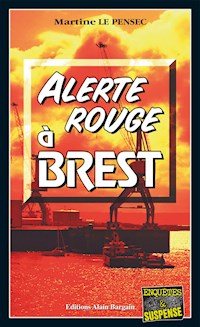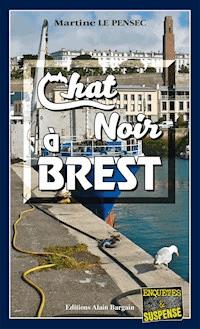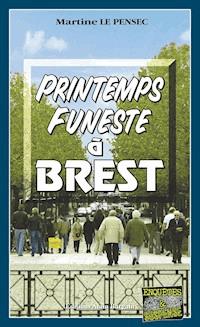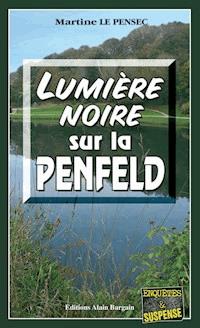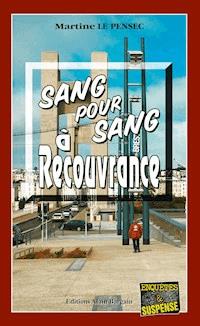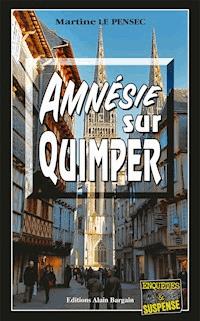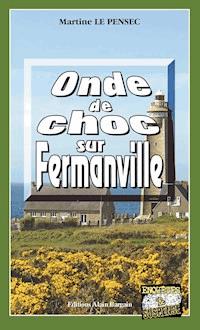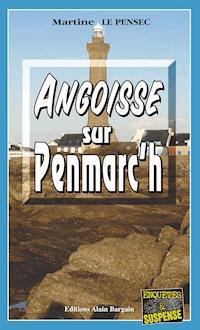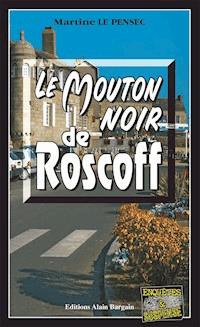
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Léa Mattei, gendarme et détective
- Sprache: Französisch
Un mouton noir tente d'éliminer les témoins de ses forfaits...
Rose, l’ex-compagne d’un policier véreux, Franck Koob, un énigmatique cuisinier, Ben, et une pyromane, Zoé, mais aussi Léa Mattei, technicienne en identification criminelle de la BR de Brest, en congé de maternité, séjournent à Roscoff. Coïncidence ? Léa occupe la maison d’une journaliste assassinée l’année précédente à New York. Curieux hasard, c’est Rose qui l’avait découverte mourante alors qu’elle était venue lui parler de l’affaire Koob, et qui, ayant fait la connaissance de Léa, tombe sur une photo de la victime chez l’enquêtrice. Celle-ci, pour s’occuper, se penche sur l’affaire, mais la situation se complique rapidement car un meurtre est perpétré. De tests ADN en confessions posthumes, Léa peine à remonter le fil de cette histoire ancienne, tandis qu’un mouton noir tente d’éliminer les témoins de ses forfaits...
Découvrez le tome 6 des enquêtes de Léa Mattei, un roman policier qui vous happera dès la première page et vous plongera dans une enquête où les fils et les secrets s'entremêlent.
EXTRAIT
Ses larmes se mêlaient aux gifles de pluie. Rose était bouleversée. Son passé venait de remonter à la surface comme une bulle nauséabonde éclatant à la surface d’un marécage. À six mille kilomètres de la France, il plantait encore ses crocs dans sa nuque.
Pourrait-elle un jour l’oublier ? Elle était aussi terrorisée par la tempête. Perdue dans ses pensées, à la sortie du restaurant, elle avait erré dans Central Park, tout proche, ignorant les nuées menaçantes. Maintenant, elle hâtait le pas, consciente de son imprudence. Ses Converse gorgées d’eau faisaient un bruit de succion à chaque pas. Il n’y avait plus âme qui vive dehors.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Éditions Bargain, le succès du polar breton. -
Ouest France
À PROPOS DE L'AUTEUR
Née à Cherbourg,
Martine Le Pensec vit et travaille à Toulon. D’origine bretonne et normande, elle puise son inspiration dans l’Ouest et le domaine médical dans lequel elle a travaillé plusieurs années. Elle signe, avec
Le Mouton Noir de Roscoff, son treizième roman policier.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
« À chaque troupeau, sa brebis galeuse ! »
Stanislaw Jerzy Lec
« Le seul chemin qui mène à la délivrance passe par la découverte et la reconnaissance du caractère unique de son identité. »
Henry Miller
- Merci à tous ceux et celles qui m’encouragent et me suivent, maman, Jean-Marc, Rose-May, Raphaëlle, Suzy, Cyrielle, et mes copines qui se reconnaîtront.
- Un petit clin d’œil à Lulu, le chat qui a agrémenté ce roman de sa présence discrète, sans oublier Ophélie “première dame de la maison” !
I
Manhattan
Cette fin d’après-midi était plus sombre que le cœur de la nuit. New York faisait le gros dos sous la poussée des éléments déchaînés. Chassées par des vents colossaux, les masses d’eau de la tempête Sandy commençaient à s’abattre sur Manhattan. Aveuglée par les trombes d’eau qui la giflaient sans relâche, et glacée jusqu’aux os, Rose Neuville avançait mécaniquement. Un pas, puis un autre. Sortir de ce cauchemar. Son sac fourre-tout pesait une tonne sur son épaule. Elle avait raté le dernier train pour Long Island. New York venait de plonger dans le noir. Rares étaient les immeubles munis de groupes électrogènes qui fonctionnaient encore. Lueurs de vie au cœur du néant énergétique qu’était devenue la ville en quelques heures. Tous les transports s’étaient arrêtés en attendant l’œil du cyclone.
Ses larmes se mêlaient aux gifles de pluie. Rose était bouleversée. Son passé venait de remonter à la surface comme une bulle nauséabonde éclatant à la surface d’un marécage. À six mille kilomètres de la France, il plantait encore ses crocs dans sa nuque. Pourrait-elle un jour l’oublier ?
Elle était aussi terrorisée par la tempête. Perdue dans ses pensées, à la sortie du restaurant, elle avait erré dans Central Park, tout proche, ignorant les nuées menaçantes. Maintenant, elle hâtait le pas, consciente de son imprudence. Ses Converse gorgées d’eau faisaient un bruit de succion à chaque pas. Il n’y avait plus âme qui vive dehors. Les rares passants fuyaient la tempête en rasant les murs. Le réseau téléphonique était hors service et elle ne pouvait même pas joindre les Collins, ses employeurs, pour les rassurer. Elle avait pris son jour de liberté et n’était pas attendue avant demain matin par eux. Pour le lever des filles et leur petit-déjeuner. Rose était jeune fille au pair chez ce couple aisé de Long Island, rencontré à Paris, depuis deux ans. Un emploi et une expatriation tombés à point.
Exceptionnellement, dans la ville qui ne dort jamais, les commerces avaient déjà baissé leur rideau de fer. Elle comprenait que son inattention allait lui coûter une nuit d’enfer, ne sachant où s’abriter.
Un pas devant l’autre.
Elle descendait Manhattan machinalement. Times Square avait cessé de clignoter violemment. La 6e Avenue était vide et sombre. Elle manqua de se faire écraser par un taxi jaune qui rentrait s’abriter et les injures du conducteur se perdirent dans une bourrasque. Une gerbe d’eau glaciale acheva de la tremper. Derrière le rideau de pluie, elle aperçut les toilettes de Bryant Park, à l’angle de la 42e et de la 6e avenue. Elle claquait des dents en abordant le trottoir. Le refuge était à portée. Les branches des arbres du parc penchaient dangereusement dans le sifflement ininterrompu du cyclone. Elle s’engouffra dans l’entrée. Une forme sombre la heurta violemment, l’envoyant valdinguer sur le mur. Ses protestations se perdirent dans le vent tandis que l’obscurité avalait l’impoli. Elle n’avait pas pu distinguer si c’était un homme ou une femme.
L’eau commençait à rentrer dans le couloir. Une fine pellicule frémissante qui augurait de la suite. Malgré tout, l’endroit lui paraissait accueillant, l’abritant du vent démentiel et des trombes d’eau. Au fond du couloir, le magnifique pot de fleurs artificielles qui décorait l’endroit lui parut en désordre. Comme s’il avait été bousculé, lui aussi, et des traces rouges maculaient son bord. Les plantes lui parurent légèrement de travers. Elle prit l’entrée de gauche, celle des toilettes des dames. La préposée, peu commode en temps ordinaire, avait déserté le poste, elle aussi. Elle posa son sac détrempé sur un lavabo et s’observa dans le miroir. Il lui sembla qu’elle avait pris dix ans depuis le moment où elle avait quitté le confortable appartement des Collins. Ses cheveux bruns, collés par l’averse, pendaient lamentablement en s’égouttant dans son cou. Visage blême. Cernes noirs. Elle ouvrit son sac à la recherche d’un linge pour s’essuyer. Tout était humide à l’intérieur, mais elle trouva tout de même un mouchoir propre dans une pochette hermétique.
Rose frotta vigoureusement sa chevelure et démêla ses mèches trempées à la brosse. Elle frissonna. Le vent qui s’engouffrait fit claquer une des portes des toilettes. Celle-ci rebondit deux fois sur le mur. Agacée, elle se dirigea vers elle pour la fermer. Il lui sembla percevoir un gémissement autre que celui de la tempête. Tandis que sa main attrapait la poignée, son cerveau enregistrait le spectacle qui s’offrait à elle. Une flaque de sang finissait de s’écouler devant une femme. Posée sur le siège fermé des toilettes, elle s’était affaissée sur sa gauche. Ses yeux grands ouverts, écarquillés de surprise et de terreur, se ternissaient tandis que les dernières gouttes de l’hémorragie coagulaient. Rose la vit tenter de tendre une main vers elle. Une bulle sanglante explosa au bord de ses lèvres.
Tranchée d’un bord à l’autre, sa gorge béait d’un horrible sourire. Rose marqua un temps d’arrêt avant de pousser un hurlement strident.
II
Roscoff
Rose Neuville gara sa petite voiture sur le parking en épi, face à la mer, de la rue Édouard Corbière. Son seul luxe car ses finances n’étaient pas au mieux de leur forme. À donner des cours de rattrapage à droite et à gauche, elle peinait à joindre les deux bouts. Ses yeux glissèrent sur la mer. Un vent sec avait dégagé les nuées de la veille et faisait claquer les crêtes blanches sur la grève. L’île de Batz se découpait à portée de regard.
Sa voiture était vieille, cent dix mille kilomètres au compteur, et la fermeture centralisée ne fonctionnait plus, mais elle lui permettait de travailler et c’était là l’essentiel. C’était tout ce qu’elle avait pu s’offrir en rentrant en France. D’un pas décidé, elle traversa la rue et poussa la porte d’une maison en pierre. Comme toutes celles de la rue, sa toiture était faite de fines ardoises. Elle croisa le regard d’un homme âgé, accoudé à la fenêtre du bas.
— Bonjour Paulin, on prend le frais ?
La réponse de l’homme se perdit dans le vent.
Rose traversa le couloir sombre et prit l’escalier. Elle occupait deux pièces à l’étage, face à la mer. Une belle pièce d’une quinzaine de mètres carrés qui lui servait aussi de salon et une cuisine d’environ cinq mètres carrés, accolée à une petite salle d’eau.
C’était Paulin Levasseur, soixante-douze ans, qui lui louait l’étage de sa maison. Il avait ainsi trouvé le moyen d’arrondir sa retraite de marin pêcheur. Cela le sortait aussi de son isolement car sa femme Bleuette, ancienne sage-femme, était gravement malade. Le vieil homme au visage cuit par les embruns semblait apprécier la jeune femme discrète qu’était Rose. Elle posa ses clefs sur la petite commode près de la porte de son appartement et ouvrit la fenêtre pour laisser entrer les effluves d’iode. Dans l’ouverture, elle respira à pleins poumons avant de refermer. Son regard croisa son image dans le miroir et elle fit une grimace. En peu de temps, sa chevelure s’était émaillée de fils gris. Même sa frange brune s’était éclaircie d’une mèche argentée. Pourtant, Rose n’avait que vingt-huit ans.
Le front appuyé sur la vitre fraîche, les yeux dans le vague, elle songeait. La vie ne l’avait pas épargnée ces cinq dernières années…
Cela faisait quelques mois qu’elle était revenue de Manhattan et tentait de se recréer une nouvelle vie. Le meurtre découvert en pleine tempête Sandy, dans les toilettes de Bryant Park, resterait à jamais gravé dans sa mémoire.
Surmontant le choc, après avoir pris la main de la victime et reçu son dernier soupir, elle était ressortie des toilettes publiques. La tempête faisait rage, lui coupant le souffle. À l’angle de la 42e rue et de la 3e avenue, elle avait pris la direction du Sud. Le siège de NYPD1 se trouvait 1, Police Plazza Path, à proximité du Pont de Brooklyn. Des dizaines de rues à descendre dans une atmosphère de fin du monde. Plus elle descendait et plus l’eau envahissait Manhattan, mais elle avançait. Son arrivée au siège de la police new-yorkaise avait fait taire le brouhaha.
Telle une apparition fantomatique, blême et échevelée, elle s’était laissée glisser à terre, épuisée. Le reste demeurait flou dans sa mémoire. Des bras qui la soulevaient, un café brûlant, ses dents qui claquaient sans pouvoir s’arrêter.
Elle avait fini par dire l’innommable. Séchée par une policière elle avait pris place à l’arrière d’un véhicule et accompagné les forces de l’ordre. Rien n’avait bougé pendant sa descente à Lower Manhattan. Un peu plus d’eau était rentrée dans le local, mais le cauchemar n’avait pas disparu. La femme égorgée gisait toujours dans les toilettes. Avant qu’on la raccompagne à Long Island, Rose avait dit ce qu’elle savait. Cette femme se trouvait à sa table, dans un sushi de la 56e rue. Elles ne se connaissaient pas mais avaient mangé ensemble et parlé tandis que le cuisinier faisait son show. Elles avaient échangé leurs prénoms. La victime s’appelait Marine.
Rose n’avait pas tout dit.
1 NYPD : New York Police Department.
III
Un bloc de haine.
La jeune femme au visage farouche se serra dans sa veste noire comme ses cheveux aile de corbeau.
Tout en elle n’était que contraste. Visage de craie, cheveux de nuit, amour, haine, lucidité, folie, fragilité, violence.
Trente ans, mais elle paraissait à la fois jeune et vieille. Au premier regard, on pensait voir une ado boudeuse. Au deuxième, d’infimes traces du temps, et d’autres choses, laissaient deviner une certaine usure. Malgré la silhouette juvénile, on sentait la fraîcheur envolée depuis longtemps.
Un quelque chose de fané.
Elle huma l’air quelques secondes et prit la direction de Pontigou. Le quartier comptait des immeubles et le sien subissait, comme les autres, les affres du temps. Le petit immeuble de trois étages aurait eu bien besoin d’un ravalement de façade. Des traînées de rouille avaient coulé sous les balcons. Nombre d’entre eux étaient fermés par des vérandas vitrées. L’appartement de Zoé Foucher, au dernier étage, en faisait partie. Elle poussa la porte d’entrée, ouvrit sa boîte aux lettres, compulsa les courriers et entama la montée des étages, un pli amer à la bouche. Une journée de plus sans nouvelles, songeait-elle. Ça la rongeait.
Elle posa son pain dans la cuisine, ôta ses chaussures qui restèrent là où elle les avait quittées. Tout en avançant vers la salle d’eau, elle dispersait ses vêtements. Le pull tomba sur le dossier d’un petit canapé. Le jeans abandonné au pied du lavabo ne formait plus qu’un petit tas noir et informe. Slip et soutien-gorge traversèrent le minuscule local et glissèrent le long de la porte jusqu’au sol.
Zoé ouvrit l’eau. Elle poussa un soupir de détente en sentant la chaleur du jet sur son corps. C’était un comble, elle qui appliquait des douches au jet aux curistes de la thalasso locale, attendait la sienne avec impatience. C’était le moment où elle débranchait, se détendait un peu. Ses épaules durcies par la tension nerveuse se relâchèrent peu à peu. La buée chaude avait rempli la petite pièce et Zoé laissait s’écouler l’eau et le temps. Au bout d’un long moment, elle s’obligea à couper le jet. À regret.
Revenir au présent et à l’infernal questionnement.
Pourquoi ?
*
Rose rêvassait sur son lit tandis que la lumière baissait. Enfin, « rêvassait » c’est un grand mot. Elle remuait plutôt de sombres souvenirs et un passé nauséabond. Elle avait eu de la chance de s’en tirer à bon compte et qu’on ne lui colle pas de la complicité sur le dos…
À vingt ans, Rose vivait à Paris et préparait, mollement, une licence de Lettres. Elle était née à Roscoff d’où était originaire sa mère puis, jusqu’à ses dix-huit ans, elle avait vécu à Versailles, fille unique d’un couple qui s’était séparé après son bac. Famille éclatée. Sa mère avait suivi un nouveau compagnon aux Pays-Bas et son père avait choisi l’Amérique du Sud pour refaire sa vie. Un grand écart qui reflétait bien leurs dissensions.
Rose avait opté pour une vie indépendante, toujours à Paris. Elle s’était inscrite en Fac et travaillait dans un fast-food près de Montparnasse, plusieurs soirs par semaine. C’était là qu’elle avait rencontré Franck Koob. Le policier, né en France mais d’origine belge, avait du charme et de l’assurance. De douze ans son aîné, il menait un train de vie qui l’avait conquise. Aurait-elle dû être plus méfiante ? Avec Franck, c’était la grande vie. Grands restaurants, voyages, vêtements griffés… elle avait quitté sa chambre universitaire pour partager son très bel appartement dans le 15e arrondissement.
Si elle avait été moins naïve, elle aurait deviné que Franck était un ripou, un policier qui « faisait des ménages », comme on dit chez eux. Il prenait sa dîme sur les saisies, arrangeait le coup pour certains gangsters… Mais il avait aussi franchi un cap décisif en s’associant avec des dealers. Elle avait noté sa nervosité les derniers temps, son regard durci, plus affûté. Il disparaissait des nuits entières. Sa vie avec Franck avait duré quatre ans. Et puis, un matin à l’aube, d’autres policiers avaient enfoncé la porte de leur domicile. Avec l’arrestation d’un dealer, l’organisation de Franck s’était écroulée. Dans ses yeux, elle avait perçu une lueur inquiétante, une petite flamme de folie. Le lieutenant avait tenté de s’échapper. Il était violent. Mais ses collègues, nombreux, avaient eu raison de lui. Rose était tétanisée. Juste avant qu’ils ne l’emmènent, Franck avait défait sa montre de son poignet.
— Tiens, garde-la pour moi. Où je vais, on va me l’enlever de toute façon !
Elle avait saisi la lourde Rolex qui gardait encore la chaleur du poignet de son compagnon. Le juge l’avait reçue par la suite, mais aucune charge n’avait été retenue contre elle. Franck payait tout. Rose n’avait que son livret d’épargne maigrement pourvu par ses salaires du fast-food, qu’elle avait économisés avant de quitter cet emploi pour vivre avec le policier.
Elle avait mis six mois à accepter de vivre complètement avec lui et, pendant cette période, il l’entretenait déjà. Elle avait trois mille euros à elle. Pas de quoi fouetter un chat.
Franck avait été incarcéré. Plus on fouillait, plus on trouvait de crimes et délits. L’ancien policier ne s’était pas gêné pour faire le ménage autour de ses affaires. Trois hommes en avaient fait les frais.
De celui d’un ripou, le dossier était passé à celui d’un criminel. Incarcéré à Fresnes en attendant son procès, Franck Koob s’était montré difficile et violent, multipliant les descentes en cellule d’isolement. Jusqu’au jour où il avait éventré un autre détenu dans les douches, dans une crise de violence paroxystique.
Son profil psychiatrique avait conduit l’ancien compagnon de Rose en UMD (Unité de Malades Difficiles) à Plouguernével dans les Côtes-d’Armor. Son transfert de la prison vers l’asile psychiatrique s’était fait en vertu de l’article D-398 du Code de Procédure Pénale. Internement d’urgence signé par le préfet.
Rose ne l’avait plus revu après son arrestation. N’étant pas mariée ni pacsée, son avocat lui avait conseillé de couper court à toute relation avec lui. Ce qu’elle avait fait, épouvantée par l’homme qu’elle avait découvert depuis l’arrestation. Par la suite, l’avocat lui avait fait part de son internement.
Quelques semaines après cette arrestation mouvementée, Rose, qui avait repris un emploi de serveuse dans une brasserie, avait sympathisé avec les Collins, venus visiter Paris avec leurs deux filles. Le courant était si bien passé entre eux qu’ils lui avaient proposé une place de jeune fille au pair, chez eux, aux USA. C’était inespéré pour tourner la page. À la fin de cette année-là, Rose s’envolait pour Long Island et oubliait Franck.
IV
Léa Mattei fronçait les sourcils en observant le paysage.
— Tu es sûr, tenta-t-elle…
— Ah non, coupa Marc Guillerm, tu ne vas pas recommencer ! On en a déjà parlé. Il faut que tu te reposes et, à la BR, tu sais bien que c’est impossible. Tu ne débranches jamais, et je te connais, dès que tu me sens sur la brèche, tu ne dors plus.
Léa soupira. La jeune femme savait que son compagnon avait raison. Marc Guillerm était le patron de la Brigade de Recherches de Brest. Commandant de gendarmerie. Et elle était son adjudant-chef. TIC, technicienne en Identification Criminelle. Mais aussi, accessoirement, sa compagne depuis l’année passée. Une relation sentimentale qui avait fini par s’installer après bien des péripéties. Pour l’un comme pour l’autre.1 Lui, Marc, après un bref mariage avec Magali, avait trouvé le bonheur auprès de Claire. Un bonheur éphémère, brisé net en quelques semaines. Sa compagne avait été emportée par une leucémie fulgurante.
Elle, Léa, avait commencé sa carrière dans le Sud. En Corse d’où elle était originaire, puis à Marseille. Elle avait vécu là un amour passionnel et destructeur avec Gilles, son supérieur. Léa avait choisi de le fuir et demandé une affectation à Brest pour mettre de la distance entre eux. Elle connaissait déjà Marc Guillerm qu’elle appréciait. Sa présence avait orienté son choix. Mais Gilles n’avait pas lâché prise et l’histoire avait repris malgré tout. Jusqu’au drame pour tous les deux. La femme de Gilles s’était suicidée au moment de leur divorce et Léa avait perdu le bébé qu’elle attendait. Fin de l’histoire. Petit à petit, les deux collègues de travail s’étaient rapprochés et désormais aucun doute n’était plus permis. Car…
— Être enceinte, ce n’est pas une maladie ! ronchonna Léa.
Marc lui jeta un regard en coin avant de répondre :
— Ma chérie, dois-je te rappeler que tu as trente-sept ans et, surtout, que cet enfant est miraculeux, après la fausse couche tardive que tu as faite il y a deux ans ?
Malgré elle, Léa devait en convenir cette grossesse était tout simplement miraculeuse. D’ailleurs, elle ne s’y attendait pas du tout, persuadée d’être désormais stérile.
— Le médecin a été très clair, de la détente et du repos. Aucune tension nerveuse. À six mois passés, ce serait dommage de revivre le même drame, tu ne crois pas ?
Léa hocha la tête. L’inactivité lui était difficile à accepter, mais Marc avait raison. Cet enfant non planifié était leur dernière chance d’être parents. Ni lui ni elle n’avaient d’ailleurs voulu connaître le sexe du bébé lors de l’échographie des quatre mois et demi. Peur de s’attacher, de trop idéaliser ce petit bout ? Les deux gendarmes étaient prudents.
— Tu devrais être contente, ton amie Laure t’a déniché une petite maison face à la mer, où tu seras très bien.
La jeune femme sourit. C’était vrai que Laure, dite LSD2, une journaliste connue qu’elle appréciait, s’était mise en quatre pour elle. Elle avait battu le rappel de ses connaissances et l’une d’elles, s’absentant quelque temps, ne demandait pas mieux que de lui laisser la jouissance de son domicile contre… l’arrosage des plantes et surtout la garde du chat. Un pépère de huit ans indéracinable. Bicolore, blanc et gris foncé, Lulu ne connaissait que son coin de Roscoff. Une fois, emmené en vacances à quelques kilomètres de là, il s’était empressé de revenir à son domicile, sans compas ni boussole, mais avec son seul instinct. Depuis, il était surnommé GPS !
Donc pas question d’emmener Lulu ailleurs et Léa tombait à point nommé pour occuper les lieux et nourrir le matou.
— Et puis tu sais, je te rejoindrai chaque fois que le boulot m’en laissera l’occasion.
— Donc pas souvent, conclut Léa avec fatalisme.
Marc soupira. Léa avait du caractère.
1 Voir Le Cobra de Brest, du même auteur aux Éditions Alain Bargain.
2 Voir Masques de terreur à Lanmeur, de Michel Courat, même collection.
V
Paulin Levasseur souleva le couvercle de sa marmite et huma le fumet qui en sortait. Un copain venait de lui amener une paire de langoustes et le retraité se réjouissait de ce repas amélioré.
Il entendit un bruit léger dans le couloir et leva la tête. Rose rentrait. Il se hâta de l’intercepter avant qu’elle ne monte à l’étage. Elle lui jeta un regard fatigué. C’était fou le charme qu’elle avait, se dit-il.
— Fatiguée, Rose ?
— Un peu, mais je ne vais pas me plaindre d’avoir du travail.
Il hocha la tête.
— C’est juste qu’aujourd’hui mes cours étaient un peu dispersés. En plus, tous les élèves n’étaient pas ravis de me voir…
Paulin comprenait. Les parents payaient des cours de soutien à leurs rejetons qui prenaient cela comme une punition. Selon les enfants, certaines heures pouvaient être difficiles pour le jeune professeur.
— Rose, mon vieux copain m’a apporté de la langouste. Ça te dirait de la partager avec moi ?
Elle aurait aimé s’allonger, mais dans les yeux de Paulin, il y avait une attente. Rose capitula.
— Volontiers, Paulin, mais c’est moi qui fais la mayonnaise ! On ne va pas gâcher un si bon produit avec une mayonnaise en pot, n’est-ce pas ?
Les yeux de Paulin pétillèrent.
— Chuis bien d’accord !
— Le temps d’une douche et j’arrive…
Un peu plus tard, devant les vestiges des deux crustacés, Paulin évoquait le passé. Sa vie avec Bleuette, du temps où elle allait bien. Ce temps était révolu. L’ancienne sage-femme avait fait un AVC conséquent qui l’avait laissée hémiplégique et quasi mutique. De plus, elle était atteinte de diabète et restait presque tout le temps dans sa chambre. C’était pour elle que venait quotidiennement une infirmière. Rose avait lu dans ses yeux une indicible tristesse. Paulin relatait aussi sa vie de marin pêcheur. La langouste sur les côtes d’Afrique, la morue en Islande…
— Une autre époque, ma petite, une autre époque où les hommes n’étaient pas des mauviettes !
Une petite lueur avait ravivé ses yeux gris d’un éclat un peu sauvage, l’espace d’un instant. Rose avait songé qu’il avait dû être un sacré gaillard. La conversation se poursuivait dans un doux murmure. Soudain, il fixa Rose et lui dit :
— Ma p’tiote, tu es tout le portrait de ta grand-mère au même âge !
De saisissement, Rose en lâcha sa cuillère.
— Ma grand-mère ? Vous l’avez bien connue ?
Rose se souvenait un peu de cette grand-mère qu’elle avait côtoyée jusqu’à ses huit ans. Toutefois, son visage était flou dans sa mémoire.
Paulin avait détourné le regard.
— Oui, c’est… c’était une belle femme. D’ailleurs, il leva le bras vers la frange de Rose, tu as la même mèche qu’elle.
— C’est fou, ça ! murmura la jeune femme. Un jour, on est partis vivre ailleurs, je devais avoir cinq ou six ans. Puis je suis revenue en vacances chez elle. Deux fois. Après, c’était fini. Je crois que mon père ne l’appréciait guère…
Le regard de Paulin s’était troublé. Il se secoua et dit :
— Allez, assez remué le passé ! Je te ressers une goutte ?
— Oui, merci Paulin. Mais je ne me souviens pas assez de ma grand-mère pour me rendre compte de notre ressemblance… c’est étrange. Le pire c’est que je n’ai pas eu le temps de la revoir…
Rose fronçait les sourcils et tentait de rassembler ses maigres souvenirs de cette époque.
— Je n’ai même pas une photo d’elle. Ça me fait bizarre d’apprendre que j’ai une ressemblance avec quelqu’un parce que c’est plutôt disparate dans ma famille… À vrai dire, je ne ressemble à aucun de mes deux parents… C’est peut-être d’elle que je tiens ces yeux verts… Dire qu’il s’en est fallu d’un cheveu pour que nous nous retrouvions ! Je lui envoyais des cartes postales de New York et quand j’ai voulu revenir en France, j’ai tout de suite pensé à Roscoff et à elle. Même si nous n’étions plus très proches, elle demeurait ma seule parente en France. Mes origines… La vie est bizarre… Elle m’a suggéré par courrier de m’adresser à vous pour un logement et quand je suis arrivée à Roscoff, elle venait de mourir, quelques semaines avant. Je n’ai décidément pas de chance avec ma famille… Mais heureusement qu’elle m’avait conseillé de vous voir pour mon logement, sans quoi le retour aurait été plus difficile !
Paulin s’était levé et grommela une réponse indistincte. Rose soupira et regarda sa montre.
— Il se fait tard. Merci pour le repas.
VI
Rose flânait sur le quai d’Auxerre. C’était là que se tenait le marché tous les mercredis matin. La saison n’était pas encore assez avancée pour qu’explosent la couleur des fruits d’été et le rouge des tomates. Non, c’était encore le temps des carottes, des navets et des poireaux. Le temps des soupes d’hiver qui réchauffent l’intérieur. Elle était libre jusqu’à seize heures. Son panier ne pesait guère lourd. Quelques carottes à râper, deux poireaux qu’elle mangerait en vinaigrette citronnée et des pommes jaunes et roses, ses préférées, des Pink Lady. Ses finances étaient calculées au plus juste. Il y avait peu de place pour la fantaisie dans son budget. Mais Rose ne se plaignait pas. Elle avait l’impression de se réveiller d’un long sommeil. Un tunnel dont elle émergeait à peine. Son histoire avec Franck commençait à reculer dans le temps. C’était comme de se réveiller après une longue maladie. Tout paraissait nouveau et décalé. Cette vie-ci était si différente de celle qu’elle menait à Paris, avec lui ! Le jour et la nuit. Après, il y avait eu les USA où elle s’était jetée dans une autre vie, une autre culture. Elle avait adoré le sentiment de liberté et de sécurité que lui avait procuré New York. Nulle part ailleurs, elle n’avait ressenti cela. À Manhattan, elle flânait en toute sécurité, que ce soit dans la rue ou le métro, dans un anonymat qui l’apaisait. Les jours de soleil, elle s’offrait le parcours de la High Line, cette ancienne ligne de chemin de fer suspendue, reconvertie en parcours fleuri. Une autre façon de découvrir Manhattan.
Ses employeurs habitaient Long Island, une partie huppée du district de New York. Lorsqu’elle avait une journée entière et que la météo s’y prêtait, elle montait dans le métro et filait à Coney Island, à quarante kilomètres de Manhattan. Là, en bord de plage, elle profitait de la mythique fête foraine, avec sa grande roue et, surtout, elle s’achetait un hot-dog chez Nathan’s, son créateur. C’était magique et elle oubliait pourquoi elle avait fui la France. Ces années aux USA avaient été une parenthèse hors du temps. Une bulle spatio-temporelle qui l’avait empêchée de trop réfléchir à ce qui s’était passé, à Franck dont elle avait partagé la vie, à ce qu’elle n’avait pas voulu voir, à sa part de responsabilité.
Rose avait repoussé tout cela à une date ultérieure. Franck, en prison, était, à cette époque, comme une écharde plantée dans son esprit. Elle redoutait l’idée de revenir un jour et de se rapprocher de lui. Ensuite, il y avait eu l’annonce de son décès, à l’UMD de Plouguernével, qu’elle avait reçue dans une sorte de sidération. C’était tellement incroyable et lointain à la fois qu’elle n’avait rien ressenti. Une sorte de blancheur glacée. La mort de Franck n’avait rien eu de glacé par contre. Son avocat lui avait envoyé un courrier pour l’en avertir. Son corps avait été retrouvé brûlé vif dans sa cellule tandis qu’un autre patient de l’UMD s’était échappé dans l’affolement de l’incendie. Quelques lignes pour clôturer tout un pan de vie. Le soulagement n’était venu qu’après, lorsqu’elle avait compris que son contrat de jeune fille au pair se terminait. Elle avait soudain réalisé qu’elle devait rentrer et qu’il n’était plus là, même enfermé. Rose savait que son existence, même derrière des barreaux, aurait pesé sur la sienne comme une menace. Ce temps était révolu et elle pensait qu’elle pouvait revenir plus sereinement. Sa grand-mère, avec laquelle elle avait repris des échanges épistolaires, lui avait proposé de se poser à Roscoff. Elle faillit buter sur un obstacle et leva la tête. Rue Amiral Réveillère, une crêperie s’était fermée et une nouvelle enseigne s’installait. Inattendue : un restaurant de sushis. Rose retint un sourire. À New York, c’était un plaisir qu’elle s’offrait de temps en temps. Elle raffolait de l’enseigne Benihana, réputée dans le monde et où elle pouvait déguster des sushis préparés devant le client. Les cuisiniers de Benihana étaient des artistes qui exécutaient des numéros bien rodés. Sur la grande table chauffante, autour de laquelle huit convives pouvaient prendre place, les légumes sautaient allègrement, avec le poulet. Agrémentés de diverses sauces, ils grésillaient sur la plaque tandis que le cuisinier tranchait les produits avec dextérité.
Elle s’arrêta, le temps de déchiffrer l’affiche. Le commerce ouvrait en fin de semaine. Deux ouvriers finissaient de nettoyer et un homme ouvrit la porte. À sa façon de parler, Rose comprit qu’il s’agissait du patron. Il la regarda et sourit.
— Vous aimez les sushis ?
— Beaucoup, répondit-elle avec un sourire.
— Alors, une bonne raison de vous voir ici. Tenez, dit-il en lui fourrant un papier dans la main. Une invitation de bienvenue pour l’inauguration de vendredi soir.
Rose lut le papier tandis qu’il traversait la rue et montait dans sa voiture. C’était un bon pour un menu. Une aubaine. Ceci améliorerait son ordinaire. Un peu plus gaie, elle se dirigea vers son logement.
VII
Laure avait rejoint Marc et Léa pour leur remettre les clefs et faire le tour du propriétaire. La maison en granit était propre et aménagée avec goût. Plusieurs canapés avaient été disposés dans le bas, offrant des espaces de vie agréables et différents. L’un faisait face au téléviseur, l’autre jouxtait une bibliothèque et du troisième on avait vue sur la mer qui se brisait sur les rochers. Léa apprécia l’agencement.
— À croire que la propriétaire me connaît ! Je suis devenue une baleine qui va de canapé en canapé !
— Tu exagères ! démentit Marc. Ta grossesse se voit à peine.
Elle lui jeta un regard torve. Laure changea de conversation en lui montrant les plantes. La maison n’en manquait pas. Tout un espace était dévolu aux orchidées. Des roses, des blanches, des pourpres et des tigrées lançaient leurs tiges fleuries. Léa se dit qu’il y aurait de quoi faire pour les entretenir.
— Alors, dit Laure, pour les orchidées, c’est une fois tous les dix jours. Tu les baignes dans l’évier et puis tu les égouttes. Il ne doit pas rester d’eau dans les soucoupes, sinon elles pourrissent. C’est tout.
Léa hocha la tête.
— Par contre, pour Lulu, c’est plus souvent, ajouta-t-elle avec un sourire taquin.
Un beau chat bicolore, gris foncé et blanc, venait de se lever et s’avançait vers elles.
— C’est un indépendant, tu verras. Mais pour les repas, il est ponctuel ! Voici ses croquettes et ses terrines.
Elle lui désigna une étagère du cellier. Léa s’était approchée du matou qui se laissa gratter la tête avec contentement.
— Ça y est, tu es adoptée !
Les deux femmes papotèrent encore un peu et puis Laure dit :
— Allez, ma belle, je te laisse. Il faut que je repasse chez Hugues prendre ma valise. Direction Paris. J’ai un vol demain. Un reportage imprévu. Ça tombe mal, avec ton arrivée… Je serai absente quelque temps. On se rattrapera à mon retour !
Les deux femmes s’embrassèrent. Marc aussi devait repartir à Brest. La BR ne chômait pas. Léa fit la grimace quand elle le vit s’apprêter à prendre le volant.
— Franchement, c’est idiot. On va vivre séparés alors que j’aurais pu rester…
— Tu l’as bien cherché, Léa ! Impossible de te faire tenir tranquille. Ici, pas de BR, pas d’affaires, et tu vas te reposer, respirer l’air de la mer et… laisser grandir ce petit bout.
Elle soupira en silence. Marc coupa court.
— Allez, j’y vais. Mais je reviens dès que possible. Tu n’oublies pas les consignes de sécurité…
— Oui, je sais, maugréa-t-elle. Porte verrouillée et volets fermés à la tombée de la nuit !
— Parfait ! À plus, ma puce !
Après son départ, Léa déambula dans la maison, s’appropriant l’environnement. Elle jeta un coup d’œil au contenu de la bibliothèque et choisit un livre. Lulu la suivit comme un chien, intrigué par cette nouvelle arrivante. Il se manifesta suffisamment pour qu’elle lui serve son repas qu’il mangea sans rechigner, avant de s’affaler dans un panier en mousse qui lui était visiblement dévolu.
Léa jeta encore un coup d’œil à la vue magnifique sur l’île de Batz avant de clore les volets. Il fallait qu’elle se fasse à l’idée de vivre ici quelques semaines. Le temps nécessaire pour passer le cap critique pour son bébé. À partir de huit mois de grossesse, le risque ne serait plus aussi grand et elle pourrait reprendre le cours de sa vie à Brest.
VIII
Rose n’avait plus l’habitude de sortir et l’invitation du propriétaire du restaurant “Zen”, tenue par un aimant sur son frigo, la narguait depuis. Elle avait même envisagé de la jeter, malgré son goût pour cette cuisine. La vie l’avait rendue encore plus repliée sur elle-même qu’elle ne l’était naturellement. Rose évitait de se lier.
Malgré tout, elle se prépara. Sa vie ne lui offrait pas de grandes perspectives, son budget était serré et refuser un repas offert n’était pas raisonnable. Elle ôta le carton du frigo et relut : « Bon pour un menu Teppanyaki… ». Elle rassembla ses souvenirs de sorties passées chez Benihana, à New York. C’était du poulet sauté accompagné de légumes. Un délice. La gourmandise l’emporta sur son désir de rester chez elle.
*
Zoé avait reçu la visite de sa sœur. Celle-ci s’était pointée sans crier gare et Zoé avait senti son regard soupçonneux peser sur elle et détailler l’appartement. Sa grande sœur s’était bornée à ramasser les fringues éparses.
— Toujours aussi méticuleuse à ce que je vois…
Zoé avait haussé les épaules. Un reste de raison lui faisait contenir l’envie qu’elle avait de lui cogner la tête contre le mur. Avec ses sept ans de plus, Ludivine se croyait investie d’une mission divine : veiller sur sa sœur en l’abreuvant de reproches divers. Si elle n’avait pas été aussi fauchée, jamais elle n’aurait remis les pieds ici. C’était uniquement parce que Ludivine lui avait obtenu ce logement miteux et cette place à la thalasso. Sans quoi…
Elle baissa les yeux et ramassa les affaires qui traînaient encore. Ludivine avait une voix aiguë qui lui perçait les tympans et lui vrillait le crâne.
— T’as intérêt à bien te tenir ! Je me suis portée caution pour toi. Alors, l’appart, tu le tiens bien. J’ai pas envie d’avoir tout à refaire dedans, moi !
Ludivine grommela encore en auscultant les pièces.
— Je ne veux rien voir traîner. Et cette vaisselle, elle attend quoi ? Bon sang, tu n’as que toi à t’occuper ! Ce n’est pas trop difficile, alors que moi…
Zoé termina dans sa tête la tirade de sa sœur : « alors que moi, je trime du matin au soir à courir le coin pour faire des piqûres et que je fais des gardes de nuit, pour une paye de misère, dans une maison de retraite. Alors que moi, je dois m’occuper de toi et réparer tes bêtises depuis toujours… »
C’était la rengaine habituelle qu’elle entendait depuis son enfance. Intérieurement, elle se boucha les oreilles et chantonna un petit air.
— Ho ! Tu m’écoutes ?
Zoé sursauta car Ludivine venait de lui secouer le bras.
— Tu entends ce que je te dis ?
La jeune femme hocha la tête. Elle n’avait aucune idée de ce dont parlait sa sœur. Ludivine articula :
— Je travaille ce soir et j’ai une invitation pour l’inauguration du nouveau restaurant de sushis.
Zoé leva l’oreille. Pour une fois que ce n’était pas une litanie de reproches…
— Le nouveau patron me l’a donnée l’autre jour. C’est un menu unique. Prends-la, ce serait dommage de la perdre et ça ne te fera pas de mal de manger un peu mieux. Tu es maigre à faire peur.
Elle lui tendit le carton et Zoé déchiffra : « Bon pour un menu Teppanyaki, pour l’inauguration, vendredi 28 février à 20 heures. »
— Alors, tu iras ? insista Ludivine.
Zoé se mordit les lèvres nerveusement avant d’accepter. Sa sœur sourit, ce qui éclaira son visage sévère. L’infirmière de trente-sept ans se sentait souvent au bord de l’implosion. La vie ne lui avait pas fait de cadeau et le retour de Zoé n’était pas fait pour la tranquilliser.
IX
L’accueil était parfait. Sylvain Le Ber, nouveau patron du Zen, avait fait les choses en grand. Passionné de culture japonaise, l’homme de trente-huit ans avait passé quelques années à Tokyo. Suffisamment pour fréquenter les innombrables restaurants de sushis de la capitale et se sentir d’exporter ce savoir-faire chez lui. Un pari risqué qu’il tentait maintenant. Il accueillait la clientèle sur le pas de la porte, tout en présentant un Asiatique énigmatique en costume foncé.
— Bonsoir Messieurs-Dames ! Je vous présente monsieur Osawa, à votre service. Mon maître d’hôtel a travaillé dix ans à Tokyo, deux ans à New York et un an à Paris.
Le Japonais hochait la tête en silence et Rose le détailla. L’aurait-elle rencontré là-bas ? Elle ne s’en souvenait pas. Elle fut dirigée vers une table de huit où chacun s’installa avec des murmures de contentement. Deux cuisiniers apparurent. Le show commençait. Les deux hommes exécutèrent des passes adroites avec leurs ustensiles. Rose avait souvent admiré cela à Manhattan et cela lui rappela le bon temps. L’entrée en matière l’avait détendue.
Sur sa droite, une femme âgée regardait la salle d’un air suspicieux. Rose se hasarda à lui adresser la parole :
— C’est la première fois que vous venez dans un sushi ?
— Ah ça oui ! C’est pour faire plaisir à mon amie Charlotte, la mère du propriétaire. Mais moi, elle se pencha en disant cela, je préférais les crêpes !
Rose se retint d’éclater de rire et la rassura sur la cuisine japonaise. Sur sa gauche, un homme d’une cinquantaine d’années lui souriait. Le cuisinier avait fini sa démonstration et commença la cuisson. Le gril du centre de la table était chaud. Il lança des courgettes et des oignons et entama leur découpe avec des gestes étudiés. Les légumes atterrirent sur la plaque où ils se mirent à grésiller. L’homme rajouta quelques cuillerées d’une sauce épaisse destinée à parfumer et saisir les ingrédients. Ensuite, ce fut au tour du poulet. Habilement émincé, il dora sur la plaque. Le cuisinier les servit un par un en leur tendant une plaque à long manche garnie de teppanyaki. C’était parfumé et délicatement épicé à la fois. Les champignons fondaient dans la bouche et Rose se dit que, finalement, elle passait une bonne soirée. Du regard, elle fit le tour de la salle. Il y avait une autre grande table de cuisson et plusieurs petites tables individuelles. Un autre cuisinier était à l’œuvre devant l’autre piano, avec des gestes bien huilés. Le niveau sonore était monté dans la pièce.
Elle aperçut une jeune femme de profil. Cheveux d’algues noires qui encadraient son visage tout en le dissimulant en partie. Par moments, elle apercevait sa peau très blanche. Elle la trouva particulièrement maigre et nerveuse.