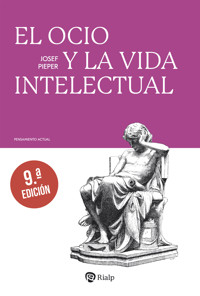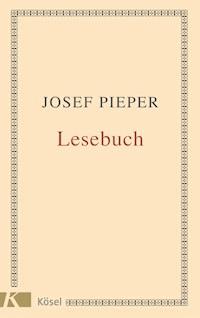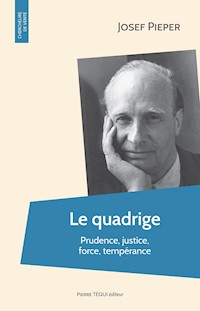
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pierre Téqui éditeur
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Après avoir magnifiquement traité des trois vertus théologales, Pieper s’est penché sur les vertus cardinales, chevaux puissants de ce quadrige antique qui emportait l’homme vers le bien et la réalisation du vrai.
Or, dans la façon actuelle de penser, les vertus et leurs relations entre elles ne sont plus comprises — Pieper le démontre ici. Leur pratique ne peut alors qu’être dévoyée. Le bonheur nous échappe. C’est l’objet de ce livre de nous les restituer dans leur splendeur originelle et leur ordonnancement, qui sont au fondement de la pensée occidentale chrétienne.
Cet ouvrage est l’un des plus grands succès de Pieper, grâce à la tournure si originale de sa pensée : une philosophie en prise sur le réel qui permet au lecteur de comprendre le monde, y compris dans son quotidien. Un maître livre pour aider à vivre.
Introduction du frère Albert-Henri Kühlem, op.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Josef Pieper (1904-1997) est probablement le plus grand philosophe catholique allemand et un des meilleurs connaisseurs de Platon, Aristote et saint Thomas d'Aquin. Ses nombreux livres font l'unanimité dans le monde laïc comme dans le monde religieux. Benoît XVI l'appelle son « docteur de l'Église personnel ». Et Hans Urs von Balthasar écrivait : « Nous sommes grandement redevables à Josef Pieper qu'il nous redise inlassablement dans ses considérations intempestives ce qui est le plus nécessaire à notre temps. »
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
CHEZ PIERRE TÉQUI
De la vérité des choses, suivi de La réalité et le bien (trad. Jean Granier).
CHEZ AD SOLEM
De la foi (trad. Jean Granier).
De l’amour (trad. Jean Granier).
Le concept de création.
Le concept de tradition.
De la divine folie.
Le loisir, fondement de la culture.
Foi et culture.
De la fin des temps, suivi de Espérance et histoire (trad. Jean Granier).
CHEZ RAPHAËL
De l’espérance.
Qu’est-ce que philosopher ? (postface de T. S. Eliot).
Abus de langage, abus de pouvoir.
Petite anthologie des vertus du cœur humain.
PRÉFACE
« Vertu, Messieurs, ce mot Vertu est mort, ou du moins, il se meurt. Vertu ne se dit plus qu’à peine. J’avoue ne l’avoir jamais entendu. Ou, plutôt, et c’est plus grave, les rares fois où je l’ai entendu, il était ironiquement dit. Je ne me souviens pas, non plus, de l’avoir lu dans les livres les plus lus et les plus estimés de notre temps1. » Ainsi parlait Paul Valéry en 1934, sans évidemment pouvoir se douter qu’aujourd’hui la vertu connaîtrait un véritable regain d’intérêt, surtout en philosophie. Un des témoins les plus éminents de cette renaissance est André Comte-Sponville : « Les philosophes sont des écoliers (seuls les sages sont des maîtres) et les écoliers ont besoin de livres : c’est pourquoi ils en écrivent parfois, quand ceux qu’ils ont sous la main ne les satisfont pas ou les écrasent. Or quel livre plus urgent, pour chacun, qu’un traité de morale ? Et quoi de plus digne d’intérêt, dans la morale, que les vertus2 ? » Josef Pieper, philosophe allemand encore trop peu connu en France, mais qui jouit d’une aura internationale3, fait partie de ces philosophes qui, comme André Comte-Sponville, ne voulaient pas se contenter des livres qu’on trouve déjà sur le marché, car il pensait que lui-même et la société avaient toujours besoin de cette sagesse qui était déjà la préoccupation majeure de ceux qui se réunissaient autour de Platon ou d’Aristote, dans une quête commune de la vérité. Cela dit, l’approche de Pieper est tout à fait particulière, car elle essaie de réactualiser une perspective de l’existence humaine qui s’est perdue au fil des siècles, mais dont l’homme aurait absolument besoin aujourd’hui, pour vivre en harmonie avec lui-même et avec la réalité du monde et de la société qui l’entourent.
L’originalité de l’approche de Pieper pour donner une vision renouvelée de la vaste question des vertus est fondée sur sa conception de l’interaction entre l’esprit humain et l’Histoire. Dans un de ses essais, Pieper se pose la question de ce que pourrait bien être « l’actualité4 ». Pour lui, l’actualité n’est pas uniquement l’information à la une, donnée par tel ou tel organe de la presse et qui perd sa valeur presque dans l’heure qui suit. La véritable actualité philosophique, au contraire, est avant tout et essentiellement existentielle, et donc un contenu qui non seulement touche, mais concerne directement et aujourd’hui la situation existentielle de l’homme dans sa personnalité individuelle. Les nouvelles quotidiennes, bonnes ou mauvaises, ont certes d’une manière directe ou indirecte une influence sur notre vie. Elles peuvent procurer des sentiments de joie ou de tristesse ; elles peuvent nous heurter, voire nous scandaliser ; mais elles n’arrivent pas à fournir des réponses aux questions concernant le sens ou le non-sens de l’existence humaine. Gottfried Wilhelm Leibniz formule cette question existentielle du sens de la vie lorsqu’il se demande : « Pourquoi y a-t-il plutôt quelque chose que rien5 ? », incluant dans cette question celle de l’existence humaine. D’une manière plus radicale encore, Albert Camus affirme : « Il n’y a qu’un problème philosophique vraiment sérieux : c’est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d’être vécue, c’est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Le reste, si le monde a trois dimensions, si l’esprit a neuf ou douze catégories, vient ensuite. Ce sont des jeux ; il faut d’abord répondre6. » Pour répondre à de telles questions existentielles, Pieper rappelle que l’esprit, dans son ouverture universelle à la totalité de la réalité, est en même temps limité par sa propre situation historique. En revanche, l’homme est capable de dépasser cette limitation justement en ne se contentant pas de l’aujourd’hui temporel, mais en élargissant son esprit et en réactualisant les réponses d’autres générations de philosophes qui se sont posé les mêmes questions que lui-même aujourd’hui et cela, non dans une démarche historique, mais existentielle, c’est-à-dire en invitant les philosophes du passé avec le courage de les intégrer existentiellement dans la réflexion philosophique. « Actuel n’est pas seulement ce qu’une époque “veut”, mais aussi ce dont elle a “besoin” ; actuel est le correctif, actuel est le “non” contre le temps, c’est-à-dire contre les dangers intérieurs d’une époque, dangers naturellement liés aux chances qu’elle offre. Ainsi peut être actuel même ce qui au sens propre du terme est démodé7. » En d’autres termes, il ne suffit pas de citer ou paraphraser les philosophes de jadis, quand telle ou telle de leurs réflexions semble confirmer les positions philosophiques d’aujourd’hui. Il s’agit au contraire d’avoir l’audace de les intégrer dans ce qui est considéré aujourd’hui comme vrai, pour ainsi être capable d’entrer dans un dialogue intemporel afin d’élargir, approfondir et peut-être aussi corriger notre vérité du moment : « Seule la vérité peut vraiment être actuelle ; seul ce qui est vrai peut véritablement correspondre aux chances et aux dangers d’une époque8. » Mais découvrir cette vérité nécessite une recherche qui s’enflamme dans le hic et nunc de la situation dans laquelle l’homme se trouve pour que le regard s’élargisse vers des zones hors de son temps et vers la vérité de la totalité de l’être. L’union de l’être et du temps dans la pensée et la réflexion de l’esprit humain est à chaque fois le point culminant de l’actualité proprement dite qui seule arrive à bouleverser l’esprit et peut-être à le convertir.
Une morale sans racine qui tourne en rond
Dans le premier chapitre de son livre Après la vertu, Alasdair MacIntyre9 pointe par une expérience fictive cette erreur philosophique qui consisterait à ne pas garder unies l’actualité du temps présent et l’actualité liée à la vérité intemporelle. Il imagine un monde après une catastrophe écologique qui toucherait non seulement les infrastructures, mais aussi tous les domaines des sciences. Aucun livre, aucune bibliothèque, aucun enseignant ou chercheur scientifique n’auraient survécu à ce désastre mondial. Ne resterait que tel ou tel fragment de telle ou telle science qui serait pour les survivants la seule base d’un renouveau scientifique, sauf que ces fragments seraient interprétés comme la totalité de la mosaïque intacte et non comme ces morceaux disparates qu’ils sont en réalité. Dans un tel contexte, la philosophie serait coupée non seulement de ses racines mais aussi du contexte général de l’existence. Serait alors tenu comme vrai ce qu’il reste sur le marché des ruines des sciences et de la philosophie. Pour la philosophie morale, les conséquences seront encore plus manifestes, même si, « d’un point de vue neutre, le désordre moral reste largement invisible. Tout ce que l’historien – et cette remarque vaut également pour le sociologue – pourrait percevoir selon les canons et les catégories de sa discipline, c’est la succession des morales : le puritanisme du XVIIe siècle, l’hédonisme du XVIIIe, l’éthique victorienne du travail, etc., mais le langage de l’ordre et du désordre lui échapperait. Si c’était le cas, cela expliquerait du moins pourquoi ce que je considère comme le monde réel et son destin est passé inaperçu des universitaires10 ». Le fragment devient totalité et va jusqu’à dominer la conception du monde réel et son destin. Charles Taylor parle dans ce contexte de « closed world structures11 » dans lesquelles se retrouve désormais l’esprit humain, dans lesquelles il se renferme de plus en plus, depuis plusieurs siècles déjà.
Presque sans le remarquer, nous avons quitté l’expérience fictive de MacIntyre pour découvrir au moins sommairement que nous vivons en fait et en réalité dans la situation qu’il nous a décrite. Pour Servais-Théodore Pinckaers, le moment de la catastrophe philosophique est assez précisément identifiable. Il le fait remonter à l’introduction d’une nouvelle conception de la liberté par Guillaume d’Ockham et il ajoute : « Ce que nous appellerons plaisamment l’explosion de la première bombe atomique de l’histoire, étant entendu que l’atome qui entre en fission, à ce moment, n’est pas physique mais psychique12. » Si pour Thomas d’Aquin, le libre arbitre procédait encore de l’intelligence et de la volonté, c’est désormais, un siècle après Thomas, le libre arbitre qui précède la raison et la volonté. Cela a des conséquences sur la conception et la compréhension de l’être humain dont même le XXIe siècle est encore héritier. Ainsi règne aujourd’hui encore dans la société, comme norme entièrement acceptée, la liberté d’indifférence qui conçoit à la manière nominaliste chaque acte comme isolé de tout contexte existentiel, ayant perdu orientation et finalité, entraînant ainsi une « atomisation de l’agir moral13 » et une séparation entre l’agir moral et la personne, puisque des actes indépendants les uns des autres n’ont plus vocation à construire ni à parfaire la personne. Le clivage qui se crée ainsi entre la liberté absolutiste et l’individualité des actes change par conséquent aussi la finalité de la morale et de l’éthique. Celles-ci deviennent des instances de contrôle ou, pour l’exprimer un peu plus positivement, d’orientation de l’agir humain qui désormais devra être canalisé par des obligations. Désormais, l’éthique ne traite plus « de la vraie conception de l’être humain » comme au temps de Thomas d’Aquin. Pour le Docteur angélique, « elle traite aussi de l’agir, des obligations, des commandements et des péchés. Mais sa particularité fondamentale est de traiter avant tout de l’être vrai de l’homme, de l’image bonne de l’homme14 ». En d’autres termes, pour Pieper à la suite de Thomas, la morale n’est pas avant tout pratique, mais contemplative et admirative envers l’être humain qui est appelé à être bon et beau, car il l’est déjà en puissance. En revanche, dans un contexte philosophique où la pensée d’Emmanuel Kant est quasi intronisée comme la mesure fondamentale et ultime de toute réflexion philosophique, il est difficile de se défaire de certains penchants de ce philosophe de l’obligation morale. La séparation de l’être et de l’agir initiée par Ockham a conduit à une méfiance généralisée ou au moins à une incertitude dans la question de savoir si l’être humain est par nature bon ou mauvais. Les contractualistes en philosophie politique, comme par exemple Hobbes, Locke et Rousseau, ont au moins ceci en commun de penser qu’en fin de compte l’homme révèle tôt ou tard ses penchants mauvais qu’il faudra maîtriser. Hobbes en est le représentant le plus concret. Il décrit l’homme comme ayant une nature mauvaise stable en le comparant avec la nature du mauvais temps de son pays natal qui « ne réside pas dans une ou deux averses, mais dans une tendance qui va dans ce sens, pendant un grand nombre de jours consécutifs15 ». Concrètement, cela signifie que « les lois de nature (comme la justice, l’équité, la modération, la pitié, et d’une façon générale, faire aux autres ce que nous voudrions qu’on nous fît) sont contraires à nos passions naturelles qui nous portent à la partialité, à l’orgueil, à la vengeance, et aux autres conduites de ce genre16 ». Pour maîtriser les mauvaises tendances de l’homme, Hobbes ne propose rien d’autre, pour le bienfait de tous, que la force rigide de l’État maintenu par le glaive, car « les conventions, sans le glaive, ne sont que des paroles17 ». Un siècle plus tard, Kant reste sur la même ligne que Hobbes en appliquant la position de celui-ci à l’homme et à sa responsabilité morale individuelle. L’être humain est désormais à lui-même son propre État et s’impose à lui-même les lois : « La vertu est donc la force morale de la volonté d’un homme dans l’accomplissement de son devoir, lequel est une coercition morale exercée par sa propre raison législatrice, en tant qu’elle se constitue elle-même comme un pouvoir exécutant la loi18. » L’homme suit la loi « par devoir, et non sous l’impulsion de quelque inclination spontanée », car « l’état moral […] c’est la vertu, c’est-à-dire l’intention morale en lutte et non la sainteté dans la possession présumée d’une parfaite pureté des intentions de la volonté19 ».
Cette conception de la vertu comme attitude guerrière et glaive moral ne la rend évidemment pas très avenante. C’est pourquoi Max Scheler regrette avec nostalgie le temps où « à l’époque du Moyen Âge, ou en Grèce et à Rome avant l’Empire, cette vieille fille acariâtre et édentée était un être gracieux, attrayant et plein de charme20 », tandis que, dans les temps modernes, la vertu « est si dénuée de charme parce que non seulement l’effort pour l’acquérir est pénible, mais qu’elle-même nous pèse21 ». Face à un tel constat, Scheler essaie une réhabilitation de l’aspect positif et existentiel de la vertu. Son point de départ est une tentative de se distinguer de Kant : « Parler, comme le fait Kant, d’un “devoir” flottant dans le vide qui ne serait devoir à l’égard de personne et qui n’aurait été ordonné par aucune autorité, c’est parler pour ne rien dire22. » Comme alternative, Scheler propose un retour vers l’homme et sa conscience qui en toute humilité reconnaît intuitivement les valeurs en leur clarté matérielle et leur pureté absolue, devenant ainsi le fondement de l’orientation pour un bon agir. La conscience et la manifestation des valeurs en elle offrent enfin cette « orientation axiologique originelle23 » que les normes, détachées de leur relation initiale, ne pouvaient en fait jamais donner. « Ni la notion de devoir ni celle de norme ne peuvent constituer le point de départ de l’éthique ni passer pour l’étalon qui rendrait possible la distinction du bon et du méchant24. » Les normes sont variables, « alors que demeure constante la reconnaissance des mêmes valeurs25 ». L’insistance sur les devoirs et les normes et la multiplication à l’infini de celle-ci est pour Scheler « le signe que le sentiment des valeurs auxquelles se réfèrent ces préceptes et ces interdits s’est obscurci26 ». Une purification des normes et des devoirs par une réforme « axiologique originelle27 » serait donc indiquée. Se pose alors le problème qu’une telle réforme aurait à lutter contre une multiplication incontrôlable des valeurs qui de plus risquent au cours de l’histoire de changer et d’être modifiées. Qui ou quoi garantit que l’obscurcissement ou le manque d’orientation ne continueraient pas avec le retour de la conscience aux valeurs ? Pieper lui-même donne dans son autobiographie un exemple frappant28. Au temps du national-socialisme, son livre sur la vertu de force et de courage, partie intégrante du présent livre, a été mis tout de suite après sa publication sur la liste des livres recommandés par « l’adjoint du Führer ». Jusqu’au jour où le Frankfurter Allgemeine Zeitung publia une recension de ce livre ; il a alors été aussitôt retiré de cette liste et mis à l’index. L’adjoint n’avait visiblement pas lu le livre avant et les valeurs qu’il proposait en fait ne correspondaient évidemment pas à son idéologie. Le retour aux valeurs n’est donc pas si évident que cela. Les valeurs en soit n’offrent pas plus que les normes et devoirs chez Kant un fondement solide pour un agir moral car elles aussi dépendent des changements socioculturels et historiques.
Pour Jürgen Habermas, le retour à sa propre conscience et les changements des conditions extérieures sont déjà en soi un facteur d’insécurité pour la vie en société. S’y rajoute le facteur de motivation pour suivre ou non ces valeurs découvertes ou redécouvertes. Pour Habermas, c’est encore la faute de Kant, qui « doit prêter le flanc à l’objection selon laquelle une éthique qui sépare catégorialement devoir et inclination, raison et sensibilité, reste sans conséquence pratique29 ». On sent toutefois un certain embarras pour donner une véritable alternative, si ce n’est la confiance en une raison qui avec le temps s’affinerait de plus en plus : « Aujourd’hui, nous vivons heureusement dans des sociétés occidentales au sein desquelles, depuis deux à trois siècles, a été mené à bien un processus certes toujours faillible, toujours susceptible d’erreurs et d’être rejeté, mais néanmoins orienté vers la réalisation de droits fondamentaux30. » Mais Habermas reconnaît qu’il ne reste en fin de compte que la solution traditionnelle, propagée déjà par Hobbes et Kant, pour être sûr du succès des droits fondamentaux : « Dans la mesure où une morale rationnelle n’offre pas aux motifs et aux attitudes de ses destinataires d’ancrage suffisant, elle est dépendante d’un droit qui contraint à un comportement conforme aux normes sans intervenir sur les mobiles et les attitudes31. » Finalement, le cercle se ferme. L’émancipation de Kant, l’émancipation d’une éthique de devoirs et de normes, passant par la rationalité de la conscience et des valeurs se retrouve là où la réflexion a commencé. Et sur la vertu, sur pourquoi elle pourrait finalement être attirante et heureuse, le chercheur d’une vie morale n’en sait pas plus.
L’opinion générale sur la vertu vue comme effort
Comte-Sponville a bien vu cette incapacité des philosophes modernes à rendre la vertu heureuse. Son approche reflète l’opinion générale sur la vertu. Il est d’accord avec Pieper, car « pas plus que Spinoza [il] ne croi[t] utile de dénoncer les vices, le mal, le péché. Pourquoi accuser toujours, dénoncer toujours ? C’est la morale des tristes, et une triste morale32 ». Comme Pieper, Comte-Sponville propose, pour sortir de cette impasse d’une morale triste, le retour aux vertus. Mais dans l’approche de l’impact de la vertu sur la vie de la personne, Comte-Sponville diffère de Pieper : « Le bien n’est pas à contempler ; il est à faire. Telle est la vertu : c’est l’effort pour se bien conduire, qui définit le bien dans cet effort même33. » Nous sommes ici ramenés à Kant et à son éthique de l’effort. Max Scheler aussi se retrouve dans les paroles de Comte-Sponville : « La vertu, ou plutôt les vertus (puisqu’il y en a plusieurs, puisqu’on ne saurait les ramener toutes à une seule ni se contenter de l’une d’entre elles) sont nos valeurs morales, si l’on veut, mais incarnées, autant que nous le pouvons, mais vécues, mais en acte : toujours singulières, comme chacun d’entre nous, toujours plurielles, comme les faiblesses qu’elles combattent ou redressent34. » La vertu est considérée comme une disposition pour lutter contre un déficit moral, une disposition avec une perspective négative au départ et sans certitude de toujours trouver la motivation nécessaire. La vertu est pour Comte-Sponville une disposition pratique, comme l’est la morale en général. C’est pourquoi son livre « se veut tout entier de morale pratique, c’est-à-dire de morale35 ». La vertu est comprise comme une disposition des lois morales ou juridiques. La motivation est toujours négative et provient de l’extérieur. Comte-Sponville voulait introduire à une morale heureuse, mais dans son point de départ, elle ne l’est pas et pourrait, peut-être, ne jamais le devenir.
La vertu ouvre l’être humain à sa pleine réalisation
Par rapport à Comte-Sponville, l’approche de la morale de Thomas d’Aquin, et de Pieper aussi, est tout à fait différente. Non seulement parce qu’au temps de Thomas, la morale en tant que telle n’était pas enseignée, car l’on s’intéressait avant tout à l’homme et à la façon dont il devrait être en lien avec son Créateur. Ce que l’homme devait faire ensuite était juste la conséquence naturelle de ce qu’il était ou devait être. Déjà peu de temps après la mort du Docteur angélique, Maître Eckhart a dû rappeler que « les gens ne devraient pas tant réfléchir à ce qu’ils ont à faire ; ils devraient plutôt songer à ce qu’ils pourraient être36 ». Dans ce contexte, Thomas d’Aquin comprend l’être humain non comme moralement déficitaire, mais comme véritablement ontologiquement déficitaire37. Le lien qui existe entre les vertus et l’être humain n’est pas avant tout un déficit moral, lequel devrait être comblé par l’obéissance à un catalogue de devoirs, mais un déficit ontologique. Thomas d’Aquin voit l’homme dans son existence comme mis en chemin par son créateur vers sa pleine réalisation dont les vertus elles-mêmes donnent l’orientation38. Les vertus sont déjà fondées en l’homme en puissance et n’attendent rien d’autre que d’être activées vers leur pleine réalisation. La motivation de cette autoréalisation de l’être humain n’a pas besoin d’autre chose que le bonheur que procure cette réalisation : devenir et être ce que l’homme peut être véritablement. L’homme lui-même veut être vertueux, car il peut et veut réaliser et amener à son terme ce qu’il y a déjà de bien en lui, car il veut être heureux. Alors que chez Ockham, volonté divine et volonté humaine se voient quasi dans une sorte d’opposition à cause de l’indépendance de la liberté d’indifférence, chez Thomas d’Aquin et Pieper, l’homme adhère et recherche même l’adhésion à la volonté de son Créateur qui l’a créé comme il est, acceptant totalement sa propre existence et la trouvant bonne par excellence.
En guise de conclusion, citons une dernière conséquence de cette approche thomasienne que Pieper nous rappelle. Quand on parle de la paresse, elle est définie en général et habituellement par le refus d’accomplir des tâches nécessaires : le paresseux ne fait pas ce qu’il devrait faire. Pour Thomas en revanche, la paresse est en fait le refus d’être ce qu’on devrait être, le refus d’accepter sa condition de créature de Dieu, le refus d’accepter sa propre existence avec joie, comme elle est, d’être toujours dans la main de Dieu comme dans la main du potier qui continue son œuvre jusqu’à son achèvement39. L’homme est créature, il ne peut pas vivre indépendamment de Dieu. Le point de départ qui permet une telle interprétation de la paresse chez saint Thomas se trouve dans sa Somme de théologie40. La paresse est pour saint Thomas non pas un péché d’oisiveté, mais un péché contre la sanctification du dimanche consistant avant tout dans le repos de l’âme qui se manifeste dans la louange de la Création et qui s’exclame : « Tout est bon et il est magnifique d’exister41. »
L’actualité de Pieper, c’est cette proposition courageuse d’un regard renouvelé sur l’homme et son existence qui va à la racine de ce qu’il pourrait être et montre à quoi il est appelé. Car Pieper nous rappelle que l’homme a été créé bon au départ et qu’un retour à la perfection initiale est possible. Pieper nous montre aussi que les brûlantes questions actuelles qui agitent notre société ne peuvent pas être résolues avant que ne soit résolu le problème de ce qu’est l’homme véritablement et au plus profond de son être. Il ne sert à rien de prêcher à l’homme les fins dernières42 s’il ne comprend pas qu’il est appelé à la sainteté, une sainteté qui est avant tout ontologique : « Ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi43. » Il ne faudrait pas non plus tomber dans le piège de croire que suivre le Christ voudrait dire s’engager dans un activisme quel qu’il soit44, si élevée que soit la cause : « Cherchez d’abord le Royaume [de Dieu] et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît45 » : autrement dit, réalisez d’abord le royaume de Dieu en vous. L’agir humain forme l’être humain en étant la manifestation et la confession de sa réalité ontologique. Être et agir peuvent bien être distingués ; en revanche, il ne faudrait jamais les séparer. Le fondement et le commencement de tout agir est l’être dans sa bonté créaturelle.
Sans vraiment l’avoir voulu, nous avons dépassé maintenant le champ de la philosophie. Mais cela va probablement dans le sens de Josef Pieper. Sans doute ne peut-on pas donner de réponses fondamentales sans avoir recours à des sources qui dépassent la raison humaine. C’était du moins déjà la méthode de Socrate et c’est aujourd’hui celle de Pieper. Dans le présent livre, il offre une réflexion sur les quatre vertus cardinales et propose le retour de l’homme vers lui-même pour se réaliser en tant que « gentleman », c’est-à-dire pour atteindre la perfection et la bonté auxquelles le Créateur l’a appelé. Cela est déjà beaucoup. Mais apparaît, ici et là, une petite lumière, ouvrant le regard vers une destinée de l’être humain qui l’élève même au-dessus de sa nature.
Albert-Henri KÜHLEM, op
1. P. VALERY, « Rapport sur le prix de vertu », 1934, in Œuvres, t. 1, Paris, 1957, p. 939.
2. A. COMTE-SPONVILLE, Petit traité des grandes vertus, Paris, 1995, p. 9.
3. Cf. A.-H. KÜHLEM, préface à J. PIEPER, La réalité et le bien, Paris, 2019, p. 5-19.
4. J. PIEPER, Was heißt Aktualität, s.d., in Werke, t. 8, 1, B. WALD (éd.), Hambourg, 2005, p. 230-233.
5. G. W. LEIBNIZ, « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? », in Kleine Schriften zur Metaphysik, t. 1 : Les principes de la nature et de la grâce fondés en raison, Darmstadt, 1985, p. 426.
6. A. CAMUS, Le mythe de Sisyphe, Paris, 1942, p. 15.
7. J. PIEPER, Was heißt Aktualität, op. cit., p. 231.
8. Ibid., p. 232.
9. A. MACINTYRE, « Une proposition dérangeante », in Après la vertu. Étude de théorie morale, Paris, 2013, p. 3-7.
10. Ibid., p. 6.
11. Cf. Ch. TAYLOR, « Closed World Structures », in M. A. WRATHALL (éd.), Religion after Metaphysics, Cambridge, 2003, p. 47-67.
12. S.-Th. PINCKAERS, « Le thème de l’image de Dieu en l’Homme et l’Anthropologie », in M. A. WRATHALL (éd.), Humain à l’image de Dieu, Genève, 1989, p. 147-163, ici p. 158. Cf. aussi S.-Th. PINCKAERS, Les sources de la morale chrétienne. Sa méthode, son contenu, son histoire, Paris, 1993, particulièrement p. 335-360.
13. S.-Th. PINCKAERS, Les sources de la morale chrétienne, op. cit., p. 344.
14. J. PIEPER, Über das christliche Menschenbild, 1936, in Werke, t. 7, B. WALD (éd.), Hambourg, 2000, p. 94-114, ici p. 95.
15. TH. HOBBES, Léviathan. Traité de la matière, de la forme et du pouvoir de la république ecclésiastique et civile, I, XIII, Paris, 1971, p. 124.
16. Ibid., I, XVII, p. 174.
17. Idem.
18. E. KANT, « Premiers principes métaphysiques de la doctrine de la vertu », in Métaphysique des mœurs II, Paris, 1994, p. 209-261, ici p. 251.
19. E. KANT, Critique de la raisonpratique, Paris, 1985, p. 121.
20. M. SCHELER, « Pour une réhabilitation de la vertu », in Six essais de philosophie et de religion, Fribourg, 1996, p. 31-48, ici p. 31
21. Ibid., p. 32.
22. M. SCHELER, Le Formalisme éthique et l’éthique matériale des valeurs, Paris, 1955, p. 227.
23. Ibid., p. 230.
24. Ibid., p. 208 ; cf. aussi l’excellent article de J. PORÉE, « Le phénomène de la valeur, le discours de la norme et la communauté des hommes », in Max Scheler. Éthique et phénoménologie, Rennes, 2015, p. 91-111.
25. M. SCHELER, Le Formalisme éthique et l’éthique matériale des valeurs, op. cit., p. 230.
26. Ibid., p. 231.
27. Ibid., p. 230.
28. Cf. J. PIEPER, Noch wußte es niemand (1904-1945), in Werke, t. supl. 2, B. WALD (éd.), Hambourg, 2003, p. 26-231, ici p. 117 sq.
29. J. HABERMAS, De l’éthique de la discussion, Paris, 1999, p. 27.
30. Ibid., p. 28.
31. J. HABERMAS, Droit et Démocratie. Entre faits et normes, Paris, 1997, p. 132.
32. A. Comte-Sponville, Petit traité des grandes vertus, op. cit., p. 9.
33. Ibid., p. 12.
34. Idem.
35. Idem.
36. MAÎTRE ECKHART, Traités et sermons, Paris, 1993, p. 81, cité chez J. PIEPER, Über das christliche Menschenbild, 1936, in Werke, t. 7, B. WALD (éd.), Francfort, 2000, p. 94-114, ici p. 94.
37. Cf. particulièrement pour cette introduction B. WALD, « Abendländische Tugendlehre und moderne Moralphilosophie. Nachwort des Herausgebers », in J. PIEPER, Werke, t. 4, B. WALD (éd.), Francfort, 1996, p. 415-431.
38. « Per virtutem ordinatur homo ad ultimum potentiæ », THOMASD’AQUIN, Quæstiones disputatæ de virtutibus, q. 1, art. 11, ad 15.
39. Cf. Jr 18, 6.
40. II-II, q. 35, 3 ad 1 : « Acediacontrariatur præcepto de sanctificatione sabbati ; in quo, secundum quod est præceptum morale, præcipitur quies mentis in Deo ; cui etiam contrariatur tristitia mentis de bono divino. »
41. Cf. J. PIEPER, Über die Hoffnung, in Werke, t. 4, B. WALD (éd.), Hambourg, 1995, p. 256-295, ici p. 279.
42. Cf. G. CUCHET, Comment notre mondea cessé d’être chrétien. Anatomie d’un effondrement, Paris, 2018, particulièrement le chapitre 6 : « La fin du salut ? La crise de la prédication des “fins dernières” », p. 243-266, où l’auteur voit la quasi-absence de la prédication des fins dernières comme une possible cause de la baisse de la participation active à la vie liturgique et sacramentelle des fidèles. Peut-on véritablement convertir par la peur, le devoir kantien ou le glaive de Hobbes ?
43. Ga 2, 20.
44. Cf. R. DREHER, Comment être chrétien dans un mondequi ne l’est plus. Le pari bénédictin, Paris, 2017. L’auteur donne une excellente analyse de la situation ecclésiale d’aujourd’hui, mais propose comme solution uniquement un catalogue pratique d’actions et de mesures à suivre. Selon Pieper, l’action seule ne suffira pas.
45. Mt 6, 33.
REMARQUES SUR LE TEXTE
Les œuvres réunies ici pour la première fois en un volume ont paru comme publications indépendantes dans l’ordre suivant : Du sens de la force (1934), Traité sur la prudence (1937), Discipline et mesure (1939), De la justice (1953). Dans la présente édition, elles ont été abrégées de quelques chapitres. Surtout, toutes les citations et remarques ont été supprimées. Qui s’intéresse aux textes originaux devra se reporter aux écrits parus séparément dans la maison d’édition Kösel, à Munich.
Les citations introduites dans le texte sans mention explicite de l’auteur proviennent de l’œuvre de saint Thomas d’Aquin.
AVANT-PROPOS
Dans LeBanquet de Platon, lorsque c’est au tour d’Agathon, maître des lieux et hôte d’ailleurs de cette réunion devenue célèbre, de tenir un discours, un éloge de l’Éros, cet intellectuel avant-gardiste l’articule sans aucune justification particulière selon les quatre vertus cardinales : prudence, justice, force, tempérance. Si évidente est pour le contemporain de Socrate cette façon de penser, héritée de la réflexion la plus antique : non seulement le concept de « vertu », qui signifie la rectitude de l’homme, mais aussi la tentative de la formuler sous ce quadruple spectre. Cette structure conceptuelle, l’expression donc de la « doctrine des vertus », l’une des grandes découvertes de l’homme dans la connaissance de lui-même, n’a plus jamais disparu de la conscience européenne. Elle est carrément devenue l’un de ses éléments fondamentaux, en raison d’un effort de réflexion qui a duré des siècles et dont sont partie prenante toutes les forces originelles de l’Occident en train de se constituer, aussi bien les Grecs (Platon, Aristote) que les Romains (Cicéron, Sénèque), et le judaïsme (Philon) comme le christianisme (Clément d’Alexandrie, Augustin).
C’est justement cette origine à vrai dire qui, aux yeux d’une certaine critique chrétienne, a rendu plus tard la « doctrine des vertus » suspecte d’être quelque chose de trop « philosophique » et de pas assez « biblique ». Et on a persisté à parler de « commandements » et de « devoirs » au lieu de vertus humaines. C’est certes également une possibilité légitime, très estimable même, et sans doute aussi indispensable, d’exprimer le devoir moral de l’homme. Mais une doctrine des commandements et des devoirs court bien sûr facilement le danger d’énoncer des exigences de façon décousue, et de perdre de vue ce faisant l’homme même qui se « doit » d’agir. La doctrine des vertus en revanche parle explicitement, également de façon naturelle, justement de cet homme-là, à savoir, aussi bien de son être créaturel qu’il apporte déjà avec soi, que de l’être à la réalisation duquel il doit se hausser en croissant – en étant prudent, juste, fort, tempérant. Cette forme de morale est étrangère par nature à l’étroitesse de tout règlement ; elle vise au contraire à dégager un chemin et à ouvrir une voie.
Ce n’est pas le lieu cependant de commencer une dispute sur les différentes possibilités du discours éthique. Il s’agit plutôt ici d’essayer de mettre sous les yeux l’une d’entre elles, mais celle-ci, si possible, dans toute son extension : en l’occurrence ce fameux « quadrige » des vertus fondamentales, dont un dicton déjà antique dit qu’il est capable de conduire l’homme au sommet de sa propre capacité d’être.
Dans ce domaine, l’originalité de la pensée et de l’expression n’a, cela se conçoit, que peu d’importance ; elle mérite plutôt d’être regardée avec méfiance. On ne peut guère s’attendre à ce que des vues absolument nouvelles soient mises au jour sur un tel sujet. D’un autre côté, pour la connaissance de la réalité de l’homme, la « Sagesse des Anciens » possède une actualité de fait inépuisable. Et c’est exactement l’intention de ce livre d’en rendre visible quelque aspect.
Si ce faisant – peut-être à l’étonnement de plus d’un – un certain auteur du Moyen Âge, Thomas d’Aquin, prend particulièrement souvent la parole, ce n’est pas un intérêt historique plus ou moins aléatoire qui joue, mais la conviction que, parmi les témoins, un rang singulier revient au « Docteur commun » de la chrétienté occidentale encore indivise – non pas tant en raison de son génie personnel que de l’altruisme véritablement fécond avec lequel dans son œuvre il exprime la diversité contrapuntique des conceptions du monde raisonnablement envisageables, et invite même au dépassement de ses propres limites. Cela suppose une capacité d’assimilation hors du commun et la puissance de clarification très exercée d’une pensée autonome, ici cependant, c’est moins l’auteur individuel Thomas qui parle que, par sa bouche, la grande tradition sapientielle de l’humanité elle-même.
S’en réclamer permet aussi d’atténuer un peu le risque du ridicule pour l’interprète postérieur de ne point rougir de dessiner une image de l’homme à l’aune de laquelle sa propre existence quotidienne échoue de mille manières.
PRUDENCE
« Si ton œil est pur, alors ton corps tout entier sera dans la lumière. »
Matthieu 6, 22
I
La prudence « engendre » la vertu morale : ce n’est pas une allégorie – Fausses interprétations contemporaines – La « quasi-suppression du traité sur la prudence » – La première vertu cardinale comme cause, « mesure », matrice – La vérité signifie : le réel se manifeste
Aucune assertion de la doctrine chrétienne classique de la vie ne sonne à l’oreille de l’homme contemporain, y compris à celle du chrétien, de façon si peu familière, et même si étrange et déconcertante que celle-ci : la vertu de prudence est la « génitrice » et la matrice46 de toutes les autres vertus cardinales : justice, force, et tempérance ; seul donc celui qui est prudent peut aussi être juste, fort et tempérant ; et l’homme bon est bon, en vertu de sa prudence.
Nous serions bien plus déconcertés encore si nous prenions cette assertion avec tout le sérieux qu’elle implique. Mais il nous est devenu courant de tenir de telles hiérarchies parmi les grandeurs spirituelles et morales, et en tout premier lieu parmi les « vertus », pour quelque chose d’allégorique, ou en tout cas d’assez oiseux au fond. Cela nous indiffère complètement de savoir laquelle des quatre vertus cardinales a bien pu obtenir le « premier prix » dans telle compétition organisée par des théologiens scolastiques.
Or, les choses sont telles que c’est cette prééminence de la prudence sur les autres vertus qui fonde ni plus ni moins que tout l’ordonnancement de la vision de l’homme de l’Occident chrétien. Dans l’affirmation de la prééminence de la prudence se reflète, comme dans aucune autre affirmation de l’éthique sans doute, la structure interne de toute la métaphysique occidentale chrétienne : à savoir, que l’être est antérieur au vrai, et le vrai antérieur au bien. Y brille même encore un dernier reflet du mystère le plus central de la théologie chrétienne : que le Père est l’origine engendrant le Verbe éternel, et que l’Esprit saint procède du Père et du Verbe.
C’est pourquoi le sentiment d’être déconcerté qui saisit l’homme contemporain face à cette affirmation de la prééminence de la prudence est plus révélateur qu’il n’y paraît. Il est fort possible que s’y exprime une aliénation objective plus profonde : l’abandon de l’image de l’homme de l’Occident chrétien qui s’imposait jusqu’alors, et le début d’une incompréhension des bases de la doctrine chrétienne sur la constitution fondamentale du réel.
Dans la façon de parler et de penser actuelle, « prudence » semble moins signifier une condition préalable du bien qu’une façon de l’éviter. « Le bien relève de la prudence » : cette phrase nous paraît presque absurde. Ou alors nous la comprenons à tort comme la formule d’une éthique utilitariste à peine déguisée. Car la prudence nous semble être, dans son concept, plus apparentée à ce qui est simplement utile, au bonum utile, qu’au bonum honestum, à ce qui est noble. Dans la représentation devenue courante de la prudence – comme aussi d’ailleurs pour prudence en anglais – pointe la signification d’une autoconservation anxieuse et réfléchie et d’une inquiétude pour soi-même non dénuée d’égoïsme. Mais ces deux choses ne conviennent pas à ce qui est noble : les deux lui sont inadéquates.
C’est pourquoi il nous est difficile de comprendre que la justice, la deuxième vertu cardinale, et tout ce qu’elle implique, doive être fondée sur la prudence. Plus encore, prudence et courage sont devenus pour la conscience commune des concepts presque inconciliables : est « prudent » celui qui sait ne pas se mettre dans la délicate situation de devoir faire preuve de courage ; c’est à la prudence qu’en appelle le « tacticien raffiné », qui sait se soustraire à l’engagement de sa personne. Quant à la relation entre la prudence et la quatrième vertu cardinale, la tempérance, la pensée contemporaine semble la comprendre en général de façon plus exacte ; cependant, ici aussi se révèle, à y regarder de plus près, l’absence d’une authentique et pleine correspondance avec les grands archétypes de ces deux vertus. Car discipliner l’appétit de jouissance sensible n’a pas pour but de conduire à la tranquille quiétude du petit bourgeois. Mais que ce soit bien là l’idée cachée dans l’expression courante de « prudente » modération, se révèle dans l’assurance bornée avec laquelle on déprécie, comme autant d’« excès imprudents », la noble audace d’une vie vouée à la virginité et la dure rigueur d’un véritable jeûne – de la même façon d’ailleurs, et pas moins, que l’on déprécie la colère agressive du courage.
Tel que le comprend la moyenne de nos contemporains, le concept de bien semble donc plutôt exclure qu’inclure celui de prudence. Il n’y a pas, semble-t-il, de bonne action qui pourrait ne pas être imprudente, et pas de mauvaise qui pourrait ne pas être prudente ; on qualifiera assez souvent le mensonge et la lâcheté de prudence, la franchise et le don de soi courageux tout aussi souvent d’imprudence.
La doctrine chrétienne classique de la vie dit en revanche : l’homme n’est prudent et bon qu’en même temps ; la prudence est partie prenante de la définition du bien. Il n’y a pas de justice et de courage qui puissent contredire la vertu de prudence ; et celui qui est injuste est, d’abord et en même temps, imprudent. Omnis virtus moralis debet esse prudens : toute vertu morale est nécessairement prudente. Au sens éthique général de notre époque, qui se manifeste dans le langage de tous les jours, correspond aussi, dans une large mesure, la théologie morale systématique actuelle. Difficile de dire ici qui souffle et qui répète. Les deux – conscience éthique générale et théologie morale – sont vraisemblablement l’expression d’un processus intellectuel de renversement des valeurs plus profond. Il est en tout cas indiscutable que la théologie morale contemporaine ne sait absolument rien dire, ou que très peu, sur le rang et la place de la prudence ; et ce même quand elle croit ou prétend suivre explicitement la théologie classique. L’un des plus importants théologiens actuels parle même d’une quasi-suppression dutraité de la prudence par la théologie morale contemporaine.
Par une diversité presque incalculable de concepts et d’images, la théologie classique a essayé de déterminer et d’exprimer le lieu systémique de la prudence. Rien ne montre plus clairement combien il s’agit ici d’une hiérarchie essentielle signifiante, et non pas donc d’ordre purement accidentel.
La prudence est la cause de ce que les autres vertus soient vertus. Il peut y avoir, par exemple, une « rectitude » instinctive pour ainsi dire de l’appétit sensible : mais ce n’est que par la prudence que cette rectitude instinctive devient vertu de tempérance. La vertu est une « capacité parfaite » de l’homme en tant que personne spirituelle ; et la justice, la force et la tempérance n’atteignent leur « perfection », en tant que « capacité » de tout l’homme, que lorsqu’elles se fondent sur la prudence, c’est-à-dire, sur la « capacité parfaite » à prendre des décisions justes ; c’est seulement par cette « capacité parfaite à décider » que les inclinations instinctives vers le bien sont élevées jusqu’au noyau décisionnel spirituel de l’homme, d’où jaillissent les actes vraiment humains. C’est en premier lieu la prudence qui perfectionne le juste agir vital et instinctif, les bonnes « dispositions » naturelles en vertu proprement dite, c’est-à-dire : en la façon vraiment humaine de la « capacité parfaite ».
La prudence est la « mesure