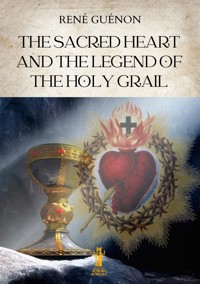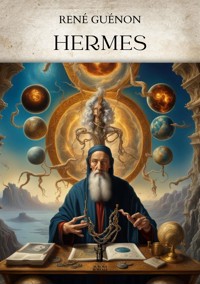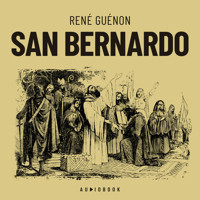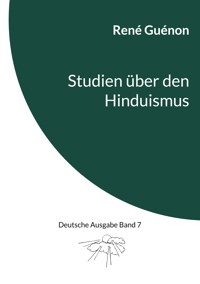1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps est un livre de René Guénon paru en 1945. Le livre se présente comme une explication globale, basées sur les données traditionnelles, des conditions cycliques qui ont amené au monde moderne, en général, et à la Seconde Guerre mondiale, en particulier. Pour Guénon, l'histoire n'est que le reflet d'un vaste processus cosmique prenant lui-même sa source dans la dimension métaphysique, intemporelle. En conséquence, l'histoire en tant que science découle de la doctrine métaphysique. Dans la perspective traditionnelle, le temps demeure une notion purement contingente du monde manifesté et ne tire sa réalité que de principes immuables... Un tel enfermement de l'histoire dans le temps coupé de toute réalité transcendante prend une dimension qui explique la chute du monde moderne : comme l'écrit Jean-Pierre Laurant, « l'histoire affirmant son autonomie [dans la sphère du temporel] et la liberté de l'homme dans une création continue faite par lui » devient, pour Guénon, « le Mal [qui désormais devient] le véritable moteur de l'histoire »...|source Wikipedia|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
SOMMAIRE
AVANT-PROPOS
CHAPITRE PREMIER QUALITÉ ET QUANTITÉ
CHAPITRE II MATERIA SIGNATA QUANTITATE
CHAPITRE III MESURE ET MANIFESTATION
CHAPITRE IV QUANTITÉ SPATIALE ET ESPACE QUALIFIE
CHAPITRE V LES DÉTERMINATIONS QUALITATIVES DU TEMPS
CHAPITRE VI LE PRINCIPE D’INDIVIDUATION
CHAPITRE VII L’UNIFORMITÉ CONTRE L’UNITÉ
CHAPITRE VIII MÉTIERS ANCIENS ET INDUSTRIE MODERNE
CHAPITRE IX LE DOUBLE SENS DE L’ANONYMAT
CHAPITRE X L’ILLUSION DES STATISTIQUES
CHAPITRE XI UNICITÉ ET SIMPLICITÉ
CHAPITRE XII LA HAINE DU SECRET
CHAPITRE XIII LES POSTULATS DU RATIONALISME
CHAPITRE XIV MÉCANISME ET MATÉRIALISME
CHAPITRE XV L’ILLUSION DE LA « VIE ORDINAIRE »
CHAPITRE XVI LA DÉGÉNÉRESCENCE DE LA MONNAIE
CHAPITRE XVII SOLIDIFICATION DU MONDE
CHAPITRE XVIII MYTHOLOGIE SCIENTIFIQUE ET VULGARISATION
CHAPITRE XIX LES LIMITES DE L’HISTOIRE ET DE LA GÉOGRAPHIE
CHAPITRE XX DE LA SPHÈRE AU CUBE
CHAPITRE XXI CAÏN ET ABEL
CHAPITRE XXII SIGNIFICATION DE LA MÉTALLURGIE
CHAPITRE XXIII LE TEMPS CHANGÉ EN ESPACE
CHAPITRE XXIV VERS LA DISSOLUTION
CHAPITRE XXV LES FISSURES DE LA GRANDE MURAILLE
CHAPITRE XXVI CHAMANISME ET SORCELLERIE
CHAPITRE XXVII RÉSIDUS PSYCHIQUES
CHAPITRE XXVIII LES ÉTAPES DE L’ACTION ANTI-TRADITIONNELLE
CHAPITRE XXIX DÉVIATION ET SUBVERSION
CHAPITRE XXX LE RENVERSEMENT DES SYMBOLES
CHAPITRE XXXI TRADITION ET TRADITIONALISME
CHAPITRE XXXII LE NEO-SPIRITUALISME
CHAPITRE XXXIII L’INTUITIONNISME CONTEMPORAIN
CHAPITRE XXXIV LES MÉFAITS DE LA PSYCHANALYSE
CHAPITRE XXXV LA CONFUSION DU PSYCHIQUE ET DU SPIRITUEL
CHAPITRE XXXVI LA PSEUDO-INITIATION
CHAPITRE XXXVII LA DUPERIE DES « PROPHÉTIES »
CHAPITRE XXXVIII DE l’ANTI-TRADITION À LA CONTRE-TRADITION
CHAPITRE XXXIX LA GRANDE PARODIE OU LA SPIRITUALITÉ À REBOURS
CHAPITRE XL LA FIN DU MONDE
Notes
RENÉ GUÉNON
LE RÈGNE DE LA QUANTITÉ ET LES SIGNES DES TEMPS
1945
Raanan Éditeur
Livre 1061 | édition 1
AVANT-PROPOS
Depuis que nous avons écrit La Crise du Monde moderne, les événements n’ont confirmé que trop complètement, et surtout trop rapidement, toutes les vues que nous exposions alors sur ce sujet, bien que nous l’ayons d’ailleurs traité en dehors de toute préoccupation d’« actualité » immédiate, aussi bien que de toute intention de « critique » vaine et stérile. Il va de soi, en effet, que des considérations de cet ordre ne valent pour nous qu’en tant qu’elles représentent une application des principes à certaines circonstances particulières ; et, remarquons-le en passant, si ceux qui ont jugé le plus justement les erreurs et les insuffisances propres à la mentalité de notre époque s’en sont tenus généralement à une attitude toute négative ou n’en sont sortis que pour proposer des remèdes à peu près insignifiants et bien incapables d’enrayer le désordre croissant dans tous les domaines, c’est parce que la connaissance des véritables principes leur faisait défaut tout autant qu’à ceux qui s’obstinaient au contraire à admirer le prétendu « progrès » et à s’illusionner sur son aboutissement fatal.
Du reste, même à un point de vue purement désintéressé et « théorique », il ne suffit pas de dénoncer des erreurs et de les faire apparaître telles qu’elles sont réellement en elles-mêmes ; si utile que cela puisse être, il est encore plus intéressant et plus instructif de les expliquer, c’est-à-dire de rechercher comment et pourquoi elles se sont produites, car tout ce qui existe en quelque façon que ce soit, même l’erreur, a nécessairement sa raison d’être, et le désordre lui-même doit finalement trouver sa place parmi les éléments de l’ordre universel. C’est ainsi que, si le monde moderne, considéré en lui-même, constitue une anomalie et même une sorte de monstruosité, il n’en est pas moins vrai que, situé dans l’ensemble du cycle historique dont il fait partie, il correspond exactement aux conditions d’une certaine phase de ce cycle, celle que la tradition hindoue désigne comme la période extrême du Kali-Yuga ; ce sont ces conditions, résultant de la marche même de la manifestation cyclique, qui en ont déterminé les caractères propres, et l’on peut dire, à cet égard, que l’époque actuelle ne pouvait pas être autre que ce qu’elle est effectivement. Seulement, il est bien entendu que, pour voir le désordre comme un élément de l’ordre, ou pour réduire l’erreur à une vue partielle et déformée de quelque vérité, il faut s’élever au-dessus du niveau des contingences au domaine desquelles appartiennent ce désordre et cette erreur comme tels ; et de même, pour saisir la vraie signification du monde moderne conformément aux lois cycliques qui régissent le développement de la présente humanité terrestre, il faut être entièrement dégagé de la mentalité qui le caractérise spécialement et n’en être affecté à aucun degré ; cela est même d’autant plus évident que cette mentalité implique forcément, et en quelque sorte par définition, une totale ignorance des lois dont il s’agit, aussi bien que de toutes les autres vérités qui, dérivant plus ou moins directement des principes transcendants, font essentiellement partie de cette connaissance traditionnelle dont toutes les conceptions proprement modernes ne sont, consciemment ou inconsciemment, que la négation pure et simple. Nous nous étions proposé depuis longtemps de donner à La Crise du Monde moderne une suite d’une nature plus strictement « doctrinale », afin de montrer précisément quelques aspects de cette explication de l’époque actuelle suivant le point de vue traditionnel auquel nous entendons nous en tenir toujours exclusivement, et qui d’ailleurs, pour les raisons mêmes que nous venons d’indiquer, est ici, non seulement le seul valable, mais même, pourrions-nous dire, le seul possible, puisque, en dehors de lui, une telle explication ne saurait même pas être envisagée. Des circonstances diverses nous ont obligé à ajourner jusqu’ici la réalisation de ce projet, mais peu importe pour qui est certain que tout ce qui doit arriver arrive nécessairement en son temps, et cela, bien souvent, par des moyens imprévus et complètement indépendants de notre volonté ; la hâte fébrile que nos contemporains apportent à tout ce qu’ils font ne peut rien contre cela, et elle ne saurait produire qu’agitation et désordre, c’est-à-dire des effets tout négatifs ; mais seraient-ils encore des « modernes » s’ils étaient capables de comprendre l’avantage qu’il y a à suivre les indications données par les circonstances, qui, bien loin d’être « fortuites » comme se l’imagine leur ignorance, ne sont au fond que des expressions plus ou moins particularisées de l’ordre général, humain et cosmique tout à la fois, auquel nous devons nous intégrer volontairement ou involontairement ?
Parmi les traits caractéristiques de la mentalité moderne, nous prendrons ici tout d’abord, comme point central de notre étude, la tendance à tout réduire au seul point de vue quantitatif, tendance si marquée dans les conceptions « scientifiques » de ces derniers siècles, et qui d’ailleurs se remarque presque aussi nettement dans d’autres domaines, notamment dans celui de l’organisation sociale, si bien que, sauf une restriction dont la nature et la nécessité apparaîtront par la suite, on pourrait presque définir notre époque comme étant essentiellement et avant tout le « règne de la quantité ». Si nous choisissons ainsi ce caractère de préférence à tout autre, ce n’est d’ailleurs pas uniquement, ni même principalement, parce qu’il est un des plus visibles et des moins contestables ; c’est surtout parce qu’il se présente à nous comme véritablement fondamental, par le fait que cette réduction au quantitatif traduit rigoureusement les conditions de la phase cyclique à laquelle l’humanité en est arrivée dans les temps modernes, et que la tendance dont il s’agit n’est autre, en définitive, que celle qui mène logiquement au terme même de la « descente » qui s’effectue, avec une vitesse toujours accélérée, du commencement à la fin d’un Manvantara, c’est-à-dire pendant toute la durée de manifestation d’une humanité telle que la nôtre. Cette « descente » n’est en somme, comme nous avons eu déjà souvent l’occasion de le dire, que l’éloignement graduel du principe, nécessairement inhérent à tout processus de manifestation ; dans notre monde, et en raison des conditions spéciales d’existence auxquelles il est soumis, le point le plus bas revêt l’aspect de la quantité pure, dépourvue de toute distinction qualitative ; il va de soi, d’ailleurs, que ce n’est là proprement qu’une limite, et c’est pourquoi, en fait, nous ne pouvons parler que de « tendance », car, dans le parcours même du cycle, la limite ne peut jamais être atteinte, et elle est en quelque sorte en dehors et au-dessous de toute existence réalisée et même réalisable. Maintenant, ce qu’il importe de noter tout particulièrement et dès le début, tant pour éviter toute équivoque que pour se rendre compte de ce qui peut donner lieu à certaines illusions, c’est que, en vertu de la loi de l’analogie, le point le plus bas est comme un reflet obscur ou une image inversée du point le plus haut, d’où résulte cette conséquence, paradoxale en apparence seulement, que l’absence la plus complète de tout principe implique une sorte de « contrefaçon » du principe même, ce que certains ont exprimé, sous une forme « théologique », en disant que « Satan est le singe de Dieu ». Cette remarque peut aider grandement à comprendre quelques-unes des plus sombres énigmes du monde moderne, énigmes que lui-même nie d’ailleurs parce qu’il ne sait pas les apercevoir, bien qu’il les porte en lui, et parce que cette négation est une condition indispensable du maintien de la mentalité spéciale par laquelle il existe : si nos contemporains, dans leur ensemble, pouvaient voir ce qui les dirige et vers quoi ils tendent réellement, le monde moderne cesserait aussitôt d’exister comme tel, car le « redressement » auquel nous avons souvent fait allusion ne pourrait manquer de s’opérer par là même ; mais, comme ce « redressement » suppose d’autre part l’arrivée au point d’arrêt où la « descente » est entièrement accomplie et où « la roue cesse de tourner », du moins pour l’instant qui marque le passage d’un cycle à un autre, il faut en conclure que, jusqu’à ce que ce point d’arrêt soit atteint effectivement, ces choses ne pourront pas être comprises par la généralité, mais seulement par le petit nombre de ceux qui seront destinés à préparer, dans une mesure ou dans une autre, les germes du cycle futur. Il est à peine besoin de dire que, dans tout ce que nous exposons, c’est à ces derniers que nous avons toujours entendu nous adresser exclusivement, sans nous préoccuper de l’inévitable incompréhension des autres ; il est vrai que ces autres sont et doivent être, pour un certain temps encore, l’immense majorité, mais, précisément, ce n’est que dans le « règne de la quantité » que l’opinion de la majorité peut prétendre à être prise en considération.
Quoi qu’il en soit, nous voulons surtout, pour le moment et en premier lieu, appliquer la précédente remarque dans un domaine plus restreint que celui que nous venons de mentionner : elle doit servir, à cet égard, à empêcher toute confusion entre le point de vue de la science traditionnelle et celui de la science profane, alors même que certaines similitudes extérieures pourraient paraître s’y prêter ; ces similitudes, en effet, ne proviennent souvent que de correspondances inversées, où, tandis que la science traditionnelle envisage essentiellement le terme supérieur et n’accorde une valeur relative au terme inférieur qu’en raison de sa correspondance même avec ce terme supérieur, la science profane, au contraire, n’a en vue que le terme inférieur et, incapable de dépasser le domaine auquel il se réfère, prétend y réduire toute réalité. Ainsi, pour prendre un exemple qui se rapporte directement à notre sujet, les nombres pythagoriciens, envisagés comme les principes des choses, ne sont nullement les nombres tels que les entendent les modernes, mathématiciens ou physiciens, pas plus que l’immutabilité principielle n’est l’immobilité d’une pierre, ou que la véritable unité n’est l’uniformité d’êtres dénués de toutes qualités propres ; et pourtant, parce qu’il est question de nombres dans les deux cas, les partisans d’une science exclusivement quantitative n’ont pas manqué de vouloir compter les Pythagoriciens parmi leurs « précurseurs » ! Nous ajouterons seulement, pour ne pas trop anticiper sur les développements qui vont suivre, que cela montre encore que, comme nous l’avons déjà dit ailleurs, les sciences profanes dont le monde moderne est si fier ne sont bien réellement que des « résidus » dégénérés des antiques sciences traditionnelles, comme d’ailleurs la quantité elle-même, à laquelle elles s’efforcent de tout ramener, n’est pour ainsi dire, sous le point de vue où elles l’envisagent, que le « résidu » d’une existence vidée de tout ce qui constituait son essence ; et c’est ainsi que ces prétendues sciences, laissant échapper ou même éliminant de propos délibéré tout ce qui est véritablement essentiel, s’avèrent en définitive incapables de fournir l’explication réelle de quoi que ce soit. De même que la science traditionnelle des nombres est tout autre chose que l’arithmétique profane des modernes, même en joignant à celle-ci toutes les extensions algébriques ou autres dont elle est susceptible, de même aussi il est une « géométrie sacrée », non moins profondément différente de la science « scolaire » que l’on désigne aujourd’hui par ce même nom de géométrie. Nous n’avons pas besoin d’insister longuement là-dessus, car tous ceux qui ont lu nos précédents ouvrages savent que nous y avons exposé, et notamment dans Le Symbolisme de la Croix, maintes considérations relevant de cette géométrie symbolique dont il s’agit, et ils ont pu se rendre compte à quel point elle se prête à la représentation des réalités d’ordre supérieur, du moins dans toute la mesure où celles-ci sont susceptibles d’être représentées en mode sensible ; et d’ailleurs, au fond, les formes géométriques ne sont-elles pas nécessairement la base même de tout symbolisme figuré ou « graphique », depuis celui des caractères alphabétiques et numériques de toutes les langues jusqu’à celui des yantras initiatiques les plus complexes et les plus étranges en apparence ? Il est aisé de comprendre que ce symbolisme puisse donner lieu à une multiplicité indéfinie d’applications ; mais, en même temps, on doit voir tout aussi facilement qu’une telle géométrie, bien loin de ne se référer qu’à la pure quantité, est au contraire essentiellement « qualitative » ; et nous en dirons tout autant de la véritable science des nombres, car les nombres principiels, bien que devant être appelés ainsi par analogie, sont pour ainsi dire, par rapport à notre monde, au pôle opposé de celui où se situent les nombres de l’arithmétique vulgaire, les seuls que connaissent les modernes et sur lesquels ils portent exclusivement leur attention, prenant ainsi l’ombre pour la réalité même, comme les prisonniers de la caverne de Platon.
Dans la présente étude, nous nous efforcerons de montrer plus complètement encore, et d’une façon plus générale, quelle est la véritable nature de ces sciences traditionnelles, et aussi, par là même, quel abîme les sépare des sciences profanes qui en sont comme une caricature ou une parodie, ce qui permettra de mesurer la déchéance subie par la mentalité humaine en passant des unes aux autres, mais aussi de voir, par la situation respective de leurs objets, comment cette déchéance suit strictement la marche descendante du cycle même parcouru par notre humanité. Bien entendu, ces questions sont encore de celles qu’on ne peut jamais prétendre traiter complètement, car elles sont, de leur nature, véritablement inépuisables ; mais nous tâcherons tout au moins d’en dire assez pour que chacun puisse en tirer les conclusions qui s’imposent en ce qui concerne la détermination du « moment cosmique » auquel correspond l’époque actuelle. S’il y a là des considérations que certains trouveront peut-être obscures malgré tout, c’est uniquement parce qu’elles sont trop éloignées de leurs habitudes mentales, trop étrangères à tout ce qui leur a été inculqué par l’éducation qu’ils ont reçue et par le milieu dans lequel ils vivent ; nous ne pouvons rien à cela, car il est des choses pour lesquelles un mode d’expression proprement symbolique est le seul possible, et qui, par conséquent, ne seront jamais comprises par ceux pour qui le symbolisme est lettre morte. Nous rappellerons d’ailleurs que ce mode d’expression est le véhicule indispensable de tout enseignement d’ordre initiatique ; mais, sans même parler du monde profane dont l’incompréhension est évidente et en quelque sorte naturelle, il suffit de jeter un coup d’œil sur les vestiges d’initiation qui subsistent encore en Occident pour voir ce que certains, faute de « qualification » intellectuelle, font des symboles qui sont proposés à leur méditation, et pour être bien sûr que ceux-là, de quelques titres qu’ils soient revêtus et quelques degrés initiatiques qu’ils aient reçus « virtuellement », ne parviendront jamais à pénétrer le vrai sens du moindre fragment de la géométrie mystérieuse des « Grands Architectes d’Orient et d’Occident » !
Puisque nous venons de faire allusion à l’Occident, une remarque s’impose encore : quelque extension qu’ait prise, surtout en ces dernières années, l’état d’esprit que nous appelons spécifiquement « moderne », et quelque emprise qu’il exerce de plus en plus, extérieurement tout au moins, sur le monde entier, cet état d’esprit n’en demeure pas moins purement occidental par son origine : c’est bien en Occident qu’il a pris naissance et qu’il a eu longtemps son domaine exclusif, et, en Orient, son influence ne sera jamais autre chose qu’une « occidentalisation ». Si loin que puisse aller cette influence dans la suite des événements qui se dérouleront encore, on ne pourra donc jamais prétendre l’opposer à ce que nous avons dit de la différence de l’esprit oriental et de l’esprit occidental, qui est en somme la même chose pour nous que celle de l’esprit traditionnel et de l’esprit moderne, car il est trop évident que, dans la mesure où un homme s’« occidentalise », quels que soient sa race et son pays, il cesse par là même d’être un Oriental spirituellement et intellectuellement, c’est-à- dire au seul point de vue qui nous importe en réalité. Ce n’est pas là une simple question de « géographie », à moins qu’on ne l’entende tout autrement que les modernes, car il y a aussi une géographie symbolique ; et, à ce propos, l’actuelle prépondérance de l’Occident présente d’ailleurs une correspondance fort significative avec la fin d’un cycle, puisque l’Occident est précisément le point où le soleil se couche, c’est-à-dire où il arrive à l’extrémité de sa course diurne, et où, suivant le symbolisme chinois, « le fruit mûr tombe au pied de l’arbre ». Quant aux moyens par lesquels l’Occident est arrivé à établir cette domination dont la « modernisation » d’une partie plus ou moins considérable des Orientaux n’est que la dernière et la plus fâcheuse conséquence, il suffira de se reporter à ce que nous en avons dit dans d’autres ouvrages pour se convaincre qu’ils ne reposent en définitive que sur la force matérielle, ce qui revient à dire, en d’autres termes, que la domination occidentale elle-même n’est encore qu’une expression du « règne de la quantité ».
Ainsi, de quelque côté qu’on envisage les choses, on est toujours ramené aux mêmes considérations et on les voit se vérifier constamment dans toutes les applications qu’il est possible d’en faire ; cela n’a d’ailleurs rien qui doive surprendre, car la vérité est nécessairement cohérente, ce qui, bien entendu, ne veut nullement dire « systématique », contrairement à ce que pourraient trop volontiers supposer les philosophes et les savants profanes, enfermés qu’ils sont dans des conceptions étroitement limitées, qui sont celles auxquelles le nom de « systèmes » convient proprement, et qui, au fond, ne traduisent que l’insuffisance des mentalités individuelles livrées à elles-mêmes, ces mentalités fussent-elles celles de ce qu’on est convenu d’appeler des « hommes de génie », dont toutes les spéculations les plus vantées ne valent certes pas la connaissance de la moindre vérité traditionnelle. Là- dessus aussi, nous nous sommes suffisamment expliqué lorsque nous avons eu à dénoncer les méfaits de l’« individualisme », qui est encore une des caractéristiques de l’esprit moderne ; mais nous ajouterons ici que la fausse unité de l’individu conçu comme formant par lui-même un tout complet correspond, dans l’ordre humain, à ce qu’est celle du prétendu « atome » dans l’ordre cosmique : l’un et l’autre ne sont que des éléments considérés comme « simples » à un point de vue tout quantitatif, et, comme tels, supposés susceptibles d’une sorte de répétition indéfinie qui n’est proprement qu’une impossibilité, étant essentiellement incompatible avec la nature même des choses ; en fait, cette répétition indéfinie n’est pas autre chose que la multiplicité pure, vers laquelle le monde actuel tend de toutes ses forces, sans cependant jamais pouvoir arriver à s’y perdre entièrement, puisqu’elle se tient à un niveau inférieur à toute existence manifestée, et qui représente l’extrême opposé de l’unité principielle. Il faut donc voir le mouvement de descente cyclique comme s’effectuant entre ces deux pôles, partant de l’unité, ou plutôt du point qui en est le plus proche dans le domaine de la manifestation, relativement à l’état d’existence que l’on envisage, et tendant de plus en plus vers la multiplicité, nous voulons dire la multiplicité considérée analytiquement et sans être rapportée à aucun principe, car il va de soi que, dans l’ordre principiel, toute multiplicité est comprise synthétiquement dans l’unité même. Il peut sembler qu’il y ait, en un certain sens, multiplicité aux deux points extrêmes, de même qu’il y a aussi corrélativement, suivant ce que nous venons de dire, l’unité d’un côté et les « unités » de l’autre ; mais la notion de l’analogie inversée s’applique encore strictement ici, et, tandis que la multiplicité principielle est contenue dans la véritable unité métaphysique, les « unités » arithmétiques ou quantitatives sont au contraire contenues dans l’autre multiplicité, celle d’en bas ; et, remarquons-le incidemment, le seul fait de pouvoir parler d’« unités » au pluriel ne montre-t-il pas assez combien ce que l’on considère ainsi est loin de la véritable unité ? La multiplicité d’en bas est, par définition, purement quantitative, et l’on pourrait dire qu’elle est la quantité même, séparée de toute qualité ; par contre, la multiplicité d’en haut, ou ce que nous appelons ainsi analogiquement, est en réalité une multiplicité qualitative, c’est-à-dire l’ensemble des qualités ou des attributs qui constituent l’essence des êtres et des choses. On peut donc dire encore que la descente dont nous avons parlé s’effectue de la qualité pure vers la quantité pure, l’une et l’autre étant d’ailleurs des limites extérieures à la manifestation, l’une au delà et l’autre en deçà, parce qu’elles sont, par rapport aux conditions spéciales de notre monde ou de notre état d’existence, une expression des deux principes universels que nous avons désignés ailleurs respectivement comme « essence » et « substance », et qui sont les deux pôles entre lesquels se produit toute manifestation ; et c’est là le point que nous allons avoir à expliquer plus complètement en premier lieu, car c’est par là surtout qu’on pourra mieux comprendre les autres considérations que nous aurons à développer dans la suite de cette étude.
CHAPITRE PREMIER QUALITÉ ET QUANTITÉ
On considère assez généralement la qualité et la quantité comme deux termes complémentaires, quoique sans doute on soit souvent loin de comprendre la raison profonde de cette relation ; cette raison réside dans la correspondance que nous avons indiquée en dernier lieu dans ce qui précède. Il faut donc partir ici de la première de toutes les dualités cosmiques, de celle qui est au principe même de l’existence ou de la manifestation universelle, et sans laquelle nulle manifestation ne serait possible, sous quelque mode que ce soit ; cette dualité est celle de Purusha et de Prakriti suivant la doctrine hindoue, ou, pour employer une autre terminologie, celle de l’« essence » et de la « substance ». Celles-ci doivent être envisagées comme des principes universels, étant les deux pôles de toute manifestation ; mais, à un autre niveau, ou plutôt à d’autres niveaux multiples comme les domaines plus ou moins particularisés que l’on peut envisager à l’intérieur de l’existence universelle, on peut aussi employer analogiquement ces mêmes termes dans un sens relatif, pour désigner ce qui correspond à ces principes ou ce qui les représente plus directement par rapport à un certain mode plus ou moins restreint de la manifestation. C’est ainsi qu’on pourra parler d’essence et de substance, soit pour un monde, c’est-à-dire pour un état d’existence déterminé par certaines conditions spéciales, soit pour un être considéré en particulier, ou même pour chacun des états de cet être, c’est-à-dire pour sa manifestation dans chacun des degrés de l’existence ; dans ce dernier cas, l’essence et la substance sont naturellement la correspondance microcosmique de ce qu’elles sont, au point de vue macrocosmique, pour le monde dans lequel se situe cette manifestation, ou, en d’autres termes, elles ne sont que des particularisations des mêmes principes relatifs, qui eux-mêmes sont des déterminations de l’essence et de la substance universelles par rapport aux conditions du monde dont il s’agit.
Entendues dans ce sens relatif, et surtout par rapport aux êtres particuliers, l’essence et la substance sont en somme la même chose que ce que les philosophes scolastiques ont appelé « forme » et « matière » ; mais nous préférons éviter l’emploi de ces derniers termes, qui, sans doute par suite d’une imperfection de la langue latine à cet égard, ne rendent qu’assez inexactement les idées qu’ils doivent exprimer|1|, et qui sont devenus encore bien plus équivoques en raison du sens tout différent que les mêmes mots ont reçu communément dans le langage moderne. Quoi qu’il en soit, dire que tout être manifesté est un composé de « forme » et de « matière » revient à dire que son existence procède nécessairement à la fois de l’essence et de la substance, et, par conséquent, qu’il y a en lui quelque chose qui correspond à l’un et à l’autre de ces deux principes, de telle sorte qu’il est comme une résultante de leur union, ou, pour parler plus précisément, de l’action exercée par le principe actif ou l’essence sur le principe passif ou la substance ; et, dans l’application qui en est faite plus spécialement au cas des êtres individuels, cette « forme » et cette « matière » qui les constituent sont respectivement identiques à ce que la tradition hindoue désigne comme nâma et rûpa. Pendant que nous en sommes à signaler ces concordances entre différentes terminologies, qui peuvent avoir l’avantage de permettre à quelques-uns de transposer nos explications en un langage auquel ils sont plus habitués, et par suite de les comprendre plus facilement, nous ajouterons encore que ce qui est appelé « acte » et « puissance », au sens aristotélicien, correspond également à l’essence et à la substance ; ces deux termes sont d’ailleurs susceptibles d’une application plus étendue que ceux de « forme » et de « matière » ; mais, au fond, dire qu’il y a en tout être un mélange d’acte et de puissance revient encore au même, car l’acte est en lui ce par quoi il participe à l’essence, et la puissance ce par quoi il participe à la substance ; l’acte pur et la puissance pure ne sauraient se trouver nulle part dans la manifestation, puisqu’ils sont en définitive les équivalents de l’essence et de la substance universelles.
Cela étant bien compris, nous pouvons parler de l’essence et de la substance de notre monde, c’est-à-dire de celui qui est le domaine de l’être individuel humain, et nous dirons que, conformément aux conditions qui définissent proprement ce monde, ces deux principes y apparaissent respectivement sous les aspects de la qualité et de la quantité. Cela peut déjà paraître évident en ce qui concerne la qualité, puisque l’essence est en somme la synthèse principielle de tous les attributs qui appartiennent à un être et qui font que cet être est ce qu’il est, et qu’attributs ou qualités sont au fond synonymes ; et l’on peut remarquer que la qualité, ainsi envisagée comme le contenu de l’essence, s’il est permis de s’exprimer ainsi, n’est pas restreinte exclusivement à notre monde, mais qu’elle est susceptible d’une transposition qui en universalise la signification, ce qui n’a d’ailleurs rien d’étonnant dès lors qu’elle représente ici le principe supérieur ; mais, dans une telle universalisation, la qualité cesse d’être le corrélatif de la quantité, car celle-ci, par contre, est strictement liée aux conditions spéciales de notre monde ; d’ailleurs, au point de vue théologique, ne rapporte-t-on pas en quelque sorte la qualité à Dieu même en parlant de Ses attributs, tandis qu’il serait manifestement inconcevable de prétendre transporter de même en Lui des déterminations quantitatives quelconques|2| ? On pourrait peut-être objecter à cela qu’Aristote range la qualité, aussi bien que la quantité, parmi les « catégories », qui ne sont que des modes spéciaux de l’être et ne lui sont pas coextensives ; mais c’est qu’alors il n’effectue pas la transposition dont nous venons de parler et que d’ailleurs il n’a pas à le faire, l’énumération des « catégories » ne se référant qu’à notre monde et à ses conditions, si bien que la qualité ne peut et ne doit réellement y être prise que dans le sens, plus immédiat pour nous dans notre état individuel, où elle se présente, ainsi que nous l’avons dit tout d’abord, comme un corrélatif de la quantité.
Il est intéressant de remarquer, d’autre part, que la « forme » des scolastiques est ce qu’Aristote appelle ....., et que ce dernier mot est employé également pour désigner l’« espèce », laquelle est proprement une nature ou une essence commune à une multitude indéfinie d’individus ; or cette nature est d’ordre purement qualitatif, car elle est véritablement « innombrable », au sens strict de ce mot, c’est-à-dire indépendante de la quantité, étant indivisible et tout entière en chacun des individus qui appartiennent à cette espèce, de telle sorte qu’elle n’est aucunement affectée ou modifiée par le nombre de ceux-ci, et qu’elle n’est pas susceptible de « plus » ou de « moins ». De plus, ..... est étymologiquement l’« idée », non pas au sens psychologique des modernes, mais en un sens ontologique plus proche de celui de Platon qu’on ne le pense d’ordinaire, car, quelles que soient les différences qui existent réellement à cet égard entre la conception de Platon et celle d’Aristote, ces différences, comme il arrive souvent, ont été grandement exagérées par leurs disciples et leurs commentateurs. Les idées platoniciennes sont aussi des essences ; Platon en montre surtout l’aspect transcendant et Aristote l’aspect immanent, ce qui ne s’exclut pas forcément, quoi qu’en puissent dire les esprits « systématiques », mais se rapporte seulement à des niveaux différents ; en tout cas, il s’agit toujours là des « archétypes » ou des principes essentiels des choses, qui représentent ce qu’on pourrait appeler le côté qualitatif de la manifestation. En outre, ces mêmes idées platoniciennes sont, sous un autre nom, et par une filiation directe, la même chose que les nombres pythagoriciens ; et cela montre bien que ces mêmes nombres pythagoriciens, ainsi que nous l’avons déjà indiqué précédemment, bien qu’appelés nombres analogiquement, ne sont nullement les nombres au sens quantitatif et ordinaire de ce mot, mais qu’ils sont au contraire purement qualitatifs, correspondant inversement, du côté de l’essence, à ce que sont les nombres quantitatifs du côté de la substance|3|.
Par contre, quand saint Thomas d’Aquin dit que « numerus stat ex parte materiae », c’est bien du nombre quantitatif qu’il s’agit, et il affirme précisément par là que la quantité tient immédiatement au côté substantiel de la manifestation ; nous disons substantiel, car materia, au sens scolastique, n’est point la « matière » telle que l’entendent les physiciens modernes, mais bien la substance, soit dans son acception relative quand elle est mise en corrélation avec forma et rapportée aux êtres particuliers, soit aussi, lorsqu’il est question de materia prima, comme le principe passif de la manifestation universelle, c’est-à-dire la potentialité pure, qui est l’équivalent de Prakriti dans la doctrine hindoue. Cependant, dès qu’il est question de « matière », en quelque sens qu’on veuille l’entendre, tout devient particulièrement obscur et confus, et sans doute non sans raison|4|; aussi, tandis que nous avons pu montrer suffisamment le rapport de la qualité avec l’essence sans entrer dans de longs développements, nous devrons nous étendre davantage sur ce qui concerne le rapport de la quantité avec la substance, car il nous faut d’abord parvenir à élucider les différents aspects sous lesquels se présente ce que les Occidentaux ont appelé « matière », même avant la déviation moderne où ce mot était destiné à jouer un si grand rôle ; et cela est d’ailleurs d’autant plus nécessaire que cette question se trouve en quelque sorte à la racine même du sujet principal de notre étude.
CHAPITRE II MATERIA SIGNATA QUANTITATE
Les scolastiques appellent materia, d’une façon générale, ce qu’Aristote avait appelé ὕλη ; cette materia, comme nous l’avons déjà dit, ne doit nullement être identifiée à la « matière » des modernes, dont la notion complexe, et contradictoire même par certains côtés, semble avoir été aussi étrangère aux anciens de l’Occident qu’elle l’est aux Orientaux ; même si l’on admettait qu’elle puisse devenir cette « matière » dans certains cas particuliers, ou plutôt, pour parler plus exactement, qu’on puisse y faire rentrer après coup cette conception plus récente, elle est aussi bien d’autres choses en même temps, et ce sont ces choses diverses qu’il nous faut avoir bien soin de distinguer tout d’abord ; mais, pour les désigner toutes ensemble par une dénomination commune comme celles de ὕλη et de materia, nous n’avons pas à notre disposition, dans les langues occidentales actuelles, de meilleur terme que celui de « substance ». Avant tout, la ὕλη, en tant que principe universel, est la puissance pure, où il n’y a rien de distingué ni d’« actualisé », et qui constitue le « support » passif de toute manifestation ; c’est donc bien, en ce sens, Prakriti ou la substance universelle, et tout ce que nous avons dit ailleurs au sujet de celle-ci s’applique également à la ὕλη ainsi entendue|5|. Quant à la substance prise dans un sens relatif, comme étant ce qui représente analogiquement le principe substantiel et en joue le rôle par rapport à un certain ordre d’existence plus ou moins étroitement délimité, c’est bien elle aussi qui est appelée secondairement ὕλη, notamment dans la corrélation de ce terme avec εἶδοςpour désigner les deux faces essentielle et substantielle des existences particulières.
Les scolastiques, après Aristote, distinguent ces deux sens en parlant de materia prima et de materia secunda ; nous pouvons donc dire que leur materia prima est la substance universelle, et que leur materia secunda est la substance au sens relatif ; mais comme, dès qu’on entre dans le relatif, les termes deviennent susceptibles d’applications multiples à des degrés différents, il arrive que ce qui est materia à un certain niveau peut devenir forma à un autre niveau et inversement, suivant la hiérarchie des degrés plus ou moins particularisés que l’on considère dans l’existence manifestée. Dans tous les cas, une materia secunda, bien qu’elle constitue le côté potentiel d’un monde ou d’un être, n’est jamais puissance pure ; il n’y a de puissance pure que la substance universelle, qui ne se situe pas seulement au-dessous de notre monde (substantia, de sub stare, est littéralement « ce qui se tient dessous », ce que rendent aussi les idées de « support » et de « substratum »), mais au-dessous de l’ensemble de tous les mondes ou de tous les états qui sont compris dans la manifestation universelle. Ajoutons que, par là même qu’elle n’est que potentialité absolument « indistinguée » et indifférenciée, la substance universelle est le seul principe qui puisse être dit proprement « inintelligible », non pas parce que nous sommes incapables de la connaître, mais parce qu’il n’y a effectivement rien à connaître en elle ; quant aux substances relatives, en tant qu’elles participent de la potentialité de la substance universelle, elles participent aussi de son « inintelligibilité » dans une mesure correspondante. Ce n’est donc pas du côté substantiel qu’il faut chercher l’explication des choses, mais bien au contraire du côté essentiel, ce qu’on pourrait traduire en termes de symbolisme spatial en disant que toute explication doit procéder de haut en bas et non pas de bas en haut ; et cette remarque est particulièrement importante pour nous, car elle donne immédiatement la raison pour laquelle la science moderne est en réalité dépourvue de toute valeur explicative. Avant d’aller plus loin, nous devons noter tout de suite que la « matière » des physiciens ne peut être en tout cas qu’une materia secunda, puisqu’ils la supposent douée de certaines propriétés, sur lesquelles ils ne s’accordent d’ailleurs pas entièrement, de sorte qu’il n’y a pas en elle que potentialité et « indistinction » ; du reste, comme leurs conceptions ne se rapportent qu’au seul monde sensible et ne vont pas au delà, ils n’auraient que faire de la considération de la materia prima. Cependant, par une étrange confusion, ils parlent à chaque instant de « matière inerte », sans s’apercevoir que, si elle était vraiment inerte, elle serait dénuée de toute propriété et ne se manifesterait en aucune façon, si bien qu’elle ne serait absolument rien de ce que leurs sens peuvent percevoir, tandis qu’au contraire ils déclarent « matière » tout ce qui tombe sous leurs sens ; en réalité, l’inertie ne peut convenir qu’à la seule materia prima, parce qu’elle est synonyme de passivité ou de potentialité pure. Parler de « propriétés de la matière » et affirmer en même temps que « la matière est inerte », c’est là une insoluble contradiction ; et, curieuse ironie des choses, le « scientisme » moderne, qui a la prétention d’éliminer tout « mystère », ne fait pourtant appel, dans ses vaines tentatives d’explication, qu’à ce qu’il y a de plus « mystérieux » au sens vulgaire de ce mot, c’est-à-dire de plus obscur et de moins intelligible !
Maintenant, on peut se demander si, en mettant de côté la prétendue « inertie de la matière » qui n’est au fond qu’une absurdité, cette même « matière », douée de qualités plus ou moins bien définies qui la rendraient susceptible de se manifester à nos sens, est la même chose que la materia secunda de notre monde telle que l’entendent les scolastiques. On peut déjà se douter qu’une telle assimilation serait inexacte si l’on remarque seulement que, pour jouer par rapport à notre monde un rôle analogue à celui de la materia prima ou de la substance universelle par rapport à toute manifestation, la materia secunda dont il s’agit ne doit aucunement être manifestée dans ce monde même, mais seulement servir de « support » ou de « racine » à ce qui s’y manifeste, et que, par conséquent, les qualités sensibles ne peuvent lui être inhérentes, mais procèdent au contraire de « formes » reçues en elle, ce qui revient encore à dire que tout ce qui est qualité doit en définitive être rapporté à l’essence. On voit donc apparaître ici une nouvelle confusion : les physiciens modernes, dans leur effort pour réduire la qualité à la quantité, en sont arrivés, par une sorte de « logique de l’erreur », à confondre l’une et l’autre, et par suite à attribuer la qualité elle-même à leur « matière » comme telle, en laquelle ils finissent ainsi par placer toute la réalité, ou du moins tout ce qu’ils sont capables de reconnaître comme réalité, ce qui constitue le « matérialisme » proprement dit. La materia secunda de notre monde ne doit cependant pas être dépourvue de toute détermination, car, si elle l’était, elle se confondrait avec la materia prima elle- même dans sa complète « indistinction » ; et, d’autre part, elle ne peut pas être une materia secunda quelconque, mais elle doit être déterminée en accord avec les conditions spéciales de ce monde, et de telle façon que ce soit effectivement par rapport à celui-ci qu’elle soit apte à jouer le rôle de substance, et non pas par rapport à quoi que ce soit d’autre. Il faut donc préciser la nature de cette détermination, et c’est ce que fait saint Thomas d’Aquin en définissant cette materia secunda comme materia signata quantitate ; ce qui lui est inhérent et la fait être ce qu’elle est, ce n’est donc pas la qualité, même envisagée dans le seul ordre sensible, mais c’est au contraire la quantité, qui est bien ainsi ex parte materiae. La quantité est une des conditions mêmes de l’existence dans le monde sensible ou corporel ; elle est même, parmi ces conditions, une de celles qui sont le plus exclusivement propres à celui-ci, et ainsi, comme on pouvait d’ailleurs s’y attendre, la définition de la materia secunda en question ne peut pas concerner autre chose que ce monde, mais elle le concerne tout entier, car tout ce qui y existe est nécessairement soumis à la quantité ; cette définition est donc pleinement suffisante, sans qu’il y ait lieu d’attribuer à cette materia secunda, comme on l’a fait pour la « matière » moderne, des propriétés qui ne peuvent aucunement lui appartenir en réalité. On peut dire que la quantité, constituant proprement le côté substantiel de notre monde, en est pour ainsi dire la condition « basique » ou fondamentale ; mais il faut bien se garder de lui donner pour cela une importance d’un autre ordre que celle qu’elle a réellement, et surtout de vouloir en tirer l’explication de ce monde, de même qu’il faut se garder de confondre le fondement d’un édifice avec son sommet : tant qu’il n’y a que le fondement, il n’y a pas encore d’édifice, bien que ce fondement lui soit indispensable, et de même, tant qu’il n’y a que la quantité, il n’y a pas encore de manifestation sensible, bien que celle-ci y ait sa racine même. La quantité, réduite à elle-même, n’est qu’une « présupposition » nécessaire, mais qui n’explique rien ; c’est bien une base, mais ce n’est rien d’autre, et l’on ne doit pas oublier que la base, par définition même, est ce qui est situé au niveau le plus inférieur ; aussi la réduction de la qualité à la quantité n’est-elle pas autre chose au fond que cette « réduction du supérieur à l’inférieur » par laquelle certains ont voulu très justement caractériser le matérialisme : prétendre faire sortir le « plus » du « moins », c’est bien là, en effet, une des plus typiques de toutes les aberrations modernes ! Une autre question se pose encore : la quantité se présente à nous sous des modes divers, et, notamment, il y a la quantité discontinue, qui est proprement le nombre|6|, et la quantité continue, qui est représentée principalement par les grandeurs d’ordre spatial et temporel ; quel est, parmi ces modes, celui qui constitue plus précisément ce qu’on peut appeler la quantité pure ? Cette question a aussi son importance, d’autant plus que Descartes, qui se trouve au point de départ d’une bonne partie des conceptions philosophiques et scientifiques spécifiquement modernes, a voulu définir la matière par l’étendue, et faire de cette définition même le principe d’une physique quantitative qui, si elle n’était pas encore du « matérialisme », était du moins du « mécanisme » ; on pourrait être tenté de conclure de là que c’est l’étendue qui, étant directement inhérente à la matière, représente le mode fondamental de la quantité. Par contre, saint Thomas d’Aquin, en disant que « numerus stat ex parte materiae », semble plutôt suggérer que c’est le nombre qui constitue la base substantielle de ce monde, et que c’est lui, par conséquent, qui doit être regardé véritablement comme la quantité pure ; ce caractère « basique » du nombre s’accorde d’ailleurs parfaitement avec le fait que, dans la doctrine pythagoricienne, c’est lui qui, par analogie inverse, est pris comme symbole des principes essentiels des choses. Il faut d’ailleurs remarquer que la matière de Descartes n’est plus la materia secunda des scolastiques, mais qu’elle est déjà un exemple, et peut-être le premier en date, d’une « matière » de physicien moderne, bien qu’il n’ait pas encore mis dans cette notion tout ce que ses successeurs devaient y introduire peu à peu pour en arriver aux théories les plus récentes sur la « constitution de la matière ». Il y a donc lieu de soupçonner qu’il peut y avoir, dans la définition cartésienne de la matière, quelque erreur ou quelque confusion, et qu’il a dû déjà s’y glisser, peut-être à l’insu de son auteur, un élément qui n’est pas d’ordre purement quantitatif ; et en effet, comme nous le verrons par la suite, l’étendue, tout en ayant évidemment un caractère quantitatif, comme d’ailleurs tout ce qui appartient au monde sensible, ne saurait pourtant être regardée comme pure quantité. De plus, on peut remarquer aussi que les théories qui vont le plus loin dans le sens de la réduction au quantitatif sont généralement « atomistes », sous une forme ou sous une autre, c’est-à-dire qu’elles introduisent dans leur notion de matière une discontinuité qui la rapproche beaucoup plus de la nature du nombre que de celle de l’étendue ; et même le fait que la matière corporelle ne peut pas malgré tout être conçue autrement que comme étendue n’est pour tout « atomisme » qu’une source de contradictions. Une autre cause de confusion en tout cela, et sur laquelle nous aurons à revenir, est l’habitude que l’on a prise de considérer « corps » et « matière » comme à peu près synonymes ; en réalité, les corps ne sont nullement la materia secunda, qui ne se rencontre nulle part dans les existences manifestées en ce monde, mais ils en procèdent seulement comme de leur principe substantiel. En définitive, c’est bien le nombre, qui, lui non plus, n’est jamais perçu directement et à l’état pur dans le monde corporel, qui doit être considéré en premier lieu dans le domaine de la quantité, comme en constituant le mode fondamental ; les autres modes ne sont que dérivés, c’est-à-dire qu’ils ne sont en quelque sorte quantité que par participation au nombre, ce qu’on reconnaît d’ailleurs implicitement quand on considère, comme il en est toujours en fait, que tout ce qui est quantitatif doit pouvoir s’exprimer numériquement. Dans ces autres modes, la quantité, même si elle est l’élément prédominant, apparaît toujours comme plus ou moins mélangée de qualité, et c’est ainsi que les conceptions de l’espace et du temps, en dépit de tous les efforts des mathématiciens modernes, ne pourront jamais être exclusivement quantitatives, à moins que l’on ne consente à les réduire à des notions entièrement vides, sans aucun contact avec une réalité quelconque ; mais, à vrai dire, la science actuelle n’est-elle pas faite en grande partie de ces notions vides, qui n’ont plus que le caractère de « conventions » sans la moindre portée effective ? Nous nous expliquerons plus complètement sur cette dernière question, surtout en ce qui concerne la nature de l’espace, car ce point a un rapport étroit avec les principes du symbolisme géométrique, et, en même temps, il fournit un excellent exemple de la dégénérescence qui conduit des conceptions traditionnelles aux conceptions profanes ; et nous y arriverons en examinant tout d’abord comment l’idée de la « mesure », sur laquelle repose la géométrie elle-même, est, traditionnellement, susceptible d’une transposition qui lui donne une tout autre signification que celle qu’elle a pour les savants modernes, qui n’y voient en somme que le moyen d’approcher le plus possible de leur « idéal » à rebours, c’est-à-dire d’opérer peu à peu la réduction de toutes choses à la quantité.
CHAPITRE III MESURE ET MANIFESTATION
Si nous estimons préférable d’éviter l’emploi du mot « matière » tant que nous n’avons pas à examiner spécialement les conceptions modernes, il doit être bien entendu que la raison en est dans les confusions qu’il fait naître inévitablement, car il est impossible qu’il n’évoque pas avant tout, et cela même chez ceux qui connaissent le sens différent qu’il avait pour les scolastiques, l’idée de ce que les physiciens modernes désignent ainsi, cette acception récente étant la seule qui s’attache à ce mot dans le langage courant. Or cette idée, comme nous l’avons déjà dit, ne se rencontre dans aucune doctrine traditionnelle, qu’elle soit orientale ou occidentale ; cela montre tout au moins que, même dans la mesure où il serait possible de l’admettre légitimement en la débarrassant de certains éléments hétéroclites ou même nettement contradictoires, une telle idée n’a rien de véritablement essentiel et ne se rapporte en réalité qu’à une façon très particulière d’envisager les choses. En même temps, puisqu’il ne s’agit là que d’une idée très récente, il va de soi qu’elle n’est pas impliquée dans le mot lui-même, qui lui est fort antérieur, et dont la signification originelle doit par conséquent en être entièrement indépendante ; mais il faut d’ailleurs reconnaître que ce mot est de ceux dont il est fort difficile de déterminer exactement la véritable dérivation étymologique, comme si une obscurité plus ou moins impénétrable devait décidément envelopper tout ce qui se rapporte à la « matière », et il n’est guère possible, à cet égard, de faire plus que de discerner certaines idées qui sont associées à sa racine, ce qui du reste n’est pas sans présenter un certain intérêt, même si l’on ne peut pas préciser quelle est, parmi ces idées, celle qui tient de plus près au sens primitif.
L’association qui semble avoir été le plus souvent remarquée est celle qui rattache materia à mater, et cela convient bien en effet à la substance, en tant que celle-ci est un principe passif, ou symboliquement « féminin » : on peut dire que Prakriti joue le rôle « maternel » par rapport à la manifestation, de même que Purusha joue le rôle « paternel » ; et il en est également ainsi à tous les degrés où l’on peut envisager analogiquement une corrélation d’essence et de substance|7|. D’autre part, il est possible aussi de rattacher le même mot materia au verbe latin metiri, « mesurer » (et nous allons voir qu’il existe ici en sanscrit une forme qui en est plus proche encore) ; mais qui dit « mesure » dit par là même détermination, et ceci ne s’applique plus à l’absolue indétermination de la substance universelle ou de la materia prima, mais doit plutôt se référer à quelque autre signification plus restreinte ; c’est là précisément le point que nous nous proposons d’examiner maintenant d’une façon plus particulière.
Comme le dit à ce sujet Ananda K. Coomaraswamy, « pour tout ce qui peut être conçu ou perçu (dans le monde manifesté), le sanscrit a seulement l’expression nâma-rûpa, dont les deux termes correspondent à l’“intelligible” et au “sensible” (considérés comme deux aspects complémentaires se référant respectivement à l’essence et à la substance des choses)|8|. Il est vrai que le mot mâtrâ, qui signifie littéralement “mesure”, est l’équivalent étymologique de materia ; mais ce qui est ainsi “mesuré”, ce n’est pas la “matière” des physiciens, ce sont les possibilités de manifestation qui sont inhérentes à l’esprit (Atmâ) »|9|. Cette idée de « mesure », mise ainsi en rapport direct avec la manifestation elle-même, est fort importante, et d’ailleurs elle est bien loin d’être exclusivement propre à la seule tradition hindoue, que M. Coomaraswamy a ici plus spécialement en vue ; en fait, on pourrait dire qu’elle se retrouve, sous une forme ou sous une autre, dans toutes les doctrines traditionnelles, et, bien que naturellement nous ne puissions pas avoir la prétention d’indiquer présentement toutes les concordances qu’on pourrait relever à cet égard, nous tâcherons cependant d’en dire assez pour justifier cette assertion, tout en éclaircissant, autant qu’il nous sera possible de le faire, ce symbolisme de la « mesure » qui tient notamment une grande place dans certaines formes initiatiques.
La mesure, entendue dans son sens littéral, se rapporte principalement au domaine de la quantité continue, c’est-à-dire, de la façon la plus directe, aux choses qui possèdent un caractère spatial (car le temps lui-même, bien qu’également continu, ne peut être mesuré qu’indirectement, en le rattachant en quelque sorte à l’espace par l’intermédiaire du mouvement qui établit une relation entre l’un et l’autre) ; cela revient à dire qu’elle se rapporte en somme, soit à l’étendue elle-même, soit à ce qu’on est convenu d’appeler la « matière corporelle », en raison du caractère étendu que celle-ci possède nécessairement, ce qui d’ailleurs ne veut pas dire que sa nature, comme l’a prétendu Descartes, se réduise purement et simplement à l’étendue. Dans le premier cas, la mesure est plus proprement « géométrique » ; dans le second, on pourrait la dire plutôt « physique », au sens ordinaire de ce mot ; mais, en réalité, ce second cas se ramène au premier, puisque c’est en tant qu’ils se situent dans l’étendue et qu’ils en occupent une certaine portion définie que les corps sont immédiatement mesurables, tandis que leurs autres propriétés ne sont susceptibles de mesure qu’autant qu’elles peuvent être rapportées d’une certaine façon à l’étendue. Nous sommes ici, comme nous l’avions prévu, bien loin de la materia prima, qui en effet, dans son « indistinction » absolue, ne peut ni être mesurée en aucune façon ni servir à mesurer quoi que ce soit ; mais nous devons nous demander si cette notion de la mesure ne se lie pas plus ou moins étroitement à ce qui constitue la materia secunda de notre monde, et, effectivement, ce lien existe du fait que celle-ci est signata quantitate. En effet, si la mesure concerne directement l’étendue et ce qui est contenu en elle, c’est par l’aspect quantitatif de cette étendue qu’elle est rendue possible ; mais la quantité continue n’est elle-même, comme nous l’avons expliqué, qu’un mode dérivé de la quantité, c’est-à-dire qu’elle n’est proprement quantité que par sa participation à la quantité pure, qui, elle, est inhérente à la materia secunda du monde corporel ; et, ajouterons-nous, c’est parce que le continu n’est pas la quantité pure que la mesure présente toujours une certaine imperfection dans son expression numérique, la discontinuité du nombre rendant impossible son application adéquate à la détermination des grandeurs continues. Le nombre est bien véritablement la base de toute mesure, mais, tant qu’on ne considère que le nombre, on ne peut pas parler de mesure, celle-ci étant l’application du nombre à quelque chose d’autre, application qui est toujours possible, dans certaines limites, c’est-à-dire en tenant compte de l’« inadéquation » que nous venons d’indiquer, pour tout ce qui est soumis à la condition quantitative, ou, en d’autres termes, pour tout ce qui appartient au domaine de la manifestation corporelle. Seulement, et nous revenons ici à l’idée exprimée par A. Coomaraswamy, il faut bien prendre garde que, en réalité, et en dépit de certains abus du langage ordinaire, la quantité n’est pas ce qui est mesuré, mais au contraire ce par quoi les choses sont mesurées ; et, en outre, on peut dire que la mesure est par rapport au nombre, en sens inversement analogique, ce qu’est la manifestation par rapport à son principe essentiel.
Maintenant, il est bien entendu que, pour étendre l’idée de la mesure au delà du monde corporel, il est nécessaire de la transposer analogiquement : l’espace étant le lieu de manifestation des possibilités d’ordre corporel, on pourra s’en servir pour représenter tout le domaine de la manifestation universelle, qui autrement ne serait pas « représentable » ; et ainsi l’idée de mesure, appliquée à celui-ci, appartient essentiellement à ce symbolisme spatial dont nous avons si souvent à signaler des exemples. Au fond, la mesure est alors une « assignation » ou une « détermination », nécessairement impliquée par toute manifestation, dans quelque ordre et sous quelque mode que ce soit ; cette détermination est naturellement conforme aux conditions de chaque état d’existence, et même, en un certain sens, elle s’identifie à ces conditions elles-mêmes ; elle n’est véritablement quantitative que dans notre monde, puisque la quantité n’est en définitive, aussi bien d’ailleurs que l’espace et le temps, qu’une des conditions spéciales de l’existence corporelle. Mais il y a, dans tous les mondes, une détermination qui peut être symbolisée pour nous par cette détermination quantitative qu’est la mesure, puisqu’elle est ce qui y correspond en tenant compte de la différence des conditions ; et l’on peut dire que c’est par cette détermination que ces mondes, avec tout ce qu’ils contiennent, sont réalisés ou « actualisés » comme tels, puisqu’elle ne fait qu’un avec le processus même de la manifestation. M. Coomaraswamy remarque que « le concept platonicien et néo-platonicien de “mesure” (μέηρο) concorde avec le concept indien : le “non-mesuré” est ce qui n’a pas encore été défini ; le “mesuré” est le contenu défini ou fini du “cosmos”, c’est-à- dire de l’univers “ordonné” ; le “non-mesurable” est l’infini, qui est la source à la fois de l’indéfini et du fini, et qui demeure inaffecté par la définition de ce qui est définissable », c’est-à-dire par la réalisation des possibilités de manifestation qu’il porte en lui.
On voit ici que l’idée de mesure est en connexion intime avec celle d’« ordre » (en sanscrit rita), qui se rapporte à la production de l’univers manifesté, celle-ci étant, suivant le sens étymologique du mot grec κόζμος, une production de l’« ordre » à partir du « chaos » ; ce dernier est l’indéfini, au sens platonicien, et le « cosmos » est le défini|10|. Cette production est aussi assimilée par toutes les traditions à une « illumination » (le Fiat Lux de la Genèse), le « chaos » étant identifié symboliquement aux « ténèbres » : c’est la potentialité à partir de laquelle s’« actualisera » la manifestation, c’est-à-dire en somme le côté substantiel du monde, qui est ainsi décrit comme le pôle ténébreux de l’existence, tandis que l’essence en est le pôle lumineux, puisque c’est son influence qui effectivement illumine ce « chaos » pour en tirer le « cosmos » ; et, d’autre part, ceci s’accorde avec le rapprochement des différentes significations impliquées en sanscrit dans le mot srishti, qui désigne la production de la manifestation, et qui contient à la fois les idées d’« expression », de « conception » et de « rayonnement lumineux »|11|. Les rayons solaires font apparaître les choses qu’ils éclairent, les rendent visibles, donc peuvent être dits symboliquement les « manifester » ; si l’on considère un point central dans l’espace et les rayons émanés de ce centre, on pourra dire aussi que ces rayons « réalisent » l’espace, en le faisant passer de la virtualité à l’actualité, et que leur extension effective est, à chaque instant, la mesure de l’espace réalisé. Ces rayons correspondent aux directions de l’espace proprement dit (directions qui sont souvent représentées par le symbolisme des « cheveux », lequel se réfère en même temps aux rayons solaires) ; l’espace est défini et mesuré par la croix à trois dimensions, et, dans le symbolisme traditionnel des « sept rayons solaires », six de ces rayons, opposés deux à deux, forment cette croix, tandis que le « septième rayon », celui qui passe au travers de la « porte solaire », ne peut être représenté graphiquement que par le centre lui-même. Tout cela est donc parfaitement cohérent et s’enchaîne de la façon la plus rigoureuse ; et nous ajouterons encore que, dans la tradition hindoue, les « trois pas » de Vishnu, dont le caractère « solaire » est bien connu, mesurent les « trois mondes », ce qui revient à dire qu’ils « effectuent » la totalité de la manifestation universelle. On sait, d’autre part, que les trois éléments qui constituent le monosyllabe sacré Om sont désignés par le terme mâtrâ, ce qui indique qu’ils représentent aussi la mesure respective des « trois mondes » ; et, par la méditation de ces mâtrâs, l’être réalise en soi les états ou degrés correspondants de l’existence universelle et devient ainsi lui- même la « mesure de toutes choses »|12|.
Le mot sanscrit mâtrâ a pour équivalent exact en hébreu le mot middah ; or, dans la Kabbale, les middoth sont assimilées aux attributs divins, et il est dit que c’est par elles que Dieu a créé les mondes, ce qui, en outre, est mis en rapport précisément avec le symbolisme du point central et des directions de l’espace|13|. On pourrait aussi rappeler, à ce propos, la parole biblique suivant laquelle Dieu a « disposé toutes choses en mesure, nombre et poids »|14|