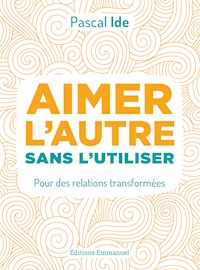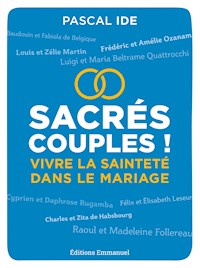Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions de l'Emmanuel
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Pourquoi les relations avec nos proches sont-elles si souvent violentes et douloureuses ? Pourquoi nos discussions qui commencent si bien se terminent elles parfois si mal ? Souvent à notre insu, nous nous trouvons entraînés dans ce qu’un psychiatre américain, Stephen Karpman, appelle le Triangle dramatique : nous tournons entre trois personnages, le Sauveteur, le Victimaire et le Bourreau. Pascal Ide décrypte avec finesse ce mécanisme, en propose des descriptions précises et les illustre par des exemples tirés de la vie quotidienne ou du cinéma. Surtout, il détaille les moyens pour en sortir. Ainsi, passer de ce triangle toxique à des relations toniques nous fait entrer dans la joie de l’échange et du don.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Monseigneur
Pascal Ide est prêtre du diocèse de Paris depuis 1990 et membre de la communauté de l'Emmanuel. Actuellement, il est chef du service des Universités catholiques à la Congrégation pour l'Éducation catholique. Il est docteur en médecine, en philosophie et en théologie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 562
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pascal IDE
Le triangle maléfique
Victimaire, Sauveteur, Bourreau : sortir de nos relations toxiques
Conception couverture : © Christophe Roger
Composition : Soft Office (38)
© Éditions de l’Emmanuel, 2018
89, bd Auguste-Blanqui – 75013 Paris
www.editions-emmanuel.com
ISBN : 978-2-35389-704-9
Dépôt légal : 3e trimestre 2018
Du même auteur
Travailler avec méthode, c’est réussir. Précis de méthodologie pour l’étudiant chrétien, Paris, Le Sarment-Fayard, coll. « Guide Totus », 1989.
Construire sa personnalité, Paris, Le Sarment-Fayard, 1991.
Guide de l’éducation, en collaboration avec Catherine DEREMBLE et Véronique MAUMUSSON, Paris, Droguet-Ardant, 1992.
L’Art de penser. Guide pratique, Paris, Médialogue, 1992.
Connaître ses blessures, Paris, Éditions de l’Emmanuel, 1993, rééd. avec préface, 2013.
Introduction à la métaphysique. I. Vers les sommets, Paris, Mame, coll. « Les cahiers de l’École cathédrale » n° 8, 1994.
Est-il possible de pardonner ?, Versailles, Saint-Paul, coll. « Enjeux », 1994.
Être et mystère. La philosophie de Hans Urs von Balthasar, Namur, Culture et vérité, coll. « Présences » n° 13, 1995.
Le Corps à cœur, Versailles, Saint-Paul, coll. « Enjeux », 1996.
Eh bien dites : don ! Petit éloge du don, Paris, Éditions de l’Emmanuel, 1997.
Mieux se connaître pour mieux s’aimer, Paris, Fayard, 1998.
Les Neuf Portes de l’âme. Ennéagramme et péchés capitaux : un chemin psychospirituel, Paris, Fayard, 1999.
Célibataires : osez le mariage !, Versailles, Saint-Paul, 1999.
Les Sept Péchés capitaux. Ce mal qui nous tient tête, en collaboration avec Luc ADRIAN, Paris, Édifa-Mame, 2002.
Regards sur « La Passion du Christ ». Lectures du film de Mel Gibson, Jean-Gabriel RUEG, Philippe RAGUIS et PascalIDE (dir.), Toulouse, Éd. du Carmel, 2004.
Le zygote est-il une personne humaine ?, Paris, Téqui, coll. « Questions disputées : Saint Thomas et les thomistes », 2004.
La Rencontre au cinéma, Paris, Éditions de l’Emmanuel, 2005.
Iubirea nefericita [Amour et amitié]. Tratarea si vindecarea ei, trad. Iosif Tiba, Galaxia Gutenberg, 2005.
« Le Christ donne tout ». Benoît XVI, une théologie de l’amour, Paris, Éditions de l’Emmanuel, 2007.
Des ressources pour guérir. Comprendre et évaluer quelques nouvelles thérapies : hypnose éricksonienne, EMDR, Cohérence cardiaque, EFT, Tipi, CNV, Kaizen, Paris, DDB, 2012.
Une théologie de l’amour. L’amour, centre de la « Trilogie » de Hans Urs von Balthasar, Bruxelles, Lessius, coll. « Donner raison », 2012.
Une théo-logique du don. Le don dans la « Trilogie » de Hans Urs von Balthasar, Leuven, Peeters, coll. « Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium » n° 256, 2013.
Le Burn-out. Une maladie du don, Paris, Éditions de l’Emmanuel et Quasar, 2015.
Gustav SIEWERTH, La Philosophie de la vie de Hans André, trad. Emmanuel Tourpe, introduction et commentaire de Pascal Ide, Paris, DDB, 2015.
Manipulateurs.Les personnalités narcissiques : décrire, comprendre, agir, Paris, Éditions de l’Emmanuel, 2016.
Puissance de la gratitude. Vers la vraie joie, Paris, Éditions de l’Emmanuel, 2017.
Introduction
« Malheureux ceux qui font leur propre malheur*. »
Au début du Gendarme de Saint-Tropez, l’adjudant Alphonse Gerber (Michel Galabru), le maréchal des logis-chef Ludovic Cruchot (Louis de Funès), tout nouvellement nommé, et les deux gendarmes, Albert Merlot (Christian Marin) et Lucien Fougasse (Jean Lefebvre), se retrouvent pour une intense activité professionnelle : la pêche aux oursins1.
Soudain, l’adjudant arbore un oursin avec fierté et gourmandise. Se précipitant avec obséquiosité, Ludovic Cruchot seconfond d’admiration : « Oooh, bravo mon adjudant ! Il est magnifique ! Vous permettez que je vous l’ouvre ? – Mais je vous en prie ! » Tout sourire, en multipliant les « Aïe ! », Cruchot s’empare de l’animal hérissé d’épines. Puis, se retournant de son supérieur hiérarchique vers son subordonné, il change soudain de visage et de voix. Il ordonne d’un ton sec : « Merlot ! » et lui envoie sadiquement l’oursin. Merlot pousse un cri de douleur qui ne mérite qu’une semonce : « Allons allons allons ! » Merlot tente de l’ouvrir avec les ciseaux tandis que Gerber s’impatiente : « Alors, Cruchot, ça vient ? » Le maréchal des logis trépigne à son tour en direction de Merlot : « Allez allez ! » Et, au moment où il s’apprête à glisser l’oursin ouvert dans la main de Cruchot, le gendarme entend l’exact contraire même de ce qu’il a fait : « Doucement doucement doucement doucement. » Cruchot apporte la pièce à Gerber comme s’il portait un œuf de Faberger, en multipliant les titres ronflants et les « Hé, hé, hé ! » de contentement : « Voilà, mon adjudant, vous allez vous régaler, mon adjudant ! » Loin d’être reconnaissant, Gerber fronce les sourcils et se plaint : « Eh ben, il n’y a pas grand-chose ! » Alors, lâchement, Ludovic Cruchot se retourne en pointant un doigt accusateur vers Merlot : « C’est lui qui l’a ouvert ! »
C’est alors que Fougasse, le ravi de la bande, exhibe une étoile à cinq branches et s’exclame avec enthousiasme : « Oh ! Une étoile de mer, chef ! » Jetant un œil, Cruchot grimace de mépris, grogne et agite la main pour lui signifier de jeter l’astérie.Fougasse a un geste de dépit et la rejette.
Merlot pousse à son tour un cri d’émerveillement en montrant un oursin qu’il vient de pêcher : « Oh, regardez, regardez, là ! ». Plein de convoitise, Cruchot s’approche tandis que Gerber est tout à la dégustation de son premier oursin et intime à Merlot de lui donner sa prise. L’autre se défend faiblement : « C’est moi, mais c’est moi qui… ! » Cruchot lui coupe la parole en lui tapant deux fois sur la main et lui prend d’autorité le hérisson de mer pour hypocritement le montrer à l’adjudant comme s’il venait de le découvrir : « Oh, regardez mon adjudant, comme c’est beau ! Oh, oh, oh ! » Puis, méprisant, il jette l’oursin à Merlot pour qu’il l’ouvre : « Allez, tenez-moi ça, vous ! »
De nouveau, Fougasse sort une étoile de mer avec le même émerveillement : « Oh, ben ça alors ! Encore une étoile de mer, deux ! » Il est accueilli par la même indifférence méprisante de Cruchot qui se retourne vers Merlot s’escrimant pour ouvrir l’oursin : « Ça vient, oui ? »
*
Suzanne et Rémi sont mariés depuis quinze ans et ont deux enfants. Éléonore, l’aînée, présente de grosses difficultés d’apprentissage scolaire et nourrit une relation de grande proximité avec sa mère qui la rassure beaucoup. Suzanne, sans activité professionnelle, passe une grande partie de son temps à aider les personnes à droite et à gauche, pendant que Rémi se bat pour lancer une petite start-up. Un soir où il rentre tard de son travail, il retrouve sa femme dans leur chambre. Après l’avoir embrassée, il lui demande :
« Au fait, es-tu passée prendre ces bouteilles de champagne en promotion, comme je te l’avais demandé ce matin ?
– Ah, non, mince, cela m’est totalement sorti de la tête !
– Pourtant, je te l’ai même rappelé par un SMS un peu avant midi. C’était le dernier jour de la promo. Demain, il faudra payer le double. Je suis vraiment déçu ! »
Prise en faute, Suzanne se met alors à pleurer. Rémi s’arrête, interloqué :
« Quoi ? Qu’y a-t-il ? Tu as appris une mauvaise nouvelle ?
– Non. Simplement, je ne trouve pas juste que tu me cries dessus, alors que j’ai dû passer toute ma journée à m’occuper de la voisine qui a un lumbago.
– Mais je ne t’ai pas crié dessus, je n’ai même pas haussé le ton de la voix. Et puis, tu m’avais promis. D’ailleurs, tu m’avais dit que cela ne te prendrait même pas une demi-heure en voiture. »
Entrant sans crier gare dans la chambre et voyant les larmes de sa mère, Éléonore apostrophe aussitôt son père :
« Papa, tu n’es pas gentil de faire pleurer Maman. Elle qui passe son temps à aider les gens. »
Perdant soudain patience, Rémi se retourne vers sa fille :
« Toi, mêle-toi de ce qui te regarde. Et depuis quand rentres-tu dans notre chambre sans frapper ? »
Du coup, Éléonore se met à pleurer. Se redressant soudain, Suzanne s’interpose :
« Non seulement tu m’enguirlandes, mais tu le fais payer à notre fille. Ça suffit ! Va passer tes nerfs dehors et reviens quand tu seras calmé ! »
*
Consultante financière ayant un franc succès professionnel, Sarah, 31 ans, vient de mettre fin à une relation d’un an avec son compagnon, Pierre. Elle décide de consulter un psychothérapeute à qui elle raconte l’histoire suivante.
Alors qu’elle avait 11 ans, son père alcoolique perdit son travail et, à cause de ses beuveries intermittentes, il ne put, par la suite, occuper que des emplois subalternes dont il se faisait systématiquement licencier. La situation financière difficile du foyer obligeant la mère de Sarah à faire des heures supplémentaires, celle-ci se vit confier la responsabilité de la maison et de ses deux jeunes frères. En dépit de cette charge, Sarah eut de bons résultats scolaires et elle obtint une bourse pour ses études supérieures. Elle quitta alors la maison et entra à l’université, mais en se sentant toujours coupable.
Parlant des années de faculté, Sarah prend conscience que tous ses petits amis de l’époque étaient des étudiants marginaux auxquels elle apportait son soutien. Elle les aidait pour leurs devoirs, leurs lessives et, à une occasion, elle combla le déficit bancaire de l’un d’entre eux. Ce schéma Saint-Bernard s’est poursuivi après ses années d’études. Ainsi, en tant que consultante financière, elle apportait son soutien à d’autres. C’est à l’occasion d’un audit budgétaire dans le service d’une petite entreprise que Sarah y rencontra Pierre, l’un de ses commerciaux.
Le chaos que Sarah découvrit dans l’environnement de travail de Pierre était le reflet de celui qui régnait dans sa vie privée : son domicile était un véritable taudis, sa situation financière catastrophique et la pérennité de son emploi menacée. Aussitôt Sarah prit les choses en main. Or, plus ils devenaient proches, plus Pierre laissait Sarah endosser la majorité des responsabilités qui, jusqu’ici, lui incombaient : « Elle est plus efficace et plus rapide que moi », expliquait-il. De son côté, Sarah aimait beaucoup se rendre et se sentir utile. Cela dura un temps, mais peu à peu, elle commença à en vouloir à Pierre.
Jusqu’au jour où un médecin découvrit que Sarah était atteinte de mononucléose. Elle était au bord de l’épuisement depuis plusieurs semaines. Alors, la réticence et l’incapacité de Pierre à la soutenir lui devinrent intolérables. Pourtant, Sarah se sentait trop coupable pour mettre fin à leur relation. Aussi proposa-t-elle à Pierre une séparation temporaire. Mais celui-ci lui promit qu’il changerait, ajoutant qu’elle était injuste de le quitter et qu’il ne survivrait pas sans elle. Les plaintes de Pierre réveillèrent la culpabilité que Sarah éprouvait depuis son enfance. À contrecœur, elle consentit à lui donner une seconde chance. Au début, Pierre fit des efforts. Mais, très vite, il revint à ses comportements d’antan. Cohérente, Sarah lui rappela sa promesse et lui demanda de partir. Pierre entra alors dans une rage folle et se mit à hurler : « Tu ne trouveras jamais personne qui t’aimera autant que moi ! »
Depuis, Sarah est insomniaque et profondément triste. Surtout, elle est rongée par la crainte d’avoir commis une erreur en mettant fin à sa relation avec Pierre. De plus, elle ne cesse de se demander : « Est-ce que je ne mériterais pas de finir ma vie toute seule2 ? »
*
Dans ces trois histoires, se déroule un même scénario psychologique appelé triangle dramatique de Karpman (désormais désigné par son acronyme : TDK) qui se passe entre trois personnages : le Bourreau, la Victime et le Sauveur.
Surjouée, cette scène piquante et réjouissante des oursins illustre le sujet épineux du TDK. Autoritaire et impatient, Gerber est Bourreau, mais il n’hésite pas à se transformer en Victime, lorsqu’il se plaint à Cruchot : « Eh ben, il n’y a pas grand-chose ! » Aussitôt, celui-ci se précipite en Sauveur. Mais autant il se positionne en permanence comme Sauveur de son supérieur, autant il se comporte en Bourreau à l’égard de ses deux subordonnés, méprisant Fougasse et tyrannisant Merlot. Enfin, les deux gendarmes, se contentant d’un faible et geignard « C’est moi » ou d’un hochement de tête désapprobateur, se laissent maltraiter sans résister et jouent à la Victime.
Dans le deuxième exemple, Suzanne est rentrée dans le TDK comme Victime et Éléonore comme Sauveuse de sa mère et Persécuteur de son père, pour finir en Victime. Rémi n’est pas Bourreau vis-à-vis de son épouse, même si celle-ci le pense et souhaite le pousser à jouer ce rôle ; en revanche, il le devient avec sa fille, en projetant sur elle sa frustration.
Dans la dernière illustration, Sarah est une Sauveuse compulsive qui a trouvé en Pierre la Victime rêvée. Leur relation prend fin dans un conflit Bourreau-Bourreau.
La découverte du TDK
Le TDK fut découvert par Stephen Benjamin Karpman3 à la confluence d’une double série d’événements4. Dans les années 1960, alors qu’il est jeune psychiatre dans la Marine américaine à San Francisco, il est invité par l’un de ses patients à participer à une série de conférences à l’hôpital naval Oak Knoll. Elles sont assurées par une personne dont il n’a jamais entendu parler, le psychiatre Éric Berne, qui est l’inventeur de l’analyse transactionnelle (AT)5. Comme beaucoup de médecins psychiatres à cette époque, Steve Karpman a été formé à la psychanalyse freudienne et à son « jargon complexe ». Le docteur Berne, lui, non seulement introduit des notions nouvelles (comme les transactions ou les jeux), mais érige en principe d’employer un langage simple « que tout le monde [peut] comprendre ». Karpman est aussitôt séduit et décide de participer aux séminaires hebdomadaires de Berne ; il n’en manquera aucun pendant pas moins de cinq ans.
Or, les séminaires sont régis par trois règles de méthode intransgressibles : 1. « Ne dites rien que vous ne puissiez dessiner dans un diagramme » ; 2. « Utilisez toujours le rasoir d’Occam », autrement dit simplifiez le plus possible ; 3. « Écrivez en langage profane pour être compréhensible par un enfant de 8 ans, un agriculteur du Midwest et un professeur du Massachussetts Institute of Technology. » S’ajoute une quatrième norme, plus informelle, mais tout aussi importante : « Vous n’êtes pas là pour apprendre l’AT », mais pour inventer vos propres théories. De fait, commente Karpman, « il n’y a pas d’autre école de psychologie qui ait produit pareille explosion créative que l’AT ».
Par ailleurs, Karpman, qui a beaucoup joué au basket-ball, est meneur de jeu, il répartit les rôles des joueurs dans une équipe et définit la stratégie. Or, cette mission requiert d’observer avec grande précision les positions des joueurs des équipes adverses, leurs actions offensives et défensives, ainsi que les feintes par lesquelles chacun cherche à piéger l’autre. Un jour, en vue d’inventer un nouveau modèle, il décide d’appliquer les règles enseignées par Berne. Il se met d’abord à dessiner ces différentes tactiques. Il se retrouve avec trente pages de schémas. Il fait alors appel au rasoir d’Occam. Finalement, en se fondant sur les trois feintes du basket (et du football américain), émerge un schéma à quatre rôles : P pour le Persécuteur, S pour le Sauveur, V pour la Victime et un quatrième, au-dessus, le Meneur de jeu. Mais, toujours fidèle au principe de simplification, Karpman décide de remplacer ce dernier rôle par des flèches entre les trois premiers puisque le Meneur a pour mission de faire circuler les rôles. Le TDK est né !
En fait, comme il arrive souvent, les deux événements (rencontre de Berne et nouvelle compréhension des tactiques du basket) ont pris un peu de temps pour converger.
Il m’a fallu deux ans pour faire le rapprochement entre mes recherches sportives et mon apprentissage AT et pour que je me décide à le montrer à Éric Berne. Il l’a immédiatement aimé et adopté. Il lui a donné le nom de Triangle de Karpman […]. Le nom est resté. Berne me conseilla très vite d’écrire pour le Bulletin scientifique [de l’AT : Transactional Analysis Journal] et me fit une promesse qui sonnait aussi comme un avertissement : « Les gens te citeront encore dans deux cents ans, alors, ton article, fais-le bien dès la première fois »6.
En 1968, Karpman écrit un bref article de cinq pages intitulé : « Contes de fées et analyse des scénarios de drame7 ». Berne fut prophète : l’article de Karpman connut et connaît encore un immense succès. Il y résume sa découverte en quatre points :
1. dans un conte de fées, les rôles se distribuent de manière constante en trois : Persécuteur, Sauveur, Victime ;
2. ces rôles sont tous trois négatifs, c’est-à-dire font souffrir le lien entre les personnages ;
3. ces rôles sont interchangeables, c’est-à-dire qu’un même personnage permute d’un rôle à l’autre, passant par exemple de Sauveur à Persécuteur ; d’ailleurs, ce changement correspond à un coup de théâtre ;
4. le drame que le conte met en scène, la vie le reproduit (drama, en grec, signifie « action ») : dans les relations toxiques avec les autres, nous adoptons souvent, mais à notre insu, ces personnages.
Karpman symbolise son invention par un schéma, le même depuis l’origine. Il « demande à tous les utilisateurs de suivre la forme équilatérale comme point d’orthodoxie8 », afin de ne pas donner plus de poids à un rôle ou une permutation qu’à un(e) autre.
Le TDK, un jeu psychologique
L’AT étudie les jeux psychologiques et le TDK est un de ces jeux. De prime abord, l’expression jeu psychologique étonne, voire choque. En effet, le jeu est détendant, alors que le jeu psychologique est déplaisant. Le substantif jeu est employé non pas en raison de sa fin qui est la distraction, mais en raison de sa nature : une activité obéissant à des règles fixes et mettant en scène des personnages. Il est qualifié de psychologique parce qu’il répond à un mécanisme inconscient : autre ce qui se dit, autre ce qui ne se voit pas et qui constitue le véritable enjeu (en-jeu)9. Par exemple, un enfant qui dit à son papa : « Maman, elle, me laisse regarder la télé le matin ! » joue à un jeu que Berne a intitulé « Battez-vous ». De manière apparente, il semble énoncer un conflit entre deux paroles parentales contradictoires. En réalité, son objectif inconscient est de pousser ses parents à se battre.
Les personnages – nous emploieront indifféremment les termes de rôle et personnage ainsi que, plus rarement, ceux de posture et attitude – correspondent aux acteurs de ces jeux ; ils se distinguent des personnes, mais aussi de fonctions ponctuelles. Ainsi l’enfant qui joue à « Battez-vous » endosse-t-il le rôle de Persécuteur ; cela ne signifie pas qu’il le fasse habituellement. Voilà pourquoi l’on désigne les trois rôles ou personnages par une majuscule.
Pourquoi parler du TDK ?
Parce que ce jeu psychologique est très fréquent. Tous, à un moment ou à un autre, nous le pratiquons. La différence ne réside pas entre ceux qui jouent au TDK et ceux qui n’y jouent pas, mais entre les joueurs amateurs et les joueurs professionnels !
Parce que ce jeu est très trompeur. En effet, si tout le monde s’accorde pour trouver dangereux, voire destructeur, le Persécuteur, comment reconnaître que la Victime et, a fortiori, le Sauveur le soient ? De plus, comme la personne ne demeure jamais en permanence dans son personnage, tourner dans les différents rôles détourne son attention, et celle des autres. Enfin, si, dans une conférence, je demande qui estime avoir été Victime un moment ou l’autre de sa vie, presque tout le monde lève la main ; en revanche, lorsque je demande qui s’est sentiPersécuteur, nul bras n’émerge de la houle des têtes… Comment 0 % de Persécuteurs peuvent-ils causer presque 100 % de Victimes ?
Parce que ce jeu est très toxique. Le TDK est source de tension, souffrance, culpabilité, frustration, découragement, etc. « Ce jeu de rôles, observe une thérapeute familiale, génère beaucoup de stress et risque d’engloutir des quantités d’énergie10. » Au maximum, ces rôles sont pratiqués (avec dextérité !) par les personnalités narcissiques : nous nous représentons souvent celles-ci comme des Persécuteurs, alors qu’elles peuvent aussi adopter les comportements de la Victime, voire du Sauveur.
Le sous-titre qualifie les relations engendrées par le TDK de toxiques. Ainsi qu’on le sait, cette épithète caractérise au sens propre un organisme qui est « empoisonné » ou « vénéneux ». Appliqué aux interactions entre personnes, elle s’entend de relations qui, au sens figuré, empoisonnent l’existence. L’étymologie est suggestive. Le substantif et l’adjectif français « toxique » sont empruntés au latin toxicum, qui signifie « poison à l’usage des flèches » ; il dérive lui-même du grec toxikon, qui présente le même sens et qui vient de toxon, « arc »11. Filant le sens métaphorique, on pourrait dire qu’adopter un mode de relation toxique n’est pas seulement venimeux, mais revient à décocher une flèche pour communiquer à l’autre son poison. C’est exactement ce qu’opère le jeu du TDK : par exemple, la Victime veut forcer l’autre à devenir Sauveur.
Pourquoi un nouveau livre sur le TDK ?
En effet, un certain nombre d’ouvrages en français (cf. bibliographie p. 281) et de nombreux articles en ligne traitent en détail du TDK. Selon Karpman lui-même, en 2006, plus de quinze mille sites internet lui étaient dédiés12. Le jeudi 12 avril 2018, en tapant sur le moteur de recherche Google « triangle dramatique de Karpman », j’ai obtenu : « environ 86 800 résultats » et seulement « triangle dramatique » : « environ 388 000 résultats » ! En douze ans, le chiffre s’est multiplié par six ou par vingt selon la manière de compter. Devant une telle avalanche de résultats, posons à nouveau la question : pourquoi rédiger un nouvel ouvrage sur le sujet ?
De prime abord limpides, les trois pôles s’obscurcissent quand on rentre dans le détail des situations. Pour reprendre un exemple de Karpman, en quoi la marraine de Cendrillon est-elle un Sauveur ? Alors que, pour le concepteur du TDK, ce personnage est négatif, le rôle de la fée paraît bénéfique. Cette ambivalence vaut même pour le Persécuteur : un parent qui punit son enfant est considéré par Karpman comme un Persécuteur. Est-ce le cas ?
Ensuite, les explications et les illustrations fournies sont souvent peu éclairantes. Parmi beaucoup, voici un exemple tiré d’un ouvrage écrit par un spécialiste de l’AT13 :
Un jeune couple part en vacances en voiture. Il conduit, elle tient la carte.
LUI. – Fais un peu attention quand tu regardes la carte et que tu me donnes les indications.
ELLE. – Mais ce n’est pas ma faute, c’est très mal indiqué.
L’auteur interprète la remarque de l’homme comme celle d’un Persécuteur et la réponse de la jeune femme comme celle d’une Victime. Si la réflexion masculine, verbalement violente, est donc caractéristique du Persécuteur, la réponse féminine, elle, peut autant être un constat objectif et neutre d’une personne qui est véritablement innocente, qu’une victimisation, potentiellement porteuse de violence.
Ces manques de précision viennent de ce que, à visée pratique et développé en sciences humaines, le TDK pose cependant des questions théoriques qui ne sont jamais affrontées pour elles-mêmes. Nous ferons ponctuellement appel à la philosophie pour enrichir l’approche seulement descriptive et pratique de la psychologie. En cela, nous serons fidèles à l’esprit de Berne et à Karpman qui invitent à innover.
De l’AT, nous garderons la notion de jeu, et du TDK, la logique du mal, la tripartition des rôles et leur circulation permanente. En revanche, pour répondre aux difficultés évoquées, nous préciserons le schéma de Karpman sur plusieurs points d’importance. Aussi, par honnêteté, après avoir rappelé l’immense dette contractée à l’égard de Karpman, devons-nous signifier la nouveauté de notre propos par la nouveauté d’un nom : le triangle maléfique, lui aussi signifié par un nouveau sigle acronymique : TM. En effet, le qualificatif « maléfique » vient du verbe latin facere, « faire », et du nom lui aussi latin malum, « mal » ; or, ainsi que l’expliquera le chapitre 2, ces relations toxiques non seulement font du mal (ce qui est commun à tous les jeux psychologiques), mais s’expliquent à partir de la logique du mal (ce qui est propre à ce triangle).
Que le lecteur ne s’effraie pas de ce bref passage par la philosophie ! Si le livre explore en quoi consistent ces trois comportements, son but demeure avant tout pratique : décrire et expliquer le TDK, le reconnaître et en sortir. Cette intention dicte le plan.
La première partie présentera en quoi consiste le triangle maléfique (chap. 1 à 4).
La deuxième partie décrira en détail les signes permettant de reconnaître les trois personnages (chap. 5 à 7).
La troisième partie explorera différents moyens efficaces pour sortir de ces trois postures maléfiques (chap. 8 à 11).
Le lecteur trouvera peut-être la première partie décourageante et un peu technique. Elle est décourageante parce qu’elle révèle la part d’ombre présente dans beaucoup de nos relations ; mais cette humble prise de conscience est nécessaire pour que nos relations deviennent harmonieuses et fécondes. Elle est un peu technique, parce qu’elle met en place les notions employées dans les autres parties. Pour qui veut aller à l’essentiel, ces notions sont résumées dans les définitions des pages 39, 49, 50 et 61.
Première partie
Comprendrele Triangle maléfique
Après avoir décrit le TM à partir d’un exemple (chapitre 1), nous en expliquerons le fonctionnement. Pour cela, nous utiliserons deux grands types de mécanismes : personnels et systémiques (la différence entre ces deux approches sera exposée au début du chapitre 4). Les mécanismes personnels eux aussi se dédoublent, faisant appel au mal (chapitre 2) et à la liberté (chapitre 3). Le mécanisme systémique les complétera (chapitre 4).
Chapitre 1
Décrire le Triangle. Le mal en action
« Il y a des blessures où nous nous complaisons, que nous entretenons et approfondissons de nos plaintes et de notre délectation morose, en savourant notre faiblesse. Il ne faut pas même les soigner, il faut seulement les laisser, les oublier, car elles se cicatriseront d’elles-mêmes, elles qui ne vivent que d’être regardées, racontées, remémorées. Et il y a des blessures qu’il ne faut pas guérir, car elles sont source de notre amoureuse intimité avec notre plus haute tâche, celle que nous avons, à l’impossible, reçue sans l’avoir cherchée*. »
Le TM tourne entre trois rôles : le Persécuteur, la Victime et le Sauveur. Leur sens est – apparemment – transparent : le Bourreau fait souffrir ; la Victime souffre et le Sauveur lui vient en aide. Voyons-les en action dans la scène d’un film avant d’analyser la situation.
1. Une soirée dramatique (Oui, mais…)
Un film met en scène à l’état chimiquement pur et de manière très pédagogique ces trois personnages : Oui, mais…1 En fait, cette exemplarité ne saurait étonner car, même s’il s’agit d’une véritable histoire et non d’un documentaire « psy », le scénario se fonde explicitement sur les thérapies brèves, surtout l’analyse transactionnelle, auxquelles il rend un hommage appuyé à travers son titre et l’un des protagonistes, Erwann Moenner (Gérard Jugnot), qui est un psychothérapeute chaleureux et compétent.
Églantine Laville (Émilie Duquenne) est une adolescente qui sort avec un garçon, Sébastien (Cyrille Thouvenin). Son père, André (Patrick Bonnel) a une liaison adultérine et sa mère, Denise (Alix de Konopka), noie son chagrin dans l’alcool.
La scène2 que nous allons analyser se déroule lors d’un dîner. Nous vous proposons de procéder en trois temps. Tout d’abord, visionnez la scène ou lisez le dialogue que nous retranscrivons, en l’accompagnant d’indications sur le langage corporel. Puis interrogez-vous sur le rôle pris par chacun des trois protagonistes lors de l’échange : se situe-t-il en Bourreau, en Victime ou en Sauveur ? Pour répondre, faites appel aux paroles, mais aussi aux signes non verbaux (ton de la voix et gestes). Enfin, lisez l’analyse du paragraphe suivant.
ÉGLANTINE, l’air triste, visage baissé. Silence. Choc des couverts contre les assiettes.
DENISE, la fourchette pointée en avant (elle restera toute la scène ainsi). – Tu manges pas ? Avec qui tu sors ?
ÉGLANTINE, levant le nez. – Sébastien.
DENISE, froncement intrigué des sourcils.
ÉGLANTINE. – Mister Douceur.
DENISE, moue, puis ton inquisiteur. – Tu le connais bien ?
ÉGLANTINE, agressive. – Mais oui, Maman, rassure-toi, je le connais bien.
DENISE, toujours le ton sec. – À quelle heure tu rentres ?
ÉGLANTINE, moue vague et soulèvement ennuyé des épaules. – Je sais pas, moi. On verra !
ANDRÉ. – Fiche-lui la paix. Elle a tout de même le droit de sortir, non ?
DENISE, méprisante. – Bien sûr ! Pause,puis,le regard agressif. Et toi, tu fais quoi ce soir ?
ANDRÉ, l’air ennuyé. Silence. Gêne visible. Bruit de fourchettes.
ÉGLANTINE, avec une voix de petite fille soumise. – Y’a du dessert ?
DENISE, le nez plongé dans son verre de vin, les yeux dans le vague, haussant les sourcils en guise de réponse. Elle prend un air souffrant.
La scène suivante, silencieuse, sur fond musical triste, montre Églantine en train d’essayer, puis de défaire ses boucles d’oreilles, tout en se regardant dans la glace. Devant la porte de l’appartement, elle s’apprête à l’ouvrir, puis la referme avec un air fataliste. Elle regarde vers le salon, y va, ouvre l’interrupteur, découvre sa mère dans l’obscurité en train de siroter un verre d’alcool.
ÉGLANTINE. – Papa est sorti ?
DENISE, regardant son verre avec une tristesse ironique. – Huhu !
ÉGLANTINE, après avoir fait un aller-retour entre la table basse où se trouvent trois bouteilles d’alcool bien entamées et sa mère, puis avoir soupiré, d’un ton de reproche. – Maman !
DENISE, contemplant encore plus intensément son verre. – Va-t’en, va-t’en, j’me débrouille !
ÉGLANTINE, avec une moue de dépit. – Hum !
Et l’on voit, dans le regard de la jeune fille, sa mère tenter de se lever, vacillante, une bouteille à la main, puis s’écrouler pesamment sur le sol du salon.
ÉGLANTINE, sortant son téléphone portable et composant un numéro. – Allô, Seb, c’est moi !… Sa mère la regarde, puis pose son verre dans la main, rassurée que sa fille ait mordu à l’appât. Euh, écoute, j’ai un gros pépin. Je suis obligée d’annuler… Hein ?… J’t’expliquerai… Tu m’en veux pas trop ?… Oui, j’sais moi aussi. Tu sais, euh… On en reparle demain, d’accord ?… J’t’embrasse !
ÉGLANTINE, raccrochant, dardant sur sa mère des yeux remplis de colère triste et s’adressant à elle avec agressivité. – Voilà, t’es contente ?
DENISE, regardant sa fille avec dédain. – Je ne t’ai rien demandé, Églantine.
ÉGLANTINE, entre hurlement et pleurs. – Mais j’en ai marre, putain !
La scène qui suit est aussi silencieuse. Nous voyons Églantine assise sur le lit de sa mère, qui est affalée plus qu’allongée dans son lit. Au passage, on observe que la table de nuit ne comporte que, métaphore évidente, deux photos d’un chien solitaire au bord de l’océan. La fille regarde vers Denise, vérifiant qu’elle est endormie. Elle se lève, la borde avec délicatesse, puis quitte la chambre à coucher en éteignant la lampe de chevet.
La dernière scène se déroule dans l’entrée de l’appartement, au moment où, en rentrant, le père croise sa fille.
ANDRÉ, un peu étonné. – T’es déjà rentrée ?
ÉGLANTINE, le ton boudeur. – Ben, j’suis pas sortie.
ANDRÉ, encore plusétonné. – Ah bon ? Pourquoi ?
ÉGLANTINE, encore plus agressive, la tête en avant, dodelinant. – Devine ! Tu pourrais pas t’occuper un peu d’elle ?
ANDRÉ, soupirant, puis, l’air pitoyable. – J’ai essayé si souvent, Églantine !
ANDRÉ, silencieux tout en remuant la tête. Puis, contournant sa fille, tout en parlant avec la mine lugubre d’un condamné à mort. – Si tu trouves la solution…
ÉGLANTINE, silencieuse. Elle regarde, un peu perdue, vers son père qui s’éloigne. Puis elle baisse les yeux, rentrant dans un dialogue intérieur, désappointée et décontenancée.
Ces brèves scènes montrent autant les traits caractéristiques des rôles que leurs interactions.
2. Les trois pôles en action
a) La mère Victime
De prime abord, Denise Lavigne est une Victime. L’allusion à peine voilée, agressive autant que triomphale : « Et toi, tu fais quoi ce soir ? », autant que le silence gêné du mari, signifient qu’André la trompe. Comment ne pas être pris de pitié pour cette femme qui passe ses soirées seule, abandonnée par son époux ? N’est-elle pas en droit de recevoir de l’aide de ses plus proches ? Comment, dès lors, ne pas comprendre qu’elle trouve sa consolation dans la boisson ? Enfin, n’est-elle pas respectueuse de la liberté de chacun, puisqu’elle n’exige rien de sa fille et n’a pas imposé à son mari de rester ?
Pourtant, comment ne pas être pris d’un doute ? La plainte de Madame Lavigne est extrêmement envahissante. Si cette attitude se reflète peu dans ses propos, en revanche, elle apparaît massivement dans le non-verbal : le ton geignard fréquemment entrecoupé de soupirs ; les silences remplis de sous-entendus ; la manière de suspendre son alimentation, comme si elle avait perdu le goût de la nourriture et le goût même de la vie. Il n’est pas jusqu’au visage qui ne s’identifie à cette lamentation généralisée : les yeux tombants, les traits affaissés.
Mais il y a autre chose. Derrière cette plainte, on ressent une sourde agressivité. Pendant le dîner, celle-ci se traduit par la fourchette pointée vers l’autre, le ton inquisiteur, la requête intrusive « Et toi ? ». Par ailleurs, le décalage entre le langage verbal qui ne demande rien (« Je ne t’ai rien demandé, Églantine ») et le langage corporel qui appelle au secours (la prise ostensible d’alcool devant sa fille) constitue ce que les psychologues appellent un double bind, une « double injonction contradictoire3 » : Denise dit une chose et montre le contraire. Le bénéfice pour la mère est grand : ne formulant rien, elle peut dénier toute responsabilité et plaider non coupable. Mais la souffrance de sa fille est encore plus grande : Denise la culpabilise intensément et violente considérablement leur lien.
Denise n’est-elle pas même entièrement centrée sur elle ? À la demande d’Églantine sur le dessert, elle se contente de répondre par un haussement de sourcil indifférent. Plus encore, incapable de se réjouir du bonheur de sa fille qui sort, elle est aussi incapable de la remercier pour sa présence et son aide : elle considère celles-ci implicitement comme un dû.
Dès lors, le doute se transforme en fort soupçon. Certes, Denise se présente comme une victime. Mais l’est-elle véritablement ? Par sa violence rentrée, mais d’autant plus réelle, n’est-ce pas son attitude qui cause des victimes ?
b) La fille Sauveuse
Autant le spectateur est tenté d’accuser la mère, autant il est touché par la fille. Églantine ne pose-t-elle pas un acte généreux en acceptant de rester pour tenir compagnie à sa mère et donc en sacrifiant sa soirée avec Sébastien ? Remonter soigneusement le drap, rester auprès de Denise jusqu’à ce qu’elle soit endormie, etc. : ne sont-ce pas autant de gestes admirables de dévouement, voire d’amour ? Pourtant, au moins quatre indices introduisent un doute :
1. Églantine précède toute demande d’aide provenant de sa mère. En cela, Denise a dit juste : « Je ne t’ai rien demandé, Églantine. » Sa fille aurait pu la prendre au mot… si elle avait été intérieurement libre. Mais elle se sent responsable du bonheur de cette mère qu’elle estime injustement abandonnée (« Tu pourrais pas t’occuper un peu d’elle ? »). Le tourment de la culpabilité et la lourdeur de la tristessetransparaissent dans son manque d’entrain à mettre ses boucles d’oreilles et son regard dans le miroir.
2. Églantine offre une aide démesurée. Non seulement, elle tient compagnie à sa mère, mais elle lui consacre toute sa soirée. Plus encore, elle couchera elle-même sa mère, prendra le soin de border son lit, éteindra la lumière, etc. Autrement dit, elle joue le rôle de mère de sa mère – scénario si connu que les psychologues lui ont donné un nom : la parentification4. Cette attitude s’est probablement mise en place depuis bien des années.
3. Normalement, celui qui sert est présent à l’autre. Or, Églantine anticipe et projette ce qui n’est pas, par le biais de son imagination ou de sa mémoire (elle a peut-être déjà assisté à une telle scène). En effet, le cinéaste intercale dans le récit de brèves images où l’on voit la mère se lever, vaciller et s’effondrer sous le coup de l’alcool. Les images suivantes font soudain prendre conscience que nous avons vu non pas la réalité, mais comment la jeune fille se la représente.
4. Le service d’autrui est source de joie. Or, non seulement Églantine est triste, mais elle est minée par une intense frustration qu’elle fait payer d’abord à sa mère (« Mais j’en ai marre, putain ! »), puis à son père (« Devine ! Tu pourrais pas t’occuper un peu d’elle ? »). Le chagrin de son renoncement se retourne en colère contre l’autre.
c) Le père Bourreau
Assurément, Denise désigne son mari comme le Bourreau. De prime abord, il ne paraît pas l’être : loin d’être accusateur, c’est lui qui est accusé ; de plus, lorsqu’il reprend sa femme, il cherche à défendre sa fille. Mais reprenons la réflexion d’André : « Fiche-lui la paix ! Elle a quand même le droit de sortir, non ? » Quatre espèces de signes – concernant l’intention, le contenu, le non-verbal et l’effet – en attestent la violence.
D’abord, le père intervient alors qu’Églantine ne lui a rien demandé. D’ailleurs, il vise sa femme alors qu’il aurait pu tout aussi bien reprendre sa fille qui lui manquait de politesse. André démasque ainsi son intention : il ne défend Églantine que pour mieux agresser Denise. Ainsi n’apparaît-il pas tant comme un Sauveur que comme un Accusateur.
André emploie de manière inattendue le verbe vulgaire « ficher ». Or, sauf emploi habituel caractéristique d’un groupe ou d’un usage, la vulgarité signale une agressivité. En outre, l’interro-négative (« non ? ») introduit, dans la grande majorité des cas, une question fermée ; or, préjuger de la réponse manipule l’interlocuteur.
Par son regard sans aménité, André dit encore plus sa violence que par sa parole. Enfin, l’effet le confirme : à l’agression d’André répond celle de Denise qui lui retourne sa violence, dans la gestuelle, le ton et le contenu (« Et toi, tu fais quoi ce soir ? »).
d) Les trois rôles
Bourreau, Victime et Sauveur désignent non pas des personnes, mais des personnages, c’est-à-dire des comportements stéréotypés qui sont adoptés par des personnes dans un type donné d’interaction. La personne se distingue doublement du personnage : le personnage n’est qu’une facette (le plus souvent blessée) de la personne ; une même personne adopte toujours plusieurs personnages selon les situations et les moments de la situation. La conséquence en est que, transformée, guérie, convertie, une personne abandonne ses personnages et non seulement ne cesse pas d’être elle-même, mais le devient.
3. Quelques leçons
Cette scène nous apprend aussi d’autres lois relatives au TM.
a) Les bénéfices secondaires
Les relations vécues au sein du TM apportent aux protagonistes des gratifications réelles et, parfois, intenses. La psychanalyse dirait que cette intensité est transférentielle, c’est-à-dire vient d’un rejeu dans le présent d’un traumatisme ou d’un manque passé et inconscient. Si Denise consent à ce que sa fille la couche et la borde, donc se laisse traiter comme un enfant, on peut supputer qu’elle n’a guère dû recevoir l’affection qu’elle attendait lorsqu’elle était petite fille, et reçoit ici ce qui lui a tant manqué.
Ces faits – et non une hypothétique pulsion de mort, imaginée par Freud, qui pousserait les êtres humains à répéter des comportements nocifs5 – expliquent pourquoi les personnages les pratiquent avec tant d’assiduité.
L’un des principaux bienfaits secondaires réside dans la confirmation des croyances fondamentales sur soi, sur les autres ou sur la vie. Par exemple : « Les médecins sont tous les mêmes », « Il ne faut jamais faire confiance », « Je n’ai jamais rien fait de bon dans la vie », « Personne ne me comprend ». Ici, Denise est confirmée que son mari en particulier et les hommes (masculins) en général sont égoïstes. Un autre bénéfice de poids consiste dans la fuite des responsabilités : puisqu’André est égoïste, ce n’est pas à elle, Denise, de changer, mais à lui ; dans la troisième scène, le père se débarrasse sur sa fille de la charge de trouver une solution.
Les bénéfices secondaires sont tellement avantageux que le joueur est constamment à la recherche d’un autre joueur qui entrera dans le triangle. Et s’il n’accroche personne, il changera d’environnement pour trouver le joueur correspondant à son jeu favori.
Enfin, ces avantages sont tellement habituels et cachés que les personnes n’ont pas conscience de les rechercher. Ainsi, Églantine ignore qu’elle désire secrètement donner d’elle-même l’image d’une gentille petite fille, toute en serviabilité.
b) La toxicité
Si réels soient ces bienfaits, ils n’éliminent pas les effets éminemment toxiques du TM. Plus encore, ils ne les compensent pas. Voilà pourquoi ces bénéfices sont qualifiés de secondaires. En effet, quelles que soient les gratifications, le jeu se termine toujours mal : les acteurs n’en sortent pas durablement heureux et la relation se trouve fragilisée. Même si la Victime a piégé son Sauveur et reçu sa dose d’aide, même si le Bourreau a coincé sa Victime et reçu sa dose de domination, même si le Sauveur a ligoté sa Victime et reçu sa dose de reconnaissance, lourd est le tribut psychologique et affectif : moins de liberté, moins de vérité, moins d’amour, moins de bien commun. Ici, Denise reste avec sa colère, Églantine sa tristesse, André sa vague culpabilité ; un silence pesant s’installe autour de la table, chacun part seul de son côté.
c) La complémentarité des rôles
Les rôles sont complémentaires : une attitude appelle l’autre. Ainsi, la Victime cherche un Sauveur. Denise tente de capter l’attention et l’affection de sa fille. Certes, elle s’en défend verbalement, mais tout son comportement atteste le contraire.
Toutefois, si forte soit l’inclination à entrer dans le Triangle, elle n’est jamais nécessaire. Le TM nous conditionne, et parfois fortement, il ne nous détermine pas. La conclusion de ce chapitre le redira : Églantine finira par se libérer de son personnage de Sauveuse.
d) La circulation des rôles
Notre interprétation pourrait faire croire que les personnages sont liés à des personnes, et donc sont fixés : André est un Bourreau, Denise une Victime et Églantine une Sauveuse. C’est tout le contraire. Loin de demeurer figés dans une posture, ils tournent – selon la formule habituelle.
De Victime, Denise n’hésite pas à devenir Accusatrice. Revenons sur le signe corporel peut-être le plus parlant : la fourchette tournée vers l’autre toute la durée de l’échange, comme en attente d’être plantée dans le cœur de celui qui est visé, est l’arme d’une vengeance qui ne demande qu’à s’exercer, et qui, en fait, s’est déjà exercée… De même, lorsque son mari se met à défendre sa fille, dans la réponse de Denise : « Oui, bien sûr ! Et toi, tu fais quoi ce soir ? », se lit le « tu » accusateur et le non-dit, d’autant plus redoutable qu’il laisse planer un soupçon et lui évite d’être accusée d’avoir accusé. Ce jeu verbal s’accompagne d’une mimique corporelle expressive : la petite mais nette montée du ton ; au visage renfrogné, rentré, succède soudain une avancée du museau. L’animal ne montre-t-il pas les dents pour décourager son adversaire ? Une nouvelle fois, la mère joue son scénario favori : distiller la violence sans en avoir l’air. Il s’ensuit un silence assourdissant…
Églantine n’est pas seulement Sauveuse ; elle est Bourreau. À la parole intrusive de sa mère lorsqu’elle se trouve à table, elle répond d’un ton sec : « Oui, Maman, rassure-toi, je le connais bien ! » De plus, cette parole interprète la question de sa mère comme une demande de rassurement ; or, débordant le simple constat, toute interprétation est, dans la relation, source de violence. La jeune fille adoptera encore à deux reprises une posture Accusatrice, vis-à-vis de sa mère : « Voilà, t’es contente ! », et vis-à-vis de son père : « Tu pourrais pas un peu t’occuper d’elle ? »
Églantine joue même à la Victime à l’égard de ses deux parents : face à sa mère lorsqu’elle éclate : « Mais j’en ai marre » ; face à son père lorsqu’elle lance d’un ton boudeur : « Ben, j’suis pas sortie. »
Lui de même, André occupe successivement les trois pôles du triangle dramatique. À sa fille qui l’accuse d’avoir laissé sa mère seule, il répond en Victime : « J’ai essayé si souvent, Églantine ! » – le non-verbal soupirant appuyant le verbal plaintif. Le loup (Bourreau) devient un chien battu (Victime) aux yeux larmoyants.
Le père ajoute : « Si tu trouves la solution… » Cette réflexion est un bijou dans le registre noir de la manipulation. D’abord, elle est précédée par une justification. Puis, André contourne Églantine en même temps qu’il parle, ce qui signifie qu’il n’attend pas de réponse, et donc qu’il ne formule pas une vraie demande : Victime, le père désire seulement être plaint, et non pas être aidé. Ensuite, en faisant appel à la serviabilité de sa fille, il entre dans le scénario de Sauveur. Enfin et surtout, il la coince dans ce que nous avons appelé un double bind. D’un côté, dans le registre verbal, le père dit : il est possible de trouver la solution ; de l’autre, dans le registre implicite du non-verbal et avec la phrase antérieure (« J’ai essayé si souvent »), il a déjà dit que le remède n’existe pas. Or, la double contrainte est un des moyens les plus efficaces et les plus violents pour bâillonner l’autre. De fait, Églantine demeure plantée là, sidérée, impuissante, le regard totalement perdu. Si le père a trouvé une sortie glorieuse – le message tout-puissant qu’il a envoyé peut se traduire ainsi : « Rien n’est de ma faute, tout est la faute de ta mère, toute solution nouvelle viendra de toi » –, il le paie au prix fort en vitrifiant la relation et en détruisant psychologiquement Églantine. Autant la jeune fille est figée au dehors, autant elle est en vrac, et même anéantie, au dedans… Une nouvelle fois, le TM apparaît dans sa redoutable toxicité. Sous des dehors policés, se joue une extrême violence.
Ainsi, les scénarios des trois personnages sont fixes, mais les personnes tournent entre eux. Plus encore, elles le doivent. Cette affirmation est même l’un des principaux apports de Karpman. En effet, la permutation est l’autre grand bénéfice du TM : en changeant de rôles, les personnes ouvrent d’autres voies pour nourrir leurs besoins (de reconnaissance, d’amour, etc.) ; elles ont aussi l’impression de changer d’existence et donc de vivre. De fait, il n’est jamais totalement possible de prévoir la réaction d’un joueur. Et cette incertitude est l’un des « intérêts » du scénario. Ainsi, lorsqu’il se retrouve accusé par Églantine, André a opté pour le scénario Victime, mais il aurait pu opter pour celui de Bourreau (« Je voudrais t’y voir ! ») ou de Sauveur (« Tu dois souffrir, ma pauvre fille, pour me parler ainsi. Parlons-en ! »).
Toutefois, cette liberté et cet intérêt sont très relatifs : si les personnes tournent entre les personnages, en revanche, elles demeurent incarcérées dans le Triangle.
e) La préférence des rôles
Même si les acteurs réels du TM (les personnes) ne sont jamais spécialisés en une posture (un personnage), ils présentent souvent un tropisme pour une entrée. De plus, les mêmes personnes jouent souvent les mêmes rôles avec le même type de partenaire, de sorte qu’ils aboutissent aux mêmes configurations relationnelles. Avec son mari et sa fille, Denise a clairement opté pour le rôle de Victime. Avec sa mère, Églantine adopte en priorité une attitude de Sauveuse, mais, avec son père, d’Accusatrice.
L’entrée favorite ou la préférence entraîne la répétition. Cette répétition quasi compulsive se traduit souvent par une prise de conscience, suite à une relation négative : « Une fois de plus, je me suis fait avoir… » ou « J’en étais sûr, je le voyais venir… ». Ces paroles intérieures signalent que l’on a participé à une séquence relationnelle caractéristique du TM. Ici, la tristesse découragée des trois protagonistes montre qu’ils sont usés de ces scénarios itératifs et mortifères.
4. Dramatique, mais point tragique
Nous retrouverons la famille Lavigne, ou plutôt la mère et la fille, au chapitre 11, qui propose un superbe exemple de sortie de la posture de Victime : au terme d’un travail psychothérapeutique efficace et fructueux avec Erwann Moenner, Églantine peut se libérer de la toxicité du lien avec sa mère, tout en conservant ce lien lui-même.
Chapitre 2
Expliquer le Triangle. Les trois pôles
« Mais où il y a danger, croît aussi le secours*. »
Le premier chapitre a décrit le Bourreau, la Victime et le Sauveur à partir d’un exemple. Tentons maintenant de les comprendre et, pour cela, de les définir.
1. Trois difficultés
Celui qui tente de définir les trois figures du TM se heurte aussitôt à trois difficultés1.
La première est l’absence de définition. Décrire n’est pas définir : affirmer que l’homme est un bipède sans plumes permet de l’identifier sans ambiguïté, mais ne me dit pas ce qu’il est. Or, les ouvrages ou les sites se contentent de décrire les personnages. Le Bourreau – qui est le rôle le plus difficile à cerner – est approché à partir de son aspect physique2, de sa parole clef3, de ses comportements4. En guise de définition de la Victime, un ouvrage propose cette « description » : « la victime est une personne fragile en apparence, plaintive voire pleurnicharde, malheureuse et passive5 » et, plus loin, elle résume ainsi son profil : « la victime apitoie, attire, énerve, excite6 »… Karpman résume le jeu du Persécuteur à celui « qui veut qu’on le craigne » et celui du Sauveur à ce « qu’on lui soit reconnaissant7 ».
La deuxième est l’imprécision des différents rôles. En effet, une définition rigoureuse est simple : par exemple, la démocratie se définit comme le régime politique dans lequel tous les citoyens ont le pouvoir (par opposition à l’aristocratie où seuls quelques-uns l’ont et la monarchie où seul le roi l’exerce). Or, les personnages sont souvent décrits par une multitude d’approches qui finissent par nous embrouiller. Le Sauveur est par exemple présenté ainsi : « Loin d’aider vraiment, il se présente simplement comme “aidant”. Il essaie d’aider, mais n’est pas efficace, car son but inconscient est d’entretenir la Victime dans son rôle pour rester dans le sien et obtenir de la reconnaissance. Je suis Sauveur quand j’aide quelqu’un qui n’a rien demandé, ou que je persiste à donner alors que ce n’est pas efficace8. » La seule première phrase dit que le Sauveteur n’aide qu’en apparence ; pourtant, la suite affirme qu’il aide, mais sans y avoir été invité.
La troisième est la confusion entre les rôles. Une bonne définition permet de distinguer clairement les notions proches : même si carré et losange sont des quadrilatères réguliers, dont les quatre côtés ont même longueur, seul le premier possède quatre angles égaux. Or, les définitions que l’on offre des trois personnages se recouvrent. La Victime fait violence à l’autre, donc présente un côté Persécuteur. Denise, tout en disant ne rien demander à sa fille, fait étalage de son autodestruction et donc la culpabilise. Le Sauveur impose son aide à la Victime et, contraignant sa liberté, devient un Bourreau. C’est ainsi qu’Églantine s’occupe de sa mère qui ne lui a rien demandé et d’ailleurs fait subir à Sébastien les conséquences de son inconséquence. Enfin, les traits du Persécuteur empruntent ceux de la Victime : « Un Bourreau : Critique et dévalorisant, blessant et cruel, menaçant voire violent, et surtout en overdose d’une frustration qu’il cherche à évacuer sur… une Victime innocente, bien sûr9. »
2. La clef de lecture : le mal en action
Pour répondre à ces difficultés et proposer des définitions rigoureuses des trois personnages, j’émets l’hypothèse suivante : le TM, c’est le mal en action : il met en scène le mal. Voilà pourquoi nous parlons de triangle maléfique, étymologiquement : le triangle « qui fait du mal ». La connotation du terme « mal » est aujourd’hui si restrictive (légaliste, punitive ou moralisante), qu’il est devenu nécessaire d’en préciser le sens.
a) La privation d’un bien
Une première voie partira de la notion classique de mal10. Seulement ébauchée chez les grands philosophes grecs11, elle n’est clairement définie qu’avec les Pères de l’Église12. Notamment avec saint Augustin : « Le mal n’est pas autre chose que la privation d’un bien13. » Or, le bien doit s’entendre non pas au sens étroitement éthique comme transgression à l’égard d’une règle ou comme déviation à l’égard de notre fin, mais au sens ontologique, comme ce qui est bon : c’est-à-dire, subjectivement, comme ce qui fait du bien et objectivement, comme ce qui accomplit mon être. Par exemple, la santé est un bien parce qu’elle requiert l’intégrité de notre corps et assure l’harmonie de notre fonctionnement, et la maladie un mal parce qu’elle est la privation de ce bien.
Par conséquent, le mal est ce qui prive l’homme de ce qui constitue son être, c’est-à-dire le détruit ou du moins l’altère. Bien évidemment, une telle définition peut s’étendre aux êtres non humains, à la nature. Le Triangle est donc maléfique parce qu’il altère ou détruit les relations et, à travers les relations, les personnes.
b) La violence
Un second chemin, actuel, identifie mal et violence14. Par exemple, quand je dis « je me suis fait violence », je signifie que j’ai contrarié ma nature, mon inclination spontanée. La violence s’entend donc de ce qui s’oppose à notre nature et rejoint ainsi le sens précédent de mal comme privation d’être. Or, le triangle se met en place lorsqu’un homme fait violence à un autre homme. Et nous verrons que chacun des trois rôles violente différemment la relation. Le TM décrit donc le cercle de la violence. Si la première approche du TM – ce qui altère ou détruit les relations et les personnes en relation – en souligne la toxicité, la seconde en explique la raison – le TM aliène la liberté des joueurs. Ainsi, le mal ou la violence est la clef de lecture qui permet de rendre compte du TM. À partir de ce point de vue, se dessinent les trois personnages.
3. Distinction des trois pôles
Puisque le TM parle du mal, il commence avec celui-ci. Pour qu’il y ait de la violence, il faut que quelqu’un la commette. Or, telle est justement la définition du Bourreau : celui qui accomplit un mal à l’encontre d’un autre. Inquisitrice et suspicieuse, dardant sa question et sa fourchette vers Églantine, Denise se comporte comme un Bourreau. En ce sens, celui-ci est la porte d’entrée dans le triangle.
Or, à l’activité répond la passivité. Le mal n’est commis d’un côté par un agent que parce qu’il est subi de l’autre par un patient (du latin, patior, « je subis »). Au Bourreau correspond donc nécessairement une Victime15. Autant le Bourreau est coupable, autant la Victime est innocente (composé, en latin, du préfixe privatif in- et du verbe nocere, « nuire », innocent signifie « qui ne nuit pas »). Ces deux rôles sont corrélatifs, car ils décrivent des comportements essentiellement relationnels qui s’appellent l’un l’autre : pas de Victime sans Bourreau et vice versa. La Victime se définit donc par l’état de celui qui subit la violence infligée par un Persécuteur. Si celui-ci demeurait seul, il ne pourrait pas exister. Certes, nous pouvons être Bourreau de nous-même16 ; mais alors notre psychisme se scinde en plusieurs personnages intérieurs, l’un d’eux jouant au Bourreau (« Tu es pathétique, ma fille, regarde comme tu l’as jeté ! Pas étonnant que tu te retrouves encore célibataire ! ») et l’autre à la Victime (« Ce n’est pas ma faute, les hommes sont incapables de s’engager ! »).
De prime abord, les jeux concernant le mal convoquent deux types d’acteur : celui qui le commet (ou Bourreau), et celui qui le subit (ou Victime). Mais cette description est insuffisante. En effet, le mal est par définition ce qui fait violence, ce qui n’est pas supportable. Celui qui en pâtit cherche donc à en être délivré. Voilà pourquoi apparaît le Sauveur. Dans la modélisation la plus fameuse de cette relation Bourreau-Victime, la dialectique du maître ou de l’esclave17, celui qui est asservi trouve en lui les ressources pour s’affranchir de la violence. Mais est-ce toujours le cas ? Surtout, n’est-ce pas manquer un fait majeur – et nullement banal – de l’expérience humaine : l’homme porte spontanément secours à celui qui est dans le besoin ? Ce constat en dit long sur la bonté, affective et effective, de l’homme : si faible soit-il, non seulement il éprouve de l’empathie vis-à-vis de la souffrance d’autrui, mais il cherche à rendre service. De nombreuses études attestent aujourd’hui cette bonté spontanée de l’être humain18. Par exemple, la théorie de la résilience, popularisée en France par Boris Cyrulnik, a montré que les résilients trouvent sur leur chemin des « tuteurs » qui gratuitement prennent soin d’eux19. C’est l’une des significations du vers mystérieux de Hölderlin placé en exergue : « Mais où il y a danger, croît aussi le secours20. »
Les trois pôles du triangle se distinguent donc selon les trois types de relation qu’il est possible d’adopter vis-à-vis du mal : le commettre, le subir ou le soigner. Il est désormais possible de proposer une définition claire des trois pôles du TM :
– le Bourreau est celui qui commet une violence contre autrui ;
– la Victime est celui qui subit la violence de la part d’un Bourreau ;
– le Sauveur est celui qui prend soin de la Victime.
En toute rigueur, il faudrait définir chacun des trois pôles en commençant par : « le rôle de la personne qui… » ou « le personnage de celui qui… ». Nous avons évité une formulation trop lourde en parlant de « celui qui », mais sans oublier que nous parlons de personnages et non pas de personnes. Reprenons ces définitions sous forme synoptique :
Les rôles dans le TM
Le Persécuteur
La Victime
Le Sauveur
Définitions vis-à-vis du mal
Attitude de celui qui fait le mal
Attitude de celui qui subit le mal
Attitude de celui qui soigne le mal
La distinction de ces trois postures épuise les possibilités : elles recouvrent sans reste les différentes attitudes vis-à-vis de la violence21. En effet, le point de départ est le mal, envisagé dans une perspective dynamique : le mal causé (donc qui apparaît), puis ôté (donc qui disparaît). Mais le mal causé présente lui-même deux pôles : actif et passif, commis ou subi. La tripartition peut donc être relue à partir de l’emboîtement de ces deux divisions exclusives et exhaustives :
Le mal causé
Pôle actif
Bourreau : celui qui fait le mal
Pôle passif
Victime : celui qui subit le mal
Le mal ôté
Sauveur : celui qui soigne le mal