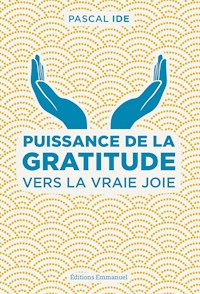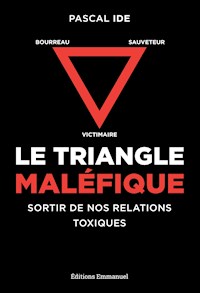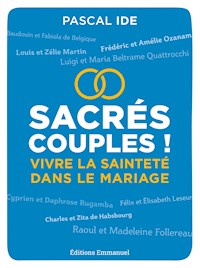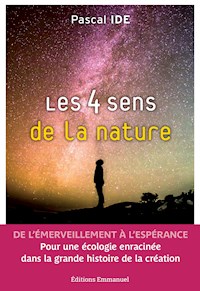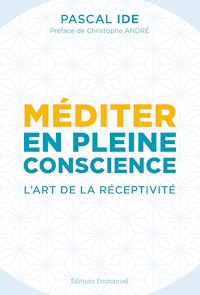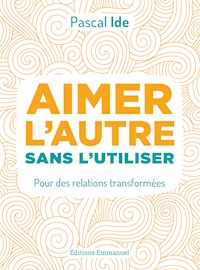
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions de l'Emmanuel
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
N’avez-vous jamais ressenti le même malaise que Claude ? Ou peut-être, comme Ralph, vous arrive-t-il de vous servir un peu des autres, parfois sans vous en rendre compte. Dans toutes nos relations,en effet, se pose une alternative : soit je choisis d’utiliser l’autre, soit je choisis de le traiter comme une personne, c’est-à-dire de l’aimer. Dans cet ouvrage lumineux, Pascal Ide décrypte avec finesse l’utilitarisme plus ou moins conscient qui empoisonne trop souvent nos relations (aux autres, à soi-même et à Dieu). En s’appuyant sur la pensée de Jean-Paul II et de nombreux exemples, il invite à une véritable conversion et nous aide ainsi à avancer sur le chemin de l’amour authentique, qui seul rend durablement saint et heureux.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Monseigneur
Pascal Ide est prêtre du diocèse de Paris depuis 1990 et membre de la communauté de l'Emmanuel. Actuellement, il est chef du service.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pascal Ide
Aimer l’autre sans l’utiliser
Pour des relations transformées
Conception couverture : © Christophe Roger
Composition : Soft Office (38)
© Éditions de l’Emmanuel, 2019
89, bd Auguste-Blanqui – 75013 Paris
www.editions-emmanuel.com
ISBN : 978-2-35389-796-4
Dépôt légal : 4e trimestre 2019
À saint Jean-Paul II, en témoignage de grande vénération et de filiale reconnaissance.
À Véronique R., en témoignage de profonde gratitude et de fidèle amitié.
Préambule
« Rendons-nous à Dieu sans retard, sans réserve et sans retour1. »
Dans LaGrande Vadrouille, l’acariâtre chef d’orchestre Stanislas Lefort (Louis de Funès) grimpe sans préavis sur les épaules du serviable peintre en bâtiment Augustin Bouvet (Bourvil) et l’oblige à le porter. Comment mieux montrer que l’homme utilise parfois son semblable, en détournant son bien et en contournant sa liberté ?
Cécile et Isabelle vivent en colocation. Cécile travaille comme puéricultrice dans une crèche et Isabelle comme chasseur de têtes dans une grosse entreprise. Ce soir-là, éreintée par sa journée avec les enfants, Cécile décide de se coucher tôt et de dévorer le dernier Fred Vargas, quand elle entend la porte d’entrée s’ouvrir discrètement. Elle connaît chaque bruit de cet appartement qui est une maison de papier et sait qu’Isabelle se prépare maintenant quelque chose à grignoter dans la cuisine. Elle connaît encore mieux sa coloc : si elle dîne à cette heure, c’est qu’elle a travaillé sans discontinuer et qu’elle aime raconter sa journée de travail. Isabelle sourit en pensant à son amie, ferme le roman en se disant qu’elle a tout le week-end pour le lire, passe sa robe de chambre, s’invente un prétexte pour venir à la cuisine, salue Isabelle, s’attable et demande, comme si elle avait tout son temps : « Alors, comment s’est passée cette longue journée ? »
*
Ce petit livre parle d’un très grand sujet. Dans toutes nos relations, nous nous trouvons face à une bifurcation d’où partent deux chemins : soit je choisis d’utiliser l’autre ; soit je choisis de le traiter comme une personne, c’est-à-dire de l’aimer. Plus simplement encore : servir l’autre ou m’en servir. L’utilitarisme lasse, casse et passe. L’amour, ou le service du bien de l’autre, est ce qui nous rend le plus rapidement saints, le plus durablement heureux et le plus profondément sains. Rien moins que cela !
Nous le verrons à partir du chapitre 5, ces deux chemins sont signalés par deux poteaux indicateurs : « norme utilitariste » et « norme personnaliste ». À leur lecture, vous pourriez craindre (ou peut-être espérer !) d’avoir entre les mains un livre de philosophie. De fait, ces expressions ont été inventées par un philosophe : Karol Wojtyła, le futur Jean-Paul II. Et si la signification de la première est assez transparente, celle de la seconde l’est moins. En réalité, l’intention de ce livre est pratique. Il ne convoquera, de temps en temps, un peu de philosophie que pour éclairer nos actions et nos décisions.
L’ouvrage est composé de trois parties. Après avoir expliqué ce que sont ces deux chemins ou ces deux voies (chap. 1 à 7), nous montrerons les multiples formes que prend l’utilitarisme dans les différents secteurs de notre vie (chap. 8 à 13) et enfin, nous détaillerons les moyens de vivre la conversion personnaliste (chap. 14 à 17).
1. Saint Michel Garicoïts, cité par Pierre Duvignau, La Doctrine spirituelle de saint Michel Garicoïts, Paris, Beauchesne, 1949, p. 66.
Chapitre 1
Utiliser l’autre
Être utilisé par l’autre
Ralph invite son ami Claude à passer un week-end dans sa maison de campagne. Ravi, Claude s’y rend et découvre en arrivant que Ralph compte sur son aide pour poser le papier peint. Claude se sent floué, non seulement parce que son ami ne lui a rien dit de ses intentions, mais surtout parce qu’il s’est servi de lui pour ses propres projets.
Laure demande à son mari, Stéphane, s’il veut bien l’accompagner ce week-end pour voir sa famille. Stéphane hésite, car il a déjà programmé une séance de tennis avec son frère. Mais sur l’insistance gentille de son épouse, qui n’aime pas faire de longs trajets seule en voiture, il finit par accepter. Laure, touchée de son renoncement et de sa disponibilité, le remercie vivement. Le soir venu, Stéphane se fait particulièrement doux. Laure comprend aussitôt qu’il souhaite plus qu’un simple câlin. Comment lui refuser, alors qu’il a si généreusement accepté de l’accompagner ce week-end ? Ce n’est que le lendemain que Laure comprend qu’elle s’est laissé manipuler par cette relation secrètement donnant-donnant.
Dans sa paroisse, Jeanne est considérée comme quelqu’un de particulièrement généreux. Ainsi, quand il y a un baptême, elle met spontanément et gratuitement sa grande maison à disposition pour la réception. On accepte d’autant plus volontiers que sa maison se trouve à une centaine de mètres de l’église. En fait, Jeanne agit d’abord pour se tailler une réputation de générosité, réputation qui lui donne de la considération. Plus encore, elle met les personnes en dette. D’ailleurs, elle n’a pas hésité, une fois ou l’autre, quelques années plus tard, à demander un service en rappelant adroitement qu’elle avait, elle, la première, rendu service.
Joseph raconte sa première mission comme vicaire :
« J’ai vécu pendant six ans avec un curé qui monopolisait la parole. Certes, il racontait des histoires qui étaient parfois riches d’enseignement ; de plus, il avait un vrai talent de narrateur. Toutefois, non seulement la parole était confisquée, mais les repas s’éternisaient. Et plus nous étions nombreux à table, plus ils duraient.
Un jour, n’y tenant plus, j’ai pris mon curé à part. Je lui ai fait remarquer que, à chaque déjeuner, il sautait sur la première réflexion qu’un des convives faisait et que nous n’avions plus qu’à l’écouter jusqu’au café. Il a pris la mouche et m’a expliqué que je le jugeais, que je ne comprenais rien, qu’il faisait cela pour le bien commun : en racontant ces histoires, il permettait que les repas soient intéressants, il évitait aussi les conflits, les rumeurs, les médisances qui sont le lot habituel des presbytères, et j’en passe.
C’est vrai que j’avais été maladroit. Je lui ai demandé pardon pour mon ton qui était plein de reproches. Il m’a alors répondu, l’air pincé, qu’il me pardonnait. Le repas suivant, il s’est tu. L’autre vicaire et moi-même fûmes tellement stupéfaits que nous n’avons pas su quoi dire. Le curé me fixait, triomphant, pour me faire comprendre que, sans lui, les déjeuners étaient mortellement ennuyeux…
Avec le recul, j’ai eu l’impression d’avoir été pris en otage par mon curé. Ces longs monologues nourrissaient son besoin de reconnaissance. Mais c’était à notre détriment. Je l’ai d’ailleurs payé. Je craignais tellement ces repas-conférences que j’ai fait une gastrite. J’ai fini par demander à mon évêque de changer de paroisse. Heureusement, il m’a écouté. »
Jean-Paul a toujours entretenu une bonne relation avec sa sœur Marthe. « Pourtant, se souvient-il, à certains moments, je me sentais agacé. Je l’écoutais longuement, parfois pendant des heures, car elle avait besoin de s’épancher, elle aimait bien rentrer dans les détails. Mais je n’ai aucun souvenir qu’elle ait pris le temps de m’écouter. Je ne me rappelle même pas qu’elle m’ait un jour demandé ce qui compte pour moi. »
Interrogé sur son agacement, Jean-Paul tente de mettre des mots : « Je me sentais frustré par l’asymétrie de la relation. Mais, en y réfléchissant, je crois que ma colère vient de ce qu’au fond, je ne sentais pas un réel intérêt pour ce qui était important pour moi et donc pour ma personne. J’étais le grand frère patient et compatissant. Oh, j’ai ma part de responsabilité. J’ai une forte tendance à jouer au Saint-Bernard, c’est-à-dire au Sauveteur2. Il n’empêche que jamais la relation n’a été réciproque, je n’ai jamais connu cet échange, cette communion avec Marthe comme je peux l’avoir avec tel ou tel ami. »
Qui n’a fait de telles expériences ? Elles présentent toutes un point commun : une personne A utilise une personne B contre le gré de cette dernière et pour son propre bénéfice. Autrement dit, la relation de A à B est une relation utilitariste.
En fait, ces expériences présentent un autre point commun : la personne A dissimule son utilitarisme, voire se présente comme altruiste. En effet, l’utilitarisme est psychologiquement si destructeur et socialement si répréhensible que personne ne peut ouvertement et spontanément adopter une telle attitude. L’utilitariste doit donc avancer masqué.
Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez à une expérience où vous vous êtes senti utilisé. Ce peut être dans votre milieu professionnel, dans votre immeuble, au sein d’une association, mais aussi avec un proche : votre conjoint, un parent ou un enfant, un ami. Celui qui s’est servi de vous peut aussi être un collectif qui a cherché à vous convaincre en prétendant que c’était pour votre bien, alors qu’il cherchait le sien avant tout.
Représentez-vous cette expérience concrètement. Mémorisez les détails, comme si l’événement venait de se dérouler. Voyez la personne qui vous utilise, son visage, ses gestes. Entendez ses paroles. Peut-être pouvez-vous sentir son odeur.
Puis, demandez-vous ce que vous ressentez. Je ne dis pas ce que vous en pensez, mais ce que vous éprouvez comme sentiment : colère, haine, peur, culpabilité, amertume, découragement, etc. Ne jugez pas ces sentiments qui sont normaux et même sains. Par exemple, la colère naît en nous quand nous avons subi une injustice ; or, être utilisé par un autre à ses propres fins est profondément injuste.
Si vous avez plus de difficulté à vous connecter avec vos émotions et vos sentiments, demandez-vous ce qui se passe dans votre corps, quelle partie de votre corps est affectée et tentez de mettre ce changement physique en relation avec un sentiment. Par exemple, cette bouche sèche est liée à la peur.
Enfin, nommez les conséquences de cette utilisation. Analysez-en les effets négatifs. Par exemple, la perte de la confiance dans l’autre, le dégoût ou le rejet de cette personne, la culpabilité de vous être laissé utiliser, l’extension aux personnes de la même famille, la même profession (tous les Untel sont utilitaristes), la même nationalité, voire à l’humanité, etc. Mesurez l’ampleur du dégât sur vous et sur votre entourage de l’attitude utilitariste que vous avez subie.
Il est en général assez aisé de repérer l’attitude utilitariste provenant d’autrui. Elle est parfois plus difficile à déceler lorsqu’elle s’accompagne de manipulation, par exemple lorsque la personne fait croire qu’elle cherche le bien de l’autre alors qu’elle ne cherche que le sien : « Pourrais-tu tondre le gazon, demande l’épouse à l’époux ? Cela te permettrait de t’aérer, tu es resté dans la maison toute la journée… » L’utilitarisme devient presque impossible à détecter lorsqu’il provient d’une personnalité narcissique et que nous sommes sous emprise. Ici, l’éclairage d’une autre personne, d’un livre, etc., est nécessaire3 ; encore faut-il que l’emprise ait déjà commencé à se desserrer. Heureusement, ces personnalités narcissiques sont rares. Il est bon de le rappeler aujourd’hui : après les avoir ignorées, nous en parlons trop, et les personnes qui ont tendance à se victimiser ont trouvé en elles le bouc émissaire rêvé. Quoi qu’il en soit, tel n’est pas ici notre propos (cf. chap. 3). Nous parlons de l’utilitarisme que je qualifierais d’« ordinaire » ou « habituel », c’est-à-dire celui que nous rencontrons au quotidien.
Utiliser l’autre
Si se demander : quelqu’un m’a-t-il déjà utilisé ? est d’importance, la question la plus décisive est la suivante : et moi, m’est-il déjà arrivé d’être utilitariste dans ma relation avec les autres ? Et elle est plus décisive, parce que, selon le mot de Socrate, « commettre l’injustice est pire que la subir4 ». Être utilisé par l’autre est un mal subi, involontaire, alors qu’utiliser l’autre est un mal volontaire, donc coupable.
L’anthropologue René Girard demandait parfois en conférence : combien parmi vous ont déjà été victimes ? Beaucoup de mains, voire toutes les mains, se levaient. Puis il interrogeait : qui, parmi vous, a déjà été bourreau de l’autre ? Personne ne levait la main. Il adressait alors une dernière demande : comment 0 % de bourreaux peuvent-ils engendrer 100 % de victimes ? Si nous nous sommes tous, à certains moments, sentis utilisés, comment serions-nous indemnes de toute instrumentalisation d’autrui ?
Cher lecteur, si vous comptiez trouver dans ce livre les critères pour pouvoir accuser l’autre d’utilitarisme, vous allez être déçu ! L’unique intention qui a dicté ces pages est de vous aider à changer la seule personne que vous êtes à même de changer et appelée à changer : vous-même ! Cet ouvrage n’a pas d’autre dessein que de vous aider à avancer sur le chemin de l’humanisation, du bonheur et de la conversion : passer de l’utilisation de l’autre à l’authentique amour.
2. Joseph fait allusion au triangle dramatique de Karpman. Cf. Pascal Ide, Le Triangle maléfique. Sortir de nos relations toxiques, Paris, Éd. de l’Emmanuel, 2018.
3. Je me permets de renvoyer à Pascal Ide, Manipulateurs. Les personnalités narcissiques : détecter, comprendre, agir, Paris, Éd. de l’Emmanuel, 2016.
4. Platon, Gorgias, 473 b, trad. Monique Canto, Paris, Flammarion, coll. « GF », 1987, p 183.
Chapitre 2
Aimer l’autre
Aimer l’autre
« Je pense que je suis souvent utilitariste, sourit Armand. En tout cas, il y a un cas où je ne le suis vraiment pas : c’est lorsque, dans mon entreprise, je vais aux toilettes, je ferme la porte, et que je nettoie à fond la cuvette pour le suivant ! Je ne me vois pas faire de la pub. Là, personne ne le sait ! »
Ève et Richard sont mariés depuis une quinzaine d’années. Comme chaque été, Richard part pendant une semaine faire une virée moto avec quelques amis. « Chic, songe Ève, je vais ainsi pouvoir nettoyer à fond son bureau sans le déranger. » Elle y passe plusieurs heures tant il est sale et finit en plaçant quelques fleurs dans un vase sur le bureau. Quand il rentre, ravi de sa balade, Richard note la présence du bouquet, remercie son épouse de la délicate attention, mais ne voit pas que le bureau est propre. Ève ne relève pas. Le soir, quand elle se couche, elle est heureuse que son mari ait vu son geste et ait exprimé sa gratitude, ce qu’il ne faisait pas au début de leur mariage. Elle a nettoyé le bureau d’abord pour que son mari s’y trouve bien, même s’il ne sait pas pourquoi ; elle l’a aussi fait pour entretenir la maison et parce qu’elle aime la propreté.
Comme chaque matin, Anne vient prier longuement dans son oratoire. Elle s’agenouille devant le tabernacle (son mari et elle ont obtenu l’autorisation de leur évêque d’avoir la Présence réelle) et alors qu’elle s’apprête à fermer les yeux, elle est attirée par une couleur jaune, sur le côté. Intriguée, elle regarde et que voit-elle ? Deux pâquerettes et un bouton d’or, posés devant la porte du tabernacle. Un sourire très ému monte à ses lèvres, sourire qui affleure à nouveau lorsqu’elle me raconte l’épisode : « C’était très probablement le cadeau d’un de mes petits-fils, 4 ans et demi. Que j’étais touchée par cet acte ! Je lui avais expliqué que Jésus était présent dans le tabernacle. Et il a déposé ce bouquet, juste pour le Bon Dieu, seulement pour Lui. »
Aînée de quatre d’une famille d’Annecy-le-Vieux, la vénérable Anne de Guigné (1911-1922) était souvent désobéissante, orgueilleuse, colérique et jalouse. Utilitariste, elle faisait tourner le monde autour d’elle. Alors qu’elle a 4 ans, son père meurt lors de la Grande Guerre. Sa mère n’est plus capable de supporter les rébellions de sa petite fille : « Anne, si tu veux me consoler, il faut être bonne. » À partir de cet instant, la petite Anne va multiplier les actes pour devenir bonne. C’est ainsi que, lorsqu’une colère la prend face aux frustrations et aux contrariétés, elle devient rouge et serre ses petits poings pour ne pas exploser. Progressivement, ses fréquentes crises s’espacent et elle change en profondeur. Et, lorsqu’une très douloureuse méningite l’atteindra, elle mènera une vie héroïque. Par amour pour sa mère, Anne a donc pris conscience que son attitude la faisait souffrir et a décidé de la consoler en devenant bonne. D’un mot, elle a vécu ce que nous appellerons une conversion personnaliste5.
Être aimé par l’autre
Ces quelques exemples ne vous ont peut-être pas laissé indifférent. Peut-être aussi vous ont-ils suggéré des souvenirs personnels.
Comme au chapitre précédent, je vous propose de vous arrêter un moment après cette lecture. Cet arrêt contrarie le désir d’avancer dans celle-ci. Mais ce que vous perdez en découverte de contenus nouveaux, vous le gagnez en profondeur, c’est-à-dire en appropriation.
Faites mémoire d’un acte d’amour désintéressé dont vous avez fait l’objet. Il peut être récent ou ancien. L’essentiel est que le souvenir soit concret, précis. Une personne que vous connaissiez ou non s’est arrêtée pour vous rendre service, vous a fait un cadeau, vous a souri, s’est intéressée à vous pour vous, sans aucune arrière-pensée, etc. Là encore, prenez le temps de détailler l’acte. Voyez le visage de la personne, entendez sa voix.
Puis goûtez ce moment et demandez-vous ce que vous ressentez. Prenez le temps d’éprouver la paix, la joie simple, voire débordante, la gratitude qui montent en vous. Pour cela, de nouveau, prenez contact avec votre corps : dans quelle partie de votre organisme (région du cœur, abdomen, etc.) ressentez-vous cette reconnaissance ? Nos sentiments agréables nous font du bien : c’est leur destination !
Derechef, aimer l’autre
Et maintenant, faites l’exercice dans l’autre sens. Rappelez-vous un acte d’amour uniquement tourné vers l’autre que vous avez posé. Ne cherchez pas un acte exceptionnel, héroïque. L’essentiel est que, dans cet acte, vous vous soyez détaché de vous-même, que vous n’ayez en rien cherché un retour, que vous vous soyez uniquement attaché au bien de l’autre, bref, que la personne de l’autre ait mobilisé votre attention. Ce peut être une simple question (« Ton mal de tête est-il passé ? » « As-tu passé une bonne nuit ? »), un geste (un sourire gratuit adressé à un inconnu, tenir la porte à celui qui nous suit, ranger la vaisselle à l’insu de tous), etc.
Maintenant, savourez ce moment pour lui-même. Avoir posé un acte d’amour, c’est-à-dire vous être donné, procure toujours une paix et une joie. Celle-ci n’est pas forcément débordante, elle peut demeurer discrète. Du moins se présente-t-elle souvent comme une dilatation intérieure.
Ce souvenir soulève parfois aussi en vous une fierté. Celle-ci est légitime. De fait, l’être humain est fait pour aimer, plus, il ne s’accomplit qu’en se donnant, ainsi que nous allons le redire.
Enfin, ce don peut éveiller en nous une attente (sera-t-il reconnu ?), un désir de retour (répondra-t-il à mon mail ?) qui est l’attente d’un échange, une tristesse mesurée (je regrette qu’aucun voisin ne m’ait rendu mon invitation). Ces sentiments sont eux aussi légitimes : le don est pour la communion. Toutefois, si cette attente se transforme en inquiétude, voire suscite une exigence ou une amertume, alors ces réactions signalent un secret utilitarisme : j’ai donné pour, en définitive, recevoir un retour, donc pour moi.
Quatre marqueurs affectifs
Nous reviendrons sur ce point important. Pour l’instant, résumons les quatre attitudes décrites dans ces deux premiers chapitres (être utilisé par l’autre, utiliser l’autre ; être aimé par l’autre, aimer l’autre) à partir de leurs signatures affectives.
Être utilisé par l’autre attriste toujours et, d’abord, suscite la colère. Utiliser l’autre peut causer un certain plaisir, mais peu durable et mêlé de tristesse. Surtout, chez la personne qui n’a pas anesthésié toute conscience morale, cet utilitarisme engendre la culpabilité et le remords.
En revanche, être aimé de manière désintéressée nous touche au cœur et nous réjouit. Au sommet de cette échelle émotionnelle, aimer l’autre (ce que nous allons appeler agir selon la norme personnaliste) nous fait éprouver une joie profonde, durable et sans mélange.
Les deux attitudes que nous avons brièvement décrites illustrent ce que, à partir du chapitre 5, le reste du livre va appeler norme utilitariste et norme personnaliste. Mais, pour bien les comprendre, sortir d’un simplisme manichéen (je suis 100 % utilitariste ou 100 % personnaliste) et du moralisme culpabilisant, il est nécessaire de montrer sur quelle vision de l’homme elles s’appuient. Ce sera l’objet des deux prochains chapitres.
5. Pour le détail, cf. Renée de Tryon-Montalembert, Anne de Guigné. Enfance et sainteté, Paris, Saint Paul, 1983. Pour une introduction, cf. Odile Gautron, Le Secret de l’enfant rebelle. Vénérable Anne de Guigné (1911-1922), Paris, Éd. du Triomphe, 2006. Cf. le site, consulté en février 2014 : http://www.annedeguigne.fr/fr/
Chapitre 3
Quatre vérités anthropologiques
Nous avons constaté qu’aimer ou être aimé rend heureux, mais qu’être utilisé par autrui ou l’utiliser rend malheureux. Demandons-nous maintenant pourquoi. Pour le comprendre, il est nécessaire de faire appel à une vision de l’homme. Ce chapitre passera brièvement en revue quatre vérités anthropologiques.
Être aimé
L’homme est d’abord fait pour être aimé. Dans un service de néonatologie, des nourrissons prématurés peinaient à prendre du poids et demeuraient donc longtemps à l’hôpital ; dans un autre, adjacent, ils grandissaient vite et bien, et donc pouvaient sortir plus tôt. Pourtant, dans les deux unités, les nouveau-nés bénéficiaient des mêmes soins, de la même compétence médicale et infirmière. Jusqu’au jour où quelqu’un remarqua que, dans le premier service, les enfants qui étaient en couveuse n’étaient jamais touchés, alors que, dans le second, une aide-soignante de nuit, prise de compassion pour ces petits qui ne bénéficiaient pas de la proximité physique de leurs parents, avait pris l’initiative de les masser, les cajoler et leur parler. Or, en touchant, cette « aime-soignante » transmettait de l’amour. Être touché signifie que notre peau a été au contact, mais aussi que notre cœur a été ému, rejoint. L’amour est donc vital, pas seulement pour notre psychisme, mais pour notre organisme6.
Ce qui est vrai de l’enfant l’est aussi de l’adulte et du vieillard. La psychologie l’a montré indirectement à travers le besoin de reconnaissance et, en creux, à travers la grande souffrance due à l’exclusion. Une étude a été faite sur le stress des chauffeurs des bus parisiens de la RATP7. On s’imagine habituellement que la tension est liée aux problèmes de conduite et d’attention dans une circulation peu fluide. En réalité, les chauffeurs racontaient surtout leur souffrance de ne pas être salués ni même regardés ; ils le vivaient comme une sorte d’objectivation, de mécanisation, de manipulation. Autant de signes du besoin d’être reconnus – et, au fond, d’être aimés – comme une personne.
Un chercheur demande à des volontaires de passer une série d’expériences de psychologie pour le laboratoire de l’université. Tout d’abord, chacun doit passer un test de personnalité. Puis, le chercheur transmet le résultat : « Désolé, vous avez le profil psychologique des personnes qui terminent leur vie dans la solitude et qui sont incapables de demeurer dans une relation épanouissante de manière durable. » Alors, il lui demande de passer dans une nouvelle pièce en vue de faire un second test, mais sans lui dire en quoi il consiste. En fait, dans la pièce se trouvent deux chaises. L’une est disposée face à un miroir et l’autre, dos au miroir, fait face à un mur nu. Dans le même temps, un autre candidat passe aussi le test et s’entend dire, tout à l’inverse : « Vous avez une vie relationnelle heureuse. » Résultat : dans 90 % des cas, la personne qui a entendu le présage sinistre s’assoit face au mur et donc tourne le dos au miroir ; la personne qui a entendu la sentence heureuse, elle, s’assoit indifféremment sur l’une des deux chaises8. Or, pouvoir se regarder en face est signe d’estime de soi ; les personnes qui s’aiment peu écartent les miroirs de leur habitation. Ainsi, les paroles d’exclusion affectent aussitôt et grandement l’estime de soi.
Notre premier besoin est donc d’être aimé. Qui n’en a fait l’expérience ? Quelle est grande la souffrance de celui qui se sent rejeté ! Quelle est grande la joie de sentir l’affection concrète d’un ami, d’un parent, d’un membre de sa communauté, parfois même d’un inconnu !
Aimer
Si l’homme a d’abord besoin d’être aimé, il a aussi et plus encore besoin d’aimer. S’il a soif de recevoir de l’amour, il ne trouve pleinement son bonheur qu’à donner à son tour. Là encore, de multiples expériences attestent que, très précocement, le petit enfant se tourne spontanément vers autrui pour le servir gratuitement, c’est-à-dire sans attente de retour. Par exemple, le bébé de 1 an et demi à 2 ans cherche à soutenir sa maman qui simule un problème, comme une tristesse, une difficulté respiratoire ou une douleur au pied9.
Là aussi, l’observation le confirme chez l’adulte. Lorsque celui-ci est en sécurité, il éprouve spontanément un élan à donner de manière désintéressée. Interrogés, la quasi-totalité des donneurs de sang (98 %) disent donner sans espérer une contrepartie, pour aider ceux qui en ont besoin10. Plus encore, si on les rémunère, leur motivation, et donc leur nombre, chute11. Le psychologue Leonard Berkowitz a demandé à un groupe de volontaires de fabriquer des boîtes en papier sous le contrôle d’un superviseur – superviseur qu’ils ne reverront jamais. Puis on divisa le groupe en deux ; on informa la première moitié que leur performance, tout en demeurant anonyme, jouerait un rôle sur la note du superviseur, alors que l’autre moitié ne savait rien à propos de celui-ci. On a alors constaté que la première moitié des participants travaillait mieux et plus longtemps que la seconde. Par conséquent, les volontaires agirent sans chercher de retour, c’est-à-dire gratuitement12. Plus encore, un certain nombre d’études ont établi que la fréquence et la motivation des actes altruistes diminuent lorsqu’on cherche à les motiver par une récompense matérielle13.
Ainsi, l’être humain aspire grandement à épancher son amour dans le cœur d’autrui. De fait, lorsqu’on demande à une personne de faire mémoire des plus importants moments de sa vie, il se rappelle spontanément les moments où il a reçu de l’affection, mais aussi, et plus encore, ceux où il s’est donné généreusement et sans retour.
« En ce moment, allongé sur mon lit de malade et me rappelant toute ma vie, je me rends compte que toute la reconnaissance mondiale et la richesse qui m’ont rendu si fier de moi, ont pâli et ont perdu tout sens devant la mort imminente. […] La richesse, pour laquelle j’ai tant lutté et que j’ai obtenue dans ma vie, je ne peux pas l’emporter avec moi. Ce que je peux emporter, ce ne sont que les souvenirs résultant de l’amour. Ce sont là les vraies richesses qui vous suivent, vous accompagnent, qui vous donnent la force et la lumière pour continuer14. »
Ainsi s’exprimait, sur son lit de mort, Steve Jobs, le fondateur d’Apple et créateur de l’iPhone, qui fut l’une des plus grandes fortunes de ce début de siècle.
S’aimer
En fait, nous avons sauté une marche. Entre être aimé et aimer l’autre, se trouve une étape intermédiaire : s’aimer soi-même. Comment aimer chez l’autre ce que je déteste chez moi ? Cet amour de soi est si fondamental que, s’interrogeant sur l’ordre entre les amours, le grand théologien saint Thomas d’Aquin affirme qu’il passe avant l’amour d’autrui. Et il avance la raison profonde suivante. Le but de l’amour, dit-il, est d’unir l’être aimant et l’être aimé. Or, nous sommes plus unis à nous-mêmes qu’à tout autre ; nous sommes notre plus proche prochain ; l’unité avec soi est plus grande que l’union avec l’autre. La charité envers soi prime donc celle envers l’autre15. Ce que l’Écriture affirme (pas moins de sept fois !) : « Aime ton prochain comme toi-même » (Lv 19, 18 ; Mt 22, 39 et // ; Ga 5, 14 ; Jc 2, 8), la psychologie le confirme : pas de bonheur sans estime de soi16.
Mais peut-être faut-il corriger saint Thomas sur un point. Si l’amour de soi est fondamental, au sens où il constitue le fondement, en lui ne réside pas le but de la vie, c’est-à-dire le bonheur : le bonheur consiste à aimer l’autre et, pour le croyant, à aimer Dieu par-dessus tout17. Qu’il serait triste un monde où nous n’aurions pas d’autre finalité que de nous aimer nous-mêmes ! L’amour de soi correspond aux fondations de la maison, l’amour des autres à la maison elle-même : le rez-de-chaussée où nous accueillons les visiteurs et les étages où nous recevons les intimes.
Tirons-en une conséquence importante.
Les trois amours
Il est frappant que, dans de nombreuses langues, les verbes connaissent trois et seulement trois voix : active, passive et pronominale. De même, l’amour est triple : aimer, être aimé et s’aimer.
Nouons ces trois vérités dans le temps. Ces besoins fondamentaux tracent un chemin : être aimé, s’aimer, aimer. On pourrait les joindre par la préposition pour qui indique la direction et la finalité : être aimé pour s’aimer ; s’aimer pour aimer l’autre. Et même si, très tôt, le petit enfant éprouve un élan à se donner et doit être éduqué précocement à le faire, les âges de la vie s’étagent selon ces moments : dans l’enfance, prime le besoin de recevoir ; à l’adolescence et lors des premiers pas dans la vie adulte (autonome), le besoin de se construire, de s’aimer ; enfin, l’âge pleinement adulte se caractérise par le primat de l’amour de don. Toutefois, ces trois âges de l’amour sont aussi présents à chaque âge : constamment, l’homme a besoin d’en éprouver la pulsation. Gary Chapman a bien relevé que, en amont des cinq langages de l’amour, je ne peux exprimer cet amour à l’autre que si mon réservoir est rempli.
Ces trois moments de l’amour correspondent aux trois moments du don : la réception, l’appropriation et le don au sens propre (le don de soi)18. Par exemple, quelqu’un me fait un sourire que je reçois avec gratitude, je le reconnais et me l’approprie comme étant un cadeau immérité et je lui réponds en lui donnant