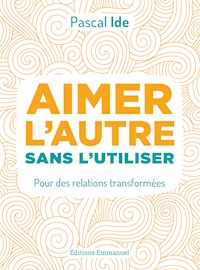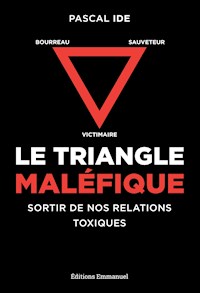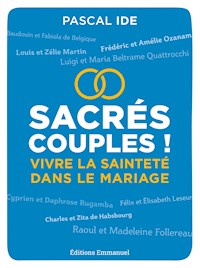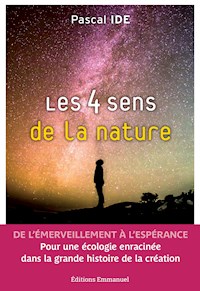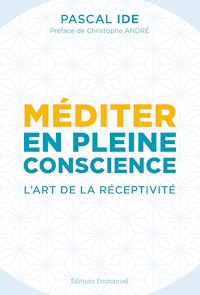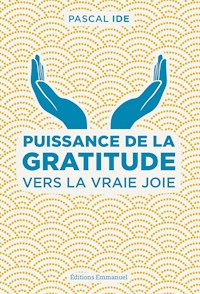
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions de l'Emmanuel
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Pascal Ide nous offre de précieux conseils pour expérimenter la puissance de la gratitude, jusque dans ses effets sur notre corps et notre psychisme.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Monseigneur Pascal Ide est prêtre du diocèse de Paris depuis 1990 et membre de la communauté de l'Emmanuel. Actuellement, il est chef du service des Universités catholiques à la Congrégation pour l'Éducation catholique. Il est docteur en médecine, en philosophie et en théologie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pascal IDE
PUISSANCE DE LA GRATITUDE
Vers la vraie joie
Nihil obstat,
Paris, le 15 septembre 2017
P. PELLETIER, Cens. dep.
Imprimatur,
Paris, le 15 septembre 2017
Mgr CHAUVET, Vic. Ép.
Conception couverture : © Christophe Roger
Image couverture : © Shutterstock
Composition : Soft Office (38)
© Éditions Emmanuel, 2017
89, bd Auguste-Blanqui
75013 Paris
www.editions-emmanuel.com
ISBN : 978-2-35389-654-7
Dépôt légal : 4e trimestre 2017
Du même auteur
Travailler avec méthode, c’est réussir. Précis de méthodologie pour l’étudiant chrétien, Paris, Le Sarment-Fayard, coll. « Guide Totus », 1989.
Construire sa personnalité, Paris, Le Sarment-Fayard, 1991.
Guide de l’éducation, en collaboration avec Catherine DEREMBLE et Véronique MAUMUSSON, Paris, Droguet-Ardent, 1992.
L’Art de penser. Guide pratique, Paris, Médialogue, 1992.
Connaître ses blessures, Paris, Éditions de l’Emmanuel, 1993, rééd. avec préface, 2013.
Introduction à la métaphysique. I. Vers les sommets, Paris, Mame, coll. « Les cahiers de l’École cathédrale » n° 8, 1994.
Est-il possible de pardonner ?, Versailles, Saint-Paul, coll. « Enjeux », 1994.
Être et mystère. La philosophie de Hans Urs von Balthasar, Namur, Culture et vérité, coll. « Présences » n° 13, 1995.
Le Corps à cœur. Essai sur le corps humain, Versailles, Saint-Paul, coll. « Enjeux », 1996.
Eh bien dites : don ! Petit éloge du don, Paris, Éditions de l’Emmanuel, 1997.
Mieux se connaître pour mieux s’aimer, Paris, Fayard, 1998.
Les Neuf Portes de l’âme. Ennéagramme et péchés capitaux : un chemin psychospirituel, Paris, Fayard, 1999.
Célibataires : osez le mariage !, Versailles, Saint-Paul, 1999.
Les Sept Péchés capitaux. Ce mal qui nous tient tête, en collaboration avec Luc ADRIAN, Paris, Édifa-Mame, 2002.
Regards sur « La Passion du Christ ». Lectures du film de Mel Gibson, Jean-Gabriel RUEG, Philippe RAGUIS et PascalIDE (dir.), Toulouse, Éd. du Carmel, 2004.
Le zygote est-il une personne humaine ?, Paris, Téqui, coll. « Questions disputées : Saint Thomas et les thomistes », 2004.
La Rencontre au cinéma, Paris, Éditions de l’Emmanuel, 2005.
Lubirea nefericita [Amour et amitié]. Tratarea si vindecarea ei, trad. Iosif Tiba, Galaxia Gutenberg, 2005.
« Le Christ donne tout ». Benoît XVI, une théologie de l’amour, Paris, Éditions de l’Emmanuel, 2007.
Des ressources pour guérir. Comprendre et évaluer quelques nouvelles thérapies : hypnose éricksonienne, EMDR, Cohérence cardiaque, EFT, Tipi, CNV, Kaizen, Paris, DDB, 2012.
Une théologie de l’amour. L’amour, centre de la « Trilogie » de Hans Urs von Balthasar, Bruxelles, Lessius, coll. « Donner raison », 2012.
Une théo-logique du don. Le don dans la « Trilogie » de Hans Urs von Balthasar, Leuven, Peeters, coll. « Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium » n° 256, 2013.
Le Burn-out. Une maladie du don, Paris, Éditions de l’Emmanuel et Quasar, 2015.
Manipulateurs.Les personnalités narcissiques : détecter, comprendre, agir, Paris, Éditions de l’Emmanuel, 2016.
« De toutes les vertus, la gratitude est la plus grande, la mère de toutes les autres1. »
« Si tu remerciais Dieu pour toutes les joies qu’il te donne, il ne te resterait plus de temps pour te plaindre2. »
« Parmi les maux de l’âme les plus fréquents et les plus grands,il n’y en a […] pas de plus répandu que l’ingratitude3. »
Introduction
On est en 1906 et il [Rainer Maria Rilke] se promène avec une amie au jardin du Luxembourg. Devant la grille, une vieille femme mendie. Ses yeux ne se lèvent jamais vers les passants, aucune prière ne sort de ses lèvres. Elle mendie, le dos rond toujours couvert d’un fichu noir. Rilke a l’habitude de déposer dans ses mains une aumône. La vieille femme, sans lever la tête, ne dit jamais un mot de remerciement. Ce jour-là, l’amie dit à Rilke : « Elle est peut-être riche et possède une cassette comme l’Harpagon de Molière ! » Rilke ne répond que par un léger regard de reproche et poursuit jusque devant la mendiante, qui vient juste de s’installer dans sa pose sans avoir encore rien reçu. Le jeune homme s’incline avec respect et dépose une rose sur les genoux de la vieille dame. Celle-ci lève alors les yeux sur Rilke, et avec un geste prompt lui saisit la main, la baise. Puis elle se lève et s’en va à petits pas usés – sans mendier davantage ce jour-là. Ce fut pour la jeune femme une immense leçon. Rilke, écrirait-elle plus tard, rendait les êtres beaux, leur suggérant des gestes descendus directement de la plus haute noblesse. L’essentiel est l’amour. Mais l’amour ne se montre qu’à celui qui reconnaît qu’il ne sait pas aimer et que l’amour est toujours plus vaste que toutes nos idées ou projets, qu’il est nécessaire à chaque moment, même dans la rencontre brève avec une inconnue. Alors, pour reprendre un des mots décisifs de Rilke, il nous métamorphose1.
Depuis son mariage, voici trente ans, Pénélope est triste. Certes, elle a des enfants et elle est contente de ce qu’ils deviennent, mais elle n’envisage son mari que de manière négative. Pour le décrire, elle ne fait appel qu’à des négations : « Il ne parle pas, il n’est pas chaleureux, il ne prend pas d’initiatives, il ne me dit pas qu’il m’aime. » Petit à petit, Pénélope se recroqueville sur sa vie. Aujourd’hui, leurs enfants ne vivant plus au foyer familial, elle est tentée de quitter son mari. Seul la retient l’engagement pris le jour de son mariage religieux : engagée dans sa paroisse, elle croit que le sacrement est un don de Dieu, même si elle n’en vit pas au quotidien.
Comme elle souffre d’angoisses de plus en plus invalidantes, Pénélope consulte un spécialiste en thérapies brèves (hypnothérapie, EFT, etc.). En découvrant un apaisement intérieur qu’elle ignorait, ses récriminations contre son mari deviennent un peu moins virulentes mais ne disparaissent pas.
Un jour, elle va à la paroisse se confesser et ressort heureuse de cette confession à laquelle elle s’est préparée et qu’elle a cherché à vivre avec une sincère contrition. En passant, elle se rend compte que le Saint Sacrement est exposé dans la chapelle de la Vierge. Alors qu’elle s’apprête à sortir pour rentrer chez elle, elle s’arrête, se retourne, s’agenouille devant Jésus-Hostie et prend le temps de rendre grâce : « Merci Jésus pour cette confession. » « Aussitôt, racontera-t-elle ensuite, tout le poids du passé est tombé. D’un seul coup, j’ai changé mon regard sur mon mari et j’ai cessé de vouloir le quitter. Et alors que je ne cessais de faire formation sur formation, j’ai aussi compris que je cherchais à fuir la maison. Toutes ces lumières, toute cette paix – paix qui dure encore – furent le fruit immédiat de l’acte de gratitude que j’ai posé en me retournant vers Jésus. J’en demeure émerveillée ! »
Même un tueur peut accomplir un acte de gratitude. Albert Kayigumire, laïc rwandais, directeur du centre spirituel de l’Emmanuel depuis 2000, témoigne d’un épisode lors de la terrible guerre ethnique qui éclate dans son pays en 1994 :
Un jour, je décide de dire bonjour à tous [ceux que je rencontre], sans distinction d’ethnie. Même à mes pires ennemis, les extrémistes ethniques, tueurs sans vergogne. À leur nom, les gens crachaient à terre. J’ai pris le contre-pied, en leur disant systématiquement bonjour. C’est grâce à cette minuscule action que je me suis extirpé d’une situation qui aurait pu tourner en un terrible massacre. Un jour, ces tueurs sont venus chez moi avec des grenades. Je suis sorti torse nu avec un chapelet : « Bonjour, est-ce que c’est la paix ? » Le chef me répond : « Même si ce n’est pas la paix, toi, tu es un homme de paix. » Puis il a crié aux autres : « Celui qui pille, je le brûle vif. Je vais rentrer moi-même ici pour essayer de trouver les personnes que nous cherchons. » Et, en entrant, il a trouvé les gens que je cachais… « Vous croyez avoir trouvé une bonne cachette ici, pauvres imbéciles ? » Et il a fermé les yeux… Pour un simple bonjour, il nous a fait grâce de notre vie2.
Après les deux précédents ouvrages qui ont traité des maladies du don, par excès (le burn-out3) et par défaut (le narcissisme pathologique4), ce livre considère le moteur, voire l’âme secrète de l’amour-don : la gratitude. En effet, nous éprouvons de la reconnaissance lorsque nous recevons un don ou un bienfait. Celui qui reconnaît un don (par exemple, un service rendu, un coucher de soleil, etc.) et en rend grâce, ne peut pas ne pas ressentir une joie, et même l’une des plus grandes joies qui soient. C’est la raison pour laquelle la gratitude est source de bienfaits immenses et durables pour notre corps, notre psychisme et notre esprit. Plus encore – le chapitre 3 le montrera en détail –, la gratitude est la source du don inépuisable de soi.
Voilà pourquoi le titre parle de la puissance de la gratitude5. La psychologie elle-même reconnaît en celle-ci une force6. En se ressourçant aux multiples dons gratuits qui lui sont faits, celui qui vit dans la reconnaissance renouvelle en permanence son énergie à se donner à son tour gratuitement. La gratitude rend amour pour amour.
Elle introduit dans une joie que le sous-titre qualifie de vraie pour signifier qu’elle correspond à la nature profonde de l’homme et n’est point trompeuse. En effet, la deuxième partie montrera en détail que l’homo festivus se transforme en homo tristus, parce qu’il oublie la « voie par excellence7 » de la joie et du bonheur : la gratitude.
Nous procédons en trois temps – selon le plan création-décréation-recréation. La première partie étudie la gratitude, pourquoi elle est source de tant de bienfaits et en quoi elle consiste. La deuxième partie traite du plaisir trompeur de l’hyperconsommateur actuel et des solutions tout aussi illusoires que notre société lui substitue. Enfin, la troisième partie détaille la pratique de la gratitude. Chacun des chapitres de la troisième partie s’achève par trois questions : leur intention est d’aider le lecteur à s’approprier son contenu et à le transformer en résolutions. En effet, si certaines personnes sont plus spontanément disposées à la gratitude, celle-ci est une inclination naturelle, présente en chaque homme, capable de croissance par entraînement8.
Les termes gratitude et reconnaissance seront considérés comme synonymes – même si la reconnaissance, comme son étymologie l’indique, souligne davantage la dimension cognitive qui est l’un des trois aspects de la gratitude (cf. chap. 2).
Un certain nombre de développements plus techniques ou latéraux sont consultables en ligne (cf. ci-après). Ils sont tous signalés en notes. Chaque chapitre propose une bibliographie sélective, à retrouver sur le site, et s’achève par une illustration cinématographique (un film ou, plus souvent, une scène) dont l’analyse est elle-même sur le site9.
Site : gratitude.pascalide.fr
Nom d’utilisateur : livre
Mot de passe : gratitude
PREMIÈRE PARTIE
La joie de la gratitude
« Nous éprouvons de la joie à prier ceux qui nous réjouissent, parce que la prière non seulement exprime la joie, mais l’accomplit ; c’est son accomplissement. Ce n’est pas seulement pour des raisons de compliment que les personnes qui s’aiment ne cessent de se dire combien elles sont belles ; l’aimé est incomplet tant que la joie n’est pas exprimée1. »
Le chapitre 1 détaille les multiples fruits de la gratitude qui sont autant de bienfaits. Le chapitre 2 tente de la définir. Le chapitre 3 montre que la source de la gratitude réside dans la dynamique du don.
CHAPITRE 1
Les multiples bienfaits de la gratitude
« Vous ne parviendrez jamais à la paix et la sécurité intérieures sans d’abord avoir reconnu toutes les bonnes choses présentes dans votre vie1. »
Un monastère de religieuses, laboratoire de gratitude
En 1986, un chercheur du Minnesota et son équipe ont étudié le lien entre gratitude et longévité. Mais comment mesurer une telle corrélation ? L’idéal serait de comparer deux populations identiques dont l’une pratique la reconnaissance et l’autre non. Ainsi, on élimine les autres facteurs qui rendent heureux et favorisent la bonne santé, comme un conjoint aimant et aimé, la présence des enfants, un travail épanouissant, etc. Les chercheurs ont trouvé des personnes combinant tous ces paramètres : dans un couvent ! Mieux encore, ils ont découvert une communauté de religieuses qui, depuis un siècle et demi, demande à ses membres d’écrire une lettre lorsqu’elles rentrent au monastère, puis à l’âge de 40 ans, enfin quand elles atteignent 70 ans. On possède en outre les dossiers médicaux des sœurs depuis la même date. Les enquêteurs ont alors remis les lettres à des sémanticiens, afin qu’ils repèrent les mots qui manifestent l’émerveillement, l’optimisme ou la gratitude. Enfin, ils ont corrélé ces données avec la santé et la longévité.
Résultat : plus il y a de termes exprimant l’émerveillement ou la gratitude, plus la vie croît en quantité et qualité. La moitié des sœurs qui avaient écrit le plus grand nombre de mots positifs étaient encore vivantes à 94 ans, contre 10 % seulement pour celles qui avaient écrit le moins de paroles de reconnaissance. On a même pu évaluer le gain moyen de vie à sept ans ! Cette étude fut reproduite et confirmée2.
Les recherches l’attestent à foison : la gratitude accroît le bien-être en toutes ses dimensions3. Une large méta-analyse qui passe au peigne fin près de 50 études comptabilisant plus de 4 000 participants le confirme4. Si bien que la cause peut se retourner en signe : le degré de gratitude évalue le degré de bien-être – voire, il le prédit six mois à l’avance5. Ces bienfaits sont de cinq ordres : physiques ou somatiques ; psychiques ou mentaux ; éthiques ou spirituels (au sens de l’esprit) ; relationnels ou sociaux ; surnaturels ou spirituels (au sens de l’Esprit)6.
Les bienfaits sur le corps
La gratitude présente d’abord des conséquences physiques bénéfiques. En voici un bref échantillon. Des personnes à qui des chercheurs ont demandé d’éprouver chaque jour un peu de reconnaissance observent dès deux semaines un meilleur sommeil et une baisse de la pression diastolique (16 %) ainsi que de la pression systolique (10 %) par rapport à un groupe-témoin7. Des patients souffrant d’une cardiopathie ont tenu un « journal de gratitude », où ils relevaient les événements qui leur faisaient éprouver de la reconnaissance ; au bout de seulement deux mois, leur niveau d’inflammation avait reculé de 7 % et leur rythme cardiaque s’était amélioré, en lui-même et comparativement à un groupe-témoin qui, ayant la même maladie, n’avait pas tenu de journal8. La reconnaissance diminue de 13 % le taux de l’hémoglobine A1c qui est l’un des marqueurs-clefs du diabète ; de même, elle abaisse de 9 % les effets de la neurodégénérescence sur la capacité verbale9.
Les bienfaits sur le psychisme
Pendant longtemps, les études psychologiques ont délaissé la gratitude. Désormais, de nombreuses recherches obligent à la considérer comme un élément essentiel du bien-être intérieur.
En psychologie, observe David Servan-Schreiber, les recherches les plus novatrices se focalisent aujourd’hui sur un état très bénéfique pour la santé tant physique que mentale et qui avait été longtemps négligé : l’optimisme10.
D’un côté, la gratitude fait partie des sentiments agréables et bienfaisants11. Plus encore, elle s’accompagne d’autres émotions qu’elle stimule12: la joie de recevoir un bienfait, l’amour pour celui qui l’a gratuitement offert, une satisfaction générale à l’égard de sa vie et de la vie.
De l’autre, la gratitude protège contre d’autres sentiments qui, aigus, sont désagréables et, devenant chroniques, sont destructeurs.
Ainsi, elle permet de mieux réguler le stress et introduit une plus grande résilience à l’égard des événements difficiles13. Autrement dit, face à des obstacles, celui qui cultive un esprit de gratitude trouve plus de force intérieure pour les affronter. En effet, en ces cas-là, celui qui est reconnaissant tend à se tourner vers autrui et à se rendre utile ; or, la tristesse vient de l’auto-commisération et du repli sur soi14. Par ailleurs, le stress est l’un des plus grands pourvoyeurs de maladies de civilisation – qui sont des maladies somatiques d’origine psychique –, comme l’hypertension, le diabète de type 2, l’obésité, nombre de maladies auto-immunes et d’inflammations chroniques, etc.
Plus une personne exprime de gratitude, moins elle est anxieuse ou frustrée, selon une étude de la directrice du laboratoire de psychologie positive de l’université de Californie15.
De même, exprimer de la gratitude protège contre la tristesse de la dépression16. Précisément, chez les patients à risque, bénir et écrire une lettre de reconnaissance réduit le risque moyen de dépression de 41 % sur une période de six mois17. La gratitude prévient le passage à l’acte suicidaire caractéristique des dépressions graves, notamment en s’attaquant à deux grandes causes, le désespoir et l’impuissance. En effet, elle réduit le désespoir en aidant à repérer des aspects satisfaisants du quotidien18 et améliore la capacité de résolution des problèmes19. Des patients suicidaires auxquels une équipe médicale a proposé de faire des exercices qui les aident à ressentir de la gratitude – comme écrire régulièrement une lettre de reconnaissance – ont vu leur désespoir disparaître pour 88 % d’entre eux et leur niveau d’optimisme s’accroître pour 94 % d’entre eux20 ! L’on a aussi montré que la dépression ne consiste pas tant dans le fait de se rappeler les événements négatifs et de ruminer les échecs (cette attitude se retrouve aussi chez les personnes qui ne sont pas déprimées !), que dans l’impossibilité d’accéder à une mémoire positive, donc ouverte à la gratitude21.
La gratitude, écrit Robert Emmons, influence l’humeur en un sens positif, de sorte que cultiver des émotions orientées vers le remerciement peut être efficace dans le traitement et la prévention de la dépression22.
En outre, l’une des grandes causes de la morosité actuelle réside dans la jalousie, cette tristesse du bien de l’autre (cf. chap. 5). Elle est particulièrement présente chez les jeunes filles qui comparent en permanence l’image de leur corps avec des canons de beauté idéalisés. Des chercheurs ont ainsi mis en évidence que les images télévisées d’autres corps féminins jugés plus parfaits jouaient un rôle important dans la dépression adolescente23. Mais l’on peut généraliser aux autres comparaisons sociales qui conduisent à ne voir que ce qui, prétendument, nous manque. Or, l’homme de la gratitude se réjouit de ce qui lui est donné24. Le jaloux veut êtrecomme (l’autre) quand le reconnaissant veut être (lui-même)25 : il est heureux de ce qu’il est et de ce qu’il a, comme il se félicite du bien qui arrive à l’autre.
La reconnaissance fait aussi entrer dans une attitude non violente26 ; de fait, à l’inverse, il est difficile de ressentir à la fois de la colère et de la gratitude. Enfin, une étude majeure sur les relations entre la religion et les troubles mentaux a montré que la gratitude, qui est au cœur de l’attitude religieuse, diminue le risque de pathologie psychiatrique27. De manière générale, une méta-analyse passant en revue toutes les études quantitatives entre 1978 et 1989, a établi que 72 % d’entre elles trouvent une association positive entre engagement religieux et santé mentale, 16 % un lien négatif et 12 % aucun28. Cette étude fut confirmée29.
Les bienfaits sur l’esprit
La gratitude exerce aussi des effets dynamisants sur l’esprit humain, qui est intelligence et volonté.
Deux chercheuses américaines, Alice Isen et Barbara Fredrickson, ont montré que la gratitude – comme d’autres émotions énergisantes – ouvre l’amplitude attentionnelle30. On a, par exemple, demandé à des internes en médecine d’étudier un cas clinique fictif afin de poser un diagnostic et de prescrire un traitement. Mais, juste avant, un certain nombre d’entre eux avaient reçu un petit cadeau, ce qui engendre de la gratitude. Or, ceux qui furent gratifiés posèrent plus vite le diagnostic et proposèrent un traitement mieux adapté. Ainsi, la gratitude a accru leurs capacités d’attention, voire leur créativité31. D’autres études ont mis en évidence que la gratitude facilite le passage de l’attention focalisée à l’attention ouverte qui, dans une situation donnée, permet d’intégrer davantage d’éléments en vue d’une tâche à accomplir32.
La volonté est à la fois capacité de décision (autodétermination) et visée d’un sens. Or, la gratitude agit sur ces deux composantes. D’une part, celui qui vit de la reconnaissance se sent plus autonome, présente un meilleur contrôle de son environnement, consent plus à lui-même et augmente l’estime de soi.
D’autre part, la gratitude accroît le sens, c’est-à-dire donne un but à la vie. Une étude conduite pendant quatre ans sur près de 700 écoliers ayant entre 10 et 14 ans a établi que ceux dont les scores étaient les plus élevés sur l’échelle de gratitude bénéficiaient des meilleurs résultats sur l’échelle de sens33. En outre, ils éprouvaient une plus grande joie et une plus vive satisfaction à l’égard de leur existence présente. L’on a même pu comparer la gratitude et l’estime de soi dans le retentissement qu’elles exercent sur ce sentiment de satisfaction : les corrélations sont aussi fortes34 ; or, l’on sait que l’estime de soi est l’un des facteurs essentiels de la joie. Donc, si la gratitude dope l’amour de soi, les deux combinés se potentialisent pour augmenter la satisfaction.
Le dernier des six mécanismes de la tristesse caractéristique de l’hyperconsommateur (cf. chap. 5) réside dans l’acédie, c’est-à-dire l’absence de but et de motivation. Or, remercier – comme être remercié (dans sa signification littérale) – signifie au donateur que son geste nous a fait du bien, qu’il a atteint sa cible : il lui donne donc du sens. Toute proche est la corrélation nette entre degré de gratitude et degré d’espoir, qui fut aussi observée dans l’étude faite sur les 700 écoliers35. Ainsi, la gratitude prévient et protège le jeune de la dépression et du suicide. L’enfant dont la capacité à remercier s’accroît par la pratique voit aussi augmenter sa joie et sa satisfaction, non seulement à l’école, mais dans les autres aspects de sa vie : la famille, les relations aux amis36.
Les bienfaits sur la relation à l’autre
L’approche psychologique de la gratitude – à l’instar du pardon ou de l’amour – est centrée sur les bénéfices personnels. Mais des effets vitalisants de la reconnaissance ont aussi été observés sur la relation.
De manière générale, la pratique de la gratitude améliore la relation à autrui pour de multiples raisons : elle introduit un climat de légèreté, de joie et de paix, fait circuler la parole et les actes, enrichit considérablement la communication.
La gratitude aide beaucoup dans des relations amoureuses dont on s’attendrait à ce qu’elles se suffisent. En effet, elle rend attentif aux petites choses, ce qui est l’un des langages de l’amour37. D’ailleurs, elle dispose au don de soi38 qui est le cœur de l’amour.
La gratitude contribue aussi grandement à la bonne atmosphère dans le travail. Ces bienfaits proviennent de la reconnaissance que l’on reçoit. Un manager qui dit « merci » peut notoirement augmenter la motivation de ses équipes. Une étude de l’université de Pennsylvanie a montré que, dans la semaine suivant le discours d’un chef ayant manifesté sa reconnaissance pour les efforts de ses collaborateurs, leur productivité a augmenté de 50 % par rapport à ceux qui n’avaient pas entendu l’allocution39. Inversement, la principale source de souffrance psychique dans le monde professionnel vient de l’absence de reconnaissance40.
Ces bienfaits proviennent aussi de la reconnaissance que l’on donne. L’état intérieur de professionnels d’hôpitaux s’améliore lorsqu’ils remercient41 ; de même, une augmentation de la gratitude au travail engendre celle de la satisfaction (+ 25 %) et de l’engagement des salariés (+ 80 %)42. D’ailleurs, si les salariés sont prompts à se plaindre de l’ingratitude de leurs supérieurs et managers, les trois quarts d’entre eux ne remercient jamais leurs collègues… Pourtant, paradoxalement, 80 % des employés pensent que la reconnaissance serait bénéfique aux deux parties43 !
Différents processus expliquent les bénéfices collectifs de la gratitude. La reconnaissance nourrit le lien. En effet, elle fluidifie la relation avec les autres, y compris pour les petites choses du quotidien ; elle stabilise la relation44 ; elle change le regard sur celle-ci45 ; en changeant la vision, elle introduit de la cohérence, donc unifie et pacifie46.
Par ailleurs, l’une des composantes importantes du bien-être est l’inclusion sociale ; plus encore, entretenir des relations positives est le meilleur prédicteur de bien-être et de bien-être durable47. Or, la gratitude accroît l’intégration sociale en favorisant les bonnes relations avec autrui48. Il est évident que les personnes qui remercient (en paroles et en actes) sont particulièrement appréciées. Philip Watkins a demandé à des personnes de noter le nom de dix proches, ainsi que le degré d’appréciation dont ceux-ci bénéficient et leur capacité à être reconnaissants. Il a constaté que plus une personne a l’habitude d’exprimer sa gratitude, plus elle est appréciée49. Les raisons de ce fait ont aussi été explorées : la reconnaissance rend plus attentif à l’autre50 et plus bienveillant à son égard51. Or, l’attention et la bienveillance données à la personne l’encouragent à entretenir le lien et plus encore à donner en retour. Donc, elles relancent le don et contribuent à construire une communion. Et pour les philosophes personnalistes comme Emmanuel Mounier, Maurice Nédoncelle ou Karol Wojtyla, la communion entre les personnes est, de tous les liens, le plus solide et le plus heureux, donc le plus désirable52. Ainsi, la gratitude nourrit ce don partagé qui est l’essence de l’amitié et le cœur de l’amour. Enfin, elle dissout les causes interdisant l’intégration sociale et la communion, notamment la principale d’entre elles : la jalousie53 (cf. chap. 5).
En outre, la reconnaissance valorise la proximité sociale (parfois aussi appelée besoin d’appartenance) : une personne a besoin de sentir non seulement qu’elle est utile, mais aussi qu’elle compte pour quelqu’un ; plus encore, pour certains spécialistes, ce sentiment de proximité sociale fait partie des trois besoins psychologiques fondamentaux, avec l’autonomie et la compétence54. Nourris, ces besoins apportent du bien-être et protègent contre les troubles psychopathologiques ; frustrés, ils engendrent mal-être et pathologies psychiques.
De même, l’orientation reconnaissante développe un réseau social soutenant ; or, la sécurité diminue le stress et apporte la paix ; donc, la gratitude accroît le soutien social55.
La gratitude stimule aussi la confiance envers celui qui remercie56 – ainsi qu’on le sait depuis longtemps57 – ; or, celui qui a confiance est poussé à approfondir la relation58 ; donc, par ce va-et-vient positif, la reconnaissance développe le réseau relationnel.
Un autre processus pourrait être décrit comme une contagion ou « effet caméléon » : plus quelqu’un éprouve de gratitude, plus il pense que l’autre est chaleureux59 ; or, la perception du caractère chaleureux de l’autre le rend plus aimable et agréable ; mais l’amour est attiré par ce qui est aimable ; nous sommes donc poussés à nous rapprocher de lui ; une nouvelle fois, la gratitude apparaît comme un facteur de rapprochement social60. Dans le même ordre d’idées, elle est un multiplicateur de liens, elle facilite l’établissement de nouvelles relations61.
La raison la plus profonde du bienfait de la gratitude est encore ailleurs : une relation n’est complète que si elle fait retour vers celui qui en a pris l’initiative ; or, c’est la reconnaissance qui opère ce retour ; elle favorise donc la réciprocité62. Une surveillante m’expliquait un jour avec conviction : « Quand je suis mécontente, les infirmières s’en rendent vite compte, parce que je leur passe un savon. Et quand je suis contente, elles le savent aussi, parce que je ne dis rien. » Mais conviction ne vaut pas raison ! S’il est juste et parfois courageux de dire son désaccord, il est aussi juste et nécessaire d’exprimer sa reconnaissance : cela nourrit et, plus encore, accomplit le lien. Cette surveillante ne soupçonnait pas que son manque de reconnaissance altérait la qualité du travail des soignantes et se répercutait même sur le bien-être des patients.
Cette loi de retour ou de réciprocité, que le prochain paragraphe détaillera, n’est plus évidente dans nos sociétés individualistes et marchandes – du moins tant que nous nous situons du côté du bénéficiaire. En effet, il en est tout autrement quand nous sommes dans la position du bienfaiteur : nous sommes étonnés, voire heurtés, quand celui à qui nous donnons de l’argent ou rendons service ne remercie pas ; si les voisins que nous avons spontanément invités une fois, deux fois, ne prennent pas l’initiative de nous convier à leur tour, nous ne continuerons pas longtemps à les recevoir chez nous. Cette attente d’un retour ne signifie pas que notre premier geste était intéressé, mais que les relations humaines se structurent à partir de deux lois : la gratuité et la réciprocité63. Et si, en creux, l’ingratitude ampute la relation, la reconnaissance, elle, l’accomplit en bouclant la boucle. Le philosophe Sénèque l’exprimait dans la belle image des Grâces (Charites, en grec), ces trois sœurs qui se tiennent par la main :
Pourquoi les mains sont-elles entrelacées en cette ronde qui revient sur elle-même ? Parce que le bienfait forme chaîne et, tout en passant de main en main, ne laisse pas de revenir à son auteur, et que l’effet d’ensemble est détruit s’il y a quelque part solution de continuité64.
Enfin, le bonheur ne tient pas seulement à la qualité du lien, mais à sa durabilité, son inscription stable dans le temps. Or, des chercheurs ont montré que la reconnaissance favorisait cette longévité. Ils ont demandé à 77 couples vivant ensemble depuis plus de quatre ans d’exprimer mutuellement leur gratitude ; ils ont alors constaté que, non seulement, l’exercice dopait la qualité relationnelle, mais que cette amélioration se faisait encore sentir six mois après l’expérience en laboratoire65. Les couples ont d’ailleurs précisé les raisons de cette efficacité : les partenaires se sentaient reconnus et encouragés.
Les bienfaits sur la relation à Dieu
Outre les bienfaits intérieurs, remarquables dans notre relation à nous-mêmes, et extérieurs, visibles dans notre relation aux autres, la gratitude apporte des bienfaits supérieurs, car elle tisse notre relation à Dieu et nous arrache au matérialisme66. Ce faisant, elle achève la création, et elle l’achève parce qu’elle l’unifie.
Le dessein de Dieu peut se symboliser dans ce dessin :
En effet, tout ce qui sort de Dieu est appelé à revenir vers Lui et en Lui. Une phrase du prophète Isaïe résume admirablement cette grande loi :
La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger ; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission (Is 55, 10-11).
Cette loi est si importante que les plus grands sages en ont fait la dynamique structurant la totalité du réel67. Le philosophe mystique grec Plotin contemple tous les êtres animés d’un double mouvement de sortie (en grec, prohodos)ou d’émanation hors du premier principe (divin) qu’il appelait Un et Bien, et de retour ou conversion (épistrophè) vers lui68. Le théologien dominicain saint Thomas d’Aquin a organisé sa grande œuvre, la Somme de théologie, à partir de la sortie de toutes choses hors de Dieu (exitus,création et providence) et de leur retour vers Dieu (reditus, rédemption et glorification), dans le Christ69.
Cette loi est si universelle qu’on la retrouve à chaque étage de la nature. « Tout effet a un mouvement naturel de retour vers sa cause », observait déjà saint Thomas pour expliquer que nous sommes toujours tenus de rendre grâce pour les bienfaits reçus70. Les processus cosmiques sont rythmés par la sortie et le retour (flux et reflux, inspiration et expiration, diastole et systole, etc.). Prenons l’exemple du souffle. L’expiration n’est pas qu’un processus d’excrétion. En réalité, si l’animal inspire de l’oxygène, qui est la source indispensable de son énergie, et expire le gaz carbonique, qui est toxique pour son métabolisme, tout à l’inverse, la plante capte le gaz carbonique et rejette l’oxygène. Ainsi, en élargissant le point de vue, ce qui pourrait se réduire à une illustration du trépied consumériste – prendre, consommer et jeter (cf. chap. 4) – apparaît au contraire comme une boucle où ce qui est jeté peut être donné pour qu’un autre le reçoive. Aujourd’hui, l’écologie montre que « tout est lié71 » : les cycles de l’eau, du carbone, de l’oxygène, etc., englobent la totalité des règnes – minéral, végétal et animal – qu’autrefois l’on cloisonnait. Notre pensée occidentale, jusqu’ici linéaire, se doit, non sans peine, d’intégrer cette pensée circulaire, pour laquelle tout ce qui sort (comme la pluie des nuages) revient tôt ou tard (par évaporation)72.
Cette loi est si originelle qu’elle trouve son fondement ultime dans le Dieu Trinité. Dans l’économie du salut (c’est-à-dire l’histoire) : Israël qui, au seuil de l’histoire sainte, est le peuple élu par Dieu (Gn 12, 1 sq.) reviendra à Lui à la fin des temps (Rm 11, 1 sq.) ; Jésus qui « est sorti de Dieu […] s’en va vers Dieu » (Jn 13, 3) – accomplissant le rythme de la berakha juive73. Et dans sa vie intime, le Père engendre le Fils « en son sein » (Jn 1, 18) et le Fils, qui est « tout tourné vers Dieu » son Père (v. 2), y retourne dans l’Esprit.
Ainsi, tout être, tout événement vit de cette pulsation primordiale : sortir-revenir, non sans une surabondance. Or, comment les créatures retournent-elles au Principe dont elles ont jailli ? Par la gratitude, qui est autant louange qu’action de grâces74. Soit consciemment et intentionnellement par la louange humaine, soit inconsciemment par la louange des créatures, omniprésente dans l’Écriture – le psautier75 s’achève ainsi : « Que tout être vivant chante louange au Seigneur » (Ps 150, 6). Le père dominicain Jacques Fontaine, bien connu de tous ceux qui ont découvert la Bible sur le terrain (BST), en Israël, aimait répéter : « L’action de grâces est la clef de l’harmonie universelle. » Bénéficiaires passives du don de Dieu, les créatures reviennent activement au Donateur. Toute grâce qui vient de Dieu (cf. Jc 1, 17) est ainsi appelée à retourner vers Lui en action de grâces. Être eucharistique par excellence, le Fils qui a tout reçu du Père fait tout remonter vers Lui dans la jubilation (cf. Mt 11, 25-27) que suscite en son cœur l’Esprit Saint (cf. Lc 10, 21-22). Marie, première disciple de son Fils (cf. Mt 12, 46-50), reçoit le Verbe fait chair par la grâce de son Fiat et le redonne dans sa chair faite verbe par l’action de grâces de son Magnificat. Voilà pourquoi, au terme de l’Écriture, le Père se désigne comme « l’Alpha et l’Oméga » (Ap 1, 8 ; 21, 7 ; 22, 13)76. Encore une fois, la pulsation qui fait battre la création surgit du cœur même de la vie trinitaire dont le Père est la source et le terme77.
On comprend donc que, sans la gratitude, l’univers est amputé : manque le deuxième temps constitutif du rythme intégral de la création. « La louange est l’attitude fondamentale de l’homme devant Dieu78. » Comme un pont qui n’aurait qu’une arche, ou un cœur qui ne serait que diastole. Même si la Passion et la Résurrection nous obtiennent le salut, l’Ascension, par laquelle le Fils retourne à la droite du Père, achève nécessairement ce que l’on appelle si justement le cycle liturgique.
Telle est la lumière la plus radicale sur la gratitude. Si elle apporte un tel bénéfice, c’est qu’elle fait participer au dynamisme le plus profond qui résonne au cœur de l’être. Loin d’être autocentrée, elle introduit dans la communion des Personnes divines.
Un feu d’artifice de bienfaits
Une étude souvent citée résume tous les effets positifs de la gratitude qui furent égrenés : somatiques, psychiques, éthiques, relationnels et surnaturels79.
Plus de 200 sujets sont divisés en trois groupes. À chacun d’eux est confiée une tâche, à accomplir avec attention pendant une durée de trois semaines : le premier doit mettre par écrit tout ce qui est arrivé d’important pendant chaque journée, qu’il s’agisse des événements tristes ou des événements joyeux ; le deuxième enregistre seulement les événements déplaisants de chaque journée ; le troisième retient uniquement les bonnes nouvelles et élabore un « journal de la gratitude » (cf. chap. 15).
Les résultats ont dépassé les attentes. Les personnes du troisième groupe se sont considérablement enrichies à tous points de vue : sur le plan décisionnel, elles étaient plus enthousiastes, mieux disposées à agir et plus déterminées ; sur le plan affectif, elles étaient plus heureuses et détendues ; sur le plan physique, leur santé était meilleure ; sur le plan cognitif, leur pensée avait été stimulée et était devenue plus créative ; sur le plan psychologique, elles avaient une plus grande estime d’elles-mêmes ; sur le plan relationnel, elles avaient une beaucoup plus grande propension à aider l’autre ; sur le plan religieux, elles étaient mieux disposées à accomplir un chemin en ce domaine80.
Que celui qui craindrait que cette perspective ne pèche par naïveté se rassure : la vision si positive de la vie offerte par la gratitude n’est pas pour autant unilatéralement positivante, c’est-à-dire ne nie en rien les difficultés, parfois dramatiques, de l’existence, mais permet de les intégrer (cf. chap. 13 et 14).
À ces multiples avantages de la gratitude, ajoutons-en un qui n’apparaît que par comparaison : la reconnaissance est plus aisée et plus rapide à mettre en œuvre que d’autres attitudes positives porteuses de grands bienfaits, comme l’amour, la sollicitude et le pardon. En effet, la pratique de la gratitude change aussi promptement notre état intérieur et fait plus vite revenir la paix81.
L’œuvre la plus propre à Dieu, écrit Philon d’Alexandrie, c’est de répandre ses bienfaits, la plus propre à la création, c’est de se répandre en actions de grâces [eukharistein], puisqu’elle ne peut offrir en échange rien de plus que cela […]. Lui rendre grâce, employons-nous à cela sans cesse et en tout lieu82.
Illustration cinéma
Les Pépites, documentaire français de Xavier DE LAUZANNE, 2016. Avec Christian et Marie-France des Pallières.
Site : gratitude.pascalide.fr
Nom d’utilisateur : livre
Mot de passe : gratitude
CHAPITRE 2
Qu’est-ce que la gratitude ?
« La gratitude – mot admirable dont il me semble qu’on a rarement pénétré le sens profond1. »
La gratitude est la réponse à un bienfait. Telle est la définition spontanée, celle qu’évoque l’étymologie du préfixe de re-connaissance, celle que l’on trouve dans les différents dictionnaires2 et aussi chez les philosophes3. Toutefois, cette définition ne résout pas deux questions. Tout d’abord, à quoi s’identifie la gratitude : à la prise de conscience du bienfait, à l’émotion éprouvée en le recevant ou à l’acte de remerciement qu’appelle ce bienfait ? Ensuite, la reconnaissance est-elle gratuite ou obligatoire ? Par exemple, quand quelqu’un me rend gratuitement service, suis-je libre ou en dette à son égard ?
La gratitude, acte simple ou complexe ?
Certains voient dans la gratitude un acte, ou même une disposition à l’acte, c’est-à-dire une vertu. Il s’agit surtout des auteurs de l’Antiquité et du Moyen Âge. C’est ainsi que Cicéron va jusqu’à affirmer que, « de toutes les vertus, la gratitude est la plus grande, la mère de toutes les autres4 ». D’autres – surtout les philosophes modernes – l’identifient à une émotion. « La reconnaissance, écrit Descartes, est […] une espèce d’amour excitée en nous par quelque action de celui [qui] nous a fait quelque bien5. » D’autres, enfin – surtout les penseurs contemporains –, introduisent une troisième dimension en insistant sur la connaissance, ou plutôt sur la reconnaissance. C’est ce que fait Paul Ricœur dans son ultime ouvrage, Parcours de la reconnaissance, qui s’achève par la reconnaissance-gratitude6.
La gratitude apparaît donc, selon les auteurs et les époques, comme un acte (voire une vertu), une émotion ou une connaissance7. Comment trancher ? Mais, au fait, pourquoi trancher ?
Lucile a un an et demi. « Elle était assise à table et venait de faire tomber son doudou. Au moment de le lui redonner, elle s’exclama : “Merciiii !”, avec des yeux pétillants de joie et de bienveillance à l’égard du bienfaiteur qui avait ramassé son lapin. Par contraste, dans d’autres situations dans lesquelles elle éprouvait de la joie, elle ne disait pas merci ; par exemple, lorsqu’elle voyait arriver son frère ou l’une de ses sœurs, elle arborait un grand sourire, mais ne remerciait pas pour autant. Elle semblait donc avoir intégré le fait que “merci” exprimait la joie éprouvée lorsqu’on bénéficie d’un geste bienveillant8. »
Lucile pose un acte complet de gratitude : connaissance du bienfait (elle a « intégré le fait que “merci” exprimait la joie éprouvée lorsqu’on bénéficie d’un geste bienveillant ») ; émotion (« yeux pétillants de joie ») ; réponse active (« elle s’exclama : “Merciiii !” »). Repartons de notre définition de la reconnaissance comme réponse de l’homme à un don gratuit. Cette réponse est un acte, parole ou geste : en effet, elle implique une décision (le bénéficiaire peut ne rien dire ni ne rien faire en retour du don reçu). Or, cette réponse suppose que le bénéficiaire sache qu’il a reçu un don. Enfin, recevoir un don ne suffit pas ; il faut encore être touché par ce don. Rébecca Shankland commence ainsi son livre sur la reconnaissance : « La gratitude est une émotion agréable que l’on éprouve lorsqu’on reçoit une aide ou un don d’autrui et qu’il s’agit d’un geste intentionnel et désintéressé9. » De fait, les études de psychologie non seulement soulignent cette dimension émotionnelle, mais elles en font sa définition10. Toutefois, elles la corrèlent toujours, en amont, à la connaissance et, en aval, à l’action11, voire à la disposition à l’action12 – au point de parler de la gratitude comme d’une « émotion morale13 ». « La gratitude, écrit le psychiatre Christophe André, consiste à reconnaître le bien que l’on doit aux autres. Et plus encore, à se réjouir de ce que l’on doit, au lieu de chercher à l’oublier14. » Enfin, si l’acte devient habituel, il engendre une disposition stable qui incite à poser aisément cet acte. La morale appelle cette disposition une vertu15 : la vertu de gratitude.
La gratitude présente donc trois aspects : cognitif, affectif et actif16– voire un quatrième, vertueux. On peut rapporter ces trois aspects aux facultés de l’homme (intelligence, affectivité et volonté) ou à leur symbole corporel (tête, cœur, mains). Ils peuvent enfin être corrélés aux trois extases du temps : je suis touché maintenant ; je re-connais, c’est-à-dire je connais que le don est déjà là, donc est passé ; je me dispose à y répondre dans un futur acte de remerciement.
Enfin, ces trois aspects sont ordonnés et se succèdent. D’abord, tout sentiment se fonde sur une connaissance préalable. Nous ne nous mettrions pas en colère si nous n’étions pas témoin d’une injustice ; Roméo n’aimerait pas Juliette s’il ne la connaissait pas, au moins un peu. Ensuite, notre action se fonde souvent sur une émotion qui la porte. En colère, nous décidons d’intenter un procès ; amoureux, Roméo met tout en œuvre pour revoir sa bien-aimée. Il en est de même pour la gratitude : celui qui (re)connaît le don est touché et, touché, pose un don en retour.
Le tableau suivant résume nos analyses sur la nature de la gratitude :
Aspect cognitif
Aspect émotif
Aspect actif(voire vertueux)
Définition
La gratitude est la conscience (re-connaissance) du bienfait
La gratitude est le sentiment éprouvé en recevant le bienfait
La gratitude est la réponse au bienfait
Prévalence selon les époques
Époque contemporaine
Époque moderne
Époque antique et médiévale
Les facultésde l’homme en jeu
Le sens et l’intelligence
L’affectivité sensible
La volonté libre
Le symbole corporel
La tête (head)
Le cœur (heart)
La main (hand)
La relation au temps
Le passé
Le présent
L’avenir
Mais comment choisir ? C’est trop de trois définitions de la gratitude. Pour pouvoir répondre à cette question, il faut d’abord en affronter une autre : la reconnaissance est-elle un dû ou un don ?
La gratitude, acte gratuit ou obligatoire ?
Là de même, deux opinions s’opposent17. Certains lient la gratitude à une dette. C’est ainsi que Kant fait de la reconnaissance « un devoir » et « pas seulement une maxime de prudence ». En effet, « je suis leur obligé [les bienfaiteurs] à cause de la bienfaisance dont j’ai été l’objet18 ». D’autres, à l’opposé, fondent la gratitude sur la gratuité. Pour Vladimir Jankélévitch, « ma gratitude suit gratuitement et gracieusement (c’est-à-dire librement) votre offrande19 ».
La reconnaissance est-elle un acte libre ou nécessaire ? Ici, contrairement à ce qui précède, il faut trancher la question.
Il est clair que le bienfaiteur ne peut en rien exiger le « merci » de la part du bénéficiaire. Jusque dans sa sonorité, le terme gratitude évoque la gratuité ; gratitudo vient du latin gratia, « grâce », qui désigne notamment un don désintéressé (c’est ainsi qu’on parle de grâce présidentielle). Ensuite, tout le monde s’accorde pour affirmer que le bienfait qui suscite la gratitude n’est pas un dû ; comment la réponse le serait-elle ? Enfin, nous le verrons en détail, le sentiment de gratitude est d’autant plus grand et l’élan du remerciement d’autant plus puissant que le bienfait est perçu comme désintéressé. Si quelqu’un vous offre spontanément son aide pour remplacer une roue de votre voiture, vous êtes reconnaissant ; mais, si après son service, vous découvrez que votre sauveur attend que vous lui rendiez la pareille, subitement, votre gratitude s’affaisse, voire s’efface.
Toutefois, si le don offert est gratuit, pourquoi le bénéficiaire se sent-il obligé à rendre quelque chose ? Cette obligation de reconnaissance est telle que les philosophes, prêtant leur voix au sens commun, font de l’ingratitude un « vice hautement détestable20 » qui éveille l’indignation.
Si la gratitude est nécessaire, ne serait-ce pas qu’elle provient d’un dû ? Si je me sens obligé de dire merci ou de rendre l’invitation, ne serait-ce pas parce que j’ai contracté une dette en acceptant le don ? Cette opinion (erronée) bloque ensemble obligation (à agir) et devoir (imposé par une loi). Elle confond deux nécessités ou obligations : extérieure et intérieure. La dette est une obligation extérieure qui m’est imposée, ici par la nature du lien : si le prix affiché de la baguette est de 1,20 €, je dois régler cette somme pour en acheter une. Mais il y a des obligations intérieures que je m’impose. Or, dans la gratitude, nulle loi ni nul contrat ne me prescrit de dire « merci » à celui qui ramasse le portefeuille que j’ai étourdiment laissé tomber et nulle contravention ne sanctionnera mon éventuel (et impoli) mutisme. En revanche, c’est du dedans et même du plus intime que le bénéficiaire aspire à remercier. Nous ne nous sentons nullement contraints à répondre au sourire d’un inconnu qui passe par un autre sourire, et pourtant nous nous sentons appelés, enclins à le faire. Si quelqu’un nous tient la porte, nous sommes spontanément incités à la tenir à notre tour à celui qui nous suit. Là encore, rien d’obligé, mais nous sommes animés par un moteur bien plus puissant qu’une loi qui nous enjoindrait à rendre la pareille. C’est ce que montrent de passionnantes expérimentations (développées dans le prochain chapitre).
Ainsi, l’acte de retour qu’est la gratitude, s’il peut être ressenti avec la force d’une nécessité, demeure profondément libre. On peut s’aider d’un suggestif doublet : en français, obligé renvoie à deux mots différents : obligeance et obligation. L’obligation est contraignante, alors que l’obligeance est libre. La première est imposée du dehors et la seconde se propose du dedans. Ainsi, la gratitude nous oblige au sens de l’expression « noblesse oblige », mais non au sens où « la loi oblige » tout citoyen. De même que le bienfaiteur digne de ce nom se doit de ne pas faire peser une attente en retour du don, de même, le bénéficiaire se doit de l’en remercier. Sénèque formulait admirablement ce qu’il appelait le « devoir réciproque » de bienfaisance : « L’un doit oublier à l’instant ce qu’il a donné, l’autre n’oublier jamais ce qu’il a reçu21. »
La gratitude, un acte intégrateur
Nous sommes désormais à même de répondre à la question relative à la nature de la gratitude : est-elle cognition, émotion ou action ?
Nous venons de voir que la gratitude réside en son essence dans le retour du don qui surgit du cœur de l’homme ; or, ce retour est une action librement consentie ; donc, la gratitude est un acte, autrement dit, elle relève de la dimension active ou volitive. Certes, cette décision est adossée à la conscience du bienfait reçu (dimension cognitive) et à son retentissement affectif (dimension affective). En ce sens, notre étude de la reconnaissance se rapproche plus des conceptions antico-médiévales que des conceptions moderne et contemporaine. Pourtant, elle retient une leçon essentielle de ces dernières : si la psychologie insiste tant sur le sentiment de gratitude, c’est sans doute parce qu’elle décrit plutôt les mécanismes que les dynamismes (les actes de liberté)22 ; c’est aussi parce qu’elle a compris que le sentiment (affectus) se transforme en quelque sorte en action (effectus). Concrètement, c’est parce que je suis touché par le don gratuit que je suis à mon tour poussé à répondre par un don gratuit. Nous le comprendrons mieux au chapitre 11. On découvre ici une loi profonde, la pulsation même du don qui est celle de la vie : recevoir pour donner.
Dès lors, les trois dimensions de la gratitude ne se répartissent pas également comme les trois sommets d’un triangle, mais se distribuent asymétriquement en deux pôles : le pôle de la réception, avec les dimensions cognitive et affective ; le pôle de la donation, avec la dimension active – qui constitue le cœur de la gratitude.
La pulsation de la gratitude
Illustration cinéma
Le Seigneur des anneaux. 1. La Communauté de l’anneau, film fantastique américano-néo-zélandais de Peter JACKSON, 2003. Avec Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Liv Tyler.
Site : gratitude.pascalide.fr
Nom d’utilisateur : livre
Mot de passe : gratitude
CHAPITRE 3
La cascade du don
« La reconnaissance vous attire d’autres situations épanouissantes. Ce que vous envoyez revient vraiment1. »
La scène se déroule dans un restaurant de Philadelphie. Deux amis viennent de déjeuner. Au moment de payer l’addition, la serveuse leur annonce qu’un couple qui vient juste de sortir l’a déjà réglée. Stupéfaction des amis qui, touchés par ce témoignage de générosité, décident de faire de même pour d’autres clients d’une autre table. Lynn Willard, l’une des serveuses, témoigne de cette épidémie de générosité, les larmes aux yeux : « Cela a continué » pendant les cinq heures qui ont suivi. D’ailleurs, non seulement les personnes payaient pour d’autres, mais elles ne s’inquiétaient pas du prix et ajoutaient souvent un généreux pourboire2 !
Après avoir vu, en aval, les fruits de la gratitude (chap. 1) et ce qu’elle est (chap. 2), considérons, en amont, son origine. La personne qui éprouve de la gratitude se sent poussée à donner – et donner librement – à son tour à son bienfaiteur. Mais d’où provient cet élan ? Pour répondre à cette question, nous ferons appel au double regard des sciences et de la sagesse.
La gratitude accroît les comportements altruistes
La superbe histoire du restaurant de Philadelphie est loin d’être unique. Elle a même fait l’objet d’un film que nous analyserons au terme de ce chapitre. D’ailleurs, cette situation est aisément expérimentable : lorsque l’on entend cette histoire, on est souvent touché et on a même envie de faire de même ; et si déjà la parole éveille notre générosité, combien plus l’acte dont nous serions bénéficiaires ?
En réalité, les études sur la psychologie de la gratitude montrent autre chose, et c’est là peut-être leur apport le plus passionnant. Celle-ci ne suscite pas seulement un sentiment, ni seulement une réponse vers le donateur, mais elle accroît les comportements altruistes3.
La gratitude, écrit un chercheur de l’université Grenoble-Alpes, va plus loin que la simple réciprocité du geste, elle génère une émotion agréable qui nous donne envie à notre tour de venir en aide à d’autres, même des personnes qui ne nous ont rien apporté et que nous ne reverrons peut-être jamais4.
Qui n’a reçu un jour, dans sa boîte mail, un montage vidéo réjouissant qui enchaîne de somptueuses photos de la nature et délivre une leçon de vie enchanteresse sur fond de musique envoûtante… ? Il goûte avec ravissement cette pause inattendue autant que bienvenue jusqu’à ce qu’il tombe sur un insistant message final faisant pression pour que cette vidéo soit partagée – y ajoutant parfois que telle est la condition pour qu’elle porte du fruit. Soudain dégrisés, vous hésitez, entre culpabilité (surtout si vous avez pris sur votre temps de travail !) et colère d’avoir été manipulé.
Outre leur caractère inefficace, voire rédhibitoire (la culpabilité est le moteur affectivement le plus coûteux), ces injonctions à donner en retour sont surtout inutiles. Nous allons voir que le retour est une loi intérieure qui structure notre être (plus le don nous apparaît gratuit, plus nous sommes enclins à répondre gratuitement) ; la doubler d’une loi extérieure, c’est plutôt courir le risque d’annuler la première. L’on a ainsi remarqué que la plus sûre manière de démotiver un donneur de sang est de le rétribuer… C’est même vrai pour les petits enfants. Deux spécialistes du comportement prosocial – terme qu’utilise la psychologie sociale pour dire la générosité ou, plus encore, le don qui est un terme trop connoté religieusement – ont récompensé de manière aléatoire des enfants de vingt mois qui avaient un comportement généreux, puis ont étudié leurs comportements altruistes ultérieurs. Le résultat fut le suivant : l’enfant qui n’avait pas été récompensé continuait d’aider ; en revanche, celui qui avait été récompensé avait une attitude beaucoup moins prosociale5.
La gratitude dans l’épreuve
Nombreux sont ceux qui, ayant reçu de l’aide à la suite d’un traumatisme, aident à leur tour ceux qui en ont subi un. En effet, dans des situations dramatiques, les réactions d’aide sont beaucoup plus nombreuses qu’on ne s’y attend de prime abord. Dans une enquête auprès de survivants de la Shoah, 82 % d’entre eux ont dit avoir alors reçu (et donné) de l’aide6. De même, une étude sur 1 000 enfants juifs survivants de la Shoah et accueillis en Grande-Bretagne dans des familles montre que non seulement, ils menèrent en grand nombre des existences épanouies, mais qu’ils ont exercé la compassion envers autrui, et cela de façon systématique et pas seulement ponctuelle, s’impliquant dans différentes actions, créant des institutions d’aide, etc7. Toutefois, même si ces enfants aidés sont devenus des adultes aidants, l’étude ne conclut pas explicitement sur cette cascade du don.
D’autres études, elles, établissent la corrélation. Ervin Staub et Johanna Vollhardt ont proposé un inventaire des origines de l’altruisme quand il apparaît dans la souffrance. Or, ils ont constaté que plus une personne a été aidée dans son traumatisme, plus elle aidera à son tour8.De même, des enfants atteints de maladies graves sont plus altruistes que d’autres enfants en bonne santé9. Or, les auteurs d’une des enquêtes émettent l’hypothèse que ces enfants hospitalisés furent davantage en contact avec des soignants altruistes.
Les psychologues parlent alors d’« altruisme né de la souffrance10 ». N’est-ce pas un peu court ? Certes, ceux qui ont souffert souhaitent que l’autre ne subisse pas ce qu’ils ont subi. Par exemple, des victimes d’abus sont animées par ce souci constant : « Protéger les enfants de ce que j’ai subi moi-même durant mon enfance a été le moteur de mon combat contre l’utilisation d’enfants à des fins sexuelles11