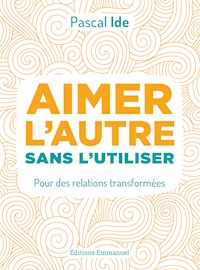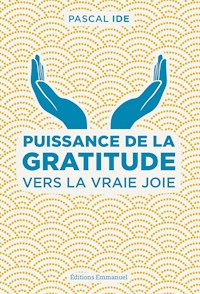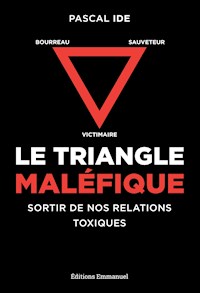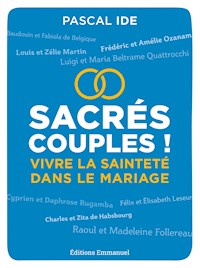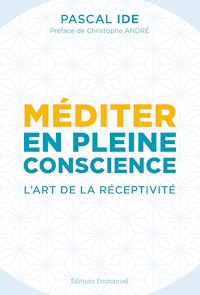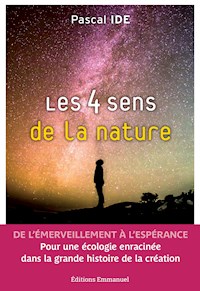
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions de l'Emmanuel
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Comme les Écritures, la nature est un « livre » où Dieu se révèle. Or, selon la Tradition, la Bible présente quatre sens : littéral, allégorique, moral et eschatologique, qui nous permettent de la recevoir dans sa plénitude. En transposant ces quatre grandes lectures à la nature, Pascal Ide élargit notre regard et nous apprend à la contempler dans toute son ampleur, afin d’y trouver notre juste place. Ni prédateur de la nature, ni simple hôte de la Terre, l’homme est appelé à reconnaître sa connexion avec toute la création et à s’inscrire dans la grande histoire qui la conduit à son accomplissement. Face à l’urgence écologique, un livre qui nous convoque à l’émerveillement, la compassion, la responsabilité et l’espérance.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Monseigneur
Pascal Ide est prêtre du diocèse de Paris depuis 1990 et membre de la communauté de l'Emmanuel. Actuellement, il est chef du service des Universités catholiques à la Congrégation pour l'Éducation catholique. Il est docteur en médecine, en philosophie et en théologie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 528
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pascal IDE
Les 4 sens de la nature
DE L’ÉMERVEILLEMENT À L’ESPÉRANCEPour une écologie enracinée dans la grande histoire de la création
Éditions Emmanuel
Conception couverture : © Christophe Roger
Photo couverture : © Unsplash.com
Composition : Soft Office (38)
© Éditions de l’Emmanuel, 2020
89, bd Auguste-Blanqui – 75013 Paris
www.editions-emmanuel.com
ISBN : 978-2-38389-762-9
Dépôt légal : 4e trimestre 2020
Introduction
« Il y a donc une mystique dans une feuille, dans un chemin, dans la rosée, dans le visage du pauvre1. »
« La doctrine du quadruple sens prend les Écritures comme une totalité symbolique, à travers laquelle la nature entière et l’histoire à venir aussi bien que passée peuvent devenir l’objet de la même herméneutique2. »
« J’ai aimé cette montagne [le mont Cervin], je l’ai aimée comme on peut aimer, non point une chose de roc et de glace, mais un être de chair et d’âme, et qui pense et qui sent et qui veut3. »
Vis-à-vis de la nature4, l’homme d’aujourd’hui, notamment quand il est chrétien, se sent parfois perdu : les pertes subies par notre environnement sont-elles irréversibles ? l’être humain est-il supérieur au vivant ou seulement différent de lui ? En affirmant : « Soumettez la terre » et « dominez sur […] tous les animaux » (Gn 1, 28), la Bible serait-elle coupable de cet anthropocentrisme qui a conduit à la catastrophe écologique actuelle ? Ce très tard venu sur la planète qui l’héberge avec une telle générosité peut-il prétendre l’utiliser à ses propres fins ?
Nous ne nous sentons pas seulement perdus, mais aussi tiraillés. D’un côté, nous comprenons bien qu’il faut en finir avec ce que certains osent appeler un « écocide5 » et le paradigme technocratique condamné par le pape François6. De l’autre, nous ne nous reconnaissons pas dans un écocentrisme radical.
Enfin, nous nous sentons souvent culpabilisés par un discours écologique envahissant et craignons que l’année Laudato sì n’ajoute à notre honte et à notre découragement. L’entrée dans l’écologie par la panique ou la culpabilisation n’est pas seulement coûteuse, elle est peu efficace. Nous sommes partagés entre un sens aigu de notre responsabilité et une impuissance pesante face à la mondialisation galopante et notre incapacité locale à recycler convenablement, entrer dans une sobriété joyeuse, prendre soin de notre propre corps, etc. tout en nous sentant tristes de l’état de notre planète et de notre santé. Et la récente pandémie de SARS-CoV-2 nous a rendus encore davantage nostalgiques des chants d’oiseau, d’une nature plus présente, d’un rythme ralenti, de relations plus proches, etc.
Comment y voir clair ? Quelle attitude adopter ?
« Avant d’agir, commence par réfléchir », dit le sage (cf. Lc 14, 28). Ce livre a pour intention de proposer non point des directives, mais une direction. Nous n’avons pas les compétences pour indiquer comment prendre soin de notre maison commune, individuellement, collectivement et institutionnellement. D’autres le font et le font bien – nous renverrons à leurs propositions. En revanche, nous souhaitons offrir une vision la plus large possible, afin d’inscrire les projets écologiques dans un projet écosophique7.
En effet, « la vérité est le tout », disait le philosophe Hegel8. Autrement dit, les erreurs sont souvent des vérités partielles absolutisées. Pour cela, nous allons proposer une grille de lecture inattendue : les quatre sens de l’Écriture. Notre hypothèse est la suivante : de même que l’Écriture présente quatre sens, de même la nature possède quatre sens. Et seule leur prise en compte intégrale offre une vision équilibrée de la nature.
La raison de ce parallèle, nous le verrons en détail, est que la nature, comme la Sainte Écriture, mais selon des lois différentes, raconte une histoire et une histoire qui présente une direction. Ce faisant, nous allons ainsi resituer l’histoire récente et chacune de nos histoires personnelles avec la nature, dans la grande histoire dont elles font partie. Et ainsi redonner du souffle en redonnant de la hauteur.
Après avoir exposé brièvement la doctrine des quatre sens de l’Écriture dans le premier chapitre, les trois parties l’appliqueront à la nature. Nous procéderons en trois moments résumés en trois mots : création,décréation,recréation. La première partie décrira en quoi consistent les quatre sens de la nature et comment ils dérivent de l’histoire. La deuxième partie s’interrogera sur les déformations de ces quatre sens aujourd’hui, ce qui donnera lieu à quatre paradigmes partiels et donc partiaux. La troisième et dernière partie proposera les attitudes pratiques qui découlent de cette vision intégrale et intégrative de la nature. Nous passerons ainsi de l’écosophie à l’écologie.
1. Pape FRANÇOIS, Lettre encyclique Laudato sì sur la sauvegarde de la maison commune, 24 mai 2015, n° 233.
2. Gaston FESSARD, La Dialectique des « Exercices spirituels » de saint Ignace de Loyola, t. III. Symbolisme et historicité, Paris, Lethielleux et Bruxelles, Culture et Vérité, 1984, p. 413.
3. Georges SONNIER, La Montagne et l’Homme, Paris, Fernand Lanore, coll. « Reflets de l’Histoire », 1990, p. 178.
4. J’entends nature au sens actuel qui la distingue de l’homme et correspond à la totalité des êtres matériels, terrestres et célestes.
5. « La situation peut être qualifiée d’écocide. L’humanité est en guerre avec la nature » (Ralph METZNER, Green Psychology, Rochester, Park Street Press, 1999, p. 42. Souligné dans le texte).
6. Cf. FRANÇOIS, Laudato sì, n° 106-114.
7. Le néologisme est inventé par le philosophe norvégien Arne Næss (qui parle d’« écosophie T », T étant l’initiale de Tvergastein, la cabane dans la montagne où il vécut et élabora ses idées un quart de sa vie) ; il est repris par Félix GUATTARI, Les Trois Écologies, Paris, Galilée, 1989, p. 70. Cf. ID., Qu’est-ce que l’écosophie ?, textes réunis et présentés par Stéphane Nadaud, Paris, Éd. Lignes, 2014. Nous ne l’entendons pas dans le même sens que celui, réactif, du fondateur de l’écologie profonde (cf. chap. 11).
8. Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, Phénoménologie de l’esprit, Préface, II, trad. Jean Hippolyte, coll. « Bibliothèque philosophique bilingue », Paris, Aubier, 1966, p. 53.
Chapitre 1
Les quatre sens de l’Écriture
« Les quatre sens de l’Écriture ne sont pas des significations particulières juxtaposées, mais précisément des dimensions d’une parole unique qui va bien au-delà de l’instant9. »
Le terme sens possède trois… sens principaux : signification (« Cette phrase n’a pas de sens »), direction (« La voiture s’engage dans un sens interdit ») et orientation (« Être élu maire a donné du sens à ma vie »). Dans l’expression « quatre sens de la nature » (et de l’Écriture), sens se dit de ce qui possède une signification, c’est-à-dire un contenu intelligible. Par exemple, dire « La cantatrice est chauve » a du sens, alors qu’affirmer « La cantatrice est un nombre impair » n’en a pas. Nous nous centrerons donc d’abord sur la première des trois acceptions. Mais la prise en compte de l’histoire, qui en est la raison d’être, invitera bientôt les deux autres : direction et orientation.
Le plus souvent, un texte ne veut dire qu’une seule chose. Cet article sur le vol d’un spationaute français vers la station ISS n’a qu’une seule signification : l’événement qu’il raconte. Parfois, un écrit présente deux sens. Quand nous lisons « La cigale et la fourmi », nous savons que, derrière l’histoire, Jean de La Fontaine propose une leçon de vie, celle que tire la morale de la fable.
La Bible (Ancien et Nouveau Testaments), elle, présente quatre sens : historique, allégorique, tropologique et anagogique. Si les deux premiers adjectifs sont connus, tel n’est pas le cas des deux autres. Surtout, cette doctrine a beau être très ancienne (sa première élaboration remonte au IIIe siècle) et avoir été rappelée récemment par le Magistère de l’Église, elle demeure encore largement méconnue de la grande majorité des chrétiens. Voilà pourquoi, sans entrer dans le détail10, nous allons brièvement l’exposer avant de l’appliquer – analogiquement – aux différents sens de la nature.
L’exemple du temple
L’exemple classique par excellence « qui comprend en quelque sorte en lui tous les autres par [son] ampleur » est Jérusalem. Celle-ci désigne « d’abord la cité historique des Juifs, puis l’Église, cité mystique, puis l’âme chrétienne, enfin la Jérusalem céleste ou l’Église triomphante11 ». Développons à partir d’une illustration très proche : le Temple12.
Le premier passage de l’Ancien Testament qui parle du temple (du vrai Dieu) est le suivant : « Samuel était couché dans le temple du Seigneur, où se trouvait l’arche de Dieu » (1 S 3, 3). Le terme « temple » renvoie alors à l’édifice matériel où se trouve l’arche qui, elle-même, contient les très précieuses Tables de la Loi données par Dieu à Moïse. Il s’agit du sens littéral ou historique.
Dans l’Évangile, quand Jésus dit : « Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai » (Jn 2, 19), il ne parle plus du temple de pierres, mais du temple qu’est son corps. D’ailleurs, le texte fait lui-même la distinction : « Les Juifs lui répliquèrent : “Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours tu le relèverais !” Mais lui parlait du sanctuaire de son corps » (v. 20 et 21). Les auditeurs de Jésus entendent les paroles de Jésus dans son sens littéral, alors qu’il s’exprime selon un autre sens dont nous allons dire qu’il est allégorique.
« Votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en vous » (1 Co 6, 19) écrit saint Paul aux Corinthiens pour les exhorter à fuir la débauche. Ici, il emploie le même vocable dans un sens encore différent : ce sanctuaire n’est plus seulement extérieur, qu’il soit matériel (premier sens) ou christique (deuxième sens), mais intérieur, en l’occurrence moral ou tropologique.
Enfin, le voyant de l’Apocalypse affirme que, dans la Jérusalem céleste, « son temple, c’est le Seigneur, le Dieu tout-puissant et l’Agneau » (Ap 21, 22). Il commence d’ailleurs en précisant : « Je ne vis pas de temple en elle [la cité céleste]. » Ainsi, ce dernier sens du terme « temple » n’est pas littéral ou historique. Il ne s’agit pas non plus du deuxième sens, christique, puisque le temple s’identifie non seulement à « l’Agneau », le Christ, mais aussi à Dieu (le Père) lui-même ; de plus, le texte parle non pas du présent ou du passé, mais de ce qui va arriver. Le substantif « temple » ne désigne pas enfin le sens moral, qui est intérieur à l’homme et actuel, puisqu’il parle de Dieu et de l’avenir. Nous sommes donc en présence d’un nouveau sens, qui est eschatologique ou anagogique.
Une première approche
La première partie du livre détaillera le contenu des quatre sens. Nous n’offrons donc ici qu’une première approche.
Le sens littéral
Comme tout écrit, quel qu’il soit, le texte de la Bible présente d’abord un sens littéral. Ce sens est premier, pas seulement parce que nous avons toujours besoin de commencer par un premier sens, mais parce qu’il est au fondement des trois autres sens qui ne peuvent pas s’en passer. Vous connaissez sans doute l’adage selon lequel, quand le sage montre la lune, le sot regarde le doigt. Il faudrait rajouter : le présomptueux (l’orgueilleux), lui, veut se passer du doigt. De même, nous ne pouvons parvenir aux autres sens qu’en passant humblement par la compréhension du sens littéral. Nous verrons les différentes tentations de le court-circuiter.
Par ailleurs, ce sens littéral est, le plus souvent, historique, c’est-à-dire renvoie à un événement s’inscrivant dans l’histoire des hommes et du cosmos. Aussi parle-t-on également d’un sens historique. Toutefois, de même que certaines lectures dévalorisent ce sens, d’autres le déforment en l’interprétant de manière historiciste, « littéraliste » ou fondamentaliste (p. 49 et 113). Tel est par exemple le cas si l’on affirme que, selon la Bible, la création s’est réellement déroulée en une semaine. C’est oublier que « Dieu, dans la Sainte Écriture, a parlé par des hommes, à la manière des hommes13 » et que celle-ci doit « être interprétée dans le même Esprit que celui dans lequel elle a été écrite14 », donc en prenant en compte les genres littéraires et le contexte.
Le sens allégorique
L’origine de cet adjectif remonte à un passage de la lettre que saint Paul a envoyée aux Galates dans les années 50 après Jésus-Christ :
Il est écrit [dans la Loi, c’est-à-dire dans l’Ancien Testament] qu’Abraham a eu deux fils, l’un né de la servante, et l’autre de la femme libre. Le fils de la servante a été engendré selon la chair ; celui de la femme libre l’a été en raison d’une promesse de Dieu. Elles sont allégoriques [allègorouména] : les deux femmes sont les deux Alliances. La première Alliance, celle du mont Sinaï, qui met au monde des enfants esclaves, c’est Agar, la servante. Agar est le mont Sinaï en Arabie, elle correspond à la Jérusalem actuelle, elle qui est esclave ainsi que ses enfants, tandis que la Jérusalem d’en haut est libre, et c’est elle, notre mère (Ga 4, 22-26).
Paul fait allusion à un épisode du livre de la Genèse où il est dit qu’Abraham eut deux fils : le premier, Ismaël, né de sa servante Agar, qui était égyptienne (cf. Gn 16 et 21) ; le second, Isaac, né de son épouse Sara, une femme libre. Peu importe ici le détail de leur destin. Pour l’Apôtre, cette histoire présente deux significations : la première, évidente et passée, celle des personnages qui ont vécu autrefois dans le Proche-Orient ; et une autre, cachée et présente, qui s’éclaire à la lumière de la venue du Christ : « les deux femmes représentent les deux Alliances », l’Ancienne entre Dieu et son peuple élu, la Nouvelle entre le Christ et la multitude des hommes. Or, ce deuxième sens, Paul le qualifie d’« allégorique ». La première signification est donc historique et la seconde, allégorique.
Aujourd’hui, l’allégorie désigne une figure de style qui parle d’une chose en en évoquant une autre présentant une ressemblance, plus ou moins vague. Le terme allégorie est en effet formé à partir du nom grec allon, « autre chose ». C’est ainsi que la rose « qui ce matin avait déclose » est l’allégorie de l’amour qui passe. Mais cette signification est étrangère à la nature de la rose et liée à l’inventivité de Ronsard. Ainsi, pour nous, l’allégorie renvoie à un sens plus ou moins arbitraire, surajouté par le narrateur.
Saint Paul accorde au terme allégorie une signification différente, plus proche du deuxième mot grec dont il provient, agoreuein. En effet, le nom agora désigne la place publique dans les cités grecques. Le verbe agoreuein signifie donc « parler en public ». Or, dans l’histoire de Sara et d’Agar, Sara représente la liberté et Agar la servitude. L’événement historique, qui présente un sens évident comme l’est une parole publique, parle aussi d’autre chose, qui n’a rien de fictif et d’arbitraire, mais est caché et sera un jour dévoilé, c’est-à-dire révélé. Donc, pour saint Paul, le sens allégorique est fondé non pas dans l’imagination du narrateur (l’écrivain biblique), mais dans la réalité elle-même.
Ce passage de l’épître aux Galates inaugure donc la distinction du sens littéral et du sens allégorique. Ce dernier sens est aussi qualifié de spirituel. En effet, saint Paul distingue la lettre et l’esprit : « La lettre tue, mais l’Esprit vivifie » (2 Co 3, 6).
Le sens tropologique
Après les deux premiers sens, littéral et allégorique, l’Écriture s’enrichit d’un troisième sens, le sens moral ou tropologique.
En effet, la Bible ne se présente pas comme un roman à énigme qui s’arrêterait quand le lecteur a déchiffré le sens allégorique caché derrière le sens littéral. Écrite « pour notre instruction » (1 Co 10, 11 ; cf. He 3-4, 11), elle invite aussi à agir. Par exemple, lorsque nous entendons Jésus dire à la femme adultère : « Va et ne pèche plus » (cf. Jn 8, 1-11), nous pouvons nous sentir nous aussi appelés à faire miséricorde sans nier la vérité sur la misère du péché. Quand Jésus exhorte ses disciples à aimer leurs ennemis (cf. Mt 5, 44) et à « pardonner du fond du cœur » (cf. Mt 18, 35), le lecteur se sait lui aussi convoqué à « faire de même » (Lc 10, 37). Ainsi, l’événement raconté ne présente pas seulement un sens historique, événementiel, mais contient aussi un enseignement éthique.
Jésus lui-même le suggère dans la scène du lavement des pieds. Après avoir accompli pour ses douze Apôtres ce geste qui était réservé aux esclaves, Jésus leur dit de manière solennelle : « C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous » (Jn 13, 15). Ainsi, pour un chrétien, agir, c’est prendre Jésus comme « exemple », s’approprier sa vie pour qu’elle devienne sienne. C’est conformer sa vie non pas d’abord à une loi extérieure, fût-ce le Décalogue (les dix commandements), mais à la « norme concrète » qu’est la vie de Jésus15. Chez les grands saints, comme saint François d’Assise, cette imitation est particulièrement frappante – au point que, dans l’église supérieure de la basilique où il est enterré, à Assise, le peintre Giotto a représenté sa vie sous forme d’une double fresque en parallèle où chaque épisode de la vie du Poverello correspond à un moment de la vie du Christ.
Voilà pourquoi ce troisième sens est appelé moral. On le dit aussi tropologique, du grec tropos, qui signifie notamment « manière » : ici, façon d’agir.
Le sens anagogique
Les sens de l’Écriture ne sont-ils pas épuisés ? En effet, les deux premiers sens scrutent le texte, en sa lettre (sens littéral) et en son esprit (sens allégorique), et le troisième l’applique à l’existence (sens moral). Or, contemplation et action forment un tout. La pulsation de la théorie et de la pratique rythme la vie.
Pourtant, la Bible comporte un quatrième sens. Tel est le cas du livre le plus mystérieux de la Bible, l’Apocalypse, qui traite symboliquement d’événements à venir, mais peut-être aussi déjà présents. C’est le cas d’un certain nombre de textes où, par exemple, Jésus parle du jugement dernier ou de la fin des temps (cf. Mt 24-25, etc.). Mais c’est surtout le cas de passages qui, pouvant être interprétés à partir des trois premiers sens, ne déploient toute leur richesse sémantique que dans un quatrième. Par exemple, la manne est, au sens littéral, la nourriture des Hébreux dans le désert (cf. Ex 16) ; au sens allégorique, l’Eucharistie comme sacrement (cf. Jn 6, 49) ; au sens moral, la nourriture spirituelle ; au sens anagogique, le « pain des anges » qu’est Jésus connu et aimé dans la gloire.
Ce quatrième sens est qualifié d’eschatologique (du grec eschata, « les choses dernières »), parce qu’il concerne notre avenir ultime. Il est aussi qualifié d’anagogique (du grec anagôgè, « élévation »), parce que le terme à venir nous élève vers la maison du Père éternel.
L’Écriture comme un tout
Comment comprendre la relation entre les quatre sens ? Sont-ils juxtaposés ou coordonnés ? L’ordre est-il indifférent ? Doit-on en privilégier un ? Peut-on se passer de l’un ou l’autre ?
Tout d’abord, les quatre sens forment un tout. En effet, il y a, « d’un sens à l’autre, dépendance nécessaire », écrit le cardinal de Lubac16. Autrement dit, l’on n’accède à la vérité totale de l’Écriture qu’en conjuguant les quatre sens qui y sont déposés. Nous verrons que l’on a souvent isolé un sens des quatre autres, déséquilibrant ainsi la compréhension de la Bible. Par exemple, une lecture seulement morale (comment l’Écriture éclaire-t-elle mon action ?) devient très vite moralisante.
Ensuite, le tout est ordonné : le sens littéral fonde les trois autres sens, dits spirituels. En effet, continue le théologien jésuite, « on doit toujours commencer par le rappel extérieur des faits » ; « le dogme repose sur des faits divins » ; « la morale à son tour est fondée sur le dogme » ; « la réalisation de la fin dernière suppose ce dogme vécu dans la morale ». Saint Jérôme emploie l’image de la maison ou de l’édifice : le sens historique montre les fondations, le sens allégorique les murs (le gros œuvre), le sens moral la décoration (aménagement intérieur) et le sens anagogique la toiture qui achève.
Enfin, cette totalité ordonnée n’est pas statique, comme pourrait le faire croire la métaphore du bâtiment, mais vitalement articulée en une « continuité dynamique ». Il faut encore préciser : « Les quatre sens ne se disposent pas en éventail : ils s’enchaînent en série continue. » En effet, les sens « s’engendrent vraiment l’un l’autre ». Les quatre sens sont donc animés par un « rythme unique » ou plutôt un « unique rythme », « dont l’histoire [le sens historique] marqu[e] le premier temps » et dont l’anagogie est « la synthèse finale ».
Les quatre sens : une histoire
Nous avons progressivement mis au jour quatre couches, toujours plus profondes. Qu’est-ce qui nous garantit que, en forant davantage, nous n’allons pas découvrir un cinquième sens, comme une cinquième couche de l’Écriture ? Répondre à cette question demande d’en affronter une autre : d’où proviennent ces différents sens ? Reprenons la métaphore des couches géologiques : sous le sens apparent qu’est le sens littéral sont présents, comme des strates cachées, trois sens spirituels. La métaphore mérite d’être filée : comme les sédiments se déposent peu à peu dans le temps, cette structure feuilletée est le résultat d’une histoire.
L’originalité de la Bible
La Bible présente une propriété remarquable souvent méconnue : elle est le seul texte sacré à se présenter majoritairement comme un récit ou plutôt une série de récits historiques. Environ trois quarts des textes qui la composent sont historiques. Précisément, ils racontent l’histoire du salut par laquelle Dieu à la fois sauve les hommes et se révèle à eux, « s’adress[ant] aux hommes […] comme à des amis17 ».
Certes, les récits bibliques n’ont pas la rigueur des histoires documentées dont nous avons aujourd’hui l’habitude18. Certes, quelques textes apparemment très réalistes (comme l’histoire de Jonas ou d’Esther) n’ont que peu de chances de correspondre à des événements réels. Mais que des textes doivent être interprétés, n’est-ce pas le statut de tout récit, même du document prétendument le plus objectif ? Pour autant, l’immense majorité des narrations de l’Ancien Testament, a fortiori du Nouveau Testament, renvoie à des événements historiquement datables. « L’Écriture, dans sa lettre – écrit Henri de Lubac –, nous livre d’abord des faits, elle nous raconte des choses qui se sont réellement passées. Elle n’est ni un exposé de doctrine abstraite, ni un recueil de mythes », ni un traité de morale, ni un manuel de prière. En effet, pour les chrétiens et pour les Juifs, « Dieu est intervenu dans l’histoire de l’humanité19 ». Dans un petit ouvrage très suggestif intitulé Les Bâtisseurs du temps, le rabbin américain Abraham Heschel affirme que la Bible se caractérise par la mise en place d’une architecture du temps : « l’espace est offert à notre volonté », donc à notre maîtrise, « mais le temps est pour nous hors d’atteinte, indépendant de notre pouvoir » car « il est à Dieu seul20 ».
En regard, les textes fondateurs des autres religions (par exemple le poème épique Mahabharata, le Tao Te King, les récits amérindiens, les traditions orales des peuples africains) sont des recueils de sagesse, des textes normatifs ou des mythes d’origine – autant de discours qui ne montrent pas la présence de l’Absolu dans l’histoire. Cette historicité est « pour tout observateur même incroyant, le caractère qui différencie peut-être le plus la Bible de tant d’autres Écritures sacrées21 ». Le spécialiste d’histoire des religions Mircea Eliade l’a bien noté : « La religion d’Israël n’a “inventé” aucun mythe », à la différence de nombreuses religions.
Le génie religieux d’Israël a transformé les rapports de Dieu avec le peuple élu en une « histoire sacrée » d’un type inconnu jusqu’alors. À partir d’un certain moment, cette « histoire sacrée », apparemment exclusivement « nationale », se révèle modèle exemplaire pour toute l’humanité22.
En accordant une place massive à l’histoire, la Bible introduit une seconde nouveauté : pour la première fois dans les cultures de l’humanité, la vision du temps passe d’une structure cyclique, sans commencement ni terme, à une structure linéaire. L’histoire quitte la fatale et désespérante répétition pour entrer dans un chemin toujours inattendu : « Voici que je fais toutes choses nouvelles » (Ap 21, 5). Cette linéarisation biblique du temps est souvent soulignée ; nous verrons toutefois plus loin qu’il faudra la nuancer.
Les quatre sens sur la ligne du temps
Appliquons cette double nouveauté à la doctrine des quatre sens. Ceux-ci se répartissent d’eux-mêmes sur la ligne du temps. En effet, le temps se distingue en passé, présent et avenir. Or, nous avons vu que le sens historique et le sens allégorique correspondaient respectivement aux événements de l’Ancien Testament et à ceux du Nouveau Testament, donc au passé. Le sens moral représente la mise en pratique des exemples et des commandements de Dieu et du Christ. Ainsi, en entendant la parabole du bon Samaritain qui est une figure du Christ, le fidèle se sent poussé à l’imiter et, en l’imitant, à être comme ses mains et son cœur. Donc, le sens moral actualise, c’est-à-dire à la fois accomplit et rend présents dans le temps de l’Église les deux premiers sens, historique et allégorique. Enfin, le sens eschatologique oriente vers ce qui est à venir – ou plutôt vers Celui qui vient. De fait, la toute dernière parole de la Bible est à la fois un cri et une prière implorant une venue : « Viens, Seigneur Jésus ! » (Ap 22, 20). Ainsi, les quatre sens se distribuent sur la ligne du temps et couvrent la totalité de l’histoire : passée – Ancien Testament (sens littéral) et Nouveau Testament (allégorique) –, présente ou temps de l’Église (sens moral) et à venir (sens anagogique).
Voilà pourquoi, de même que la Bible est le seul texte fondateur de religion trouvant sa source dans l’histoire, de même est-il le seul à posséder ces quatre sens23.
Visualisons ces correspondances en un tableau :
Le temps profane
Passé
Présent
Avenir
L’histoire sainte
Temps de l’Ancien Testament
Temps du Nouveau Testament
Temps de l’Église
Derniers temps
Quatre sens de l’Écriture
Sens historique
Sens allégorique
Sens tropologique
Sens anagogique
Cette présentation visuelle pourrait faire croire qu’il s’agit d’une simple correspondance terme à terme. Or, nous venons de voir que la relation va dans un sens : la succession des événements est la cause de la superposition des sens de la Bible. C’est parce que la traversée de la mer Rouge préfigure et prépare la mort et la résurrection du Christ, que le sens littéral (l’événement de la traversée) contient le sens allégorique (l’événement du mystère pascal)24. Il est donc nécessaire de compléter le tableau par le schéma suivant qui croise la ligne horizontale de l’histoire et la ligne verticale de la signification :
Il existe un lien entre ces deux lignes, horizontale et verticale. Si les textes bibliques ne présentent pas seulement un sens littéral, mais aussi un sens plus profond, caché, qu’est le sens allégorique, c’est parce que le temps passé lui-même prépare secrètement le temps qui vient.
Une histoire sainte
La polysémie de l’Écriture est la sédimentation d’une histoire. Mais il faut dire plus. En effet, les événements ne font pas que se succéder. De même, ce ne sont pas les auteurs de la Bible ou la communauté des fidèles qui, en relisant cette histoire, ont trouvé des corrélations riches de sens. Pour le comprendre, approfondissons ce que nous avons dit du sens allégorique.
Pour le poète, l’allégorie est le fruit de sa créativité et seulement d’elle. Il n’est pas inscrit dans l’essence de l’ébène de signifier la noirceur de la chevelure ou d’une caverne d’exprimer l’emprisonnement des hommes dans l’illusion25. L’allégorie biblique, elle, se fonde non pas sur l’imagination de l’auteur sacré, mais sur la réalité, à savoir l’histoire sainte : l’événement passé prépare et préfigure un événement à venir. Pour reprendre un exemple déjà cité, l’histoire d’Abraham, de Sara et d’Agar renvoie à l’histoire du Christ qui libère l’homme. Plus généralement, le double sens, littéral et allégorique, de l’Écriture se fonde donc sur le double sens, réel, des événements qu’elle raconte. Et ce qui est vrai des deux premiers sens l’est tout autant des deux autres : le sens moral et le sens eschatologique. Ils correspondent, eux aussi, à des événements réels : le troisième à l’actualisation de l’Écriture dans le cœur du fidèle, et le quatrième à la venue glorieuse du Sauveur.
Ce constat capital pose deux questions : comment un événement passé peut-il préfigurer un événement à venir ? ; pourquoi Dieu veut-il que certains événements en préfigurent d’autres ? Il suscite aussi trois objections : quel est le sens allégorique du Nouveau Testament ? ; les quatre sens sont-ils toujours présents dans l’Ancien Testament ? ; pourquoi, si importante hier, la notion des quatre sens de l’Écriture a-t-elle disparu aujourd’hui26 ?
Les quatre sens : une lumière
Résumons. Les sens de l’Écriture proviennent de l’histoire qu’elle raconte : ils sont simultanément présents parce qu’ils le sont successivement dans l’histoire. Ensuite, cette histoire contient cette richesse d’événements et de sens parce qu’elle est conduite par Dieu, donc parce qu’elle est sainte. De plus, cette histoire est aussi sainte parce qu’elle conduit à Dieu : ce terme est promis par Dieu et Dieu tient toujours ses promesses. Enfin, cette histoire possède un centre qui est un cœur : le Christ.
Les quatre sens de l’Écriture ne seraient pas aussi pénétrants s’ils ne rentraient pas en résonance avec d’autres quatuors concernant les questions fondamentales sur l’homme, les facultés de l’homme, l’être, le don, l’union de l’homme à Dieu, le Christ, le Dieu trinitaire… Nous en détaillerons un seul qui nous sera particulièrement précieux27.
Derrière les quatre sens de l’Écriture, nous rencontrons ce que les penseurs médiévaux ont appelé les transcendantaux. Dans l’histoire de la philosophie, quatre se sont particulièrement détachés : l’un, le vrai, le bien et le beau. Les transcendantaux se définissent comme des propriétés de l’être, donc ont la même amplitude que lui28. C’est ainsi que, sous un certain angle, toute réalité est une, vraie, bonne et belle. De même qu’une vision complète de l’être requiert tous les transcendantaux, de même une compréhension adéquate de l’Écriture demande de les embrasser tous. Précisément, chacun des quatre sens honore l’un des transcendantaux : le sens littéral, la beauté ; le sens allégorique, la vérité ; le sens tropologique, le bien ; le sens eschatologique, l’unité29.
Conclusion
Un dominicain danois, Augustin de Dacie (mort en 1282), est devenu fameux pour avoir résumé les quatre sens en un distique versifié :
La lettre enseigne les événements, l’allégorie, ce que tu as à croire,
le [sens] moral ce que tu dois faire, l’anagogie ce à quoi tu aspires30.
Rassemblons en un tableau les principales conclusions :
Les quatre sens de l’Écriture
Sens littéral
Sens allégorique
Sens tropologique ou moral
Sens anagogique ou eschatologique
Définition
Les événements historiques à reconnaître
Le sens christologique à croire
Le sens pratique à accomplir
Le sens ultime à espérer
Exemple du Temple
Le temple mosaïque qui est à Jérusalem
Le temple christique qu’est le corps de Jésus
Le temple mystique qu’est le cœur du croyant
Le temple eschatologique qu’est la Jérusalem céleste
Histoire sainte
Le temps de l’Ancien Testament
Le temps du Nouveau Testament
Le temps de l’Église
La fin des temps et l’éternité
Les transcendantaux
Le beau
Le vrai
Le bien
L’unité
La doctrine des quatre sens est d’une telle richesse qu’elle déborde le seul cadre de l’Écriture et peut éclairer d’autres réalités31. De fait, certains, et non des moindres – les jésuites théologiens et philosophes Gaston Fessard (1897-1978)32 et Albert Chapelle (1929-2003) –, l’ont étendue à l’homme33. Nous sommes désormais prêts à l’appliquer à la nature.
9. Joseph RATZINGER-BENOÎT XVI, Jésus de Nazareth, 1. Du baptême dans le Jourdain à la Transfiguration, trad. Dieter Hornig, Marie-Ange Roy et Dominique Tassel, Paris, Flammarion, 2007, Avant-propos, p. 16.
10. La bibliographie dans les notes et sur le site pascalide.fr donnera des pistes d’approfondissement.
11. Henri DE LUBAC, « Sur un vieux distique. La doctrine du “quadruple sens” », in Mélanges offerts au R.P. Ferdinand Cavallera, Toulouse, Bibliothèque de l’Institut catholique de Toulouse, 1948, p. 347-366 : Théologies d’occasion, Paris, Aubier, 1984, p. 117-136, ici p. 124.
12. Cf. Jean DANIÉLOU, Le Signe du Temple ou de la présence de Dieu, Paris, Gallimard, coll. « Catholique », 1942 ; Yves-Marie CONGAR, Le Mystère du Temple ou l’Économie de la présence de Dieu à sa créature de la Genèse à l’Apocalypse, Paris, Cerf, coll. « Lectio divina » n° 22, 21963. Cf. pascalide.fr : « Le Temple de Dieu. L’évolution des significations à la lumière du don ».
13. CONCILE ŒCUMÉNIQUE VATICAN II, Constitution dogmatique Dei Verbum sur la Révélation divine, 18 novembre 1965, n° 12, § 1.
14. BENOÎT XVI, Exhortation apostolique post-synodale Verbum Domini sur la Parole de Dieu dans la vie et dans la mission de l’Église, 30 septembre 2010, n° 34, § 1.
15. Cette expression est de Hans Urs VON BALTHASAR, « La morale chrétienne et ses normes (1974) », in Commission théologique internationale, Textes et documents (1969-1985), Paris, Cerf, 1988, p. 85-135, ici Thèse 1 « Le Christ comme norme concrète », p. 90-92.
16. Pour cette citation et celles qui suivent : Henri DE LUBAC, « Sur un vieux distique », art. cit., p. 125-127.
17. CONCILE ŒCUMÉNIQUE VATICAN II, Dei Verbum, n° 2.
18. Cf., par exemple, Mario LIVERANI, La Bible et l’invention de l’histoire, trad. Viviane Dutaut, Paris, Gallimard, coll. « Folio Histoire » n° 178, 2008.
19. Henri DE LUBAC, « Sur un vieux distique », art. cit., p. 122.
20. Abraham HESCHEL, Les Bâtisseurs du temps, Paris, Minuit, coll. « Aleph », 1957, p. 201. « La sainteté du temps vint d’abord, puis la sainteté de l’homme, et enfin seulement la sainteté de l’espace » (ibid., p. 108).
21. Henri DE LUBAC, « Sur un vieux distique », art. cit., p. 132.
22. Mircea ELIADE, Histoire des croyances et des idées religieuses, 1. De l’âge de la pierre aux mystères d’Éleusis, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque historique », 1976, p. 183-184.
23. En fait, l’on trouve une thématisation des quatre sens dans la lecture rabbinique de la Bible. Cf. pascalide.fr : « Annexe 1. Les quatre sens de l’exégèse juive ».
24. En termes techniques, la distinction synchronique, c’est-à-dire structurelle, se fonde sur une distinction diachronique, c’est-à-dire historique.
25. Cf. PLATON, République, VII, 514 a-521 b.
26. Cf. pascalide.fr : Annexes 2 à 6.
27. Cf. pascalide.fr : « Annexe 7. Les quatre sens en relation avec différents quaternaires ».
28. Cf. Pascal IDE, Introduction à la métaphysique, I. Vers les sommets, Paris, Mame, coll. « Les cahiers de l’École cathédrale » n° 8, 1994, chap. 2. Pour une approche nouvelle, ici mobilisée, cf. pascalide.fr : « Annexe 8. Une autre interprétation des transcendantaux ».
29. Pour la justification de cette corrélation, cf. pascalide.fr : « Annexe 9. Transcendantaux et sens de l’Écriture ».
30. « Littera gesta docet, quid credas allegoria, / Moralis quid agas, quo tendas anagogia » (AUGUSTIN DE DACIE, Rotulus pugillaris, I, éd. Angelus Walz, Angelicum, 6 [1929], p. 256). Henri de Lubac traduit : « La lettre instruit des faits qui se sont déroulés, / L’allégorie apprend ce que l’on a à croire, / Le sens moral apprend ce que l’on a à faire, / L’anagogie apprend ce vers quoi il faut tendre » (Exégèse médiévale. Les quatre sens de l’Écriture, 1re partie, t. I, Paris, Aubier, 1959, p. 23).
31. Cf., par exemple, Pascal IDE, « Pourquoi aimons-nous les séries télévisées ? Une exégèse selon les quatre sens de l’Écriture », Nouvelle revue théologique, 142 (2020), n° 3, p. 437-455.
32. Cf. Gaston FESSARD, Symbolisme et historicité, op. cit., p. 397-410 et 414-417.
33. Cf. Albert CHAPELLE, Herméneutique, Bruxelles, Lessius, coll. « Institut d’études théologiques de Bruxelles » n° 21, 2010, p. 109-122 ; À l’école de la théologie, Paris/Namur, Lessius, coll. « Institut d’études théologiques de Bruxelles » n° 22, 2013, p. 63-98. Pour un développement philosophique sans mention explicite des quatre sens, cf. ID., Symbole, langage et corps, Syllabus, IET, 1971-1972, p. 76-81.
Première partie
Création
« Maurice CLOCHE. – Mais Monsieur, le monde est ce qu’il est. Monsieur l’abbé VINCENT DE PAUL. – Monsieur, le monde est comme on le fait34. »
La nature est une fête des sens ! Chacun de nous fait l’expérience que la nature est riche de plusieurs significations. Tous, nous avons contemplé un jour, bouche bée, le soleil se coucher « dans son sang qui se fige » ou feuilleté, extasié, un ouvrage sur les papillons. Tous, en visitant un zoo, nous avons regardé avec intérêt ces grands singes dont les comportements sont à la fois si proches et pourtant si différents de ceux de l’homme. Tous, nous avons retenu le geste de jeter un papier en forêt et procédons au tri sélectif. Tous, nous nous sommes interrogés sur le sort de notre planète, sur ce que la Terre deviendra, quitte pour certains à opter pour le climato-scepticisme. Même un prix Nobel de médecine spécialiste des membranes cellulaires s’arrête pour s’émerveiller d’une chaîne de montagnes couronnées de neige, sans se demander comment mettre cet émerveillement en équations.
Ces différents sens sont-ils en nombre infini ? Sinon, quels sont-ils ? Comment les organiser ? Pour répondre à ces questions, nous allons nous aider d’une puissante analogie entre la nature et l’Écriture. Elle joue de deux manières : comme l’Écriture, la nature est un livre (chap. 2) ; comme l’Écriture, la nature est une histoire (chap. 3). Et ces deux manières sont ordonnées : la première se fonde sur la seconde.
Or, le premier chapitre a établi que l’Écriture possède quatre sens. Nous allons donc voir comment ces quatre sens se déploient au sein de la nature (chap. 4 à 7).
Ajoutons que le parallèle entre les quatre sens de l’Écriture et les quatre sens de la nature est une pédagogie précieuse pour le chrétien, mais elle n’est pas indispensable à notre propos. Il est en effet possible de comprendre l’articulation dynamique des quatre sens de la nature à partir d’autres quaternaires comme le beau, le vrai, le bien et l’un. En revanche, sans les yeux de la foi, est-il possible d’adhérer à la lecture historique de la nature qui va être proposée ? Ce sera au lecteur de le dire.
34. Monsieur Vincent, biopic français de Maurice CLOCHE, 1947 ; avec Pierre Fresnay et Aimé Clariond.
Chapitre 2
La nature, un livre
« Lorsque l’homme est ainsi conçu comme un grand prêtre officiant dans le très noble temple de la nature, sa fonction essentielle est alors de prêter sa propre voix à une création qui autrement resterait muette, d’aider chaque chose à confesser […] son essence, car chacune d’entre elles est une parole, alors que seul l’homme peut la dire35. »
En tapant sur le moteur de recherche Google « Livre de la nature » (en attaché), ce 13 juin 2020, j’ai presque instantanément obtenu plus de 23 millions de réponses et plus de 26 millions avec « Book of Nature »36. L’expression est tellement courante qu’elle est devenue amnésique de son origine37, pourtant riche de sens.
La nature comme un livre
C’est avec le christianisme qu’apparaît la métaphore selon laquelle Dieu parle à l’homme à travers un double livre : le livre de l’Écriture (la Bible), bien sûr, mais aussi le livre de la nature38. En effet, le cosmos est théophanique, c’est-à-dire, étymologiquement, le lieu d’apparition ou de manifestation de Dieu39. « L’image de la nature comme un livre trouve ses racines dans le christianisme », disait Benoît XVI à l’Académie pontificale des sciences : « C’est un livre dont nous lisons l’histoire, l’évolution, “l’écriture”40. »
Cette métaphore du livre est suggérée par la Bible : « Ce qu’il [Dieu] a d’invisible depuis la création du monde se laisse voir à l’intelligence, à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité » (Rm 1, 20). Elle traverse toute la tradition chrétienne depuis l’Antiquité41, en passant par le Moyen Âge, où elle est développée de manière systématique par Hugues de Saint-Victor42, puis saint Bonaventure43, jusqu’à l’époque actuelle44. « Jésus a daigné m’instruire de ce mystère, écrit sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. Il a mis devant mes yeux le livre de la nature45. »
On la retrouve aujourd’hui, sécularisée, par exemple, sous la plume d’André Gide :
À nos pieds, comme un livre ouvert, incliné sur le pupitre de la montagne, la grande prairie verte et diaprée, et dont les mots distincts sont des fleurs […] que les vaches viennent épeler avec leurs cloches, et où les anges viennent lire, puisque vous dites que les yeux des hommes sont clos. Au bas du livre, je vois un grand fleuve de lait fumeux […]46.
L’analogie
Soulignons un mot que nous avons employé et que nous utiliserons souvent par la suite : analogie, en l’occurrence, l’analogie entre la nature et l’Écriture. Dans le langage courant, l’analogie évoque une vague similitude. En utilisant ce terme, qui a une longue et riche histoire47, nous l’employons dans un sens précis et précieux. Nous voulons souligner notamment trois points.
Le premier est d’ordre logique. L’analogie est l’instrument qui me permet de distinguer les différents sens d’un mot. Reprenons l’exemple canonique. Je peux dire : « Une personne est saine (en bonne santé) » ; et aussi « ses urines sont saines » (parce qu’elles ont un juste taux de sucre). Or, bien évidemment, cette unique épithète ne qualifie pas le sujet de la même manière. Dans le premier cas, la santé est une propriété de la personne, donc est une caractéristique interne de celle-ci ; dans le second cas, la santé est attribuée à l’urine seulement comme à un signe, celle-ci n’est pas saine en elle-même. Ainsi, l’analogie exprime un dosage entre du même et du différent, et permet de classer les sens en sens propre (ou premier) et sens figuré (ou dérivé). D’ailleurs, les mots sont analogues non point parce qu’ils sont flous, mais parce qu’ils ont une histoire et donc évoluent en leur signification.
Ainsi, lorsque nous disons de la Bible qu’elle est un livre, nous le disons au sens propre – ainsi que l’étymologie l’exprime (« livre » se traduit biblos en grec). En revanche, c’est seulement dans un sens analogique (figuré) que l’on a attribué ce terme de « livre » à la nature : comme un écrit, elle est remplie de signes intelligibles qui proviennent d’un auteur et qu’un lecteur doit déchiffrer (voilà pour la part du même) ; en revanche, contrairement à un livre, la nature n’est pas un artefact que l’on feuillette, avec une couverture, etc. (voilà pour la part du différent).
Le deuxième est d’ordre ontologique, c’est-à-dire réel. Ici, ce n’est plus seulement les sens d’un mot qui sont analogues, c’est-à-dire à la fois semblables et dissemblables, mais les réalités signifiées par le mot. Par exemple, le théologien peut dire de Dieu qu’il est père : comme le père biologique, humain, il donne la vie à un fils (voilà pour le même) ; mais à l’inverse du père créé, il exerce sa paternité hors des conditions matérielles et sexuées, il communique la totalité de son être, etc. L’analogie est alors un instrument précieux, parce qu’elle permet de passer d’un ordre de réalité à un autre, ici de la création à Dieu même. Sans l’analogie, nous ne pourrions rien dire de Dieu. Nous ne saurions rien de lui, même pas qu’il existe. L’analogie avance ainsi entre deux erreurs opposées : trop de similitudes conduit à la confusion48 ; trop de dissemblances conduit à la séparation.
Nature et Écriture sont aussi (et plus encore) analogues en ce sens réel. En effet, elles sont semblables en ce qu’elles sont toutes deux des dons de Dieu, des réalités pleines de sens (d’intelligibilité), composées de multiples parties comme un livre, etc. Mais elles sont aussi très différentes. La nature se propose à nos cinq sens, notre intelligence, notre liberté pour être admirée, explorée, employée, etc. L’Écriture, quant à elle, dépasse nos capacités naturelles (et, en ce sens, est surnaturelle), parce qu’elle nous révèle Dieu que « nul n’a jamais vu » (Jn 1, 18).
Ne pas assez souligner la différence entre nature et Écriture, c’est sombrer dans l’erreur panthéiste. Aujourd’hui, l’expression « Nouvel Âge » (devenue un sobriquet dont on accuse l’autre, mais dont on n’aime pas s’entendre affubler) renvoie à ce monisme49 qui brouille les frontières entre Dieu, la nature et l’homme. Trop souligner la différence, en revanche, c’est tomber dans l’erreur déiste50 qui a pointé le nez avec Descartes et qui est malheureusement devenue monnaie courante chez tant de chrétiens : en créant le monde, Dieu donne la chiquenaude initiale, puis s’en désintéresse, pour se polariser sur le seul salut des hommes. Pascal posait déjà un jugement lucide sur ce minimalisme théologique il y a quatre siècles :
Je ne puis pardonner à Descartes : il aurait bien voulu, dans toute sa philosophie, se pouvoir passer de Dieu ; mais il n’a pu s’empêcher de lui faire donner une chiquenaude pour mettre le monde en mouvement ; après cela, il n’a plus que faire de Dieu51.
D’ailleurs, le panthéisme est une réaction à cet éloignement déiste (dont on accuse à tort le christianisme qui est un théisme et non un déisme), de même que, au XIXe siècle, le romantisme réagissait contre le « Dieu horloger » de Voltaire qui avait régné au siècle des « Lumières ».
La troisième remarque est d’ordre dynamique. Les différents sens ne sont pas seulement juxtaposés, mais dessinent un chemin52. Le préfixe grec ana renvoie notamment à une montée.
Or, la nature est une voie qui conduit à son auteur. En ce sens, pour l’homme de la Bible (comme du Coran, d’ailleurs), la nature apparaît comme une création, c’est-à-dire comme l’œuvre d’un Créateur. Selon un adjectif cher à l’Orient, le cosmos est théophanique (du grec Théos, « Dieu », et phanein, « apparaître »). D’ailleurs, ce terme analogie est tellement important qu’on le trouve dans l’un des deux passages de la Bible où il est dit que, sans la lumière de la foi, l’homme peut connaître l’existence de Dieu et certaines de ses propriétés. Nous avons cité le premier ci-dessus (cf. Rm 1, 19-21). Voici un extrait du second : « À travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler, par analogie, leur Auteur » (Sg 13, 5. Cf. v. 1-9). En effet, en contemplant les créatures, dans leurs perfections et leurs imperfections, la raison humaine peut remonter au Créateur comme à sa cause première. Or, précise le livre de la Sagesse, cette remontée s’opère « par analogie ».
Il était nécessaire d’insister sur ce point essentiel. Aujourd’hui, en effet, nous sommes profondément influencés par les sciences, qui n’emploient que des mots univoques, c’est-à-dire des mots possédant un seul sens, au nom de la rigueur scientifique. Nous croyons donc que l’exactitude est synonyme d’univocité et que l’analogie est synonyme de flou, voire d’erreur. Mais cette exigence ne vaut que pour le domaine des disciplines scientifiques, pour deux raisons : elles emploient une méthode, empirique et formelle, qui requiert qu’à chaque réalité corresponde un mot (une nouvelle espèce d’oiseau doit être désignée par un nouveau mot) ; elles se limitent à un domaine très spécialisé du réel (l’ornithologie s’intéresse seulement aux oiseaux et à leur écosystème).
Mais d’autres disciplines, comme la philosophie et la théologie, ont besoin de l’analogie, pour deux raisons symétriques. D’abord, elles emploient souvent le langage commun dont on a vu qu’il s’inscrit dans une histoire riche de sens et donc qu’il évolue. Ensuite, elles mettent en relation des réalités d’ordre différent : la philosophie fait des allers-retours entre le monde (extérieur) et l’esprit (intérieur) ; la théologie, entre Dieu et la création.
Les quatre sens du livre de la nature
Puisque la nature et l’Écriture sont les deux livres par lesquels Dieu s’exprime, comment ne pas songer à appliquer la doctrine des quatre sens, qui vaut pour l’Écriture, à la nature ? Telle est l’intuition qui guide cet ouvrage. Mais d’autres ne l’ont-ils pas tenté avant nous ? Nous n’avons rencontré qu’une tentative chez ce grand admirateur de la nature qu’est Hugues de Saint-Victor. Le théologien saxon, croisé plus haut dans ce chapitre, rapproche les deux livres divins, celui de la création (la nature) et celui du salut (la Bible), et affirme que le sens littéral de la création intéresse le physicien, le sens allégorique, c’est-à-dire spéculatif, le théologien et le sens tropologique, c’est-à-dire éthique, le maître spirituel53. Toutefois, la correspondance demeure partielle (il manque le quatrième sens) et seulement théologique (le sens allégorique est rattaché à Dieu). Surtout, elle n’est pas expliquée.
Les tentatives d’établir un parallèle entre les quatre sens de l’Écriture et ceux de la nature sont quasi inexistantes pour une raison profonde. En effet, le premier chapitre a montré que, avant de s’étager de manière synchronique, des fondations jusqu’au toit, les quatre sens de l’Écriture se distinguent de manière historique de l’Ancien Testament (donc de la création) jusqu’à la fin des temps. Or, au Moyen Âge, la vision de la nature était encore anhistorique, et elle l’est demeurée jusqu’au XIXe siècle. Voilà pourquoi personne à notre connaissance n’a songé à appliquer de manière systématique et élaborée la doctrine des quatre sens à la nature. Il fallait attendre que celle-ci se déploie comme un grand récit pour que l’hypothèse d’un quadruple sens de la nature puisse apparaître. C’est ce que montrera le prochain chapitre.
L’analogie entre les quatre sens de l’Écriture et les quatre sens de la nature
Appliquons ce que nous avons dit de l’analogie à la thèse centrale de cet ouvrage : les quatre sens de la nature. Nous pouvons désormais la préciser. Nous ne parlons de quatre sens de la nature qu’en un sens analogue. De même que l’on dit de la nature et de l’Écriture qu’elles sont un livre seulement de manière analogique.
Ainsi, nous ne posons surtout pas une identité entre les quatre sens de la nature et les quatre sens de l’Écriture, mais une similitude et dissimilitude que, chaque fois, il nous faudra indiquer. Pour le comprendre, il nous faudra détailler en quoi consiste, selon nous, le deuxième sens de la nature, qui est l’équivalent (l’analogue !) du sens allégorique de l’Écriture.
Conclusion
Comme l’Écriture, la nature est un livre et donc, analogiquement, comporte quatre sens. Toutefois, si, ponctuellement, l’on a pu tenter une application des quatre sens de l’Écriture à la nature ou plutôt à la création, l’entreprise n’a jamais été conduite systématiquement. Il fallait que l’on découvre que ce livre de la nature est aussi, et plus encore, un livre d’histoire.
35. Étienne GILSON, L’Unité de l’expérience philosophique. La tentative médiévale, Paris, Petrus a Stella, 2016, p. 48.
36. Pour le détail, cf. pascalide.fr : « Annexe 10. L’expression “Livre de la nature” ».
37. Ainsi, en donnant comme sous-titre Le livre de la nature à un ouvrage sur Lucrèce, Henry FLEURY fait à son insu un anachronisme (En relisant Lucrèce. Le livre de la nature et la physique moderne, Paris, E. Larose, 1927).
38. Cf. Olaf PEDERSEN, The Book of Nature, Notre Dame (Indiana), The University of Notre Dame Press, 1992. Pour une première approche, cf. l’entrée « Book of nature » de l’encyclopédie en ligne Wikipédia (il n’y a pas l’entrée en français).
39. Cf. Bertrand SOUCHARD et Fabien REVOL (dir.), Controverses sur la création : science, philosophie, théologie, Actes du colloque de la chaire science et religion, à l’Institut catholique de Lyon, 9-11 avril 2015, Paris, Vrin, Lyon, Institut interdisciplinaire d’études épistémologiques, coll. « Science – Histoire – Philosophie », 2016. Je profite de l’occasion pour préciser que, même si l’article que j’y ai commis (« Les quatre sens de la nature », p. 349-398) porte le même nom que ce livre, celui-ci n’en est pas seulement une amplification, mais présente des modifications très notables.
40. BENOÎT XVI, Discours aux participants de l’assemblée plénière de l’Académie pontificale des sciences, 31 octobre 2008.
41. Par exemple chez S. AUGUSTIN (cf. Enarrationes in Psalmos, 45, 7, PL 36, 518).
42. Cf. Dominique POIREL, Livre de la nature et débat trinitaire au xiie siècle. Le « De tribus diebus » de Hugues de Saint-Victor, Turnhout, Brepols, coll. « Bibliotheca Victorina » n° 14, 2002 ; Constant J. MEWS, « The World as Text. The Bible and the Book of Nature in Twelfth Century Theology », in Thomas J. HEFFERNAN et Thomas E. BURMAN (dir.), Scripture and Pluralism. Reading the Bible in the Religiously Plural Worlds of the Middle Ages and Renaissance, Leiden-Boston, Brill, coll. « Studies in the History of Christian Traditions » n° 123, 2005, p. 95-122.
43. Pour le Docteur séraphique, la création est un livre transparent de Dieu. Elle en est une parole : « Toute créature est parole de Dieu » (S. BONAVENTURE, Commentarius in Ecclesiasten, chap. 1, in Opera omnia, Firenze, éd. Quaracchi, t. VI, 1893, p. 16). Elle est aussi une échelle : « Dans l’état présent de notre nature, l’universalité des choses est une échelle pour monter à Dieu » (S. BONAVENTURE, Itinerarium mentis in Deum, chap. 1, n° 2 : Itinéraire de l’esprit vers Dieu, trad. Henry Duméry, Paris, Vrin, coll. « Bibliothèque des textes philosophiques », 1960, 41981, p. 27). Elle est même un sacrement : la création est « un immense sacrement » de Dieu (Jacques Guy BOUGEROL, Introduction à saint Bonaventure, Paris, Vrin, 1988, p. 29). Cf. Olivier BOULNOIS, « La théologie symbolique face à la théologie comme science », in Lire le monde au Moyen Âge : signe, symbole et corporéité, Actes du colloque des 8 et 9 janvier 2009, Institut catholique de Paris, Faculté de philosophie, Revue des sciences philosophiques et théologiques, 95 (2011), p. 211-250, ici p. 234-238 ; Laure SOLIGNAC, « De la théologie symbolique comme bon usage du sensible chez saint Bonaventure », ibid., p. 413-428.
44. Sans rien dire du Magistère (cf. VATICAN I, Dz 3004-3026 ; JEAN-PAUL II, Lettre encyclique Fides et ratio sur les rapports entre la foi et la raison, 14 septembre 1998, n° 22 ; BENOÎT XVI, Verbum Domini, n° 7).
45. Ste THÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS ET DE LA SAINTE-FACE, Ms A, 2 v°, in Œuvres complètes (Textes et dernières paroles), éd. Conrad de Meester, Paris, Cerf/DDB, 1992, p. 72.
46. André GIDE, La Symphonie pastorale, Paris, Gallimard, 1919, coll. « Folio » n° 18, 1972, p. 93.
47. Sur cette histoire, cf., par exemple, Jean-François COURTINE, Inventio analogiæ. Métaphysique et ontothéologie, Paris, Vrin, coll. « Problèmes & controverses », 2006. Pour plus de détail, cf. le développement sur notre site pascalide.fr : « Analogie. Une longue et riche histoire ».
48. Ce que, en termes techniques, l’on appelle, respectivement, l’univocisme (absolutisation de l’univocité) et l’équivocisme (absolutisation de l’équivocité).
49. De monos, « seul » (racine que l’on retrouve dans le terme moine, celui qui est seul face à Dieu), le monisme désigne la doctrine selon laquelle tout est un, toute distinction entre les êtres est illusion.
50. Cf. Jacques FORGET, art. « Déisme », Dictionnaire de théologie catholique, Paris, Letouzey & Ané, 1920, vol. 4, col. 232-243. Sur le déisme anglais, cf. Charles CONSTANTIN, art. « Christianisme rationnel », Ibid., vol. 2, Paris, Letouzey & Ané, 1910, col. 2415-2417.
51. Blaise PASCAL, Pensées, éd. Brunschvicg, n° 77 ; éd. Lafuma, n° 1001.
52. Sur ce sens, ignoré de et refusé par l’acception classique du terme analogie, cf. Pascal IDE, « L’analogie selon Balthasar. Une relecture à partir de l’amour de don », Science et Esprit, 66/1 (2014), p. 85-108. Une illustration majeure est : Erich PRZYWARA, Analogia entis, trad. Philibert Secretan, Paris, PUF, coll. « Théologiques », 1990.
53. Cf. Dominique POIREL, « Les statuts de l’image chez Hugues de Saint-Victor », Chôra. Revue d’études anciennes et médiévales, philosophie, théologie, sciences, 3-4 (2005-2006) : Image et représentation dans la philosophie ancienne, numéro double dédié au professeur Jean Jolivet pour le doctorat honoris causa de l’université Babes-Bolyai (Cluj), p. 117-137.
Chapitre 3
La nature, une histoire
« La philosophie de la nature repose désormais sur le principe que tout doit être compris comme le fruit d’une histoire. La notion de genésis, sous la forme francisée de genèse, s’impose en tout domaine : cosmogenèse, biogenèse et anthropogenèse54. »
Aujourd’hui, une grande nouveauté dans notre regard sur la nature permet d’oser ce parallèle audacieux entre les quatre sens de l’Écriture et les quatre sens de la nature : aujourd’hui, la nature s’inscrit dans une histoire ; plus encore, elle est une histoire.
Un constat grammatical mérite l’attention : nature et Écriture sont construits à partir d’un même suffixe -ture qui renvoie au participe futur. En fait, le français ne connaît que le participe présent (« chantant ») et le participe passé (« chanté »). Mais le latin possède un participe futur (« qui chantera », en quelque sorte), signalé par ce suffixe -turus ; d’ailleurs, le terme futur lui-même est construit à partir de cette modalité temporelle du participe. Ainsi, les vocables nature et Écriture incluent implicitement une histoire ouvrant sur un avenir.
Voyons en général en quoi la nature est une histoire, avant d’en proposer trois récits et d’ouvrir, dans les chapitres suivants, à une autre compréhension de celle-là.