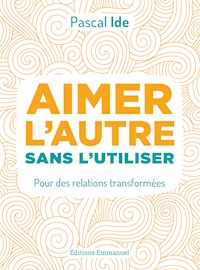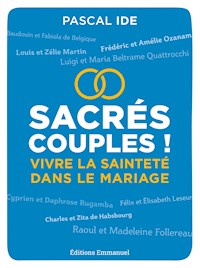Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions de l'Emmanuel
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Französisch
Les chercheurs ont montré que cette maladie moderne touche particulièrement les personnes généreuses (soignants, éducateurs, prêtres, etc.) Est-ce dire que pour éviter le burn-out, il faudrait renoncer à aider les autres ?
À PROPOS DE L'AUTEUR
Monseigneur Pascal Ide est prêtre du diocèse de Paris depuis 1990 et membre de la communauté de l'Emmanuel. Actuellement, il est chef du service des Universités catholiques à la Congrégation pour l'Éducation catholique. Il est docteur en médecine, en philosophie et en théologie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pascal IDE
LE BURN-OUT, UNE MALADIE DU DON
Le comprendre, le reconnaître, le traiter
Conception couverture : © Christophe Roger
Composition : Soft Office (38)
© Éditions Quasar, 201589, bd Auguste-Blanqui – 75013 Pariswww.editionsquasar.com
© Éditions Emmanuel, 2015www.editions-emmanuel.com
ISBN : 978-2-36969-034-4
Dépôt légal : 4e trimestre 2015
Table des matières
Introduction
1.Brève histoire du burn-out
1 •La découverte
2 •La systématisation
3 •L’approfondissement
2.Qu’est-ce que le burn-out ?
1 •Le mot
2 • La définition
L’épuisement émotionnel
La dépersonnalisation
La diminution de l’accomplissement personnel
3 • Les moyens diagnostiques
4 • Les signes
Manifestations émotionnelles
Manifestations cognitives
Manifestations somatiques
Manifestations motivationnelles
Manifestations comportementales
5 • Les sujets à risque
6 • Les formes
7 • Les étapes
8 • Ressemblance et différence entre BO, stress, fatigue chronique et dépression
Le stress
La fatigue chronique
La dépression
3.Le burn-out, une maladie du don
1 • Des explications partielles
2 • Notre hypothèse
3 • Arguments en faveur de l’hypothèse
Les sujets atteints
Les motivations initiales
Le manque de reconnaissance
Le paradoxe du BO
Le modèle de la conservation des ressources
Un modèle théologique : l’acédie
Un modèle théologique : le BO
4.Le don, une valse
1 • L’amour comme don
Deux exemples et trois images
Du don reçu au don de soi
La phrase la plus importante du concile Vatican II
2 • Le BO, une maladie du don
3 • Deux autres enjeux
Sortir du modèle mécanique
Sortir de la suspicion à l’égard du don de soi
4 • Une hypothèse qui reste à valider
5.Traiter le burn-out
1 • Remèdes personnels et institutionnels
2 • Remèdes préventifs et curatifs
3 • « Remèdes » somatiques, psychologiques, éthiques et spirituels
6.Reconnaître le burn-out pour le prévenir
1 • Une enquête exemplaire
Les signes
Les causes
Conséquences thérapeutiques
2 • Le prêtre, un sujet particulièrement exposé au BO
Encore quelques études
Quelques explications
Des symptômes spécifiques ?
Même les « saints » ne sont pas immunisés contre le BO…
3 • À l’écoute de l’Écriture
L’acédie voilée de David
Un enseignement du Christ
Un exemple du Christ
4 • À l’écoute de soi
Connaître le BO
Reconnaître le BO
Décider
7.Apprendre à recevoir
1 • Recevoir
Recevoir avant de donner
Recevoir pour donner
2 • Consentir à ses limites
3 • Prendre soin de soi
4 • Prendre soin de son sommeil
Le sommeil, un don (à respecter)
Le sommeil : un abandon
Une prière
5 • Se détendre
L’eutrapélie, une vertu oubliée
Le rythme ternaire de la vie
Les trois repos essentiels
6 • Prendre soin de son alimentation
7 • Faire un peu de sport
a) Pourquoi ?
b) Comment ?
8.Apprendre à s’approprier
1 • Du tonneau des Danaïdes à l’arche de Noé
2 • Faire mémoire
3 • Pratiquer la reconnaissance
Le bénéfice de la reconnaissance
La pratique de la reconnaissance
4 • Intégrer l’échec
5 • Nourrir l’estime de soi
9.Réapprendre à donner
1 • Donner à nouveau
La tentation
La lutte
2 • Veiller à la pureté du don
Quelques signes du don impur
Quelques formes du don impur
3 • Combattre la tristesse spirituelle
La tristesse de l’acédie
La tristesse jalouse
4 • Aimer
Se donner avec prudence
Se donner avec discernement
Se donner avec confiance
5 • Réformer l’institution
6 • Mystérieuse fécondité d’une crise
Conclusion
Bibliographie
Notes
Du même auteur
Introduction
« L’âme qui brûle d’amour ne fatigue ni ne se fatigue1. »
Pour commencer, voici trois histoires de burn-out qui ont été anonymisées et partiellement maquillées.
Dominique, médecin, raconte :
Ma première « baisse de régime » arriva après un voyage et fut taxée par un psychiatre de « petite déprime ». Je me retrouvai, au seuil de l’automne, sans voix au milieu d’un coup de téléphone. Je ne pouvais plus répondre… J’avais passé ma thèse de médecine fin juin, achèvement de longues années d’étude et d’internat, et avais eu envie de vivre un peu. Le voyage avait été fatigant bien sûr mais passionnant. Ont suivi six mois inattendus : ayant eu un arrêt de travail de trois semaines par mon médecin généraliste, j’ai scrupuleusement adressé aux quatre hôpitaux où j’étais vacataire les papiers administratifs nécessaires. Le résultat a été ma disparition de l’ordinateur et donc deux semaines non rémunérées… C’est à cet instant, je crois, qu’une petite phrase s’est inscrite très profondément dans mon cerveau : « Tu es médecin et tu n’as pas le droit de t’arrêter, tu dois tenir… Ils ne te feront aucun cadeau. » Ce message m’avait déjà obsédée lors des lendemains de garde de réanimation, lorsqu’il fallait rester debout et travailler après seulement trois heures de sommeil. J’avais un jour dit à un de mes chefs que j’étais fatiguée après un week-end entier de garde, et il m’avait rétorqué : « Tu n’es vraiment pas résistante ! » J’avais avalé ! Désormais, je tenais sans broncher, me disant que la médecine était exigeante.
Les mois suivants, je suis devenue raisonnable et ne suis sortie aucun soir afin de dormir et récupérer. J’expérimentais à 27 ans une vie monacale, ce que je n’avais pas vraiment prévu. Malgré cela, j’ai eu un accident de voiture, alors que je faisais des remplacements en ville pour des raisons pécuniaires. J’ai alors découvert que j’avais 8,5 de tension. Gagner sa vie après dix ans d’études et de formation n’était pas si simple…
Quelques années plus tard, je me suis installée et, après avoir mûrement réfléchi, j’ai débuté une activité libérale organisée en société civile professionnelle. Ayant été dûment sollicitée par deux médecins de ma spécialité et ayant étudié très précisément le contrat, j’ai décidé de leur faire confiance. À cette époque, il fallait acheter des parts et je dus emprunter. Quelque temps plus tard, je réalisai avec angoisse que mes associés ne respectaient pas notre contrat commun, ce qui m’a occasionné des pertes d’argent et a nécessité que je fasse appel à un avocat. Puis trois deuils familiaux m’ont affectée la même année. J’ai décidé de quitter l’association, alors qu’il me restait encore des emprunts bancaires et que je n’avais aucune aide financière. Impossible donc de faire un break pour tourner la page, alors que je venais de vivre plusieurs années avec deux semaines de vacances annuelles et un week-end sur trois d’astreinte. J’étais lasse, lasse. Mais la petite voix s’est de nouveau fait entendre : « Tu es médecin et tu n’as pas le droit de t’arrêter, tu dois tenir… Et puis que sais-tu faire d’autre ? Rien ! ». C’est aussi à ce moment que je lus pour la première fois la description du tableau clinique sur le burn-out. Je me suis reconnue, tout en me demandant si je ne présentais pas un fond dépressif.
J’ai repris une activité hospitalière et ce fut une autre aventure, la découverte plus profonde des dysfonctionnements, des luttes de pouvoir et des fragilités mises à nu par le rythme quotidien, la pression administrative, financière, celle des patients et des collègues, les décompensations psychologiques des uns et des autres. Je cherchais de l’aide, des explications, mais trouvais plutôt le déni et la toute-puissance. Après quelques années enthousiasmantes malgré tout, face à de nouveaux projets, lucide et ayant décidé de m’accrocher à l’espérance, trouvant même le temps de me mettre au piano, ce dont je rêvais depuis longtemps, j’ai ressenti une fatigue de plus en plus intense, accompagnée de troubles du sommeil et de cauchemars. J’étais au bord du suicide. Différentes lectures et rencontres m’ont faire prendre conscience que j’étais sous l’emprise d’une personnalité narcissique avec qui j’avais des patients en commun. Le médecin généraliste qui me suivait et connaissait aussi par expérience ce type de situation m’a conseillé de partir en courant de mon lieu de travail et m’a arrêtée, ce que je souhaitais de tout mon cœur. À distance de l’hôpital j’allais de mieux en mieux. J’ai été protégée durant quelques semaines par des soignants bienveillants et compréhensifs. Ce fut une trêve dont je savourais chaque instant.
Je repris mon travail quelque temps plus tard, la personne malveillante partie ; le cœur y était et je reprenais espoir, me réinvestissant de nouveau. Mais la configuration hospitalière fut encore maintes fois bousculée avec des changements répétés de cadres infirmiers et de médecins du travail, des audits, un plan social, des difficultés administratives, un budget déficitaire et opaque. Charge de travail aidant, le mal est revenu encore plus sournoisement et les symptômes se sont manifestés insidieusement : douleurs musculaires, maux de tête, difficultés à monter les étages, essoufflement, ulcères gastriques, fracture de fatigue, zona, pensées négatives, réveils nocturnes, arthrite du poignet gauche rendant la pratique du piano impossible. J’avais beaucoup de satisfaction sur le terrain, mais aucun soutien réel ! La petite phrase revenait : « Tu es médecin et tu n’as pas le droit de t’arrêter, tu dois tenir ! » Le doute s’insinuait sur mes capacités, mes compétences et le sens même de mes actions.
C’est alors que l’événement décisif est arrivé. Je rentrais chez moi d’une garde éreintante, j’étais à mobylette. Mon dernier souvenir est qu’au feu rouge, tout a valsé. Je me suis réveillée à l’hôpital, sous perfusion. Quinze jours. Bonne à rien. Tenir ma petite cuillère pour manger un yaourt était un effort presque insurmontable. C’est un psychiatre spécialiste, demandé par le médecin, qui a prononcé le mot : « Burn-out ». Mais il a ajouté : « Un vrai ! Pas un pré burn-out, comme c’est souvent le cas. Mais cette réaction de survie de l’organisme qui vous sauve malgré vous, en se débranchant pour conserver l’ultime réserve avant que tout ne s’éteigne pour toujours. » Ces paroles auraient pu m’atterrer. Mais je sentais qu’elles étaient justes. De plus, ce psychiatre a pris le temps d’écouter mon histoire. Par cette écoute bienveillante, j’ai pris conscience qu’une deuxième petite phrase me susurrait depuis plusieurs mois : « Si tu continues sur ce rythme, tu n’iras pas jusqu’à ta retraite, tu mourras avant ! » Or, il se trouvait que ce psychologue était aussi psychothérapeute.
En sortant de l’hôpital, j’ai enfin décidé de prendre du temps et de réfléchir. Et, pour cela, de commencer une psychothérapie afin de nommer ce qui se passait en moi et passer mon histoire au peigne fin. Je découvris ainsi, non sans résistance, que, si la personnalité narcissique m’avait manipulée, j’avais aussi laissé prise à sa manipulation. J’ai compris que, au-delà de ce système qui me laminait, j’avais une liberté, donc que j’avais aussi ma part de responsabilité. Je vis également que les critiques justifiées de l’institution hospitalière, voire médicale, légitimaient une attitude victimaire de ma part. Je me suis demandé pourquoi j’étais restée si longtemps dans ce fonctionnement qui ne convenait pas à mon équilibre de vie. J’ai compris que celui-ci était premier, que je ne devais plus subir et courber l’échine. Il m’appartenait d’en prendre définitivement conscience et de tordre le cou à cette petite phrase si culpabilisante : « Tu es médecin et tu n’as pas le droit de t’arrêter, tu dois tenir ! » En finir avec les fausses croyances et m’ouvrir à la vie. J’ai repris le piano, à quatre mains, avec un professeur charmant, de surcroît célibataire, comme moi… Je suis maintenant en chemin…
Bruno, ordonné prêtre il y a trois ans dans un diocèse du Nord de la France, confie :
« J’ai été nommé vicaire dans une paroisse. Je m’entendais bien avec mon curé qui est un homme relationnel et entreprenant. Toutefois, assez vite, je me suis rendu compte qu’il prenait beaucoup d’initiatives sans me prévenir. Notamment, il avait mis en place des réunions de secteur, à raison de deux par semaine, où je devais participer, sans qu’il me demande mon avis ni même me prévienne. Lorsque je lui en ai parlé, il m’a dit dit qu’il ne m’avait pas prévenu parce qu’il n’arrivait jamais à me joindre… Une incompréhension a commencé à s’installer entre nous, lourde de non-dits et de frustrations croissantes.
« Je suis un homme particulièrement actif. Avant d’entrer au Séminaire, j’occupais des fonctions importantes dans l’entreprise où je travaillais. J’aime bien dire que me reposer, c’est changer d’activité. De fait, j’ai passé mes deux derniers mois d’été entre deux camps scouts, une session à Lisieux où je n’ai pas cessé d’accueillir et de confesser, un pèlerinage de célibataires entre Le Puy-en-Velay et Conques, etc. J’ai roulé quatre mille kilomètres en août. Bref, je n’ai pris que trois jours de vrai repos en famille.
« J’ai entamé ce mois de septembre avec une fatigue qui m’a étonné. Je mangeais beaucoup plus que d’habitude et, malgré le régime jockey imposé par le camp scout, j’ai pris dix kilos ces trois derniers mois. De plus, alors que j’ai besoin de dormir beaucoup, je suis actuellement en déprivation régulière de sommeil à cause d’une multiplication de réunions. J’ai cherché à ralentir le rythme, me coucher plus tôt, mais maintenant je ne trouve plus le sommeil.
« Ce qui m’a encore davantage surpris, lors de la rentrée, c’est que je n’avais plus l’élan que j’avais lors de la première année de mon ministère. J’avais perdu le feu sacré. Pour le retrouver, il n’y avait qu’un seul moyen, confirmé par mon père spirituel que je vois très épisodiquement : moins me regarder et me donner deux fois plus.
« J’ai même commencé à douter de faire un travail vraiment fécond. La prière ne me ressourçait plus. Une amertume vis-à-vis de mon curé me rongeait ; elle s’est même étendue au vicaire général qui est en charge du secteur et qui n’a pas pris de mes nouvelles depuis trois ans.
« Puis, ce fut l’accident de voiture, avec fracture-tassement d’une vertèbre dorsale, heureusement sans déplacement ».
C’est alors que je rencontre Bruno. Il me fait, désemparé, le récit que je viens de résumer. Une fois qu’il a terminé son histoire, je lui demande : « Le burn-out, tu as déjà entendu parler ? »
Isabelle, vierge consacrée, travaille à plein temps dans une paroisse au sein d’une grande ville depuis cinq ans. Dynamique, elle est appréciée de tous. Elle aide autant pour la catéchèse que pour les funérailles ou les finances (elle a une formation de comptable). Voici son récit :
En septembre, retour de super vacances (un beau voyage en Terre sainte), j’ai de nombreux petits pépins de santé (angines, rhinopharyngites, problèmes digestifs). Mon médecin me parle alors de dépression cachée, ce qui me fait rire, car je suis en super forme mentale avec un métier qui me passionne, de nouvelles responsabilités dans la paroisse, ce qui m’exalte, une vie de prière régulière et beaucoup de sorties sympa avec des amis…
Les mois qui suivent, je suis de plus en plus fatiguée tout en gardant cet excellent moral. Tout me fatigue, y compris les choses les plus anodines, comme faire des courses au Monoprix situé en dessous de mon studio.
À ma visite annuelle chez le médecin du travail en février, je parle à celui-ci du diagnostic de dépression cachée, ce qui le surprend, car il n’en voit pas le motif. Il me conseille alors de prendre quelques vitamines et de voir si cela passe après une semaine de repos. De retour de cette semaine de repos, je reviens aussi lasse qu’avant, si ce n’est plus.
Je me remets dans ma mission pastorale. Toutefois, tout est difficile, et notamment les choses que je faisais avant avec enthousiasme me paraissent insurmontables. Je me dis qu’il y a des enjeux, donc qu’il s’agit d’un combat spirituel.
Il arrive un moment où me retrouver pour déjeuner avec les responsables de la catéchèse ou les membres du conseil économique me fatigue, et je me réfugie dans mon bureau. Je m’irrite facilement pour des broutilles et, alors que je suis habituellement si maîtresse de moi-même, je me sens très fragile émotionnellement. Mon état de fatigue commence à vraiment me déprimer. De plus, je dors de plus en plus mal, me réveille à l’aube. Je n’ai plus aucun appétit. Si je suis ravie de maigrir si facilement, je m’étonne de ne plus trouver goût à la nourriture.
Puis, le premier lundi d’avril, alors que je dois préparer mes dossiers pour le conseil pastoral qui a lieu ce soir-là, je me rends compte que j’en suis incapable, alors que, normalement, je le fais facilement. Je n’arrive plus à me servir de mon ordinateur, j’ai l’impression que mon cerveau patine, que je ne peux plus réfléchir et que même un simple copier/coller devient une affaire d’État.
Je prends rendez-vous avec le médecin le lendemain et il pose son diagnostic de burn-out.
Le burn-out (BO) – pour faire bref et incomplet, l’épuisement professionnel – touche aujourd’hui un pourcentage impressionnant de la population active en Occident. Le 22 janvier 2014, le cabinet Technologia a réalisé un sondage auprès d’un échantillon représentatif de 1 000 actifs. L’enquête a révélé que 12,6 % d’entre eux – soit plus de 3,2 millions de travailleurs en France – encourent le risque d’un BO2. Objet d’une attention soutenue des sciences sociales depuis quarante ans (plus de dix mille études lui ont été consacrées3 !), le sujet est maintenant suffisamment sensible pour faire régulièrement la couverture de grands hebdomadaires4 et susciter un intérêt encore balbutiant mais réel de la part des institutions.
Le coût personnel du BO est considérable. Un BO diagnostiqué comme tel (à distinguer du pré-BO, avec lequel il est souvent confondu) conduit le plus souvent à un arrêt professionnel allant de plusieurs mois à plusieurs années. De plus, la moitié seulement des personnes retrouvent leur ancien travail, du fait de la souffrance mentale sévère, de la lourdeur des prises en charge et de la longue durée du traitement5. Or, le BO est encore peu reconnu. En droit, il peut être aujourd’hui diagnostiqué comme une maladie, au titre de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale. Mais, pour cela, il faut qu’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles admette qu’il engendre une incapacité permanente de travail de plus de 25 % et qu’il est en lien « direct et essentiel » avec l’activité professionnelle. Dans les faits, seuls quelques dizaines de cas sont reconnus chaque année en France6.
Le coût social est tout aussi sévère. Déjà dans les années 2000, on estimait que le stress professionnel en Europe coûtait annuellement 265 milliards d’euros7 et que plus de la moitié des journées de travail perdues étaient dues aux tensions professionnelles8. Or, nous le verrons, le stress chronique est une cause nécessaire (quoique non suffisante) du BO.
Ce livre présente trois originalités.
D’abord, il propose une grille de lecture inédite du BO, celle qu’énonce le titre : il serait une pathologie du don. Les chapitres 3 et 4 le montreront en détail. Par exemple, les personnes généreuses et à haut idéal qui s’engagent dans une profession d’aide (helping professions, disent les anglophones), comme les enseignants ou les soignants, ou une activité humanitaire, sont des candidats particulièrement prédisposés au BO.
Ensuite, là où trop d’ouvrages s’attachent plus à comprendre le BO qu’à le soigner, ce livre propose des remèdes, et des remèdes originaux, qu’il détaille longuement. Faire du BO une maladie de l’amour-don conduira à proposer des traitements spécifiques (chapitres 5 à 9).
Enfin, l’ouvrage applique cette analyse particulièrement à la pastorale des prêtres. Bien qu’étant l’un des secteurs le plus concerné par le BO, il est encore l’un des plus oubliés, du moins en France. Ces deux dernières années, j’ai rencontré un certain nombre de mes frères prêtres, souvent jeunes, en BO ou en pré-BO. C’est cette expérience qui m’a poussé à m’intéresser à ce syndrome, qu’auparavant j’ignorais. Mais les exemples, les descriptions, les explications et les conseils peuvent aisément se transposer à tout laïc engagé à plein temps dans une mission pastorale et, le plus souvent, à tout homme de bonne volonté.
Rappelons d’abord comment cette notion de BO est apparue (chapitre 1) et ce qu’elle recouvre (chapitre 2).
1
Brève histoire du burn-out
On peut distinguer trois étapes dans l’évolution des études sur le BO : la découverte, la systématisation et l’approfondissement9.
1 •La découverte
Si l’état d’épuisement est connu depuis longtemps des cliniciens10, le terme même de burn-out est introduit pour la première fois, semble-t-il, par Bradley, en 196911, « pour qualifier les personnes présentant un stress particulier et massif en raison de leur travail12 ». Mais le vocable ne prend une connotation scientifique que suite aux contributions décisives de deux chercheurs.
Le premier, Herbert J. Freudenberger (1927-1999), est un psychologue et psychothérapeute américain. Il travaille dans une free clinic – un établissement de soins privé à but non lucratif fonctionnant avec des jeunes bénévoles – qui accueille des patients toxicomanes, dans le Lower East Side de New York. Venu pour traiter les patients, le Dr Freudenberger constate avec grand étonnement que le personnel est tout autant en souffrance. En quelques années, parfois en un an, de nombreux soignants, très enthousiastes au départ, perdent leur dynamisme, leur motivation et manifestent des signes de souffrance à la fois physiques (douleurs musculaires, rhumes persistants, céphalées, etc.), psychologiques (fatigue, épuisement, insomnies) et comportementaux (irritation, cynisme, stratégies de surenchère dans le travail ou, au contraire, d’évitement des collègues). Freudenberger fait alors appel au terme burn-out, qui est utilisé notamment pour désigner les effets de la toxicomanie. Il en suggère l’explication suivante : le décalage entre la demande – extérieure, celle de l’administration, mais aussi intérieure, issue des besoins ou des idéaux des soignants – et les capacités d’y répondre : « Le BO c’est comme faillir, s’user, se consumer, ou être épuisé pour avoir excessivement sollicité ses énergies, ses forces ou ses ressources13. »
Si Freudenberger, comme bien des découvreurs dans le domaine psychologique, a si bien compris le BO, c’est parce qu’il l’a lui-même subi. Il est ainsi devenu son propre laboratoire. Il raconte son rythme quotidien : il arrive à l’hôpital à 8 heures et consulte jusqu’à 18 heures ; ensuite, il rejoint la free clinic où il travaille jusqu’à la fermeture, à 23 heures ; enfin, il anime les réunions du staff ; il ne rentre chez lui qu’à 2 heures du matin. Il enchaîne ce rythme pendant des mois. À qui s’en inquiète, il affirme : « Je devrais en faire beaucoup plus : il y a des centaines d’enfants qui n’ont même plus de toit » ; à qui s’alarme de son amaigrissement, il rétorque en souriant : « So’s Frank Sinatra14 ! » Ayant promis à sa famille de partir en vacances, quand arrive le matin du départ, il se trouve incapable de se lever. Il n’est pas question qu’il prenne l’avion. Il dort pendant trois jours. À son réveil, il prend son magnétophone et s’enregistre. En s’écoutant, il mesure combien il est épuisé, angoissé – voire déprimé –, mais aussi arrogant, cynique et culpabilisé (vis-à-vis des siens). En alternant cure de sommeil et auto-analyse, il se remet peu à peu sur pied.
Deux années plus tard, une chercheuse en psychologie sociale, Christina Maslach, enrichit l’apport de Freudenberger. Alors que ce dernier centre son observation sur les facteurs personnels et la description des signes – notamment l’épuisement –, elle introduit les facteurs environnementaux et différents mécanismes – notamment la mise à distance et l’agression. Son histoire, là encore, vaut la peine d’être racontée. Dans les années 1970, Christina Maslach étudie les stratégies mises en place par les médecins pour se protéger du débordement affectif, en particulier le detached concern ou « inquiétude distante » (détachement émotionnel), et la dehumanization in self-defense ou « déshumanisation autodéfensive » (mise à distance par réduction du patient à sa pathologie : « C’est la cirrhose du lit 40 »). En étudiant les réactions des infirmières et des médecins, singulièrement des psychiatres, la chercheuse constate trois choses : premièrement, les émotions, même si elles sont gratifiantes, sont surtout stressantes (du fait des conflits avec les collègues, des patients difficiles, du personnel administratif, etc.) ; deuxièmement, la sérénité et le détachement étant inaccessibles, les professionnels de santé se protègent par le cynisme envers leurs patients ; troisièmement, les soignants déprécient leurs compétences, voire s’interrogent sur leur travail.
Or, en parlant avec un magistrat, Christina Maslach découvre que les avocats qui travaillent avec des personnes en difficulté sociale présentent les mêmes symptômes. La chercheuse émet alors l’hypothèse que ces dysfonctionnements touchent les professions centrées sur la relation d’aide en général. Elle décide alors d’étudier le comportement des employés des services sociaux vis-à-vis des personnes prises en charge15. Elle remarque et souligne en particulier le désengagement, qu’il soit verbal (emploi de termes techniques ou stigmatisants) ou comportemental (prise de distance physique, application stricte et légaliste du règlement). L’attitude des employés est tellement négative que le concept d’inquiétude distante (detachedconcern) ne suffit pas à en rendre compte. Christina Maslach introduit alors celui de « dépersonnalisation », qui va devenir classique. Elle complète ensuite le tableau en décrivant les trois caractéristiques du BO : l’épuisement émotionnel, la dépersonnalisation et l’amenuisement du sentiment d’accomplissement personnel et professionnel16. Dans son article clé de 1976, à la suite des avocats qui nomment ce phénomène burn-out, elle parle de « dynamique du burn-out », même si le terme qu’elle emploie le plus est celui de cracking, « craquage ».
Comme souvent, une découverte est faite simultanément par plusieurs chercheurs (que l’on songe à celle du calcul différentiel et intégral par Newton et Leibniz). Ici, le clinicien Freudenberger et la chercheuse Maslach esquissent les deux approches traditionnelles du BO.
2 •La systématisation
Ces premières études viennent combler « un vide en étiquetant un phénomène jusqu’ici sans nom, mais prédominant17 ». S’ensuit une explosion d’écrits pendant cinq ans. Au début, on perd en précision ce que l’on gagne en extension. Dans les articles publiés entre 1974 et 1980, on recense ainsi plus de 48 définitions différentes et parfois incompatibles du BO18.
Pour sortir de ces imprécisions et permettre au concept de BO d’accéder à un véritable statut scientifique, il fallait d’abord élaborer un instrument de mesure objectif standardisé, puis procéder à des enquêtes par questionnaires, pour aboutir enfin à une définition opérationnelle. La formation de Christina Maslach l’y prédisposait19. Elle retint comme définition descriptive le ternaire symptomatique déjà évoqué : l’épuisement émotionnel, la dépersonnalisation, l’impression d’inaccomplissement. Partant de là, elle élabora un test sous la forme d’un questionnaire psychométrique, le Maslach Burnout Inventory ou MBI20. Nous le présenterons plus bas.
L’un des premiers résultats de ces mesures systématiques fut l’extension du BO, que Christina Maslach et Susan Jackson réservaient au point de départ aux professionnels de la relation comme les enseignants ou les soignants, à des professions non relationnelles21. Depuis, les recherches sur le BO ont été étendues à un grand nombre de catégories de sujets22 et de pays, y compris non anglophones23, par exemple grâce à la validation du questionnaire MBI en français24.
Sans nier leurs grands mérites, les études de Christina Maslach ne prennent toutefois pas en compte le facteur temps ; autrement dit, elles demeurent synchroniques. On doit à Cary Cherniss d’avoir élaboré, en 1980, le premier modèle évolutif, c’est-à-dire diachronique, du BO. Ce psychologue américain y est parvenu en développant une conception qui intègre systématiquement ce qui n’est encore qu’implicite chez les autres chercheurs : l’interaction entre l’individu et l’environnement. Comme elle prend en compte le tout, cette vision du BO est qualifiée de holistique (du grec holon, « tout ») ou de « transactionnelle » ; or, qui dit interaction entre un individu et son milieu dit adaptation, donc évolution et temps. En étudiant sur une longue période (entre 1974 et 1976) des jeunes professionnels débutant dans divers métiers (avocats, enseignants, infirmières, etc.), il observe que le BO s’installe progressivement en suivant trois étapes25 :
1. La première étape se caractérise par le déséquilibre entre la personne (ses attentes, ses ressources) et le terrain (les exigences du travail), par exemple entre l’idéal d’entraide dans l’équipe et la réalité des conflits entre collègues. Ce déséquilibre se traduit par une profonde désillusion et un stress.
2. La deuxième étape se marque dans la tension (strain) : le hiatus est ressenti non plus seulement comme un stress, mais comme une fatigue physique et un épuisement émotionnel.
3. Le troisième temps s’inscrit dans le comportement (extérieur) et l’attitude (intérieure) du sujet : cynique vis-à-vis des autres, complaisante vis-à-vis de lui-même. Cette dernière étape correspond à un transfert de la désillusion sur l’idéal lui-même : le sujet en arrive à réduire la motivation qui l’a entraîné à vouloir exercer cette profession. Il est désormais en plein burn-out. Cherniss définit donc le BO comme un « processus dans lequel un professionnel précédemment engagé se désengage de son travail en réponse au stress et aux tensions ressenties26 ».
Si limitée soit la base empirique, donc la portée, de cette étude importante de Cherniss, elle fut validée27.
3 •L’approfondissement
Le diagnostic de BO désormais bien cerné, nous sommes entrés dans ce que l’on pourrait appeler l’âge des études théoriques. Sans négliger les approches de terrain, celles-ci multiplient les modèles explicatifs. Parmi beaucoup d’autres, trois études ont une importance particulière : le modèle « exigences-contrôle » de Karasek28 ; le modèle transactionnel de Lazarus et Folkman29 et la théorie de la conservation des ressources de Hobfoll30.
Certains se sont même aventurés à proposer des explications philosophiques31.
2
Qu’est-ce que le burn-out ?
1 •Le mot
Le terme « burn-out » (ou, selon l’usage anglo-saxon, le mot unique « burnout32 ») vient du verbe anglais to burn out, qui signifie, au sens propre, « griller » (par exemple, pour une prise électrique) et, au sens figuré, « brûler », « s’user », « s’épuiser ». Il désigne notamment l’état d’une bougie qui, après avoir éclairé longtemps, n’offre plus qu’une flamme tremblotante prête à s’éteindre au moindre souffle. Freudenberger l’a emprunté au vocabulaire des toxicomanes – comme eux, ces workaholics que sont souvent les personnes en BO sont intoxiqués et comme brûlés, incendiés33 – et Maslach à celui des avocats. Chaque fois, il s’agit d’une « maladie du trop ».
Si la métaphore est parlante en français (« brûler ses réserves34 », « se consumer », etc.), voire présente des résonances propres (« être en surchauffe », etc.), l’expression peine à être rendue de manière adéquate. Est-ce la raison pour laquelle les chercheurs ne se sont pas donné la peine de traduire le terme (la pratique généralisée de l’anglais dans les milieux scientifiques et l’obligation pour les spécialistes en psychologie sociale de publier dans cette langue faisant le reste) ?
Quoi qu’il en soit, le terme « burn-out » – à l’instar du mot « stress35 » – a rapidement connu un succès mondial. Certaines langues présentent un lexique propre pour le BO. Le terme le plus célèbre est le japonais karoshi (lire kaloshi), qui signifie « mort par fatigue au travail »36. Touchant plusieurs milliers de personnes au Japon, il désigne le stade ultime du BO et est dû à la destruction des glandes surrénales qui sécrètent les hormones de stress. Aucun cas n’a été décrit en France pour l’instant.
2 • La définition
La définition la plus souvent citée vient de l’ouvrage de Maslach et Jackson : « Le BO est un syndrome d’épuisement émotionnel, de dépersonnalisation et de diminution de l’accomplissement personnel qui peut survenir chez les individus qui travaillent37. » Une autre définition, plus large, ne limite pas le BO aux seuls symptômes psychologiques. Selon elle, le BO est « un état d’épuisement physique, émotionnel et mental, causé par une implication sur le long terme dans des situations émotionnellement exigeantes38 ». On constatera que, à chaque fois, il s’agit non pas de définitions, mais de descriptions qui regroupent les signes39. Aussi parle-t-on du BO non pas comme d’une maladie, mais comme d’un syndrome, c’est-à-dire d’un ensemble organique de symptômes.
Il existe aujourd’hui un consensus presque général autour des trois signes caractéristiques du BO.
L’épuisement émotionnel
Le premier symptôme affecte le travail. Alors que, dans les débuts, la personne accomplissait son travail avec joie et entrain, elle ne ressent désormais plus ni l’une ni l’autre. L’adjectif exprime la face affective du processus. Surtout, l’épuisement se traduit au plan effectif par une absence totale d’énergie pour le travail et, du point de vue de la volonté, par une carence de motivation et donc d’élan vers l’idéal. Concrètement, le BO se déclare progressivement ou de manière brutale (mais après une longue période de lassitude dont le sujet parvient de moins en moins à récupérer), par une soudaine incapacité à accomplir les gestes les plus élémentaires de la vie quotidienne, comme faire ses courses ou un simple copier/coller sur son ordinateur. La personne a l’impression que son cerveau « patine », qu’il ne répond plus40.
La dépersonnalisation
Le deuxième symptôme est d’ordre interpersonnel. Alors que, dans les débuts, l’actif s’engageait dans sa relation avec ses élèves, ses patients, ses clients, etc., désormais, il s’en désinvestit, il se tient à distance. Cette attitude peut s’étendre à l’institution et s’accompagner d’une critique systématique, d’une amertume à son égard. Cette froideur est un moyen de se protéger : moins s’ouvrir pour moins souffrir. Le terme de dépersonnalisation, employé par Christina Maslach, est ambigu. En effet, il ne s’agit pas de la dépersonnalisation du professionnel atteint par le BO : il s’agit de la dépersonnalisation des sujets qu’il a en charge. Aussi serait-il plus clair de nommer ce deuxième symptôme « désengagement ». Dans la forme générale du MBI (MBI-General Survey), la dépersonnalisation a été remplacée par l’une de ses attitudes, le cynisme, terme auquel on donne un sens plus global que dans le langage courant, comme l’attestent les verbatim suivants : « Je doute parfois de l’importance de mon travail » ; « Je suis moins intéressé par mon métier depuis que je suis dans cette entreprise. »
La diminution de l’accomplissement personnel
Le troisième signe touche la personne elle-même. Alors que, dans les débuts, le sujet éprouvait un réel auto-accomplissement dans sa profession, il croit dorénavant qu’il n’atteint plus ses objectifs. Bientôt il étend cette croyance à ses capacités, se convainquant de son incompétence et de son inaptitude à répondre aux attentes de son entourage. Peu à peu, à travers cette forte impression d’échec, ce sont l’estime de soi et la confiance en soi qui se trouvent touchées. De fait, dans le MBI-General Survey, l’accomplissement personnel a été renommé « efficacité professionnelle41 ». Voici le témoignage d’une femme atteinte d’un BO extrême : « Je n’avais qu’un désir : me coucher et mettre sur la porte de ma chambre un écriteau disant : “Laisse-moi seule, monde, parce que je ne suis pas ici42.” »
Synchroniques43, ces trois signes présentent aussi, partiellement, un sens diachronique. Pour presque tous les chercheurs44, le BO commence avec l’épuisement émotionnel ; celui-ci entraîne les deux autres signes, soit conjointement, soit successivement.
Ainsi, le modèle initial élaboré par Maslach en 1976 bénéficie de précisions : l’épuisement émotionnel demeure ; le désinvestissement est considéré comme une forme de désengagement engendrant des attitudes cyniques vis-à-vis de soi, d’autrui et de la sphère professionnelle ; l’amenuisement de l’impression d’accomplissement se traduit par la diminution de l’efficacité personnelle45.
Malgré les clarifications considérables apportées par le travail de définition du BO, des divergences demeurent entre les différentes approches46. La distinction la plus grande réside entre les définitions en termes d’état (synchroniques) et les définitions en termes de processus (diachroniques). Évidemment complémentaires, ces définitions sont hiérarchisées : la logique profonde du BO ne se déployant que dans une histoire, l’approche diachronique est première et englobante par rapport à l’approche synchronique.
3 • Les moyens diagnostiques
Aujourd’hui, le MBI élaboré par Christina Maslach « est de loin l’échelle la plus utilisée, la mieux maîtrisée » (94 % des publications en 2003). Elle s’avère en effet d’« une bonne validité prédictive47 ».
1. Je me sens vidé(e) nerveusement par mon travail.
2. À la fin d’une journée de travail, je me sens totalement épuisé(e).
3. Je suis fatigué(e) quand je me lève le matin et que je dois affronter une nouvelle journée de travail.
4. Il m’est facile de comprendre ce que ressentent les personnes dont je m’occupe.
5. J’ai l’impression de traiter certains usagers comme s’ils étaient des « objets » impersonnels.
6. Travailler toute la journée avec d’autres personnes est pour moi une source de tension.
7. Je m’occupe très efficacement des problèmes des personnes dont j’ai la charge.
8. Je me sens totalement « lessivé(e) » par mon travail.
9. Par mon activité professionnelle, je crois que j’exerce une influence positive sur la vie des personnes dont j’ai la charge.
10. Par rapport à mes débuts dans la profession, j’ai l’impression que je suis devenu(e) nettement moins sensible envers les personnes dont je m’occupe.
11. J’ai peur que mon travail ne m’endurcisse.
12. Je me sens plein(e) d’énergie.