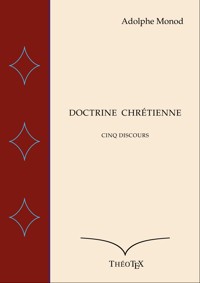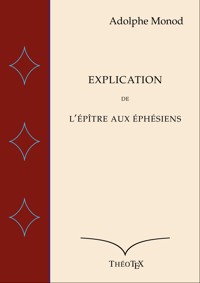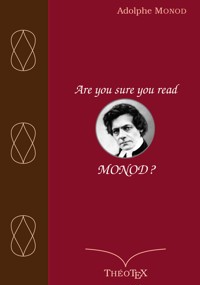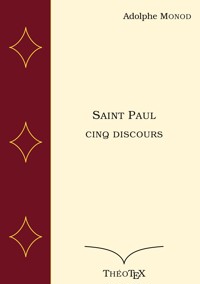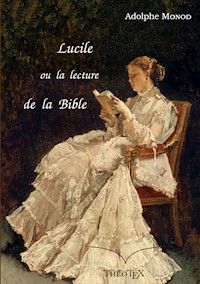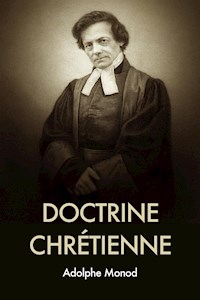Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
« Que ma vie ne s'éteigne qu'avec mon ministère, et que mon ministère ne s'éteigne qu'avec ma vie...» Cette prière continuelle d'Adolphe Monod lui a été tragiquement exaucée : atteint vers la cinquantaine d'un cancer du foie, incurable à l'époque, son dernier ministère fut celui de la souffrance. A son lit était fixée une barre de fer à laquelle il lui fallait parfois s'accrocher pour surmonter des douleurs croissantes en fréquence et en intensité. Tous les dimanches se réunissaient dans sa chambre un petit groupe d'amis qui lui portaient la communion, et auxquels il adressait de familières méditations. Soigneusement notées elles ont constitué Les Adieux, ce recueil autrefois bien en vue dans les librairies évangéliques, mais aujourd'hui épuisé. On a pu dire qu'avec cet ouvrage les protestants possédaient comme les catholiques leur propre Imitation de Jésus-Christ. Car en effet ce qui frappe dans ces pages admirables c'est la figure centrale du Sauveur, occupant toute la pensée et la dévotion de Monod dans sa longue agonie. « Voilà, disait-il ce qui soutient le chrétien dans la douleur. Jésus-Christ a souffert : plus je souffre, plus je lui ressemble, la douleur est un privilège.» En 1929, Wilfred Monod, petit-neveu du grand orateur, fit précéder les Adieux d'un avant-propos, que nous reproduisons dans cette réédition ThéoTeX ; nous faisons suivre le texte original de 1857 de deux prédications faites à Paris une dizaine d'années auparavant : La Parole Vivante et La Vocation de l'Église.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ThéoTEX
Site internet : theotex.org
Courriel : [email protected]
Table des matières
Avant-propos
Préface
I. Tout dans l’Écriture est idéal
II. Heureux dans la vie et dans la mort
III. La communion fréquente
IV. Le pasteur souffrant pour le bien de l’Église
V. Quelques mots sur la lecture de la Bible
VI. Dieu glorifié dans la souffrance
VII. L’amour de Dieu manifesté dans les siens
VIII. La foi
IX. Jésus-Christ notre exemple dans la souffrance
X. Le péché
XI. La croix nous révélant l’amour de Dieu
XII. Les choses invisibles
XIII. L’homme de douleurs et les hommes de douleurs
XIV 1. — Les regrets d’un mourant : Le secret d’une vie sainte, active et paisible
XV 2. — L’étude de la parole de Dieu
XVI 3. — L’emploi du temps
XVII 4. — La prière
XVIII 5. — La préoccupation des petits intérêts
XIX. Jésus-Christ
XX. L’Écriture
XXI. Le Saint-Esprit
XXII. Tout en Jésus-Christ
XXIII. La Trinité
XXIV. La résurrection
XXV. Dieu est amour
La Parole Vivante
La Vocation de l’Église
AVANT-PROPOS
Le petit livre des Adieux est l’un des plus authentiques trésors de l’Église chrétienne. Les sermons du célèbre orateur ont vieilli, à bien des égards; mais les brèves allocutions réunies dans ce recueil, testament spirituel d’un mourant, prononcées dimanche après dimanche sur un lit d’agonie, coupées de gémissements, scellées par la sainte Cène, continueront à nourrir les âmes d’âge en âge.
Les esprits attachés à l’orthodoxie doctrinale y retrouveront toujours, avec émotion, les formules traditionnelles de la croyance chrétienne; les âmes qui emploient un autre vocabulaire pour exprimer l’Évangile éternel, sauront toujours y découvrir les accents graves et jubilants de la foi qui sauve.
Non seulement ces pages feront leur chemin, comme par le passé, en dehors des Églises protestantes, et se répandront à travers la chrétienté, mais elles seront sans doute accueillies avec intérêt, avec respect, dans des cercles non confessionnels. Aujourd’hui, beaucoup plus qu’au milieu du xixe siècle, la science psychologique poursuit une vaste enquête ; nombreux sont les chercheurs qui, dans le domaine religieux, apprécient les documents de première main, les « témoignages » qui sont des « faits », et dont toute philosophie doit tenir compte pour élaborer un système conforme à la réalité.
Qu’est-ce, en définitive, qu’un chrétien? Quelle est l’expérience fondamentale, à la fois révélatrice et libératrice, qui l’unit, dans le monde entier, à tous ceux qui se réclament du même titre? Les chrétiens se reconnaissent entre eux, spontanément : est-ce avant tout par tel ou tel credo, par telle pratique rituelle, par telle notion de l’Église? L’Évangile a répondu d’avance : « Je suis le Cep, vous êtes les sarments.» Quand l’Esprit du Chef se manifeste dans les siens, ils perpétuent sa présence ici-bas; malgré les diversités passagères des christianismes historiques, ils constituent, sur le plan spirituel, une chrétienté.
Un professeur hindou demandait à l’un de ses compatriotes, gagné à l’Évangile : « Mais enfin, que vous a-t-il apporté qu’on ne puisse trouver dans les religions de l’Inde? » Réponse : « Jésus-Christ. »
La personne morale du Messie, l’étoffe même de son caractère, la substance de son âme, la qualité spirituelle de son rayonnement, la nature intime de la radio-activité qui émane inépuisablement de lui, l’Esprit rendu sensible, enfin, « la Parole faite chair », — voilà ce que l’Évangile donna au monde.
Une fois découverte l’aiguille aimantée, qui frémit sous le mystère du magnétisme et pointe vers l’Étoile polaire, les marins osèrent s’élancer dans la brume des océans, au large. Depuis deux mille ans bientôt, l’humanité possède également une boussole, dans le domaine moral ; la conscience immaculée du Révélateur oriente les âmes «travaillées et chargées », dolentes et pécheresses, vers le cœur même de l’univers, et nous décèle une Pitié sainte, une Compassion divine, un Amour ineffable, un Dieu capable de souffrir, que Jésus nommait, « le Père ».
C’est trop peu dire encore. Le Christ ne nous renvoie pas vers son Dieu. Il appelle : « Venez à moi! » Nous saisissons en lui l’Esprit-Saint.
Voilà ce qu’affirment Les Adieux, par les lèvres d’un moribond, torturé dans sa chair; cela suffit pour assurer la valeur universelle du petit livre.
Lorsqu’il fut nommé pasteur à Paris, en 1847, Adolphe Monod, dans son discours d’installation, entonna un véritable hymne à la « Présence » de la Parole vivante qui est l’âme de la Parole écrite, un cantique au Glorifié qui reste à jamais l’animateur de l’Église, corps mystique dont il est la Tête. Il s’écria : « Je voudrais moins traiter du christianisme, de sa doctrine, de sa morale, de son histoire, de son inspiration divine, que vous donner Jésus-Christ lui-même. Je voudrais plus encore. Non content de réserver à la personne de Jésus-Christ la première place, je voudrais faire d’elle le centre et le cœur de mon ministère, la contemplant dans tout autre objet et contemplant tout autre objet en elle. Oui, je voudrais, ô mon Dieu Sauveur, et quel ministre fidèle ne le voudrait avec moi? ne chercher qu’en toi seul le principe, le milieu et la fin de tout mon ministère. C’est toi, ta vie, ta personne, ton esprit, ta chair et ton sang, dont j’ai faim, dont j’ai soif, pour moi-même et pour ceux qui m’écoutent! C’est toi que je veux porter dans cette chaire! Toi que je veux annoncer à ce peuple! Toi que je veux apprendre à mes catéchumènes! Toi que je veux distribuer dans les sacrements! Toi tout entier, rien que toi, toi toujours et encore toi! ».
De tels accents révélaient au dehors le secret du sanctuaire intime.
Le ministère parisien d’Adolphe Monod prit fin prématurément. Quand il comprit que le ressort de son activité extérieure était brisé, il écrivit cette prière : «Mon Dieu! tu veux éprouver ce qui est dans mon cœur. Tu veux voir si ce vieux serviteur, qui a prêché, avec puissance et conviction, qu’il n’est rien dont la foi ne puisse triompher, est en état de le prouver lui-même, et s’il accepte le fardeau qu’il a posé sur les épaules des autres. Ce fardeau, je l’accepte. . . Tu es amour. Tu es fidèle. Cette vie crucifiée que j’ai désirée si souvent dans les temps de ma santé, tu me l’as faite maintenant et je l’accepte, pour montrer que le chrétien peut trouver la paix dans cette vie crucifiée. »
L’expression tragique : « vie crucifiée », était autre chose que de la pieuse littérature. Ceux qui soignaient le malade entendirent ses cris d’angoisse : «O mon Dieu! toi qui vois mes douleurs, Homme de douleur, aie pitié de moi! Par ton sang répandu, aie pitié de moi! Par les humiliations de ta passion, aie pitié de moi! Par les angoisses de ton agonie, aie pitié de moi! Par la victoire de ta résurrection, aie pitié de moi ! Par la gloire de ton ascension, aie pitié de moi! Par la compassion de ton amour, aie pitié de moi! Par la fraternité de tes souffrances, aie pitié de moi! Partout et en tout, aie pitié de moi !—Omon Dieu, c’est ta main! Qu’elle est redoutable, cette main divine! Qu’elle est irrésistible! Qu’elle est secourable, cette main paternelle! O mon Sauveur, guéris-moi! Jésus, qui guérissais tout le monde, guéris-moi! Si j’ai assez souffert, et si j’ai tâché de souffrir pour ta gloire, guéris-moi! O mon Dieu, je ne murmure pas, il n’y a pas une fibre, pas un sentiment en moi qui murmure; guéris- moi pour ta gloire, pour ton service, ou retire-moi dans ton sein. Mon Dieu, je t’attends. Que je suis heureux de te connaître ! de pouvoir t’appeler le Dieu d’amour! Mon âme s’élève à toi. »
Telles sont les circonstances dans lesquelles s’organisèrent, autour de l’agonisant, les « Réunions du dimanche ». Ses brèves allocutions, préparées dans l’angoisse et la prière, sont tellement pétries de la substance des Saintes Écritures, qu’elles forment l’un des rares ouvrages de dévotion, ici-bas, dont la lecture soit tolérable, sans transition, après celle de la Bible.
Si l’on essayait de grouper systématiquement les quelques méditations contenues dans Les Adieux, on pourrait les classer ainsi :
I. Les Bases.
La Sainte Bible, ch. 1, 5, 15, 20.
La Sainte Cène, ch. 3.
La Foi, ch. 8.
La Prière, ch. 17.
II. La Doctrine chrétienne.
A. Dieu.
Le Père ou la Révélation, ch. 7, 11, 25.
Le Fils ou la Rédemption, ch. 19, 22.
Le Saint-Esprit ou la Sanctification, ch. 21.
La Trinité, ch. 23.
B. L’Homme.
Le péché, ch. 10.
III. La Morale chrétienne.
Epreuve, ch. 4, 6, 9, 13.
Sainteté, ch. 14, 16, 18.
Joie, ch. 2.
IV. Au delà.
Les choses invisibles, ch. 12.
La résurrection, ch. 24.
Méditons ces pages, en nous appliquant l’avertissement formulé dans le chapitre sur la Foi : « Il faut recueillir de la foi pour l’avenir ; il faut travailler aujourd’hui pour avoir la foi dont vous aurez besoin dans cinq, dix, vingt ans. Il faut amasser jour après jour cette provision spirituelle, afin que tout entourés des dons de Dieu les plus abondants, vous n’ayez plus qu’à ouvrir les yeux et à étendre les mains lorsque viendra le temps où la force même de prier sera affaiblie, où votre corps languissant et votre esprit abattu se prêteront moins à cette lutte terrible dont la foi est le prix et la récompense. Ah! n’attendez pas ces moments suprêmes pour acquérir la foi : on la trouve toujours; mais appliquons-nous à les prévenir en amassant toujours et toujours, et en croissant tous les jours dans la foi. »
Ainsi soit-il.
Wilfred Monod. (1929)
PRÉFACE
M. Adolphe Monod a été enlevé à l’Église le 6 avril 1856, après une maladie de deux années. Six mois de repos et d’inaction forcée, puis six mois d’un ministère continué malgré les progrès de la maladie ; enfin près d’une année de souffrances, et de souffrances croissant toujours (il l’a dit lui-même) en intensité et en continuité : ainsi se répartit cette dernière période de sa vie. Les discours qu’on va lire ont été prononcés dans l’automne et l’hiver 1855-1856, depuis le temps où il apprit que son mal était sans remède, jusqu’au jour où Dieu avait marqué le terme de sa prédication en même temps que de ses souffrances.
C’est vers la fin de septembre (1855) que M. Monod et sa famille connurent toute la gravité de sa maladie. Sans perdre encore ni l’espoir ni le désir de se relever, et de voir le Seigneur accomplir en lui ce que l’art humain n’espérait plus, dès ce moment il se prépara paisiblement à déloger, si telle était la volonté de Dieu, et sentit le besoin de se tenir encore plus près de lui. Aussi, quand un ami, son collègue dans le ministère, lui parla de la communion « comme d’un moyen de grâce trop négligé et très puissant, et lui conseilla de s’en servir abondamment, » il se rendit volontiers à ce conseil. Il résolut de prendre chaque dimanche la communion, et d’admettre tour à tour à la partager les amis qui en exprimeraient le désir. Mais il voulut faire plus encore. Deux fois en quelques jours il avait pu adresser à sa famille des exhortations d’une assez grande étendue; encouragé par ce premier essai, il pensa que la communion hebdomadaire lui fournirait l’occasion d’exhorter, chaque semaine, un petit auditoire d’amis. Telle fut l’origine de ces réunions du dimanche ; la première eut lieu le 14 octobre 1855, et elles se succédèrent sans interruption jusqu’au 30 mars 1856.
Avec l’occasion de prêcher encore l’Évangile, M. Monod trouva celle de montrer l’esprit de largeur chrétienne dont il était animé; cet esprit qui faisait de lui, non pas seulement l’homme de son Église, mais l’homme de l’Église fidèle tout entière. Tous ceux qui partageaient sa foi, quelle que fût d’ailleurs leur dénomination particulière, étaient pour lui des frères; et tour à tour des pasteurs des Églises Réformée, Luthérienne, Indépendante, Wesleyenne, présidèrent à cette fête de l’amour fraternel, au chevet du frère malade et mourant. Ainsi, à la douceur de travailler pour l’Évangile, il joignait la douceur de travailler pour « cette Église de l’avenir, que tous pressentent, »comme il l’a dit lui-même, et au-devant de laquelle il voulait marcher.
[Il ne sera peut-être pas sans intérêt pour les lecteurs de retrouver ici les noms des pasteurs qui ont successivement présidé ce service. Ce sont MM. Frédéric Monod, Guillaume Monod, Meyer, GrandPierre, Gauthey, Vaurigaud (de Nantes), Vallette, Armand-Delille, Vermeil, Fisch, Jean Monod, Edmond de Pressensé, Petit, Paumier, Zipperlen, Hocart, Louis Vernes, Boissonnas et Vulliet.]
Le service se célébrait dans la chambre du malade. Une table placée auprès de son lit portait le pain et la coupe ; devant cette table prenait place le pasteur officiant. La famille de M. Monod, avec un petit nombre d’amis, en tout de trente à quarante personnes, occupaient autour de lui des places, toujours en trop petit nombre, quelque réserve que l’on dût s’imposer dans les admissions, en s’attachant surtout à faire varier le petit auditoire, et à recevoir ainsi successivement tous ceux qui avaient demandé à venir 1. Une invocation, un chant, une prière, la lecture d’un chapitre de la Bible, puis la distribution des éléments, tel était l’ordre du service. Quand la cène était distribuée, M. Monod prenait la parole; et ce qu’il y avait alors dans son accent de paisible sérénité, d’amour profond et chrétien pour ceux qu’il exhortait, souvent d’énergie et de pénétrante éloquence, ceux qui l’entendirent en d’autres temps peuvent s’en faire quelque idée ; ceux-là seuls le peuvent dire, ou sentir, qui l’ont entendu dans ces derniers jours.
Le service, on l’a vu plus haut, était né des circonstances, sans être ni cherché ni prévu. Les paroles du pasteur malade n’avaient pas plus d’apprêt. Souvent ce n’était plus le prédicateur, c’était un frère souffrant et près de déloger qui donnait à ses frères des conseils tirés de sa propre expérience, avec une simplicité, une familiarité que le lecteur retrouvera tout entières. Mais souvent aussi revenait la voix sonore, le tour vif et imprévu, l’accent rapide et entraînant d’autrefois. Privé d’une prédication qui était sa vie, il aimait cette prédication nouvelle, si réduite qu’elle fût, et par l’état du malade et par les difficultés des circonstances. Il parlait selon ses forces, toujours trop petites pour lui permettre une longue fatigue. Il ne pouvait, on le pense bien, supporter un long travail de préparation ; aussi, les premiers temps, il se contentait de méditer quelques moments sur les idées qu’il se proposait de développer. Ces idées lui étaient fournies par quelque expérience, quelque réflexion nouvelle que la semaine avait apportée; ou bien il s’entretenait avec un de ceux qui l’entouraient sur le sujet qu’il pourrait choisir; souvent aussi la souffrance se chargeait de le lui fournir, et il se plaisait alors à montrer comment le chrétien doit en user pour glorifier Dieu.
Plus tard, voyant que sa vie se prolongeait, et que Dieu l’appelait à souffrir et à parler du sein de sa souffrance plus longtemps qu’il n’avait pensé, il voulut réunir les allocutions qui suivraient sous une forme commune; de là deux séries de discours : dans l’une il donna, sous le nom de Regrets d’un mourant, des conseils tirés de son expérience; dans l’autre il fit connaître les principaux Résultats2 où cette expérience avait conduit sa foi. Il voulut alors se préparer avec plus de soin, dictant le samedi, ou dans la nuit du samedi au dimanche, des notes assez étendues, quelquefois presque autant que le discours lui-même, et se faisant relire ces notes peu de temps avant de parler. Mais il s’aperçut bientôt que cette méthode gênait sa liberté, par la répugnance qu’il éprouvait à ne pas remplir exactement le cadre tracé d’avance, et qu’elle lui donnait trop de fatigue, en lui faisant souvent dépasser la mesure de ses forces pour suivre jusqu’au bout ses développements. Aussi, après quatre allocutions ainsi préparées, celles du mois de février, il revint pour les suivantes à son ancienne habitude.
On s’étonnera sans doute que souffrant jour et nuit des douleurs presque toujours vives et souvent extrêmes, M. Monod pût soutenir la fatigue d’une réunion tenue auprès de son lit chaque dimanche pendant une heure entière, et celle d’un discours, même de quelques pages, à composer et à prononcer. On a vu de quelle manière il se préparait à parler, dans les moments de liberté que la douleur lui laissait ou qu’il savait lui enlever. Quant à la fatigue qu’il éprouvait à les prononcer, elle était grande assurément; encore que les organes de la parole eussent conservé une vigueur singulière, et qu’on s’étonnât de retrouver une voix aussi ferme dans ce corps brisé, l’effort d’attention qu’il fallait faire pour recueillir ses pensées et improviser des paroles, souvent au momentmême où l’aiguillon de la souffrance se faisait le plus sentir, — cet effort ne pouvait manquer de réagir sur la douleur et de l’irriter encore. Mais Dieu lui dispensait chaque dimanche, comme chaque jour, la mesure de soulagement, ou la mesure de patience et d’énergie, qui lui était nécessaire. Quelquefois la douleur était suspendue, ou du moins adoucie ; quelquefois il la dominait pour pouvoir parler. Souvent les heures qui suivaient le service étaient des heures plus douloureuses, surtout dans les premiers temps. Il le savait, mais il s’y résignait volontiers. « Je souffre beaucoup, disait-il un dimanche soir; mais il faut qu’il en soit ainsi dans la nuit du dimanche au lundi; c’est un sacrifice que j’offre volontiers à Dieu. » Et encore, dans une prière : « S’il me faut chaque semaine gagner par une douleur redoublée le privilège d’annoncer ta parole, que ta volonté soit faite, et non la mienne! » Le 25 novembre (nous aimons à faire parler M. Monod lui-même, pour mieux apprendre au lecteur avec quels sentiments il considérait sa prédication nouvelle) : « J’ai beaucoup souffert ce matin; il y avait lieu de craindre que je ne pusse pas parler : eh bien, Dieu a suspendu ma douleur pendant une heure, tout exprès pour me permettre de le glorifier, et il m’a accordé la grâce d’exercer ce petit ministère, qui m’est une si grande consolation.» Et enfin le 2 mars, un mois avant sa mort : « Voici encore un dimanche que Dieu m’a permis d’adresser quelques mots à notre petite assemblée, malgré ma faiblesse croissante et dont mon accent rendait témoignage. Qu’il daigne me soutenir jusqu’à la fin, et m’accorder, s’il est possible, (car je n’ai garde de lui rien prescrire,) la grâce de ne cesser de proclamer son nom que quand je cesserai de vivre. »
Dieu l’a soutenu jusqu’à la fin, Dieu lui a fait la grâce dernière qu’il demandait. Depuis le dimanche 14 octobre, le service eut lieu chaque dimanche, pendant près de six mois. Le 23 mars, jour de Pâques, il put prononcer son dernier discours sur la résurrection de Jésus-Christ, après une longue incertitude, il est vrai, et avec une si grande difficulté, qu’il parut s’évanouir en articulant les derniers mots. Le 30 mars, bien que sa faiblesse eût rapidement augmenté les jours précédents, qu’il fût incapable de prendre presque aucune nourriture, et que la difficulté à parler fût extrême, « sachant à peine s’il pourrait se faire entendre, il recueillit le peu de forces qu’il avait, pour glorifier l’amour éternel et infini de Dieu, » et finit par une prière d’action de grâces toute sa prédication sur la terre. Du 30 mars au 6 avril, le déclin fut encore beaucoup plus rapide; M. Monod n’avait plus la force de parler même à sa famille; et l’on se demanda s’il fallait contremander la réunion convoquée pour le 6 avril. Mais ce jour-là, l’heure n’était pas venue que Dieu retirait à lui son serviteur, exauçant ainsi sa prière souvent répétée : «Que ma vie ne s’éteigne qu’avec mon ministère, et que mon ministère ne s’éteigne qu’avec ma vie. »
Il nous reste à présenter au lecteur divers éclaircissements sur les discours contenus dans ce volume.
On se demandera comment ils ont été reproduits; car on a pu voir que pas un ne fut rédigé d’avance par l’auteur. Dès l’origine, les enfants de M. Monod s’occupèrent de les recueillir. A l’aide de la mémoire, et de notes fort étendues, où souvent presque rien ne manquait, on parvint à les reproduire avec une grande fidélité, fidélité qui allait croissant avec l’habitude. Ce travail se fit d’abord à l’insu même de M. Monod, et toujours sans qu’il y prît lui-même aucune part. Le seul de ces discours revu par lui est le vingtième, ayant pour titre l’Écriture. Il se le fit lire deux fois, le corrigea même avec soin, et y fit des changements assez considérables ; ajoutons qu’il s’est étonné, dans cette occasion, de trouver ses paroles aussi exactement reproduites.
Ainsi la rédaction n’était guère qu’un travail de plume : copier les notes prises par diverses personnes, en les complétant les unes par les autres, ou à l’aide de la mémoire, à cela se réduisait tout le travail. Pour les derniers discours, on parvint à une fidélité à peu près parfaite. Les premiers furent reproduits aussi avec une assez grande exactitude ; le premier seul a été écrit de mémoire ; mais ceux qui l’ont entendu n’y verront rien qu’ils ne reconnaissent, et chacun y retrouvera la manière de l’auteur. Pour tout le volume on peut garantir, sinon d’avoir donné toutes les paroles de M. Monod, au moins de n’avoir donné que ses paroles. Et si, dans ces exhortations familières ainsi reproduites, il se rencontrait quelque négligence de langage, s’il manquait ici et là quelque phrase pour lier les idées ou les éclaircir, on a mieux aimé accepter un léger défaut, que de prêter à l’auteur ce qui ne serait pas de lui. Quelques passages ont paru exiger un très léger changement, qui en éclaircit le sens ; mais ces corrections d’un texte qui n’était pas, après tout, tracé de la main de l’auteur, sont en fort petit nombre.
Parmi les titres des allocutions, deux ou trois seulement ont été donnés par l’auteur. — Les textes de l’Écriture imprimés en tête de plusieurs discours, ont été, pour la plupart, et notamment les derniers, désignés par lui, et lus sur sa demande avant qu’il prît la parole. On a donné, à la suite de quelques discours, des prières ou fragments de prières, dont il les avait accompagnés.
Le portrait placé en tête de ce volume est dessiné par un habile artiste, d’après un daguerréotype pris au mois de janvier 1856. Il sera apprécié de ceux qui ont vu et entendu M. Monod dans les Réunions du dimanche. Ils le retrouveront tel qu’ils l’ont vu prononçant les Allocutions.
Ce volume servira, nous l’espérons, à la gloire de Dieu et à l’avancement de son règne; selon cette belle parole de l’Épître aux Hébreux : « Tout mort qu’il est, il parle encore.» Que le lecteur, tout en conservant le souvenir de l’homme à qui nous devons ce beau témoignage rendu à la puissance de la foi, regarde à celui de qui procède toute grâce excellente et tout don parfait. «N’oublions pas, disait M. Monod le dimanche 2 mars au soir, d’arroser de nos prières ce que nous plantons ainsi au nom du Seigneur, et demandons-lui de ne pas permettre qu’une curiosité stérile, ni même qu’une affection purement humaine, prenne la place que doit occuper ici, dans celui qui parle et dans ceux qui écoutent, le pur désir de glorifier Dieu. » C’est dans cet esprit que nous offrons ce volume au peuple de Dieu ; qu’il l’accueille aussi dans cet esprit, saintement jaloux de rapporter toute gloire à celui qui donne tout bien. Mais qu’il nous soit permis aussi, en livrant ce volume au public, d’y faire admirer la bonté de ce Dieu fidèle. Voici bientôt un an que l’Église commença de s’alarmer pour la vie de M. Monod, et de redemander à Dieu ce serviteur, qu’il semblait marquer déjà de son sceau pour la vie éternelle. Après huit mois de prières, M. Monod lui était retiré, et huit mois de quelles souffrances! Mais ce n’est pas en vain qu’il s’était senti, comme il l’a dit lui-même, « porté sur les prières du peuple de Dieu.» En lui retirant et sa santé, et sa prédication, et sa vie, Dieu se réservait d’exaucer autrement ses prières et celles de ses frères pour lui : il voulait le mettre en exemple à tout son peuple. A la prédication de M. Monod il manquait le sceau de cette dernière et cruelle maladie; ceux qui l’entendirent aux jours de sa force, et qui le virent aux jours de sa faiblesse, diront si le prédicateur, dans toute la vigueur du corps et toute la liberté de l’esprit, a parlé plus efficacement, plus utilement à leur cœur que le chrétien malade et mourant. Et dans cette maladie, où Dieu faisait éclater ainsi en lui la puissance de la foi, il lui permettait encore de parler en son nom chaque dimanche ; il le lui a permis jusqu’au dernier jour, et il a fait sortir de cette longue amertume ce petit livre, humble mais éloquent témoignage rendu à l’Évangile, unique peut-être dans l’histoire de l’Église, où l’on entendra redite, semaine après semaine, par un homme qui attendait la mort, sans oser la souhaiter, et redite avec une fermeté, une patience, une paix, une joie toujours croissantes, cette même doctrine de l’Évangile, telle qu’il l’avait connue, prêchée, vécue pendant les vingt-cinq années de son ministère. Gloire à Dieu !
Dans un sermon prêché le jour de Noël 1854, sur ce texte : « Pour toi, une épée transpercera ton âme, » M. Monod, déjà malade depuis le commencement du printemps, prononçait quelques paroles que nous aimons à placer ici, pour faire voir comment Dieu a su vérifier en lui ce qu’il lui mettait alors sur les lèvres.
Il venait de montrer que la vie crucifiée est la véritable vie du chrétien et du ministre de la Parole de Dieu en particulier, et termina cette partie de son discours par ces mots :
« Que si, parmi ces croix qu’il vous donne à porter, il en est quelqu’une qui vous semble, je ne dis pas plus lourde à porter que les autres, mais plus compromettante pour votre ministère, mais capable de ruiner à jamais toutes les espérances de votre mission sainte; si la tentation extérieure s’unit à la tentation intérieure ; si tout semble frappé, corps, esprit, cœur; si tout semble enfin perdu sans retour, eh bien, acceptez cette croix-là, dirai-je? ou cet assemblage de tant de croix, dans un sentiment particulier de soumission, d’espérance et de gratitude, comme une infirmité dans laquelle le Seigneur va vous faire trouver une mission toute nouvelle; saluez-la comme le point de départ d’un ministère d’amertume et de faiblesse, que Dieu a réservé pour la fin comme le meilleur, et qu’il veut faire plus abonder en fruits de vie que ne fit jamais votre ministère de force et de joie dans les jours passés! »
1. Au moisde mars, les forces diminuées de M. Monod ne lui permirent plus de recevoir ses auditeurs dans sa chambre pour une heure entière ; et dans les quatre dernières réunions, ils durent se tenir debout auprès de son lit pour entendre son exhortation; puis on passait dans une pièce voisine, où se célébrait la communion; elle était portée au malade par le pasteur officiant.
2. Les titres que nous donnons ici sont de M. Monod lui-même. La première série comprend les numéros XIII-XVIII ; la seconde, les numéros XIX-XXIII, auxquels il faut joindre le numéro X, comme il l’a indiqué lui-même.
I
TOUT DANS L’ÉCRITURE EST IDÉAL.
(14 octobre 1855.)
Mes chers amis, frères et sœurs bien-aimés, avec qui je suis si heureux et si reconnaissant de pouvoir recevoir la chair et le sang de notre Sauveur, cette chair qui est « réellement une nourriture » et ce sang qui est « réellement un breuvage, » pour qui les reçoit avec foi par le Saint-Esprit, il y a dans l’Écriture un trait qui suffirait à lui seul pour la faire connaître pour la Parole de Dieu : c’est que tout y est idéal. Il n’y a rien dans l’Écriture que d’absolu et de parfait. Elle ne songe jamais à nous appeler à une certaine mesure de sainteté par une certaine mesure de foi, et toute mesure est contraire à l’instinct de la Bible, parce qu’elle est contraire à Dieu. L’idéal de l’Écriture n’est pas comme celui des poètes, qui prennent les choses de la terre pour les élever au troisième ciel ; elle fait l’inverse pour elle les choses visibles ne sont que des types des invisibles, seules réelles; et c’est au point de vue de Dieu qu’elle considère toutes choses. C’est une remarque qui m’a frappé ce matin, en réfléchissant devant le Seigneur à ce que je pourrais vous dire au sujet de la communion, et de la croix de Jésus-Christ, dans laquelle seule nous trouvons la rémission des péchés.
L’Écriture nous présente partout le péché idéal. Il n’y a pas un de nous qui se fasse une idée de l’horreur et du crime du péché devant Dieu. Nous avons toujours vécu dans une atmosphère tellement saturée de péché, sur cette terre qui boit l’iniquité comme l’eau et la mange comme le pain, que nous ne savons plus discerner ce péché qui nous enveloppe de toutes parts. Voici en deux mots l’expérience que j’ai faite. Nous trouvons dans la Bible ces paroles : « Nous étions autrefois insensés, rebelles, égarés, asservis à diverses convoitises et voluptés, vivant dans la malice et dans l’envie, dignes d’être haïs et nous haïssant les uns les autres. » Pendant longtemps il m’a été impossible d’admettre cette déclaration qui me paraissait empreinte d’une exagération manifeste. J’avoue que même après que Dieu, par sa grâce, eut tourné vers lui mon cœur au jour qu’il avait marqué dès les temps éternels, je suis resté longtemps encore sans pouvoir l’accepter complètement. Il y a plus : j’avoue que depuis lors, aujourd’hui même, je ne puis pas la comprendre dans sa plénitude ; non pas que je ne sois convaincu qu’elle est parfaitement vraie, et que si je ne la réalise pas dans mon expérience, la faute en est toute à moi. C’est là que j’ai compris la nécessité d’un témoignage existant avant, en dehors, et au-dessus de nous. J’accepte cette déclaration comme venant de Dieu, parce que je la trouve dans sa Parole, et je le prie d’achever de m’en révéler le sens par son Esprit. Je suis arrivé, par la grâce de Dieu, — non d’année en année, les choses ne vont pas si vite, mais d’un intervalle de plusieurs années à un autre intervalle de plusieurs années, — à voir cette doctrine plus clairement, et à en sentir de plus en plus la vérité dans mon propre cœur; et je suis sûr que quand ce voile de chair sera tombé, je reconnaîtrai que c’est la peinture la plus fidèle et le portrait le plus ressemblant qui ait jamais été tracé de mon cœur, j’entends de mon cœur naturel. Demandons à Dieu de nous révéler notre état de péché, sans pourtant le trop presser, parce qu’il sait bien que s’il nous faisait croître plus vite dans cette connaissance que dans celle de sa miséricorde, nous tomberions dans le désespoir.
Mais le pardon nous est aussi partout représenté dans l’Écriture comme idéal. Si une partie seulement de nos péchés étaient pardonnés, si sur mille péchés ou un million de péchés (si l’on pouvait compter nos péchés), il en restait un seul qui ne le fût pas, ce pardon ne nous servirait de rien; mais c’est un pardon complet. Le passage que l’on vous citait tout à l’heure (2Cor.5.21) est un de mes passages favoris. Jésus-Christ n’a pas seulement expié quelques péchés : il a expié le péché. Il n’a pas été considéré comme pécheur, il a été fait le péché même; et par le mystère des mystères, toute la malédiction de Dieu a été rassemblée sur cette tête innocente et sainte. Aussi nous ne sommes pas seulement rendus justes en lui, mais la justice même; en sorte que quand Dieu nous contemple en Jésus-Christ, il nous voit comme son Fils bien-aimé lui-même, et trouve en nous tout ce qui peut attirer ses regards et sa complaisance. Nous qui croyons, nous avons été donnés de Dieu à Jésus-Christ pour prix de son sacrifice. Il ne peut pas plus nous manquer de parole qu’à Jésus-Christ lui-même, et toutes ses perfections y sont tellement engagées, que ce don de sa miséricorde infinie devient comme un droit de notre justice parfaite en Jésus-Christ. Les termes mêmes employés par l’Écriture, en nous montrant ce qu’est le péché devant Dieu, nous montrent comment il les a effacés. Il les a « jetés derrière son dos, » comme s’il avait peur de les revoir; « précipités au fond de la mer, dissipés comme un nuage, anéantis comme une nuée » : nous voyons par là ce que c’est pour Dieu que d’oublier le péché. Le Seigneur nous est représenté comme faisant effort pour oublier ; ou plutôt, ce n’est pas oubli, c’est un effacement complet.
Enfin l’Écriture est idéale dans ce qu’elle nous dit de la sanctification. Nous ne nous faisons aucune idée de ce que l’Écriture demande de nous, et du degré de sainteté auquel nous pouvons et devons atteindre. Quelle plénitude dans cette parole : « Le Dieu de paix veuille vous sanctifier lui-même parfaitement, afin que tout ce qui est en vous, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ.» Et pour nous prouver que ce n’est pas un simple vœu, l’Apôtre ajoute tout aussitôt : « Celui qui vous a appelés est fidèle, c’est pourquoi il le fera. » Il n’est pas plus possible qu’il nous refuse cette grâce qu’il ne l’est de le concevoir rompant avec sa parole. Et comment pouvons-nous arriver à cette sainteté? comment ont été grands les saints hommes dont la Bible nous montre l’exemple? Ce n’est pas par leurs lumières, ni par leurs dons naturels, mais par leur foi. Voyez saint Jacques. Pour nous montrer la puissance de la foi et de la prière, il prend l’homme le plus miraculeux peut-être de la Bible dans le plus miraculeux de ses miracles; il nous présente la hardiesse de cette prière d’Élie comme une chose toute simple, et le propose en exemple aux plus petits, aux plus humbles, pour nous montrer ce que peut la prière persévérante (littéralement la prière énergumène) du juste.
Si nous pouvions, chacun de nous, sentir dès aujourd’hui, dans notre cœur, l’énormité du péché, la plénitude du pardon et la puissance de sainteté à laquelle nous devons atteindre, quel changement dans notre vie, quelle influence salutaire pour l’Église elle-même!
Prière.
O Dieu! toi qui sais tout ce que le péché a amené de maux et de souffrances sur notre pauvre terre et dans cette pauvre humanité ; toi qui vois tout ce qui se souffre en ce moment même et dont nous ne pourrions pas supporter la vue, nous te recommandons tous ces affligés, pour que tu répandes sur eux les trésors de ta grâce et de ta consolation. . . Nous ne pouvons pas te les nommer tous, mais tu te les nommes à toi-même; nous te recommandons les victimes de la guerre, tant de familles plongées dans le deuil, et tant d’autres qui vivent dans une inquiétude continuelle. . . Nous te recommandons les opprimés et les persécutés pour la justice. Nous te recommandons les esclaves; considère ces milliers, ces millions d’esclaves opprimés par des hommes qui professent ton nom, par des serviteurs de Christ qui ne sont pas serviteurs. Nous te recommandons les pauvres, — ah ! les pauvres! — les malades, les malades qui sont pauvres. . . Nous te recommandons tous ceux qui te connaissent, pour que tu les soutiennes et que tu répandes sur eux ta paix et tes consolations. Et quant à ceux qui ne te connaissent pas, nous les recommandons à ta grâce, afin que tu te révèles à eux, car ils n’ont pas d’autre alternative que le désespoir s’ils ne te possèdent pas. Pour moi qui souffre un peu, je confesse Christ et sa paix. Je te rends grâces de la joie que tu répands dans mon âme. Tu nous appelleras peut-être à nous séparer pour un peu de temps; mais qu’est-ce que cela? Nous savons que par ta grâce nous serons tous un jour réunis auprès de toi. . .
II
HEUREUX DANS LA VIE ET DANS LA MORT.
(21 octobre 1855)
Lecture de Philippiens 1.19-6
Je sais que ceci me tournera à salut par votre prière, et par le secours de l’Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance que je ne serai confus en rien, mais qu’en toute assurance, Christ sera maintenant, comme il l’a toujours été, glorifié en mon corps, soit par la vie, soit par la mort. Car Christ est ma vie et la mort m’est un gain. Mais s’il m’est utile de vivre en la chair, et ce que je dois choisir, je n’en sais rien; car je suis pressé des deux côtés, mon désir tendant bien à déloger et à être avec Christ, ce qui m’est beaucoup meilleur; mais il est plus nécessaire pour vous que je demeure en la chair. Et je sais cela comme tout assuré que je demeurerai et que je continuerai d’être avec vous tous, pour votre avancement et pour la joie de votre foi ; afin que vous ayez en moi un sujet de vous glorifier de plus en plus en Jésus-Christ, par mon retour au milieu de vous.
Mes chers amis, je voudrais vous rendre attentifs au sentiment dans lequel le saint apôtre considère ici la vie et la mort. Remarquez d’abord cette parole, qui lui sert de point de départ et qui est comme la devise de sa vie chrétienne : « Pour moi, vivre, c’est Christ, et mourir, c’est un gain » (traduction littérale); c’est-à-dire ma vie, ma vie naturelle, dont je vis aujourd’hui et dont je puis mourir demain, n’est pas employée à autre chose qu’à suivre et servir Jésus-Christ. «Mourir, c’est un gain; » cette parole n’a pas besoin d’explication. Là-dessus, l’Apôtre se demande ce qui vaut mieux pour lui de vivre ou de mourir. Cette question s’est souvent présentée à nous, et peut-être avons-nous dit comme l’Apôtre. Mais il est à craindre que nous l’ayons dit dans un sentiment bien différent. Quand nous avons désiré la mort, cela signifiait : Je ne sais ce que je dois le plus redouter, ou des afflictions de la vie, dont la mort me délivrerait, ou des terreurs de la mort, dont la vie me préserve; c’est-à-dire que la vie et la mort nous apparaissent comme deux maux dont nous ne savons quel est le moindre. Quant à l’Apôtre, elles lui apparaissent comme deux biens immenses dont il ne sait quel est le meilleur. Personnellement, il préfère mourir, pour être avec Christ. Quant à l’Église et au monde, il préfère vivre, pour servir Jésus-Christ, étendre son règne et lui gagner des âmes. Quelle admirable vue de la vie et de la mort, admirable, parce qu’elle est toute dominée, toute sanctifiée par l’amour, et semblable à la vue que Jésus-Christ en a eu lui-même. Appliquons-nous à entrer dans ce sentiment. La vie est bonne ; la mort est bonne. La mort est bonne, parce qu’elle nous affranchit des misères de cette vie, et surtout parce que, la vie fût-elle pleine pour nous de toutes les joies que la terre peut donner, la mort nous fait entrer dans une joie et une gloire dont nous ne pouvons nous faire aucune idée. Nous devons donc considérer la mort comme une chose désirable en soi. N’éloignons pas de nous ce qui peut nous la rappeler. Que toutes les maladies, que toutes les morts subites, que tout ce qui se passe autour de nous, nous rappelle que, pour chacun de nous, elle peut venir d’unmoment à l’autre. La vie aussi est bonne, parce que nous pouvons servir Jésus-Christ, glorifier Jésus-Christ, imiter Jésus-Christ. Il ne vaut pas la peine de vivre pour autre chose. Tout ce que nous avons de force, de souffle, de vie, de facultés, doit être consacré, dévoué, sanctifié, crucifié pour le service de notre