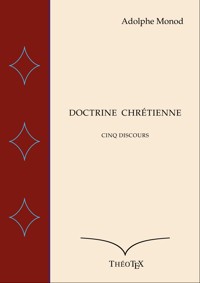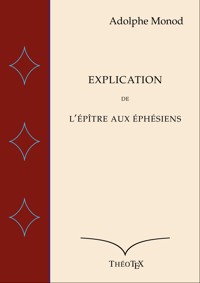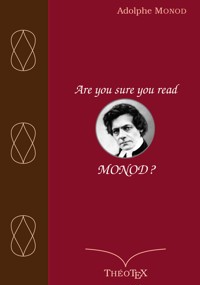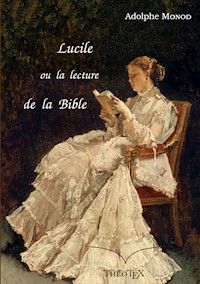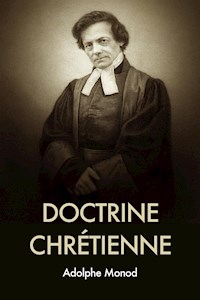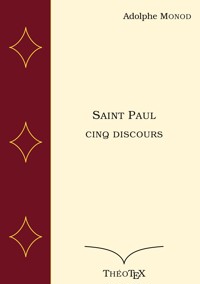
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Les cinq sermons sur saint Paul, d'Adolphe Monod, forment un ensemble apologétique des plus admirés, depuis qu'il ont été prononcés à Paris vers 1850, puis réunis en un volume. Ils démontrent que sans l'apôtre Paul, le christianisme, et par conséquent le monde actuel, ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Ironiquement d'ailleurs, ce jugement est souvent partagé par les ennemis modernes du grand missionnaire, qui l'accuse d'avoir inventé le christianisme. En réalité il ne saurait exister aucune opposition entre l'enseignement de Jésus-Christ, et celui de Paul, puisque ce dernier a été l'instrument spécialement choisi et préparé par le premier, pour apporter son Évangile aux Nations. Ces sermons ne sont ni dogmatiques, ni exégétiques, ni a fortiori textuels, mais pleins de vie, de conviction, de sérieux et d'émulation spirituelle. On y retrouve l'orateur puissant du Réveil que fut Adolphe Monod, et on y découvre combien lui-même a pratiqué avec succès ce qu'il attendait de ses auditeurs : devenir imitateur de saint Paul. Le texte de cette reproduction ThéoTeX est celui de l'édition de 1851.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
THÉOTEX Site internet : theotex.org Courriel : [email protected]
Table des matières
Note ThéoTeX
Avertissement
Saint Paul, son œuvre
Saint Paul, son christianisme, ses larmes.
Saint Paul, sa conversion
Saint Paul, sa personnalité, ou sa faiblesse
Saint Paul, son exemple
Note ThéoTeX
Adolphe MONOD (1802-1856), le plus célèbre des orateurs protestants français du XIXe siècle, ne sera jamais soluble dans le néo-calvinisme américain. En tête de ce recueil de cinq sermons sur l’apôtre Paul, il importe de le signaler, non dans une intention agressive, mais dans le souci de préserver ces beaux et puissants messages de toute tentative de récupération.
Adolphe Monod a été assurément un protestant évangélique orthodoxe dans sa théologie, croyant aux dogmes essentiels qui la définissent : l’inspiration de l’Écriture, le péché originel, la Trinité, la Rédemption, l’Élection, la Prédestination. . . Mais homme du Réveil, il n’a jamais placé son identité, ou sa fierté, dans un système théologique faussement rigoureux. Monod appartient à cette lignée de pasteurs commencée avec Samuel VINCENT, VINET, VERNY, qui se sont distancés aussi bien du rationalisme de la Révolution française, que de la froide scolastique réformée du XVIIe siècle. On ne trouve dans ses sermons rien de ces étalages pédantesques de termes d’école, rien de ces présomptions métaphysiques outrées, rien de ce pharisaïsme académique, qui caractérisent trop souvent la mode néo-calviniste.
A ce géant évangélique pourrait s’appliquer ce que lui-même disait de l’Écriture : « la Bible, le plus pratique et le moins systématique des livres. . . » Adolphe Monod, le plus pratique, et le moins systématique des théologiens. . . Peu systématique, car ses discours sur saint Paul ne se laissent pas étiqueter, ils ne sont ni thématiques, ni exégétiques, ni textuels, ils sont vivants! Même à l’écrit on sent battre le cœur d’où ils sont sortis. Pratique, parce que l’orateur vise, non à persuader l’auditeur de son grand savoir, mais à l’entraîner, à l’émuler pour suivre le Seigneur Jésus-Christ à travers l’apôtre. Dans le quatrième sermon en particulier, celui sur la personnalité de Paul, Monod s’adresse aux jeunes de l’Église, eux qui plus tard devront prendre le relais et continuer l’œuvre du réveil. Quel conseil leur laisse-t-il? Se barder de titres ronflants? se muscler de force philosophique? Non, mais au contraire de savoir mettre, comme saint Paul, toutes leurs faiblesses au service du Maître.
Dans le cinquième discours, qui est l’aboutissement des précédents, Monod aborde ce qu’il avait coutume d’appeler « la plaie du réveil » : le danger de tomber dans une orthodoxie biblique morte, un christianisme confortable, un refus de porter toute croix personnelle. Que ferait Paul aujourd’hui, en 1850, pour relever l’Église de sa décadence, se demande le prédicateur? Il ne peut le savoir en détail, mais il est certain d’une chose, c’est que l’apôtre nous presserait encore d’être ses imitateurs comme lui-même l’était de Christ. A notre tour nous pourrions nous demander ce que prêcherait Adolphe Monod, s’il avait à nous parler aujourd’hui, deux siècles plus tard. N’en doutons pas, la réponse se trouve contenue dans les pages qui suivent.
Phœnix, le 11 janvier 2019
Avertissement
Il ne faut pas chercher dans ces discours une étude historique de la vie et des écrits de l’Apôtre : l’objet en est plus humble, plus pratique et plus actuel.
Jaloux que je suis de voir se former un peuple de Dieu capable de répondre à la tâche spirituelle de l’époque, je lui cherche un type réel et vivant ; et ce type, je le trouve dans saint Paul.
Apprécier le bien que saint Paul a fait à l’Église et par elle au monde, étudier les ressorts moraux de son immense action, et le proposer en exemple par ce côté accessible à tous, voilà ce que j’ai voulu.
Je parle pour ceux de mes frères en Jésus-Christ qui, « ne voulant savoir autre chose que Jésus-Christ et lui crucifié, » déplorent avec moi les langueurs de l’Église fidèle, et, comme moi, poursuivent sa réformation, appelée de toutes parts, dans le développement de sa vie spirituelle. Ces frères gémissants, mais gémissants dans l’espérance, où qu’ils soient et quelque nom qu’ils portent, ont toutes mes sympathies : ne puis-je pas compter sur leur amour et sur leurs prières?
J’en éprouve un besoin plus qu’ordinaire. En ces jours agités et sérieux, comment parler, surtout comment écrire sur « la seule chose nécessaire, » sans un saint tremblement? Ce tremblement m’est trop bien connu. . . Je supplie mes bienveillants lecteurs de ne rien accepter de moi sans y appliquer la règle de l’Écriture : « Examinez toutes choses ; retenez ce qui est bon. »
Pour revenir à saint Paul, je veux exprimer ici un vœu qui est gravé profondément dans mon cœur : c’est que notre littérature religieuse s’enrichisse d’une histoire du grand apôtre. Ne se trouvera-t-il pas un jeune ministre de l’Évangile qui, réalisant ce que je n’ai su pour ma part que rêver à l’entrée de la carrière théologique, prendra dès le début saint Paul pour objet de son étude favorite, et finira par donner à l’Église un travail approfondi sur la vie et les écrits de saint Paul? Il trouverait la voie déjà ouverte par plus d’une publication, ancienne ou moderne, française ou étrangère. A ne parler que de notre époque, Neander a et les Allemands lui fourniraient des matériaux abondants et précieux. Mais l’ouvrage contemporain le plus complet qui existe sur cette matière est celui qui se publie aujourd’hui en Angleterre, par livraisons, sous ce titre : Life and Epistles of St. Paul ; comprising a complete Biography of the Apostle, and a translation of his letters inserted in chronological order. By the Rev. W. J. Conybeare M. A., and the Rev. J. S. Howson, M. Ab. Il est difficile de juger un livre qui n’est pas achevé ; mais il est permis de dire, dès à présent, que celui-ci réunit le mérite des recherches solides à celui de tous les embellissements par lesquels l’art peut seconder la science.
On remarquera que je m’écarte parfois des versions reçues dans mes citations bibliques, bien que ces différences affectent rarement le sens du texte. Quelque jaloux que je sois de restituer au langage sacré, autant que le permet notre idiome, sa simplicité et son énergie primitives, je me ferais scrupule, en général, de toucher sans nécessité pressante au texte consacré par un long usage et en possession du respect populaire. Mais aujourd’hui que l’on travaille de divers côtés à corriger la version française, il me semble que chacun doit saisir les occasions d’apporter au moins sa petite pierre à la construction du nouvel édifice. Dans ce travail je fais souvent usage de la version du Nouveau Testament qui a paru en 1839 à Lausanne, sous ce titre : « Le Nouveau Testament de notre Seigneur Jésus-Christ, traduit sur l’original par une société de ministres de la Parole de Dieu, » et qui vient d’être réimprimée, dans un format plus portatif, avec ce titre un peu singulier : « Version du Nouveau Testament, traduit en Suisse. » Cette version, trop littérale à mon gré pour être adoptée dans le culte commun, offre un précieux avantage qui tient à ce défaut même : exacte jusqu’au scrupule, elle tient lieu de l’original, autant que cela est faisable, à ceux qui n’y peuvent pas recourir. Cette classe nombreuse de lecteurs du Nouveau Testament devraient toujours avoir la version de Lausanne à leur portée, au moins pour la consulter.
a. Les vues de Neander sur saint Paul ont été résumées admirablement par lui-même, sous une forme populaire, dans deux articles de l’excellente collection publiée par le Dr Piper de Berlin, auxquels je fais ici plus d’un emprunt (Evangelisches Jahrbuch, 1850 : Pauli Bekehrung ; Pauli Leben und Leiden).
b. Longman, etc., Paternoster Row, London, 1851 ; en vingt livraisons.
I SAINT PAUL, SON OEUVRE
J’ai travaillé plus qu’eux tous.
(1 Corinthiens 15.10)
Mes frères,
Régénérer la société chrétienne, par l’Église chrétienne restaurée, tel est l’objet que se propose aujourd’hui le vrai disciple, et plus spécialement le vrai ministre de Jésus-Christ.
Tout l’annonce, et chacun le pressent : le temps approche où l’Église chrétienne sera rendue à cette grande mission, qu’elle a tant oubliée dans le désordre et la crise de la situation présente. Il approche, mais est-il venu? J’ai peine à me le persuader : s’il était venu, les gens de bien seraient moins partagés d’opinion pour reconstituer l’Église sur des bases à la fois assez fermes et assez étendues.
Mais, en attendant qu’il vienne, nous avons à le hâter par une œuvre analogue ; bien que distincte : par une œuvre spirituelle, qui doit précéder l’œuvre ecclésiastique ; par une œuvre dont je vous ai plus d’une fois entretenus, et dont je vous entretiendrai plus d’une fois encore, s’il plaît à Dieu, parce qu’elle est parmi les préoccupations dominantes de mon ministère.
Il faut qu’il se forme « un peuple particulier de Jésus-Christ Tite.2.14 » recueilli de toutes les communions chrétiennes, au nom de ce qu’il y a de plus vital dans la foi chrétienne et dans la vie chrétienne, et qui, marchant, par la grâce de Christ, dans l’amour de Christ, sur les pas de Christ, « aille de lieu en lieu faisant le bien Actes.10.38, » et réhabilite l’Évangile compromis dans l’esprit des hommes, en montrant comme à l’œil ce qu’il est et de quoi il est capable.
Pour se former, ce peuple bienfaiteur a besoin d’un type sur lequel il puisse se régler. La seule peinture de la vie chrétienne dans l’Évangile ne suffit pas : du vouloir au faire la distance est si grande, et en nous et autour de nous, que la théorie la mieux établie nous inspire je ne sais quelle défiance involontaire, si la pratique ne lui vient en aide. Plus même la morale évangélique est sainte, plus nous avons besoin, pour la croire réalisable, de la voir réalisée dans un homme vivant, ou tout au moins dans un homme qui a vécu.
Le type désiré ne l’avons-nous pas en « Jésus-Christ homme, » cette loi vivante, en qui l’idéal se confond avec le réel? Sans doute, et son exemple, seul parfait, est aussi, vous le savez bien, celui auquel j’en appelle dans tous mes discours. Mais la perfection même de ce modèle, tout en lui donnant un prix unique, nous invite à en chercher quelque autre moins élevé au-dessus de notre portée, par où il sera, tout ensemble, et plus accessible à notre imitation et plus humiliant pour notre infidélité. Eh bien! ce type de second ordre, éminent sans être parfait, je viens vous le présenter dans la personne d’un apôtre qui s’est acquis le droit de se proposer pour exemple, par sa fidélité à suivre l’exemple du Maître : « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ 1Cor.11.1. »
Saint Paul n’est pas le seul modèle que j’aurais pu choisir dans l’histoire évangélique ; mais il est, à mon sens, le plus accompli. D’ailleurs, la question de supériorité personnelle écartée, j’ai deux autres raisons pour lui donner la préférence : Saint Paul est de tous les apôtres, et celui dont l’histoire nous est la mieux connue, et celui qui nous intéresse le plus directement, ayant été établi de Dieu apôtre des gentils, c’est-à-dire notre apôtre à nous, issus de ces gentils. Au reste, ne craignez pas de ma part un panégyrique, où le saint du jour usurpe la place réservée à son Maître et au nôtre. Outre que l’imperfection du tableau ne m’est pas moins nécessaire que sa beauté pour le dessein que je me propose, ce serait mal entrer dans l’esprit de saint Paul que de lui rendre ce qui n’appartient qu’au Seigneur. Si je pouvais m’oublier jusque-là, je croirais voir son image se jeter au-devant de moi, et me crier, comme il fit autrefois aux habitants de Lystre : « O hommes, pourquoi faites-vous ces choses? Nous sommes aussi des hommes, sujets aux mêmes infirmités que vous Actes.14.15. » Etre vrai, c’est toute la grâce que je demande à Dieu ; sachant bien qu’il y a dans notre apôtre assez de sainteté pour le placer bien au-dessus de nous, avec assez d’infirmité pour le maintenir bien au-dessous du « Seigneur de gloire. »
Si l’on me demandait quel me paraît être, entre tous les hommes, le plus grand bienfaiteur de notre espèce, je nommerais sans hésitation l’apôtre Paul. Son nom est pour moi le type de l’action humaine la plus étendue à la fois et la plus utile dont l’histoire ait gardé le souvenir.
Nul ne contestera, croyant ou non, que la révolution opérée par Jésus-Christ ne soit la plus grande et la plus salutaire qui ait été accomplie dans le monde. J’en ai pour garant un témoignage encore plus sûr que celui des historiens, le témoignage de tous les peuples civilisés. Ils ont si bien senti que Jésus-Christ est la clef de voûte de l’humanité et le centre de toute son histoire, qu’ils ont compté leurs années à partir de lui : nous sommes en 1851, pourquoi? parce qu’il y a mil huit cent cinquante et un ans que Jésus-Christ est venu. Bien plus : on calcule de la sorte pour les temps mêmes qui ont précédé sa venue, malgré l’inconvénient de compter à reculons. Avant comme après, la place d’un fait ou d’un homme est marquée dans l’histoire par la distance qui le sépare de Jésus-Christ. Ne nous amusons pas à prouver l’évidence : l’établissement du christianisme dans le monde est l’événement des événements.
L’auteur de cette révolution a été plus qu’un homme ; mais il a employé comme instruments de simples hommes, les apôtres, qui sont devenus, sous lui, les organes du mouvement à la fois le plus vaste et le plus fécond qui ait agité le genre humain. Ce germe spirituel qu’ils ont déposé de lieu en lieu dans le sein de notre pauvre terre, en a changé la face : l’affranchissement des esclaves, l’émancipation de la femme, l’élévation de la vie domestique, l’amélioration des lois, l’adoucissement des mœurs, la diffusion des lumières, le progrès, je devrais dire la création de la bienfaisance, que sais-je? le monde renaissant à une vie nouvelle, tel est le fruit que nous recueillons tous les jours, sans nous souvenir, ingrats que nous sommes, des mains fidèles par lesquelles Dieu l’a semé pour nous.
Il y a apôtre et apôtre. Entre ses douze apôtres, accrus d’un treizième par la conversion de Paul, Jésus-Christ a partagé les deux grandes tâches dont se composait la régénération du monde : l’évangélisation des juifs, et celle des gentils. Les juifs n’étaient qu’une seule nation, petite et méprisée ; les gentils occupaient le reste du globe, et comptaient dans leurs rangs les peuples les plus glorieux de la terre. Vous auriez, n’est-il pas vrai, réservé le plus grand nombre des apôtres pour la plus grande des deux œuvres à accomplir? mais les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Sauf la pénétration inévitable de chacune des deux œuvres par l’autre, et les commencements de l’une et de l’autre promis à Simon-Pierre, Dieu laisse aux juifs les douze premiers apôtres, et n’en donne aux gentils qu’un seul, qu’il forme tout exprès pour eux, et qui sera appelé l’apôtre des gentils, ou seulement l’Apôtre, ce nom seul le désignant assez clairement chez les enfants des gentils Gal.2.7-8. A cette vocation toute spéciale qui fait de Paul un apôtre à part, correspond chez lui je ne sais quelle attention jalouse à dégager son travail d’avec celui d’autrui Rom.15.20-21. Atlas spirituel, Paul porte à lui seul le monde païen sur ses épaules. Cet empire romain qu’un peuple entier, et le plus puissant de la terre, a mis sept siècles à former, ce seul homme met un quart de siècle à le renouveler. C’est son œuvre, son œuvre spéciale, j’allais dire son œuvre exclusive : tant les travaux d’un saint Pierre à Césarée ou à Antioche, d’un saint Jean à Ephèse ou à Patmos, pour ne rien dire de ceux des apôtres de second plan, Barnabas, Timothée, Tite et tant d’autres, s’effacent devant les siens! Il s’est acquis le droit de dire, dans un esprit d’humilité et d’actions de grâces, en se comparant avec tous les autres apôtres réunis : « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis ; et sa grâce envers moi n’a point été vaine, mais j’ai travaillé beaucoup plus qu’eux tous, toutefois non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi 1Cor.15.10. » Le plus grand des apôtres, que Jésus-Christ a faits les plus grands des hommes, tel est saint Paul.
Mais laissons cette appréciation relative : prenons le travail de notre apôtre en lui-même, et rendons-nous compte, si nous le pouvons, du bien qu’il a fait sur la terre.
Ne pensez pas toutefois que je veuille suivre avec vous notre apôtre dans tous les travaux qu’il a accomplis, durant les trente ans environ qu’a duré son apostolat c. Le suivre, voyageant ainsi qu’il a fait par tout le monde, et dans un temps où les voyages étaient si lents, si difficiles, si périlleux ; le suivre, préludant à la vie missionnaire par quatre ou cinq années passées dans la retraite d’Arabie, dans l’évangélisation de Damas, dans la fuite de Damas à Jérusalem, et de Jérusalem à Tarse, et dans la conduite de ce nouveau peuple d’Antioche, chez lequel s’inaugure le nouveau nom de chrétien ; le suivre, à la voix du Saint-Esprit qui l’appelle, parcourant le vaste empire romain, rasant le sol à n’en juger que par l’étendue de sa course, le creusant profondément à en croire la trace qu’elle laisse après elle, et semant la terre, chemin faisant, d’une traînée d’églises naissantes, de Jérusalem à Rome (si ce n’est au delà), et de Rome à Jérusalem ; le suivre, dans sa première mission, traversant l’île de Chypre de Salamine à Paphos, convertissant le proconsul et fermant la bouche au faux prophète, de là courant en Pisidie, à Antioche, à Iconie, à Lystre, à Derbe, à Perge, à Attalie, allant des juifs aux gentils et souvent repoussé des uns et des autres ; tour à tour adoré comme un dieu par un peuple en délire et lapidé par ce même peuple en furie, et n’en repassant pas moins par toutes les églises pour leur donner des pasteurs ; le suivre, dans sa seconde mission, après de nouveaux travaux dans Antioche et dans Jérusalem, reprenant sa course, et cette, fois passant le détroit, remplissant notre Europe du nom du Dieu inconnu, et fondant les églises de Philippes, de Thessalonique, de Bérée, d’Athènes, de Corinthe, je ne les nomme pas toutes ; le suivre, dans sa troisième mission, embrassant et l’Europe et l’Asie dans son immense tournée d’inspection : la Galatie (nous comptons ici par provinces), la Phrygie, Ephèse, c’est-à-dire tout l’occident de l’Asie Mineure, la Macédoine, la Grèce ; et au retour, Troas, avec cette résurrection d’un mort, Milet, avec cet inimitable discours d’adieu, Chypre, Tyr, Ptolémaïs, Césarée, Jérusalem enfin, où l’attendaient la rage des Juifs et les fers des Romains ; le suivre, dans sa quatrième mission, apôtre-prisonnier, mais prisonnier-apôtre, porté au travers des tempêtes sur un navire qui n’eut eu qu’à l’écouter pour ne pas se perdre, dispensant à ses compagnons de péril la vie présente avec la vie éternelle, payant, pauvre naufragé, l’hospitalité de Malte par la création d’une église, et n’arrivant enfin à Rome que pour y porter l’Évangile jusque dans la maison de César ; le suivre, dans ses dernières excursions (où le livre des Actes ne le suit plus, et où nous en sommes réduits à quelques données disséminées dans ses dernières épîtres), jusqu’à sa seconde captivité de Rome, et à ces mots tout pleins de son prochain martyre : « Je m’en vais maintenant être mis pour l’aspersion du sacrifice, et le temps de mon départ est proche 2Tim.4.6 » ; le suivre de la sorte — quand j’en aurais le temps, quand j’en aurais le courage, ce serait mal rendre justice à mon sujet. Eh! comment transporter dans la parole humaine tout ce qu’il y a de mouvement et d’action dans cette vie, dont le héros fatigue l’historien? Comment y transporter aussi ces combats, ces joies, ces douleurs, ces prières et tout ce travail du dedans, sans lequel celui du dehors ne nous offrirait qu’un corps privé d’âme? Parole pour parole, j’aimerais bien mieux citer l’Apôtre lui-même et résumer, avec lui, ou son travail extérieur dans ce naïf témoignage qu’il se rend en écrivant aux Romains, quand il n’en était encore qu’à la moitié de sa course : « Je n’oserais rien dire que Christ n’ait fait par moi pour amener les gentils à l’obéissance, en parole et en œuvre, par la vertu des prodiges et des miracles, par la puissance de l’Esprit de Dieu, tellement que depuis Jérusalem et les lieux d’alentour jusque dans l’Illyrie, j’ai tout rempli de l’Évangile de Christ Rom.15.18-19 ; » ou son travail intérieur dans cet appel qu’il adresse à la conscience des Corinthiens, après une énumération succincte de tout ce qu’il a souffert pour le nom du Seigneur : « Outre les choses du dehors, ce qui m’assiège tous les jours, c’est le souci que j’ai de toutes les églises. Qui est affaibli, que je ne sois aussi affaibli? qui est scandalisé, que je ne sois aussi brûlé 2Cor.11.28-29? » La vie missionnaire de saint Paul est de ces tableaux trop grandioses pour qu’on ose essayer de les peindre de face : c’est de profil qu’il faut les prendre. Contentons-nous donc d’apprécier son œuvre indirectement, et mesurons-la par ses résultats.
Je prends devant moi la carte de l’empire romain. J’y aperçois ces cités fameuses, centres du pouvoir et de la civilisation dans l’Orient et dans l’Occident, Antioche, Tarse, Ephèse, Thessalonique, Athènes, Corinthe, Rome et tant d’autres. Puis, je me pose cette question : Dans ces villes, et dans les contrées qu’elles représentaient, quel était l’état moral et religieux des populations, avant que la mission de Paul eût commencé? quel était-il, quand elle se termina par son martyre? Pour rendre la question plus précise, restreignons-la à une seule de ces cités : Ephèse nous servira d’exemple pour toutes.
Une aveugle et puérile superstition avait envahi Ephèse, placée qu’elle était sous la protection d’une divinité mensongère, la fière et vindicative Diane. Son temple, célèbre dans tout le monde par la richesse de ses ornements, par l’éclat de son architecture et par la beauté de ses statues, rassemblait dans son sein tous les genres d’idolâtrie, comme pour séduire plus sûrement tous les esprits : celle des images, celle de l’or, celle de l’art antique. Une corruption de mœurs inconnue de notre génération, toute corrompue qu’elle est, avait suivi cette doctrine d’erreur, où elle trouvait à la fois sa justification et son aliment. Quelques hommes supérieurs échappaient seuls à l’entraînement universel : mais c’était pour se jeter la plupart, après avoir épuisé toutes les ressources du génie et de l’étude, dans un scepticisme désolant et désespéré, terme fatal de toute la sagesse des sages. Ou bien, s’ils se rattachaient à l’un ou à l’autre des deux systèmes philosophiques qui se piquaient de répondre aux besoins élevés de la nature humaine, l’un, le stoïcisme, les enivrait par l’orgueil de l’esprit et par une impie déification d’eux-mêmes ; l’autre, le platonisme, les égarait dans un spiritualisme sentimental, qui, loin d’attaquer de front le fanatisme vulgaire, le consacrait sous couleur de l’épurer. Que restait-il alors à l’esprit humain, vide de lumière et de foi, aspirant à la vérité, mais enfoncé dans la matière, que d’appeler à son secours les folies des arts magiques, tentative chimérique pour combler l’abîme qui sépare le monde visible de l’invisible, s’ils ne sont pas un pacte immoral avec l’Esprit de ténèbres contre l’Esprit de Dieu? Qu’on ajoute à tout cela une portion de la ville esclave de l’autre, le pauvre plus écrasé qu’on ne l’a jamais vu dans les temps modernes, la femme abaissée et toute la vie domestique avec elle, le désordre passé en maxime Rom.1.32 ; et qu’on se figure, si on le peut, tout ce qu’un tel état de choses engendre d’effroyable confusion dans les idées et dans les mœurs. On n’aura plus devant soi qu’un monde qui s’en va en dissolution, sans savoir où se prendre pour arrêter le travail de sa décomposition morale ; tandis que les généreuses, mais vagues aspirations de quelques esprits, de quelques cœurs, peut-être de quelques consciences d’élite, se perdent et s’évanouissent comme un vain son dans les airs. Ce spectacle humiliant et lugubre est celui que présente, aux yeux de l’observateur impartial et judicieux d, la superbe Ephèse (pour ne parler ici ni d’Antioche, ni d’Athènes, ni de Rome, ni de toutes les autres capitales du monde civilisé), tant que la doctrine de Jésus-Christ n’a pas franchi les étroites limites de la Judée.