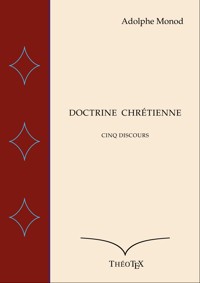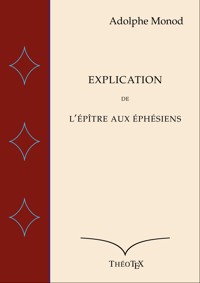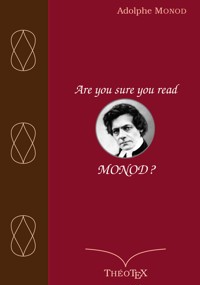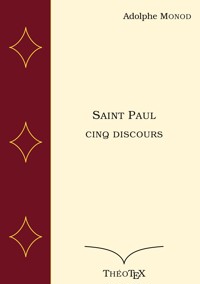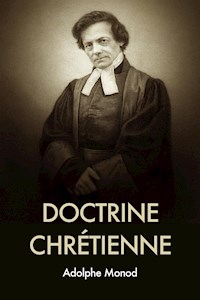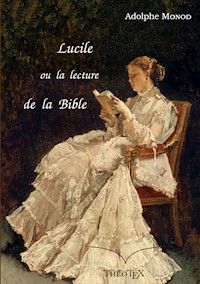
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Cet ouvrage aujourd'hui oublié, du grand prédicateur protestant Adolphe Monod, fut réédité plus de vingt fois au dix-neuvième siècle. Sous forme de dialogues et d'échange de lettres entre quatre personnages, il démontre pourquoi la lecture de la Bible est absolument essentielle à la foi et à la vie chrétienne. Sans doute le public catholique pratiquant, auquel il était destiné, a quasiment disparu aujourd'hui ; cependant les exposés de la vraie doctrine chrétienne, selon les Écritures, la pertinence et la force des arguments, ont gardé toute leur valeur, et restent toujours aussi appropriés aux âmes de notre temps. Malgré son ton informel, nous tenons là un exemplaire de la meilleure apologétique, écrite par un maître de la chaire et un profond connaisseur du coeur humain. A la fin du livre, Monod nous informe d'ailleurs, que loin d'être imaginaires, les personnages qu'il fait parler, sont les figures à peine retouchées d'une histoire réelle : ce fait n'est sans doute pas étranger au plaisir qu'on a d'en lire le récit, et au succès que connut naguère Lucile. Cette édition ThéoTeX reproduit celle de 1881.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Bienheureux, l’homme qui prend plaisir dans la loi de l’Éternel, et qui médite jour et nuit dans sa loi.
Psaume 1.2
Table des matières
Couverture
Introduction
Première lettre
Seconde lettre
Entretiens sur l’inspiration de la Bible
Premier entretien
Second entretien
Correspondance sur l’interprétation de la Bible
Première lettre
Deuxième lettre
Troisième lettre
Quatrième lettre
Cinquième lettre
Sixième lettre
Septième lettre
Huitième lettre
Neuvième lettre
Dixième lettre
Onzième lettre
Douzième lettre
Treizième lettre
Quatorzième lettre
Quinzième lettre
Seizième lettre
Dix-septième lettre
Dix-huitième lettre
Dix-neuvième lettre
Au lecteur
Introduction
Première lettre
LUCILE À L’ABBÉ FAVIEN
Vous allez être étonné en recevant une lettre de moi. Vous le serez bien davantage quand vous l’aurez lue. Mais je ne vois que vous au monde à qui j’ose m’ouvrir sur un sujet qui m’occupe beaucoup depuis quelques semaines.
Pour la première fois de ma vie, je commence à m’apercevoir que je n’ai point de religion, et à désirer d’en avoir une. J’ai eu, comme tout le monde ou comme toutes les femmes du moins, un moment religieux, à cet âge où le cœur commence à sentir le besoin d’aimer, et se donne à Dieu faute d’autre attrait. Mais ce n’a été qu’un éclair. Bientôt les plaisirs, les petits succès que j’obtins dans le monde, plus tard l’affection que sut m’inspirer M. de Lassalle, enfin les devoirs de la vie, un mari, un ménage, des enfants, ont absorbé toute mon attention ; et si l’habitude que j’ai prise d’assister à la messe avec ma famille m’a rappelé de temps en temps qu’il y a un Dieu, je dois avouer que je ne songeais guère à lui hors de l’église. Mon mari, vous le savez, Monsieur l’Abbé, s’inquiète peu de ce que je fais sur l’article de la religion; si j’ai été indifférente, il est tout à fait incrédule.
Vous ignorez vraisemblablement que je suis née protestante. C’est à peine si je m’en souviens moi-même. Je perdis ma mère en naissant, et mon père avant d’avoir accompli ma douzième année. Quand je me suis mariée, il ne me restait que des parents éloignés ; j’ai suivi sans résistance, sans parti pris, la religion de ma nouvelle famille, et mes enfants y sont élevés. Mais enfin, je vous le confesse avec quelque honte, je ne m’approche jamais de la communion.
Une circonstance qui vous paraîtra presque puérile est venue me faire penser à tout cela. Le jour de la Toussaint le temps était superbe; nous allâmes nous promener et nous passâmes sous les murs du cimetière. Notre conversation perdit un moment sa frivolité ordinaire ; il fut question pour quelques minutes de mort et d’enterrement. Et moi, me dis-je alors, si je mourais, où serais-je enterrée ? Protestante d’origine, catholique par circonstance, mais au fond ne tenant à rien et ne communiant nulle part, à laquelle des deux Églises mon corps appartiendrait-il ? Vous penserez de moi ce que vous voudrez, Monsieur l’Abbé; mais enfin ce doute m’a tracassée, m’a poursuivie, etm’a suggéré les premières réflexions un peu sérieuses que j’aie jamais faites sur la religion. J’avais commencé par ne m’inquiéter que pour le corps et j’ai fini par m’inquiéter pour l’âme; j’ai voulu savoir enfin ce que je suis.
Ou plutôt, j’ai voulu être enfin catholique en réalité. Je ne vois nulle raison pour retourner au culte de mes pères. Quand les choses seraient égales entre les deux communions, je trouverais plus facile de rester ce que je suis, ce qu’on me croit du moins. Je puis devenir catholique sans bruit ; je ne puis me déclarer protestante sans faire un éclat. Je répugne d’ailleurs à me séparer de mon mari et de mes enfants, et je ferais tout au monde plutôt que de risquer une division dans ma famille.Mais des motifs plus graves m’attachent à la religion catholique. Ne prenez pas ceci pour un compliment : je parlerais de même si j’écrivais à un ministre. Malgré le préjugé de naissance, je ne puis m’empêcher de reconnaître à votre religion un certain air d’autorité que n’a pas l’autre : son étendue, son bel ordre, son antiquité, jusqu’à la pompe de ses cérémonies et à la beauté de ses édifices, tout m’attire vers elle. J’éprouve cependant le besoin de mieux connaître une loi que je veux achever d’embrasser ; et en attendant d’autres lumières, je me suis mise à étudier le Manuel du Chrétien, dont j’avais fait usage à l’église, sans presque songer à ce que j’y lisais.
Une chose surtout m’a frappée dans ce livre, ce sont les morceaux des saintes Écritures que j’y vois cités ; soit parce que la Bible est le fondement commun de l’une et de l’autre religion, et que je ne puis manquer en la lisant ni à la foi catholique ni à la foi protestante, soit à cause d’un cachet particulier que je trouve à cette partie du Manuel et qui la distingue de toutes les autres. J’ai lu le reste avec plaisir, avec édification ; mais les Évangiles et les Épîtres, je les relis sans pouvoir m’en lasser, et ils laissent dans mon esprit une double impression dont j’ai peine àme rendre compte àmoi-même, et qu’il faut, Monsieur, que vous m’aidiez à démêler.
D’un côté, comme je viens de vous le dire, ce que j’ai lu de la Bible dans le Manuel me paraît avoir un ton de candeur et d’autorité qui me dispose à croire qu’elle a été écrite par une inspiration divine.Mais j’y vois d’un autre côté, je vous l’avoue, des choses si étranges, si opposées à toutes les idées reçues, que j’ai peine à me persuader qu’elles soient vraies et que Dieu ait parlé de la sorte. Tenez, Monsieur l’Abbé, s’il faut tout vous dire, j’ai peine à me persuader que Dieu ait parlé aux hommes en aucune manière. Une révélation, des prophètes, des miracles. . . excusez ma franchise, mais il ne me paraît guère croyable que les choses se soient ainsi passées, et bien que je sois loin de goûter les discours de mon mari là-dessus, ses raisons me touchent quelquefois plus que je ne voudrais. Qu’en dites-vous, Monsieur ? Ces histoires merveilleuses sont-elles bien réelles ? Vous les croyez, je n’en puis douter, je connais trop la droiture de votre caractère. Un homme comme vous ne se rend pas sans preuves ; quelles sont donc ces preuves ? En avez-vous à me donner qui puissent satisfaire complètement mon esprit ? Il n’est pas des plus ouverts à la foi, vous le voyez bien, mais il n’est pas non plus fermé à la lumière. Quoi qu’il en soit, je ne suis pas pour faire les choses à demi; et une fois entrée dans cet examen, j’en veux avoir le cœur net.
Vous soupçonnerez bien pourquoi je ne m’adresse pas au curé de la paroisse. M. Alexis est un homme de bien ; mais c’est une de ces jeunes têtes dont on remplit aujourd’hui les églises et qui ne savent que leur séminaire. J’ai besoin d’un homme qui m’inspire plus de confiance et sur la discrétion duquel je puisse compter. Si vous prenez la peine de me répondre, n’oubliez pas, je vous en prie, que je n’ai ni un grand esprit ni beaucoup de savoir ; parlez-moi tout simplement et ne me donnez que des raisons qui soient à ma portée.
Seconde lettre
L’ABBÉ FAVIEN À LUCILE
La peine de vous répondre ! Ah! Madame, ne parlez point ainsi. La lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire est la plus agréable que je pusse recevoir. Qu’y a-t-il de plus satisfaisant pour un ministre de Jésus-Christ que de voir une personne qui cherche la vérité avec autant de bonne foi que vous le faites ? Et quelle occupation plus conforme tout ensemble à mes goûts et à mon devoir, que de vous aider dans cette recherche, selon mes faibles lumières, mais de toute l’ardeur de mon zèle ?
Dieu a commencé de vous éclairer ; il achèvera, n’en doutez point. Il est vrai que vous prenez un chemin différent de celui que les âmes fidèles ont coutume de suivre. On débute le plus souvent par croire à l’Église, et puis, sur la foi de l’Église, on croit à la sainte Bible dont l’Église nous garantit l’inspiration. Mais vous, au contraire, vous semblez vouloir aller de la Bible à l’Église. Cela ne laisserait pas que de me donner quelque sollicitude, si je n’avais la conviction que vous ne tarderez pas à rentrer dans la voie accoutumée, qui est sans contredit la plus simple et la plus sûre. Vous reconnaîtrez bientôt, Madame, qu’il n’y a de tranquillité bien établie que pour celui qui s’en remet entièrement à l’Église, comme un enfant à une bonne mère, du soin de le conduire à Dieu. La prière, l’expérience, l’étude de votre propre cœur, les difficultés même que vous rencontrez déjà sur votre route vous feront sentir cela bien mieux que ne le pourraient faire mes avertissements, et finiront d’arracher de votre esprit ce reste de protestantisme qui vous a fait renverser l’ordre de la conversion.
Vous voulez que je vous expose les preuves qui démontrent l’origine divine de notre sainte religion. Cela serait bien plus facile, ou plutôt ce soin serait superflu si vous eussiez suivi la marche que je viens de vous expliquer, et appris dès l’abord à vous soumettre en toute chose à la décision de l’Église. Alors j’aurais tout dit en quatre mots : La Bible est un livre inspiré de Dieu, car ainsi l’enseigne l’Église qui ne peut nous égarer. Mais au point où vous en êtes, je vois trop que cette réponse ne vous contenterait pas. Je ne me refuserai donc point à vous en faire une plus conforme à votre désir, pour ne pas vous donner lieu de soupçonner une défaite dans mon silence. Dieu me préserve de rien faire qui pût scandaliser votre foi naissante ! Mais, Madame, le sujet sur lequel vous me consultez est trop considérable pour une lettre. Je m’expliquerai mieux là-dessus dans un entretien où vous pourriez me proposer sur le moment vos difficultés et vos doutes. Je dois faire un voyage à ***, la semaine prochaine. Le temps ne me permettra pas de m’arrêter en y allant ; mais en revenant, j’aurai l’honneur de descendre au château, et nous pourrons conférer à loisir sur une matière qui vous intéresse tant et à si juste titre.
Entretiens sur l’inspiration de la Bible
Premier entretien
L’ABBÉ.
Me voici prêt, Madame, à dégager ma promesse.
LUCILE.
Soyez le bienvenu,Monsieur l’Abbé, je suis vraiment impatiente de vous entendre.
M. DE LASSALLE.
Vous avez un entretien particulier, je me retire.
LUCILE.
Mon ami, tu n’es pas de trop. Tu sais que je commence à m’occuper de religion. M. l’Abbé a bien voulu venir à ma prière, pour éclaircir quelques doutes que je lui ai soumis. Tu n’as pas moins besoin que moi de ses instructions; et qui sait ? le plus près de croire de nous deux n’est peut-être pas celui qu’on pense.
M. DE LASSALLE.
Non, mon enfant, M. l’Abbé ne saurait douter du plaisir que j’ai toujours à l’entendre ; mais il vaut mieux pour toi que je te laisse avec lui. Tu connais mon esprit sceptique. La crainte de te troubler me gênerait moi-même, et je ne m’expliquerais pas avec la liberté nécessaire pour une discussion approfondie, que je ne redoute pourtant pas.
L’ABBÉ.
La religion ne la redoute pas davantage, Monsieur. C’est une faveur, je devrais dire une justice, qu’elle sollicite toujours, mais qu’elle obtient rarement. Demeurez, je vous prie, et faites-moi la grâce de vous expliquer sans réserve. Après ce que vous venez de dire, votre présence m’est nécessaire pour convaincre l’esprit de madame. J’aurais beau répondre à ses raisons, il lui resterait toujours l’arrière-pensée que j’aurais eu moins bon marché des vôtres.
M. DE LASSALLE.
Je resterai, puisque vous le voulez ; mais je vous rends responsable des conséquences. N’allez pas non plus vous formaliser si je vous parle
Avec la liberté
D’un soldat qui sait mal farder la vérité.
L’ABBÉ.
C’est ce que je demande, et je vous en donnerai l’exemple. La politesse, sans doute ; mais la vérité avant tout.
M. DE LASSALLE.
Eh bien ! Monsieur l’Abbé, pour me mettre à l’aise avec vous, je vous confesse tout d’abord que je suis disciple de Jean-Jacques. Voltaire et son école ne me vont pas : il est trop léger pour contenter un homme réfléchi, et trop méchant pour plaire à un homme de bien. Mais ma profession de foi est celle du Vicaire savoyard. Voilà qui est grave, solide, éloquent ; j’y vois le cachet du bon sens et de la vérité. Je crois un Dieu et une vie future : mais la révélation, je n’y crois guère.
L’ABBÉ.
Et moi,Monsieur, si j’avais à choisir un maître, c’est Pascal que je nommerais. Vous conviendrez, je pense, qu’il ne le cède à personne en véritable éloquence ; et pour la solidité des arguments comme du caractère, il vaut bien Rousseau, n’est-il pas vrai ? Mais laissons les hommes et voyons les raisons. Quelles sont, je vous prie, celles qui vous empêchent de croire à la révélation ?
M. DE LASSALLE.
J’en ai cent pour une. Voici la première qui me vient à l’esprit. Il y a autant de religions prétendues révélées qu’il y a de peuples dans le monde. Chaque nation a la sienne, qui lui vient de Dieu en droite ligne et qui a ses preuves irrésistibles, ses miracles et ses prophètes. Les croire toutes, c’est impossible, puisqu’elles se contredisent et s’anathématisent entre elles. Mais de quel droit choisir ? En croire une et rejeter toutes les autres, passez-moi ma franchise, n’est-ce pas une partialité manifeste ? Je suis plus conséquent : je les rejette toutes.
L’ABBÉ.
Votre franchise ne me déplaît nullement, Monsieur, mais votre logique me semble en défaut. Qu’il y ait tant que vous voudrez de religions qui se vantent faussement d’une origine divine, ce n’est pas une preuve qu’il n’existe nulle part de révélation véritable. De ce qu’il y a vingt-trois personnes qui aspirent aussi bien que vous à la succession de votre cousin M. de Lacombe, le tribunal devra-t-il en conclure qu’il n’y a point d’héritier légitime, et vous débouter de vos prétentions avec tous les autres sans voir les pièces ?
Il y a plus. Tant de prétentions mal fondées me persuadent, quant à moi, qu’il doit y avoir quelque part un droit réel. Le mensonge est trop léger pour se soutenir tout seul ; il ne saurait prendre qu’en s’appuyant sur quelque vérité, à la faveur de laquelle il s’établit dans l’opinion. Ces vingt-trois compétiteurs n’auraient jamais songé à produire de faux titres, si les justes réclamations de votre famille ne leur en eussent suggéré la pensée. On n’a eu l’idée de battre de fausse monnaie, que parce qu’il y en a de véritable ; et les charlatans n’ont tant de crédit sur l’esprit du peuple, que parce qu’il y a des médecins et de vrais remèdes. Vous voyez ma pensée. Si Dieu n’eût parlé aux hommes, et s’il ne leur eût parlé dès le commencement du monde, ce que votre Rousseau appelle « la fantaisie des révélations » n’aurait jamais pris naissance. Et ainsi, au lieu de conclure qu’il n’y a point de véritable révélation, puisqu’il y en a tant de fausses, il faut dire, au contraire, qu’il n’y en a de fausses que parce qu’il y en a une véritable 1.
M. DE LASSALLE.
Cette réflexion est toute nouvelle pour moi. Je pourrais bien trouver quelque chose à répondre ;mais cela ne me paraît pas nécessaire. Car, quoi qu’il en soit, c’est assez qu’il existe une telle quantité de fausses révélations pour qu’on ne puisse jamais s’y reconnaître. Y eût-il une révélation véritable, ce que je ne crois pas, il serait impossible de la démêler dans cette confusion.
L’ABBÉ.
Pas si impossible que vous le pensez. On a fait beaucoup de bruit des religions fausses pour discréditer la véritable. Mais de religions qui se soient incontestablement et sérieusement attribué une origine divine, dans le même sens que le fait celle de Jésus-Christ, en d’autres termes, de religions qui nous présentent un livre dont l’auteur soit bien connu et qu’elles nous donnent pour inspiré, il y en a peu. Et cependant on ne peut parler que de celles-là. Ce serait une chose trop vaine que de nous alléguer je ne sais quelles prétentions qui ne sont déposées dans aucun témoignage écrit, et au sujet desquelles on peut affirmer tout ce qu’on veut, parce qu’elles se perdent dans la nuit des temps. Il faut bien avoir sur quoi fonder une discussion ; et vous n’irez pas apparemment comparer aux titres de la religion chrétienne les oracles des Sybilles ou les leçons d’Hermès Trismégiste.
M. DE LASSALLE.
Eh bien ! soit : tenons-nous-en aux révélations qui ont des livres tels que vous les demandez. Encore-trouvons-nous dans cette catégorie la religion de Jésus-Christ, celle de Moïse, celle de Mahomet, celle de Zoroastre, celle de Sanchoniaton, celle de Confucius, celle de Brahma, celle d’Odin, etc., etc.
L’ABBÉ.
C’est ce que je nie. Vous parlez d’après vos philosophes du siècle dernier, qui n’étaient pas toujours fort scrupuleux dans leurs assertions. A l’exception de Moïse, de Jésus-Christ et de Mahomet, il n’y a rien de solide dans tout cela. Tous les autres livres que vous venez de nommer, ou ne sont pas d’une authenticité démontrée, ou ne se donnent pas pour inspirés. Autre chose est qu’il s’y trouve jeté quelques mots sur un secours du ciel, autre chose qu’ils s’attribuent une inspiration proprement dite, comme la Bible ou le Coran. Vous me parlez de la révélation de Zoroastre. Mais quand la tradition n’en serait pas si incertaine qu’elle compte jusqu’à six Zoroastres différents, quand l’authenticité du Zendavesta ne serait pas contestée comme elle l’est, ce livre est plutôt un traité de théologie, de philosophie et de bien d’autres choses encore qu’une prétendue révélation. L’auteur en est moins un faux prophète qu’un législateur, ce qui est le nom que lui donne M. Anquetil du Perron, et on peut le comparer à Solon et à Lycurgue, qui ont invoqué l’autorité des dieux pour leur législation sans se donner pour des prophètes. Quant à Confucius, il a si peu revendiqué ce caractère qu’on ne trouve aucune notion d’un Dieu ni d’une vie à venir dans les livres dont on le fait l’auteur 2. On n’a de Sanchoniaton qu’un fragment plus que suspect, que nous tenons de la quatrième main : il nous est rapporté par des Pères de l’Église, qui ont cité Porphyre (adversaire déclaré du christianisme), qui a cité Philon de Biblos, qui a cité l’auteur phénicien. Les Indous ont, il est vrai, des livres qu’ils croient inspirés ; mais ces livres n’ont rien qui ressemble à une origine authentique : le mystère le plus impénétrable couvre leur naissance. Non, Monsieur : parlons, s’il vous plaît, de choses claires, saisissables. Je ne trouve de religions qui aient prétendu à une inspiration divine pour des écrivains bien connus, que ces trois, celle de Moïse, celle de Jésus-Christ et celle de Mahomet. Et tout cela, notez-le bien, sort d’un même principe : car Jésus-Christ s’appuie sur Moïse, et Mahomet prétend s’appuyer sur les deux autres. L’Ancien Testament, le plus vieux de tous les livres, en appelle clairement à l’inspiration de Dieu; c’est de cette source commune que sont venues toutes les révélations, vraies ou fausses, qui se sont accréditées dans le monde, et parmi lesquelles il n’en est que trois dont il soit possible ou nécessaire de vérifier les pouvoirs.
M. DE LASSALLE.
Toujours faudrait-il étudier et comparer au moins ces trois religions et ces trois livres. Combien y a-t-il d’hommes qui soient capables de cette étude?
L’ABBÉ.
Ce travail ne serait pas infini ; mais il peut se resserrer encore. La religion judaïque et la chrétienne tiennent ensemble de telle sorte que si la seconde est de Dieu, la première, à laquelle elle rend témoignage, en est aussi. Et la religion chrétienne est si fort opposée à la mahométane que si celle-là est divine, celle-ci ne saurait l’être. En voici une preuve qui suffit, sans en chercher d’autres : Jésus-Christ étant Dieu d’après l’Évangile, Mahomet ne peut être un plus grand prophète que Jésus-Christ, comme le veut le Coran, sans que l’Évangile soit renversé de fond en comble. Cela étant, Monsieur, nous pouvons commencer nos recherches par la religion de Jésus-Christ. Si nous lui reconnaissons une origine divine, tout sera dit alors en faveur de Moïse et contre Mahomet ; dans le cas contraire, il sera temps d’examiner à leur tour les titres des deux autres. Cet ordre doit d’autant plus avoir votre approbation que celles des trois religions qui a les plus grandes apparences pour elle, vous n’en disconviendrez pas, c’est la religion chrétienne. Voici notre discussion bien simplifiée, puisqu’il ne s’agit plus que d’une seule religion, et d’une religion dont les documents se rapportent à des temps bien connus. Voyez ce que deviennent toutes les déclamations de Rousseau sur l’impossibilité de faire un pas dans la recherche qui nous occupe : elles sont d’une éloquence qui entraîne en dépit de soi, mais c’est l’éloquence d’un sophiste.
Lucile.
Il me semble, mon ami, que tu ne peux refuser ce que te demande M. l’Abbé. Tout le monde gagne à préciser l’objet de la discussion.
M. DE LASSALLE.
Je me laisse mener un peu où vous voulez, Monsieur l’Abbé. Mais enfin commençons par la religion chrétienne, sans préjudice des autres.
Je ne nie pas qu’il n’y ait dans l’Évangile, surtout dans sa morale et dans le caractère de son fondateur, des traits admirables et qui m’ont fait parfois désirer d’y croire. Mais cette même religion a des choses si incroyables que je ne puis les admettre, ni même les concevoir. Je dirai volontiers avec mon auteur favori : « Si je vois en sa faveur des preuves que je ne puis combattre, je vois aussi contre elle des objections que je ne puis résoudre. Il y a tant de raisons solides pour et contre, que, ne sachant à quoi me déterminer, je ne l’admets ni ne la rejette, » In dubio abstine, dit-on; je m’abstiens donc.
L’ABBÉ.
Cela n’est pas possible en pareille matière. L’Évangile contredit l’opinion commune sur beaucoup de points ; dès que vous demeurez incertain, vous suivez l’opinion commune et vous rejetez l’Évangile. Ce que Pascal a dit en parlant de l’existence de Dieu, « ne pas parier que Dieu est, c’est parier qu’il n’est pas, » est encore plus vrai de la religion chrétienne : c’est se déterminer contre elle que de ne pas se déterminer en sa faveur. « Qui n’est pas pour moi, dit Jésus-Christ, est contre moi. »
M. DE LASSALLE.
Cela pourrait bien être ; mais ce n’est pas ma faute si le christianisme répugne à ma raison.
L’ABBÉ.
En quoi ?
M. DE LASSALLE.
Ah! en bien des choses. Par exemple, que Dieu se soit incarné, que Jésus-Christ soit né d’une vierge ; que l’innocent souffre pour le coupable, etc. ; et qu’il faille croire tout cela, qu’on le puisse ou non, sous peine d’être brûlé en enfer, seulement pendant toute l’éternité !
L’ABBÉ.
Permettez, cher Monsieur, procédons avec ordre. Vous trouvez dans la doctrine chrétienne des choses qui vous étonnent, qui vous scandalisent ; je le conçois.Mais voici le point à éclaircir avant tout : l’Évangile vient-il de Dieu ou n’en vient-il pas ? Une fois convaincu que Dieu a parlé, vous ne refuseriez pas, je pense, de recevoir ce qu’il a dit, conforme ou non à vos idées. Car enfin Dieu en sait plus que nous, et ce n’est pas faire tort à notre raison que de la soumettre à la raison de son Créateur. Vous dites à votre petit Théophile que c’est la terre qui tourne, non le soleil. Cela est contraire au jugement de son jeune cerveau et au témoignage même de ses yeux; il le croit pourtant parce que c’est vous qui le dites. A-t-il tort ?
M. DE LASSALLE.
Il a raison : il doit se fier à mon jugement plus qu’au sien. Mais il sait pour sûr que c’est son père qui lui parle ; et moi je ne suis pas assuré, je ne puis jamais l’être, que Dieu m’ait parlé dans l’Évangile. C’est ce premier pas qui est impossible à faire. Car enfin comment m’en assurerai-je ? n’est-ce pas avec le secours de ma raison ?
L’ABBÉ.
Sans aucun doute.
M. DE LASSALLE.
Mais si ma raison est aussi blessée des enseignements de l’Évangile que satisfaite de ses preuves, que faire alors ? Il faut bien dans ce cas que ma raison soit en défaut d’un côté ou de l’autre ; et n’ai-je pas autant de sujet de me défier d’elle quand elle pèse les arguments que lorsqu’elle juge la doctrine ?
L’ABBÉ.
Non, Monsieur ; peser les arguments et juger la doctrine, ce sont deux choses fort différentes. Permettez-moi de suivre ma comparaison. Si la raison de Théophile est aussi blessée d’entendre dire que la terre tourne, qu’elle est convaincue que c’est son père qui le lui dit, que fera-t-il ? D’après vous, il pourra aussi bien douter si vous lui avez parlé qu’admettre le mouvement de la terre.
M. DE LASSALLE.
Ah! Monsieur l’Abbé, vous vous moquez. Il ne lui faut que des yeux pour reconnaître son père, au lieu qu’il faut pour étudier le mouvement des astres une intelligence qui lui manque et des observations qu’il ne peut pas faire. Théophile sait bien faire cette différence, tout jeune qu’il est.
L’ABBÉ.
Bien dit. Je dis de même : Ex ore tuo te judicabo ; c’est-à-dire, Monsieur, votre propre bouche va déposer contre vous. Pour peser les arguments, pour savoir si des miracles ont été faits ou si des prophéties se sont accomplies, il ne faut que des recherches dont la raison est capable.Mais pour juger la doctrine, pour savoir quel est Dieu, sa nature, sa volonté, ses décrets, il faut des lumières que la raison ne possède pas. Que la Bible vienne de Dieu ou des hommes, c’est, passez-moi l’expression, un fait terrestre et qui tombe sous l’observation humaine. Mais que Dieu ait telle nature, telle volonté, tels desseins, c’est un fait céleste et qui est en dehors du champ de notre expérience.
M. DE LASSALLE.
Excusez-moi, Monsieur, je ne vous comprends peut-être pas bien ; mais vous me paraissez en contradiction avec vous-même. J’en reviens toujours à ce dilemme si simple : ou la raison est capable de nous guider, ou elle ne l’est pas. Dans le premier cas, elle n’a pas besoin d’une révélation ; dans le second, elle n’en peut pas vérifier les pouvoirs.
L’ABBÉ.
Voilà de ces maximes générales et absolues avec lesquelles on embrouille les questions, tout en paraissant les éclaircir. Le fait est que la raison est capable de nous guider pour certaines choses, incapables pour d’autres. Elle peut nous guider pour les choses d’expérience et d’observation ; et c’est assez pour vérifier les pouvoirs de l’Évangile.Mais pour les choses de Dieu, elle ne peut pas nous guider ; et c’est assez pour rendre une révélation nécessaire. C’est toujours comme Théophile qui peut reconnaître son père, mais qui ne sait pas étudier le mouvement des astres. Prenons une autre comparaison qui se rapporte plus directement encore à cette partie de notre sujet. Un aveugle ne peut pas découvrir son chemin de lui-même; mais il sait fort bien discerner si la voix de la personne qui s’offre à le conduire est celle d’un ami. Il est incompétent dans le premier cas, parce que l’organe de la vue lui fait défaut ; il est compétent dans le second, parce qu’il possède l’organe de l’ouïe. Il n’y a point là de contradiction. Il n’y en a pas davantage en moi, Monsieur, quand je me sers des facultés dont jouit ma raison pour discerner si la voix de l’Évangile est en effet celle de Dieu, et que je supplée ensuite à celles qui lui manquent en me laissant conduire par la voix céleste. Défiant jusqu’à la preuve faite, mais après cela confiant, parfaitement confiant ; car mon intelligence bornée n’a pas moins besoin de la lumière de Dieu que l’aveugle des yeux de son ami. « La raison, dit saint Augustin, ne se soumettrait jamais, si elle ne jugeait qu’il y a des occasions où elle doit se soumettre. Il est donc juste qu’elle se soumette quand elle juge qu’elle doit se soumettre, et qu’elle ne se soumette pas quand elle juge avec fondement qu’elle ne doit pas le faire. Mais il faut prendre garde à ne pas se tromper 3. »
LUCILE.
Mon ami, voilà une distinction bien simple à laquelle je n’avais pas songé, et qui fait tomber une bonne partie des objections de ton Vicaire.
M. DE LASSALLE.
Je ne nie pas tout à fait cela ; mais je doute que nous en soyons plus avancés. Reste à savoir si notre raison peut en effet vérifier les pouvoirs de l’Évangile. Les preuves de la révélation sont et doivent être surnaturelles ; mais notre raison, qui est dans la nature, ne peut rien saisir de ce qui est surnaturel. Vous nous avez dit, Monsieur, que ce n’est là qu’une recherche terrestre. Certes, je ne conçois pas cela : qu’y a-t-il de plus céleste qu’un miracle ?
L’ABBÉ.
Un miracle vient du ciel, cela est vrai ; mais il s’accomplit sur la terre. C’est dans ce sens que je l’ai appelé un fait terrestre, qui tombe sous l’observation, à la différence des pensées et des décrets de Dieu, que nul homme ne peut voir et qu’on ne peut connaître que par une révélation. Le miracle, devant prouver la révélation, n’a pas besoin d’être révélé lui-même. Il se voit, exactement comme un événement naturel, et ceux qui l’ont vu en rendent témoignage aux autres. Jésus est-il ou n’est-il pas ressuscité des morts ? C’est une question d’histoire, que la raison humaine peut résoudre tout aussi bien que celle-ci : César, a-t-il été assassiné dans le sénat de Rome ou ne l’a-t-il pas été ? La seule différence qu’on doive faire entre un miracle et un événement naturel, c’est qu’il est juste de demander en faveur du premier des témoignages plus considérables, parce qu’il est plus difficile à croire que l’autre et qu’il a des suites plus graves. Mais le miracle bien prouvé, notre raison, qui sait bien que la nature humaine n’est pas capable de telles choses, est obligée de conclure que Dieu y a eu la main et qu’une religion accompagnée de tels signes est son ouvrage.
M. DE LASSALLE.
Passe encore si j’avais vu le miracle de mes yeux.Mais le malheur est que d’autres ont vu pour moi, et des témoins que je n’avais pas choisis. Ce mot de Rousseau me revient toujours : « Que d’hommes entre Dieu et moi! »
L’ABBÉ.
C’est-à-dire que pour être plus libre de rejeter les miracles, vous récusez la preuve du témoignage, la seule par laquelle ils puissent s’établir. Mais y songez-vous ? Si vous ne pouvez être certain que de ce que vous avez observé par vos propres yeux, à quoi serez-vous réduit ? Combien de choses que vous ne savez que par le témoignage et dont vous n’avez pas le plus léger doute ! Quelle autre preuve avez-vous de l’existence de l’Amérique ou de l’histoire d’Alexandre ? Vous est-il jamais venu à l’esprit de douter de l’une ou de l’autre ? Croyez seulement à la résurrection de Jésus-Christ comme vous croyez à l’Amérique ou à Alexandre, et cela me suffit. Supposez qu’il s’élevât aujourd’hui en France un vrai prophète qui fît de vrais miracles, publiquement, à Paris, à Lyon, à Marseille, vous semble-t-il qu’il n’y aurait absolument aucun moyen de les attester d’une manière assez authentique pour convaincre les nations étrangères et les générations futures qui ne les auraient pas vus de leurs yeux? Soyons de bonne foi. Au fond, vos doutes portent bien plus sur la possibilité de faire un miracle, que sur celle de le prouver s’il était fait. Si vous n’étiez préoccupé de la pensée qu’un miracle est impossible en soi, vous reconnaîtriez bientôt qu’il y a tel témoignage qui suffit pour en démontrer la vérité, et que ce témoignage existe en faveur des miracles de l’Évangile.
M. DE LASSALLE.
Je nem’en défends pas : un miraclem’a toujours paru impossible. C’est que je le trouve indigne de celui à qui on l’attribue. Ce bel ordre de la nature que le miracle se vante de troubler, c’est la grandeur de Dieu et sa gloire. Ne pouvait-il relever un de ses ouvrages sans en gâter un autre ?
L’ABBÉ.
Quand il serait vrai, Monsieur, que l’ordre du monde physique soit la plus belle des œuvres de Dieu, je ne vois pas ce que sa gloire perdrait à en suspendre un instant le cours. Non seulement cette suspension ferait ressortir avec plus d’éclat l’harmonie habituelle de la création, mais on y verrait une marque incontestable que Dieu en est l’auteur et le maître. Ce n’est pas la gloire de l’œuvre qui importe, c’est celle de l’ouvrier. Et que diriez-vous si un temps devait venir où les cieux et la terre seront embrasés et consumés avec tout ce qu’ils renferment, pour faire place « à de nouveaux cieux et à une nouvelle terre ? » Ce temps viendra, Monsieur, et ce miracle des miracles, croyez-le, n’ôtera rien à la gloire de Dieu. Mais c’est une grande erreur de penser que le monde physique soit la plus glorieuse de ses œuvres. La plus glorieuse des œuvres de Dieu, c’est le monde des esprits, le monde moral. Je ne doute pas que vous ne soyez d’accord avec Pascal dans cette belle pensée : « Tous les corps, le firmament, les étoiles, la terre et les royaumes, ne valent pas le moindre des esprits ; car il connaît tout cela, et soi-même; et le corps, rien. » La plus haute gloire du monde physique, c’est qu’il figure et représente aux yeux les phénomènes du monde moral, dont il est comme un type et un reflet : « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et ses perfections invisibles se voient comme à l’œil dans ses ouvrages depuis la création du monde. » Ainsi, un arbre qui croît et qui pousse des feuilles et des fruits est l’emblème d’un esprit qui, grandissant dans la vérité de Dieu, se développe et se répand en lumière et en œuvres de charité. Sous ce point de vue, comparaison peut bien être parfois raison, malgré le proverbe ; car c’est la même main qui a fait les deux mondes, et on y reconnaît le même dessein. Dès lors, il peut entrer dans le plan de Dieu de sacrifier quelque chose de l’ordre naturel pour sauver l’ordre spirituel ou pour le rétablir. Tel est l’objet du miracle. C’est comme une ouverture pratiquée dans le ciel physique, pour nous laisser apercevoir le ciel moral qui est au-dessus.
M. DE LASSALLE.
Vous avez toujours des comparaisons toutes prêtes, et toutes les grâces du langage sont à votre disposition, Monsieur l’Abbé; mais voulez-vous que je vous dise une raison qui me déciderait à elle seule contre la religion chrétienne? C’est qu’elle n’est pas connue de tout le monde. On nous prédit bien qu’elle doit pénétrer un jour chez les nations les plus reculées et couvrir toute la terre ; les prédictions ne coûtent rien; Mais, en attendant, elle a laissé passer quarante siècles avant de faire son apparition dans le monde; et, depuis dix-huit siècles qu’elle y est, c’est à peine si elle est parvenue au quart du genre humain. Que d’hommes, que de familles, que de peuples ont péri sans en avoir entendu parler ! Est-il croyable qu’une révélation indispensable à connaître pour se sauver, ne fût pas pas mise à la portée de tous les peuples, je dis plus, de tous les hommes! Quoi! le soleil luit pour tous depuis le premier jour du monde, ou si vous l’aimez mieux depuis le quatrième ; et la lumière de la révélation, qui est bien autrement importante, est cachée au plus grand nombre !
L’ABBÉ.
Vous soulevez ici, Monsieur, une difficulté plus sérieuse que les précédentes ; mais elle ne porte pas sur la religion seulement. Elle tient à tout le plan de Dieu. La lumière du soleil se lève à la fois sur tout le monde, parce que c’est une chose où l’homme n’est pour rien.Mais quand il s’agit d’avantages intellectuels et moraux, où les hommes peuvent avoir leur part de travail, nous voyons partout que Dieu la leur donne et les fait être « ses coopérateurs, » selon une expression de l’Écriture sainte. Ni la lumière de la civilisation, ni celle des arts ne s’est répandue tout d’un coup chez tous les peuples. Tout cela est venu par degrés avec le concours de l’homme et le labeur des siècles. Ne nous en plaignons pas ; c’est un honneur que Dieu fait au génie et à la liberté de l’homme que de l’associer en quelque sorte à son œuvre. Pourquoi nous étonner qu’il ait suivi pour la religion l’ordre que nous lui voyons suivre pour tout le reste ?
M. DE LASSALLE.
C’est bien différent. Car l’ignorance dans les choses que vous venez de nommer ne compromet pas le salut ; mais l’ignorance en matière de religion l’empêche, selon vous ; et tous ces malheureux païens sont perdus à tout jamais pour n’avoir pas cru en Jésus-Christ qu’ils n’ont pas seulement entendu nommer.
L’ABBÉ.
N’exagérons rien. L’Évangile ne dit pas cela, et l’Église ne le dit pas non plus. « Dieu jugera les peuples selon l’équité, » et nul ne sera puni d’avoir ignoré ce qu’il n’a pas pu connaître. Si le païen est condamné, ce ne sera pas pour n’avoir pas cru à l’Évangile, mais pour avoir péché contre la lumière naturelle qui n’est refusée à personne. C’est par là que saint Paul lui ôte toute excuse dans le premier chapitre de son Épître aux Romains.