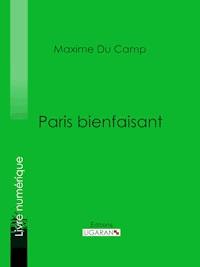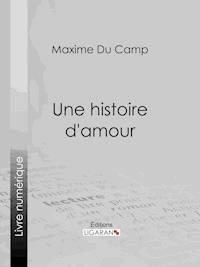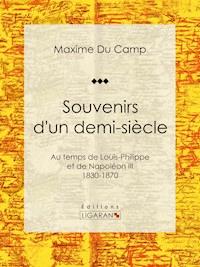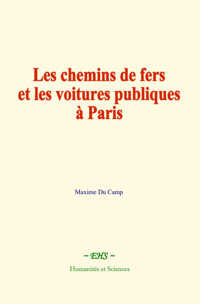
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EHS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Pendant longtemps on ne put voyager en France qu’à pied ou à cheval, et la voiture faisant de longs trajets est une invention relativement moderne. Les premiers coches appartenaient à l’Université, dont les messagers étaient primitivement destinés à amener les écoliers à Paris et à les reconduire dans leur province. Ils partaient fort au hasard, selon le temps qu’il faisait, selon la saison, selon leur fantaisie. En 1517, on voit s’établir entre Paris et Orléans le premier service de carrosses. Henri IV, guidé par Sully qui semble avoir toujours été préoccupé de faire communiquer les différentes parties de la France les unes avec les autres, institua un surintendant général des carrosses publics, et le parlement ne dédaigna pas de fixer lui-même le prix des places ; en 1610, au moment de la mort du roi, les coches mettaient Paris en relations suivies et régulières avec Orléans, Châlons, Vitry, Château-Thierry et quelques autres villes.
Louis XIV, qui voulait que tout en France découlât directement de l’autorité royale, ordonna en 1676 que les divers services de messageries, de coches, de carrosses, seraient réunis à la ferme des postes. C’était donner à cette dernière administration un labeur au-dessus de ses forces ; aussi, ne conservant que le transport des dépêches, elle abandonna celui des personnes et des marchandises à différents industriels qui l’acceptèrent à bail débattu. Cet état de choses dura jusqu’en 1775. À cette époque, le roi, réunissant au domaine les concessions précédemment faites, racheta tous les baux et fit créer un service de voitures uniformes pour tout le royaume...
Ce fut là en réalité le premier service public, régulier, sérieux, responsable, établi en France pour le transport des voyageurs ; il constituait un progrès remarquable et était un véritable bienfait pour la population.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 162
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les chemins de fers et les voitures publiques à Paris
Les chemins de fers et les voitures publiques à Paris
Exposé historique
Maxime Du Camp
EHS
Humanités et Sciences
Première partie
Les chemins de fer à Paris{1}
I. Les tâtonnements et les premiers moyens de transport en France.
Pendant longtemps on ne put voyager en France qu’à pied ou à cheval, et la voiture faisant de longs trajets est une invention relativement moderne. Les premiers coches appartenaient à l’Université, dont les messagers étaient primitivement destinés à amener les écoliers à Paris et à les reconduire dans leur province. Ils partaient fort au hasard, selon le temps qu’il faisait, selon la saison, selon leur fantaisie. En 1517, on voit s’établir entre Paris et Orléans le premier service de carrosses. Henri IV, guidé par Sully qui semble avoir toujours été préoccupé de faire communiquer les différentes parties de la France les unes avec les autres, institua un surintendant général des carrosses publics, et le parlement ne dédaigna pas de fixer lui-même le prix des places ; en 1610, au moment de la mort du roi, les coches mettaient Paris en relations suivies et régulières avec Orléans, Châlons, Vitry, Château-Thierry et quelques autres villes.
Louis XIV, qui voulait que tout en France découlât directement de l’autorité royale, ordonna en 1676 que les divers services de messageries, de coches, de carrosses, seraient réunis à la ferme des postes. C’était donner à cette dernière administration un labeur au-dessus de ses forces ; aussi, ne conservant que le transport des dépêches, elle abandonna celui des personnes et des marchandises à différents industriels qui l’acceptèrent à bail débattu. Cet état de choses dura jusqu’en 1775. À cette époque, le roi, réunissant au domaine les concessions précédemment faites, racheta tous les baux et fit créer un service de voitures uniformes pour tout le royaume. Les messageries royales s’installèrent rue Notre-Dame-des-Victoires, où elles sont encore ; les diligences qu’elles livrèrent au public furent ces turgotines dont on a tant parlé jadis et qui semblaient alors le nec plus ultra du confortable et de la rapidité. Le surnom qu’on leur avait donné indique suffisamment qu’elles étaient l’œuvre de l’infatigable Turgot ; le public les adopta avec reconnaissance, mais elles encoururent un reproche que l’on n’avait guère soupçonné : on les accusa d’encourager l’athéisme. En effet, les anciens entrepreneurs de voitures devaient, par leur cahier des charges, offrir aux voyageurs la possibilité d’entendre la messe; l’activité de service imprimée aux turgotines supprimait la messe et le chapelain : d’où grande colère dans ce que l’on appellerait aujourd’hui le parti clérical ; on ne ménagea pas les insultes à Turgot, et les anas du temps ont conservé ce quatrain injurieux :
Ministre ivre d’orgueil, tranchant du souverain,Toi qui, sans t’émouvoir, fais tant de misérables.Puisse ta poste absurde aller un si grand train.Qu’elle te mène à tous les diables !
Quoi qu’il en soit, ce fut là en réalité le premier service public, régulier, sérieux, responsable, établi en France pour le transport des voyageurs ; il constituait un progrès remarquable et était un véritable bienfait pour la population, qui semble cependant n’en avoir pas compris toute l’importance, car bien des cahiers des états généraux formulent le vœu « que l’on supprime le privilège des messageries, et, par contre, qu’on diminue le nombre des grandes routes. » Idée fausse par excellence. Par ce moyen on eût rendu, il est vrai, des terres à l’agriculture, mais on eût immobilisé les denrées et détruit tout mouvement commercial.
Modifiée dans sa constitution par les lois du 29 août 1790, du 25 vendémiaire an III, du 9 vendémiaire an VI, cette entreprise s’est sans cesse améliorée ; elle a servi de modèle à ses rivales, qui ne l’ont jamais complètement égalée, et elle a fonctionné avec un succès que la construction des chemins de fer devait arrêter pour toujours. Autour de ces messageries qui tour à tour, suivant le vent politique qui soufflait, furent royales, nationales, impériales, s’étaient groupées diverses entreprises qui reliaient Paris à la banlieue et à la province. C’étaient les diligences Laffitte et Caillard, les gondoles, les accélérées, les carabas, les pots-de-chambre, les coucous, les tapissières, sans compter ces voitures de louage qu’on appellerait aujourd’hui de grande remise, calèches, briskas, landaus, qui le dimanche menaient les familles bourgeoises à la campagne. Les chemins de fer ont mis à néant tous ces véhicules qui furent la joie de notre enfance et qui maintenant n’existent plus que dans notre souvenir.
Quelques-uns ont tenu contre la mauvaise fortune et ont voulu protester jusqu’à la fin. Le dernier coucou n’a disparu de Paris qu’en 1861 ; il siégeait place de la Bastille et allait à Vincennes. Son cocher, un vieux cocher d’autrefois, à carrick et à sabots fournis de paille, appelait les voyageurs, les entassait dans sa boite incommode, en prenait un en lapin, fouettait ses rosses amaigries et partait au petit trop balancé. Il était fier sans doute de son entêtement, car sur la caisse jaune de la voiture on lisait en grosses lettres noires : Au coucou obstiné.
Nous qui sommes accoutumés aux rapidités de la vapeur, nous sourions volontiers de ces façons de voyager si désagréables et si lentes. Ces voitures de toute sorte étaient cependant bien supérieures à ce qui les avait précédées. Avant elles, les moyens de communication étaient presque nuls. Quand, le 21 août 1715, Louis XIV, après avoir passé une revue à Marly, rentra souffrant du mal qui devait l’emporter, et qu’on lui ordonna les eaux de Bourbon-l’Archambault, on fut obligé d’établir entre cette dernière localité et Versailles des relais pour les deux cents chevaux destinés à traîner les six charrettes payées 25 livres par jour, qui servaient à voiturer la boisson et les bains du roi. Le bonhomme Buvat raconte, dans son Journal de la régence, qu’à Lyon, Aix, Strasbourg, Bordeaux, au moment de l’agiotage de la rue Quincampoix, « les carrosses et autres voitures publiques étaient retenues deux mois d’avance et que même on agiotait les places, tant il y avait d’empressement de tous les côtés pour venir à Paris pour avoir des actions, comme si c’eût été le comble de la fortune la plus assurée. »
Lorsque en 1721 mademoiselle de Montpensier épousa le prince des Asturies, elle employa trente jours à franchir les 187 lieues qui séparent Paris de Bayonne. Il est juste de dire qu’elle marchait en gala, et s’arrêtait souvent ; mais en 1775 le service régulier des turgotines mettait vingt jours, c’est-à-dire quatre cent quatre-vingts heures, à accomplir le même trajet : aujourd’hui il dure exactement seize heures dix minutes, et encore on perd cinquante minutes à Bordeaux. Il y a cent ans, il fallait douze jours pour aller de Paris à Strasbourg, dix pour aller à Lyon, trois pour aller à Rouen. La moyenne du parcours quotidien était de dix lieues ; le soir on s’arrêtait, à toutes les côtes on descendait de voiture pour soulager les chevaux, à toutes les descentes on mettait pied à terre par prudence, la maréchaussée escortait les voitures par crainte des voleurs, qu’on n’évitait pas toujours. Les chemins de fer, en supprimant la distance, ont doublé la vie de l’homme qui voyage.
La France a été lente, très-lente à accepter franchement ce nouveau mode de locomotion ; par suite d’un esprit de défiance et de paresse assez difficile à définir, elle en était encore aux hésitations et aux tâtonnements que déjà l’Angleterre et la Belgique construisaient en hâte et partout des voies ferrées. Comme bien des découvertes, celle-là s’égara dès le principe, et il fallut attendre bien des années avant qu’elle pût franchir l’énorme distance qui sépare la théorie de la pratique. En principe, les chemins de fer sont nés de cette idée fort simple qui déjà dans l’antiquité avait créé les voies romaines : supprimer par des moyens artificiels les causes naturelles de résistance offertes à la traction. Depuis des siècles on se servait en Allemagne, dans les mines du Harz, de chemins à bandes de bois (hudegestœnge) qui facilitaient singulièrement le passage des chariots. Il est à présumer que les ouvriers allemands ont introduit ce système en Angleterre lorsque la reine Elisabeth les y appela pour exploiter les mines de Newcastle. C’est là du moins qu’en 1676 on constate d’une façon certaine l’emploi dans les houillères anglaises des premiers chemins de bois. Un siècle plus tard, en 1776, l’ingénieur Cun, voyant les traverses de bois s’user rapidement au contact des roues, imagina de les remplacer par des bandes de fer qu’il nomma rails. Ces rails, d’abord plats, n’offrirent pas une grande solidité ; on les modifia, et sauf des détails peu importants, on les façonna en forme d’ornière saillante, comme nous les voyons encore aujourd’hui ; la roue qui devait les parcourir était munie d’un ourlet extérieur débordant qui l’empêchait de dévier. En somme, la voie était trouvée. On hésitait entre la fonte et le fer, et il fallut qu’en 1820 John Birkinshaw imaginât l’art de laminer les rails en fer pour que ces derniers fussent définitivement adoptés.
Restait le moteur à découvrir, et ce ne fut pas l’affaire d’un jour. Dans le principe, les wagons étaient traînés par des chevaux comme sur le chemin de fer dit américain qui va de la place de la Concorde à Versailles. Le premier homme qui tenta d’appliquer la vapeur à la traction des voitures sur les routes ordinaires fut un officier du génie nommé Cugnot, qui fît différents essais à Paris en 1769, et construisit même une machine ingénieuse qu’on peut voir exposée dans une des salles du Conservatoire des arts et métiers. Destinée, dans le principe, au transport des grosses pièces d’artillerie, elle fut expérimentée en présence de MM. de Choiseul et de Gribeauval. Asthmatique et oscillante, elle s’arrêtait fréquemment ; mal pondérée, elle donnait des à-coups inattendus et défonça un des murs de l’Arsenal. Bref, elle ne fut jamais que ce qu’elle est aujourd’hui, un objet de curiosité.
James Watt, le véritable inventeur de la machine à vapeur, c’est à-dire celui qui la rendit pratique, apporta dans la construction des perfectionnements dont chacun profita, et dès 1804 une locomotive construite par Trewithick et Vivian fut attelée à des wagons sur un chemin de fer des mines de Newcastle ; elle avait la vitesse d’un cheval de roulage, et le foyer était activé à l’aide de soufflets mis en jeu par les mouvements mêmes de la machine. Tout cela était bien incomplet. On était parti d’une théorie fausse, non expérimentée, et qui longtemps paralysa les essais. On croyait que la pesanteur de la locomotive l’immobiliserait et la forcerait à tourner sur place. Pour remédier à cet inconvénient imaginaire, Blenkinsop inventa des roues dentelées et Brunton alla jusqu’à armer sa locomotive de deux béquilles de fer qui s’élevaient et s’abaissaient à chaque tour des roues. Ce fut en 1813 seulement qu’on revint de cette erreur, grâce aux expériences faites avec succès par Blacken, et l’on reconnut alors que si le poids de la locomotive était suffisant pour maintenir l’adhérence sur les rails, il était loin d’être assez considérable pour la rendre stationnaire. On avançait lentement, pas à pas, à travers mille tentatives dont chacune constituait un progrès, mais ne donnait aux engins de traction ni sécurité ni vitesse.
La France peut réclamer sa part de gloire dans la mécanique appliquée aux transports, car ce fut M. Marc Séguin qui, en 1828, inventa la chaudière tubulaire, étendit la surface de chauffe dans des proportions inespérées qui devaient donner à la locomotion une continuité de puissance irrésistible. À la même époque, George Stephenson imaginait d’activer le tirage par un jet de vapeur échappée du cylindre. Ces deux améliorations étaient toute une révolution ; on allait enfin entrer dans la pratique ; en cette matière la pratique c’était l’établissement des chemins de fer, c’est-à-dire une rapidité de locomotion sans exemple et l’application d’une force infatigable aux transports de toute espèce.
Aussi, lorsqu’en 1829, au concours des machines ouvert par la Compagnie du Railway de Manchester à Liverpool, George Stephenson exposa la locomotive the Rocket (la Fusée), construite d’après les principes nouveaux de la chaudière tubulaire et de l’accélération du tirage, ce fut un cri d’admiration. Elle était à la fois forte et vive, car, pesant 4 316 kilogrammes, elle faisait 22 kilomètres à l’heure et remorquait un poids de 12912 kilogrammes. Elle ne ressemblait guère aux admirables machines que chaque jour, et sans même y prendre garde, nous voyons rouler sur nos voies ferrées ; elle était aux locomotives de Crampton ce que l’ichthyosaure est aux lézards ; mais telle qu’elle était, avec sa forme maladroite, ses roues trop écartées, son tender chargé d’une barrique pleine d’eau réservée à la chaudière, elle renfermait les organes principaux, organes de vie, de mouvement, de vigueur, qu’on a pu améliorer depuis et rendre presque parfaits, mais qui sont restés les organes essentiels et primordiaux de toute machine destinée à la traction.
Le moteur étant trouvé, comme la voie, les chemins de fer étaient créés. C’était une révolution analogue à celle qui, par la découverte de Gutenberg, avait substitué l’imprimerie à l’art des copistes. Dans sa biographie de James Watt, Arago se sert d’une comparaison saisissante pour faire comprendre à quelle puissance de force et à quelle rapidité d’action l’homme parvenait, grâce à la machine à vapeur : « L’ascension du mont Blanc, dit-il, à partir de la vallée de Chamouny, est considérée à juste titre comme l’œuvre la plus pénible qu’un homme puisse exécuter en deux jours. Ainsi le maximum mécanique dont nous soyons capables en deux fois vingt-quatre heures, est mesuré par le transport du poids de notre corps à la hauteur du mont Blanc. Ce travail ou l’équivalent, une machine à vapeur l’exécute en brûlant un kilogramme de charbon de terre. Watt a donc établi que la force journalière d’un homme ne dépasse pas celle qui est renfermée dans 500 grammes de houille. »
L’invention devait avoir d’incalculables conséquences ; mais le plus difficile restait à faire, il fallait qu’elle sortit du domaine de la science industrielle et entrât dans nos mœurs. La France y fut réfractaire à un point qu’il serait bien difficile de comprendre aujourd’hui, si nous ne savions que l’esprit de routine semble être l’âme même d’une nation dont l’entêtement seul égale la mobilité. Une ordonnance du 26 février 1823 avait autorisé la création d’un chemin de fer entre Saint-Étienne et Andrézieux ; inauguré cinq ans après, le 1er octobre 1828, il ne servait guère qu’au transport des marchandises. Ce fut ce bassin houiller qui donna l’exemple au reste du pays, les voies ferrées y furent promptement adoptées et offertes au besoin de l’industrie ; des lignes très-courtes, locales, égoïstes, si l’on peut dire, s’ouvrent successivement de Rive-de-Gier à Givors (1830), de Givors à Lyon (1832), de Rive-de-Gier à Saint-Étienne (1833), d’Andrézieux à Roanne (1834). Une gondole traînée par trois chevaux était mise à la disposition des voyageurs.
Cependant quelques députés qu’on traitait volontiers de téméraires demandaient à la tribune que la France ne se refusât pas plus longtemps à un progrès qui tendait à devenir universel, et qu’elle ne laissât pas l’Angleterre nous devancer trop rapidement dans cette admirable voie ouverte à l’activité humaine. Efforts inutiles ; c’est à peine si on les écoutait, et ce ne fut pas sans grande difficulté qu’on arracha aux représentants du pays légal, ainsi que l’on disait alors, le vote de la loi du 27 juin 1833, qui accordait un crédit de 500 000 francs pour études et exécutions de chemins de fer ; c’était dérisoire, ou peu s’en faut. Une mauvaise volonté latente et perpétuelle semblait déjouer les intentions les meilleures. Dans la séance du 7 mai 1834, M. Larabit demanda l’établissement immédiat des lignes de chemins de fer dont la France avait besoin. Ce qui prouve combien la question était peu à maturité et sur quelles illusions on vivait, c’est que l’orateur déclara qu’une somme de 400 millions serait suffisante pour mettre Paris en rapport avec les frontières à l’aide de voies ferrées Ce fut M. Auguis qui lui répondit, et après avoir affirmé que la dépense totale dépasserait même 800 millions, il se sert, pour repousser la motion de M. Larabit, de l’étrange argument que voici : « L’intérêt le plus élevé dans les chemins de fer anglais ne va pas au delà de 9 pour 100, tandis que l’intérêt dans les canaux va de 30, 32 à 50, 52, 70 et 72 pour 100 »; et il termine en disant, avec l’approbation de la chambre : « Ne nous engageons pas facilement dans la construction des chemins de fer ! »
Précisément à la même époque, dans un meeting à Tamworth, Robert Peel, chef du ministère anglais, disait : « Hâtons-nous de construire des chemins de fer ; il est indispensable d’établir d’un bout à l’autre de ce royaume des communications à la vapeur, si la Grande-Bretagne veut maintenir dans le monde son rang et sa supériorité. » Pendant que les chefs du foreign-office stimulaient l’émulation de leurs compatriotes, nos ministres raillaient les efforts des nôtres, et dans cette même année 1834 un homme d’État français, déjà irréfutable à cette époque, après avoir été visiter le railway de Liverpool, déclarait d’une manière irréfragable que les chemins de fer étaient bons à amuser les désœuvrés d’une capitale, et il ajoutait avec assurance : « Il faut voir la réalité, car, même en supposant beaucoup de succès aux chemins de fer, le développement ne serait pas ce que l’on avait supposé. Si on venait m’assurer qu’en France on fera cinq lieues de voie ferrée par année, je me tiendrais pour fort heureux ! » On ne peut s’empêcher d’éprouver un sentiment d’amertume et de tristesse en pensant que la France a plusieurs fois remis ses destinées et obéi à des hommes de vue si courte et de si défaillante initiative. Le résultat d’un pareil système et d’un tel aveuglement est facile à constater : en 1836, l’Angleterre avait 3 046 kilomètres de chemins de fer en exploitation ; la France en avait 142.
Cependant on ne pouvait rester absolument sourd aux appels de l’opinion publique ; mais, au lieu de prendre une détermination sérieuse, on s’arrêta à un moyen terme peu digne d’une grande nation, et une loi votée le 9 juillet 1835 autorisa la construction d’un chemin de fer entre Paris et Saint-Germain. Selon l’expression d’un ingénieur, ce ne fut qu’un joujou, mais ce joujou apprit aux Parisiens d’abord, aux Français ensuite, quels services innombrables un chemin de fer pouvait leur rendre. Ce fut donc là, en réalité, le germe expérimental d’où notre grand réseau ferré devait sortir. Il ne fallut rien moins que les deux petits souterrains qu’on avait à traverser en sortant de Paris pour faire évanouir des craintes conçues par le public, qui s’était avec empressement emparé de l’opinion émise par un savant illustre : « On rencontrera dans les tunnels, avait-il dit, une température de 8° Réaumur, en venant d’en subir une de 40° à 45°. J’affirme sans hésiter que, dans ce passage subit du chaud au froid, les personnes sujettes à la transpiration seront incommodées, qu’elles gagneront des fluxions de poitrine, des pleurésies, des catarrhes ! » Diafoirus et Purgon n’auraient pas plus sagement raisonné.
Une ordonnance du 24 août 1837 nomma auprès du chemin de Paris à Saint-Germain des commissaires spéciaux de surveillance, et l’inauguration du premier railway