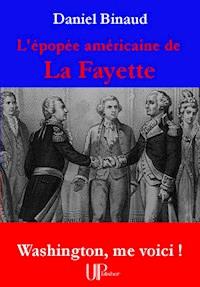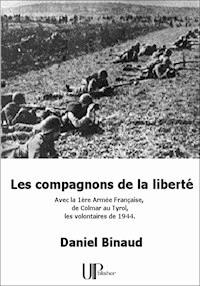
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UPblisher
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Retracez avec Daniel Binaud la vie des soldats qui ont combattu de Colmar jusqu’à Tyrol pour repousser les allemands
Ce livre est l’histoire du choix volontaire de quelques français qui se sont joints à la 1re Armée commandée par le Général de Lattre de Tassigny pour libérer la France. Ils ont été les soldats de la revanche. Inspiré des lettres quasi quotidiennes que Daniel Binaud écrivit à sa mère, ce livre retrace avec chronologie et précision la vie de ces soldats, originaires pour la plupart d’Afrique du Nord (cf. : le film
Indigènes), qui ont combattu à Colmar puis jusqu’au Tyrol pour repousser l’Armée allemande au-delà de ses frontières...
Un ouvrage au contenu précieux, édité en octobre 1998, désormais seulement disponible en numérique
EXTRAIT
Charles ouvrit les yeux. À travers les brins de paille il aperçut la ligne brunâtre du Vivarais se déroulant lentement, encadrée par l'ouverture béante du wagon.
Au loin, le halètement besogneux de la locomotive scandait la marche du convoi vers le Nord. Presque deux jours déjà qu'ils avaient quitté le centre d'instruction de l'armée marocaine au camp de Caïs près de Fréjus.
Les crapahutages dans l'Esterel, le maniement d'armes, les exercices de tir, tout cela avait été rondement mené, sous la férule des sous-off de l'armée d'Afrique, débarquée le 15 août sur cette côte d'Azur à la renommée prestigieuse.
Tout ce que Charles en découvrit au mois de novembre ce furent les ponts détruits, les villas abandonnées parfois éventrées par l'artillerie, les barbelés, les palmiers déchiquetés.
Se rendre à St Raphaël n'avait pas été une sinécure.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les compagnons de la liberté
Daniel Binaud
Charles ouvrit les yeux. À travers les brins de paille il aperçut la ligne brunâtre du Vivarais se déroulant lentement, encadrée par l'ouverture béante du wagon.
Au loin, le halètement besogneux de la locomotive scandait la marche du convoi vers le Nord. Presque deux jours déjà qu'ils avaient quitté le centre d'instruction de l'armée marocaine au camp de Caïs près de Fréjus.
Les crapahutages dans l'Esterel, le maniement d'armes, les exercices de tir, tout cela avait été rondement mené, sous la férule des sous-off de l'armée d'Afrique, débarquée le 15 août sur cette côte d'Azur à la renommée prestigieuse.
Tout ce que Charles en découvrit au mois de novembre ce furent les ponts détruits, les villas abandonnées parfois éventrées par l'artillerie, les barbelés, les palmiers déchiquetés.
Se rendre à St Raphaël n'avait pas été une sinécure.
Venant de son Sud-Ouest natal, Charles n'avait pu le premier jour atteindre que Béziers. Ayant passé une nuit dans l'hôtel douteux que son mince pécule lui permettait, il était monté le lendemain dans un train qui ne dépassa pas Beaucaire. Le pont sur le Rhône n'existait plus.
Les voyageurs étaient priés de se diriger vers l'amont où, depuis un appontement de fortune, des barques leur permettraient de rejoindre, sur la rive gauche, près de Tarascon, le train de Marseille.
Charles ne savait pas nager. À vrai dire, il avait quelques notions qui auraient été bien insuffisantes pour affronter les vagues d'un Rhône boueux et gonflé par les pluies d'automne.
Il ne fût rassuré que lorsque la barque racla les galets de la berge après avoir parcouru, déportée par le courant, plus de cinq cents mètres.
Il grimpa dans le wagon de queue où s'entassaient civils et militaires. De Marseille, il ne se souvenait que du grand escalier de la gare qui portait le nom de son saint patron.
Par les rues grouillantes, il avait atteint le tramway qui desservait Aubagne. La douceur de la température l'avait étonné mais, on était tout de même en hiver et il craignait que la nuit ne le surprît sans gîte et loin du but.
Par une chance extraordinaire, il trouva un camion à gazogène qui le déposa à Toulon.
Il avait une adresse pour loger chez un amiral en retraite, que des amis lui avaient indiqué.
On fût au petit soin pour lui. Sans enfant, l'amiral et sa femme le traitèrent comme ils l'auraient fait si leur propre fils avait manifesté la volonté de rejoindre les forces combattantes.
Après un petit déjeuner, dont l'opulence cachait mal les difficultés d'un ravitaillement misérable, il quitta ses hôtes qu'il ne devait plus jamais revoir.
Le tourbillon de la guerre favorisait ces rencontres sans lendemain. Celle-ci avait mal échappé à la mélancolie d'un couple sans descendance, dont la fin de la vie était marquée par le désastre humiliant du sabordage de la flotte. L'amiral mourrait avec, au cœur, l'amertume de cette défaire immobile.
Sur la route de St Raphaël, Charles fût recueilli par un camion du centre d'instruction qui le déposa devant le bureau où travaillait celui, sans lequel il n'aurait probablement jamais entrepris ce voyage.
Deux semaines plus tôt, chez une amie où il se retrouvait souvent avec un groupe de son âge, il avait fait la connaissance du frère ainé, tout fraichement arrivé du midi où il avait débarqué en août avec l'armée d'Afrique.
Simple caporal à trente-cinq ans, il avait été mobilisé, comme tant d'autres, au Maroc, où il vivait. Affecté aux services il s'était retrouvé dans l'équipe de fonctionnement du centre que le général de Lattre de Tassigny avait souhaité créer pour répondre à l'attente des gars désireux de s'engager jusqu'à la fin de la guerre.
Hubert Souraky, de père turc et de mère italienne, alliait le charme qu'il avait hérité de sa mère et le calme fataliste que le Proche-Orient lui avait légué. Naturalisé Français, il élevait des chevaux au Maroc, ce pays d'Orient allongé au bord de l'Atlantique.
En peu de mots, il expliqua à Charles qu'il pouvait, quand il le voudrait, venir signer un engagement au C.I.A.M. à St Raphaël.
Pour ce faire, il faudrait qu'il se libérât de l'unité à laquelle il était déjà lié. Cette dernière était, il est vrai, une étrange formation, installée dans une caserne abandonnée par la Wehrmacht à la fin août.
Se voulant groupement Nord-Africain, elle était comme les unités F.F.I. un mélange de gens de tous âges, sans armes, si ce n'est hétéroclite, sans uniformes et presque sans encadrements.
Beaucoup de ceux qui auraient pu commander avaient trouvé un énorme avantage à rejoindre, parfois après le départ de l'armée allemande, tel groupe de F.F.I. où ils avaient, sans contrôle, troqué leurs anciens galons de sous-off contre ceux, beaucoup plus prestigieux, de capitaine ou commandant. Si les uniformes faisaient défaut il n'y avait apparemment pas de pénurie de galon doré dans les merceries.
Le groupement Nord-Africain, récemment formé avait à sa tête un colonel massif, à cheveux blancs et qui paraissait, lui, tout à fait authentique.
Il reçut Charles à sa demande et, sans ambages, lui déclara sur un ton bonhomme : « Si vous voulez partir là-bas, sans doute, en effet, pourrez-vous y servir plus efficacement. Je n'ai aucune raison de vous retenir. Qu'est-ce-que j'ai à vous offrir pour le moment ? Pas d'uniforme, pas d'arme. Rien ! »
Il avait signé à Charles un bel ordre de mission, grâce auquel on ne pourrait accuser ce dernier de désertion.
Face à la table de bois blanc derrière laquelle étaient assis Hubert Souraky et un adjudant rondouillard, Charles déclina son identité et signa un engagement pour la durée de la guerre.
Son destin, fait des pires incertitudes, venait de se sceller.
Une heure après, un 4x4 Dodge le déposait au camp de Caïs où il reçut son paquetage, entièrement américain. On lui désigna un baraquement de cet ancien centre d'hivernage des troupes coloniales et, au milieu d'une trentaine de gars du midi, de tous poils mais d'accent uniformément pimenté, il commença l'instruction accélérée qu'avait voulue le général de Lattre.
Après sa conquête rapide du littoral méditerranéen et son avance foudroyante dans la vallée du Rhône, où les avant-gardes s'arrêtèrent faute de carburant, la 1ère armée avait dû marquer le pas du fait de la résistance farouche de la Wehrmacht devant la trouée de Belfort.
Ayant atteint le Rhin au Sud de Mulhouse, dans le froid précoce et dans la boue, tenant enfin les premiers villages alsaciens, amoindrie, épuisée par ses derniers combats, il ne restait à l'armée d'Afrique qu'à se préparer à affronter l'hiver depuis la ligne des Vosges jusqu'au Rhin, à l'est de Sélestat.
Conséquence des combats violents de la fin de l'automne, les pertes dans certaines unités avaient provoqué l'appel des garçons du CIAM. Il fallait reconstituer certains régiments durement éprouvés par une offensive qui aurait dû permettre la libération de toute l'Alsace. Mais bien des facteurs, dont le temps, exécrable, et la résistance opiniâtre des Allemands, en avaient disposé autrement.
À la veille de Noël, Charles apprit avec tous ceux de sa baraque, que leur instruction s'arrêtait là et qu'ils étaient expédiés en renfort, parce que la 1re Armée avait besoin d'eux.
Le 25 décembre, dans la matinée, des camions les avaient déposés sur les quais en plein air de la gare de Fréjus.
Leurs wagons-lits les attendaient, tous marqués de l'inscription bien connue : « Hommes 40 - chevaux en long 8 ». Garnis de paille ils allaient recevoir chacun une vingtaine d'hommes.
Après un repas qu'on avait voulu exceptionnel et qui était dominé par de la dinde froide, ils avaient embarqué avec leurs paquetages pour un voyage dont la destination et la durée restaient inconnues.
C'était vers le Nord, vers le froid et, pour la plupart d'entre eux, vers la première et quelquefois la dernière grande épreuve de leur vie.
« O, les copains ! Je crois que ça va être l'heure du petit déjeuner. »
Accroché à la porte, la tête à l'extérieur, le garçon à l'accent chantant observait la manœuvre qui venait de commencer, dans le gémissement des roues sur les rails et les secousses du passage des aiguillages.
Dans un long grincement le convoi s'arrêta.
« Bougez pas, je vais aux nouvelles. »
La paille se souleva, des têtes apparurent au-dessus des couvertures kaki. Pas un d'entre eux ne semblait soucieux de descendre sur le ballast à la suite de Moscatelli, ce gars de Nice, bourré de verve et de vitalité. Parmi cette troupe de méridionaux, il était de ceux qui semblaient en accuser les traits jusqu'à la caricature.
Sans attendre, il était parti s'enquérir, fureter du côté des autorités, comme un chien de chasse sur une piste.
À moitié réveillés, qui en maillot de corps, qui en chemise ou en chandail, les gars n'étaient guère bavards. Les moins vêtus se drapèrent dans leur couverture car l'air vif, soufflant du Nord, s'engouffrait par bouffées froides dans le wagon.
« Le temps a changé cette nuit. Peuchère ! Cette porte de wagon, on dirait la porte de la cave ! »
Le petit maigre, au nez crochu, qui venait de parler, serra sa couverture autour de lui. Dans la rue, on lui aurait donné vingt sous pour sa mauvaise mine et son air nécessiteux. Il n'avait pas dû manger souvent à sa faim avant de mettre les pieds à Caïs.
Moscatelli reparût, l'oeil brillant.
« Vous impatientez pas, le larbin me suit avec les petits fours. »
Tout heureux de cette plaisanterie, il partit d'un grand éclat de rire, qu'en comédien accompli, il coupa brusquement.
« Oh là ! Mais vous avez des mines à faire chialer un adjudant, les copains ! »
Un des garçons répliqua : « Eh, couillon, t'as peut-être pas remarqué, mais le thermomètre, il est tombé de haut depuis qu'on est parti de chez nous... »
Ils furent interrompus par l'arrivée du « larbin » annoncé, porteur d'une grande gamelle de café fumant et de cinq boules de pain. Les conserves, embarquées à Fréjus avant le départ, firent le complément du petit déjeuner.
Le train s'était vidé. Tous déambulaient le long du convoi, en attendant un départ qui paraissait du domaine de la plus grande incertitude.
Ils étaient sur les voies de triage de Lyon-Perrache, mais la gare était loin. Autour d'eux voisinaient les traces de destructions remontant au mois de septembre, et les stocks d'approvisionnements militaires.
Désœuvrés, saisis par le froid que le mistral soufflait depuis l'Alsace lointaine, où couvait la guerre, les gars se groupèrent peu à peu par affinités spontanées... Ils avaient encore à faire connaissance en attendant le terme du voyage où ils seraient de nouveau dispersés. La répartition par wagon avait déjà séparé partiellement les anciens copains de chambrée.
Ici ou là, des amateurs avisés avaient sorti des jeux de cartes pour des parties de belote sans fin.
Le repas de midi, désespérément froid acheva de vider les grandes boîtes de Meat & Beans, Pork Loaf et Irish Stew. Il avait fallu de l'appétit pour en venir à bout car, après un mois de camp, la lassitude avait déjà fait son apparition. Même en sortant de longues restrictions et de carences alimentaires de toutes sortes, ces palais français supportaient mal une monotonie, nourrissante certes, mais que seuls des G.I's auraient encaissée sans broncher.
L'après-midi vit la montée d'un brouillard pénétrant que le vent empêchait de se fixer. Très vite les conversations n'eurent plus pour objet que ce froid, éprouvant pour des organismes méridionaux.
Moscatelli survint à point nommé pour apporter une solution, comme un prestidigitateur sortant un lapin de son chapeau. Même le boniment y était.
« Vous avez la trouille de vous retrouver demain matin comme des pingouins sur la banquise ? Vous voulez un truc fait avec rien ? La solution miracle qui ne coûte pas un rond ? La chaleur assurée aux frais des amerlos ?... »
Il marqua un temps, l'œil pétillant de malice, sûr de son effet devant les dix-neuf copains rassemblés. Il lisait sur leurs visages le doute, la curiosité et même l'inquiétude mêlée à l'amusement.
« Les pingouins sont insensibles au froid grâce à leurs poils. Moi je vous offre un poêle instantané... » Il riait à moitié du jeu de mot qu'il venait d'inventer. « Un poêle comme vous n'en avez jamais vu. »
Tout en parlant il s'était approché du wagon, avait saisi une boite de cinq kilos de Irish Stew vide et l'avait remplie de terre et de paille, en mélangeant les deux au fur et à mesure.
« Bien sûr, vous vous demandez comment cette mixture va vous apporter le bien-être et la chaleur dont vous rêvez... »
Moscatelli s'interrompit une fois de plus, tournant lentement sur ses talons pour présenter son "poêle" au cercle de ses copains sceptiques.
« Eh bien, mes seigneurs, reprit-il d'un ton docte, vous avez raison, ça ne peut pas marcher... sauf si j'y ajoute le carburant. Et, ce dernier, où est-il, je vous le demande ? »
Les sourcils levés, jouissant de la curiosité attentive qu'il avait créée, il tendit brusquement le bras d'un geste solennel.
« Là ». Tous les regards se tournèrent vers le terre-plein qui, deux voies plus loin, supportait une montagne de jerrycans.
« Restes de l'offensive de l'automne, ils sont vides, mais pas assez pour que nous n'y trouvions pas la chaleur dont nous rêvons. »
Il ne leur fallut qu'une seconde pour réagir. Toute la bande se rua vers la solution miracle, imitée sinon précédée par la plupart des autres soldats, car Moscatelli avait trouvé son idée en trainant autour des wagons voisins. Quel bricoleur de génie l'avait formulée le premier ? Ils ne le sauraient jamais.
Le jour commençait à décliner. De proche en proche, comme des feux follets dansèrent les flammes bleuâtres, autour desquelles les petits groupes tendaient leurs mains. Ils avaient l'impression de retrouver un peu de chaleur de leur midi. Comment auraient-ils su qu'ils allaient, avant peu, souffrir d'un des hivers les plus rigoureux de cette guerre ?
Un sous-off passa le long du convoi, annonçant un départ imminent, et ajoutant d'un ton sans réplique :
« Et éteignez moi ces brûlots avant le départ. S'agirait pas de fout' le feu aux wagons ! »
À regret, les hommes jetèrent de la terre sur les braseros, dont la plupart disparurent à l'intérieur des wagons.
Parmi les compagnons de Charles, le malingre au nez crochu qui s'appelait Garassin, avait préféré envisager l'avenir. Pendant que les autres se chauffaient, il avait transvasé dans un jerrycan tous les fonds d'essence récupérables. Il lui avait fallu une bonne heure pour ce faire, mais ce prévoyant besogneux avait ainsi récolté de quoi fabriquer de la chaleur pour de longues heures. D'un air de conspirateur et comme s'il avait la P.M. à ses trousses, il grimpa dans le wagon en serrant contre lui le jerrycan soustrait aux stocks de l'armée U.S.
Un long coup de sifflet monta de la tête du train.
Les hommes se dépêchèrent d'embarquer.
« Et Mora ? » La question avait fusé avec une note d'inquiétude « qui est-ce ? » demanda Charles. « Un copain de Toulon. Il est parti ce matin pour voir des parents qu'il a à Lyon. Il sait pas quand on doit repartir. Il va louper le train... »
Un appel lui fit écho à l'extérieur, vers le dernier wagon, au moment où, dans une forte secousse, le convoi s'ébranlait.
« Grouille-toi, Mora. Tu vas le louper. Grouille... »
Le gars courait, encouragé par les soldats des autres wagons. Il atteignit la porte au moment où le train obliquait sur un aiguillage. Il faillit s'aplatir sur le ballast, mais trois paires de bras l'attrapèrent au vol. Il s'écroula dans la paille hors d'haleine.
Accroché à une poignée, Charles regarda s'éloigner la montagne de jerrycans.
Comme dans un mirage, il revit sa mère sur le quai de la gare, le jour où il était parti de chez lui. Serrée dans son manteau élimé, le manteau à chevron qui avait fait quatre ans de guerre, elle levait une main tremblante dans un geste dont elle ne savait si c'était un adieu ou un au revoir. Elle voyait partir vers l'inconnu son fils unique et sa détresse devait être immense. Il y avait déjà six ans que le père de Charles était mort. Mais pour elle c'était hier, et Charles devinait que, derrière ses lunettes, elle avait les yeux pleins de larmes.
« Oh, l'ami, tu crois pas qu'on a assez pris l'air pour aujourd'hui. Tire la lourde, si ça te fait rien. »
Rappelé à la réalité, Charles détourna la tête et hala la lourde porte.
Les gars s'affairaient déjà à libérer un espace au centre du wagon de manière à pouvoir y allumer (au diable soit de l'adjudant) un brasero qui chaufferait le wagon pendant la nuit.
Charles arrangea sa couverture et poussa son sac marin contre le bord de la porte droite afin d'empêcher l'air froid de rentrer. Il s'assit dans la paille en observant ses compagnons d'un moment qu'un choix capital avait lancé, comme lui, vers le plus incertain et le plus périlleux des avenirs. Il s'obligea à ne penser à rien, car le passé ne pouvait être, lui, que porteur de mélancolie.
Tel un écho, deux coups de sifflets de la locomotive traversèrent la nuit. Jamais encore Charles n'avait remarqué à quel point ce signal pouvait ressembler à un cri d'angoisse.
Belfort était sous la neige. Dans les rues, le faible trafic fait en majorité de camions militaires et de jeeps chassait la neige sale vers les trottoirs glissants.
Les Belfortains se hâtaient comme si leurs maigres courses devaient accaparer tout leur temps. Ils étaient gris comme la ville, comme le temps.
Des soldats de toutes armes et de tous grades se rencontraient partout.
La cité était devenue le point de concentration des renforts et la plaque tournante des permissionnaires et des blessés.
Charles et ses compagnons se retrouvèrent dans une immense caserne où le dénuement et les courants d'air semblaient n'être là que pour les convaincre que le front d'Alsace serait forcément plus confortable.
Pendant deux jours de désœuvrement, ils déambulèrent dans la ville, allant de la place d'Armes à la porte de Brisach et à la citadelle. Ils s'arrêtèrent longuement devant le lion de Bartoldi, symbole de la résistance de la ville, en 1870, sous le commandement du colonel Denfert-Rochereau.
Touristes frigorifiés et désargentés, ils laissèrent quelques francs au foyer militaire la veille de leur départ, pour acheter l'insigne de leur régiment, le 5éme tirailleurs marocains, auquel Charles venait d'être affecté avec quelques-uns de ses camarades.
Ce n'est que plus tard qu'il apprit que, sur l’emblème comportant une tête de lion, était inscrite en arabe la devise « Sans peur et sans pitié ».
Charles ressentait le froid autant au dedans de lui-même que sur son épiderme, du fait du déracinement, de la tristesse de cette ville figée, à deux pas d'une Alsace encore sous l'emprise allemande, mais surtout parce qu'il souffrait de solitude.
Lorsqu'il était chez lui, ses échanges avec sa mère étaient pourtant limités, essentiellement à cause de leur grande différence d'âge.
Veuve une première fois et remariée à 37 ans, elle avait subi comme un déchirement le décès du père de Charles. Elle était d'autant plus désemparée que la guerre était survenue un an après, apportant d'énormes soucis matériels qu'elle devait affronter seule. Souffrant moralement, elle était amoindrie physiquement par les problèmes quotidiens d'un ravitaillement toujours plus difficile.
Elle se confiait peu, comme tant de parents l'auraient fait à sa place, et Charles ne réalisait pas toujours l'étendue de sa détresse ni la profondeur de son inquiétude.
Son bac de philo en poche il avait envisagé de partir faire son service militaire en Afrique du Nord. Curieusement, même en zone occupée, on pouvait alors passer un conseil de révision dans ce but. La tentative avait tourné court en novembre 1942 lorsque les Américains avaient débarqué en Algérie et au Maroc et que les Allemands avaient envahi la zone libre.
L'année suivante, était survenu le recensement de la classe 1943, en vue du service du travail obligatoire, suite funeste de la duperie organisée avec l'aval du gouvernement de Vichy et qui s'était appelée « La relève ». Il y avait déjà longtemps qu'on ne parlait plus d'échanges des prisonniers contre des travailleurs. L'industrie de guerre allemande avait besoin de main-d’œuvre et prélevait celle-ci, classe par classe, là où elle était.
Charles n'était pas un garçon spécialement coriace et décidé. Il avait simplement considéré comme inconcevable de se laisser prendre en esclavage.
Il avait donc fui, grâce à un réseau de résistance, pour se retrouver avec d'autres réfractaires dans un coin de campagne où, de maladresses en actions inutiles, les responsables du secteur attirèrent l'intervention de la gendarmerie. Arrêté, Charles avait réussi à échapper aux suites de cette rafle grâce à son authentique carte d'identité. Elle paraissait tellement vraie à côté des faux papiers de ses compagnons d’infortune ! Ces derniers, moins chanceux que lui, furent livrés à la Gestapo et plusieurs laissèrent leur vie dans un camp de concentration, mais Charles ignorait tout de cette terrible suite de son arrestation.
Déjà secouée par ces aventures dont l'issue aurait pu être funeste, la mère de Charles avait dû se résigner à le voir s'enrôler dans un groupement F.F.I., puis décider de partir pour le midi, où son désir de combattre pour la liberté devait trouver son accomplissement.
Dans le silence glacial de la chambrée à la caserne de Belfort, pelotonné dans son lit, Charles tournait dans sa tête tous ces évènements, ces sentiments, ces décisions et leurs chaotiques conséquences. N'aurait-il pas dû, en fin de compte, rester chez lui ?
Faire comme tant de Français, pour qui la guerre était finie puisqu'elle était partie de chez eux avec les bottes des occupants ? Mais fallait-il donc laisser les autres, les Français Libres, les mobilisés d'Afrique du Nord, les volontaires enfuis par l'Espagne, sans compter ceux qui avaient traversé l'Atlantique ou la Manche, terminer cette monstrueuse guerre, engendrée par l’Allemagne ?
Pour lui la réponse était « non » et à force de retourner ces pensées tumultueuses dans sa tête, Charles finit par s'endormir.
Face à ce sentiment de solitude il trouva inopinément une compensation due au hasard, comme tant de rencontres de cette période.
Lucien Moraglia avait été affecté au même bataillon que lui. Ils devaient donc rejoindre ce dernier dès qu'ils en recevraient l'ordre. Ils prirent ensemble leur dernier diner à la caserne.
D'emblée ils s'étaient découvert des points communs, des atomes crochus, comme on dit. Peut-être parce qu'ils avaient fait tous deux leurs humanités et avaient en poche un bac tout récent. Lucien n'était pas grand et il avait les cheveux et les yeux noirs. Un vrai méditerranéen mais sans la faconde et les gestes.
Ils parlèrent longuement, non pas de banalités, ni même de ce qui les avait amenés à Belfort, mais de leurs familles, de leurs amis, de leurs études et de l'avenir qui s'ouvrirait lorsque le cessez-le-feu sonnerait enfin.
Ils libéraient leur besoin de parler, d'exprimer ce qu'ils ressentaient à quelqu'un qui les comprit.
La barrière de l'inconnu était tombée d'elle-même parce qu'aucun des deux ne sentait d'obstacle à un échange. Ils avaient le sentiment d'avoir tout d'un coup trouvé au milieu de tant de gens de leur âge, de toutes conditions et de tempéraments si différents, un interlocuteur.
Leurs dernières heures à Belfort en furent transformées, et ils blaguaient encore lorsque, le lendemain, ils embarquèrent dans des GMC sous un soleil radieux qui changeait brusquement la campagne en un joyeux décor de fête.
C'était le premier jour de l'année 1945.
Le pays semblait figé sous la neige et le givre. Au loin, les contreforts des Vosges s'enveloppaient d'un voile gris.
Serrés sous la bâche du camion, les soldats avaient renoncé à comprendre où on les emmenait. Le convoi fit plusieurs haltes, au gré des affectations et des cantonnements prévus pour la nuit.
Au crépuscule, alors que le froid piquant reprenait le dessus, Charles, Lucien et leurs compagnons furent débarqués à la Chapelle sous Rougemont.
Une famille devait les loger jusqu'au lendemain.
Les Sully portaient comme les villages alentour, des noms à consonance française. À quelques kilomètres c'était Bretten, Mortzwiller, Laun, comme si au-delà commençait un autre pays. La Doller, minuscule rivière, constituait la « frontière » renforcée pendant les périodes d'hégémonie allemande, entre le Territoire de Belfort et l'Alsace. Mais, le reste du temps, toute la différence résidait dans les noms des villages, et des habitants, dans leur dialecte et leur accent.
Les Sully accueillirent leurs hôtes de passage comme si rien n'était plus naturel. En zone frontalière ils savaient mieux que quiconque ce que la guerre, le passage des troupes et l'occupation voulaient dire. Leur génération en resterait marquée plus que beaucoup d'autres. Et puis n'avaient-ils pas quatre fils sous les drapeaux, tous volontaires, dans la 1ère Division Française Libre, la 5e DB et les Spahis ?
Trois d'entre eux étaient passés récemment à la maison pour embrasser papa et maman après de longs mois d'absence sans nouvelles. On espérait voir le quatrième, blessé devant Montbéliard, lorsqu'il sortirait de l'hôpital.
Les parents Sully racontaient ces années de guerre et ce qui avait dû être leur angoisse à écouter les nouvelles des fronts lointains, d'une façon sobre et naturelle comme si leurs enfants n'avaient été que des commis voyageurs. Comment pourtant n'auraient-ils pas craint leur perte à Bir-Hakeim, à Cassino, pendant le débarquement en Provence, ou en n'importe quel lieu obscure, même pas cité dans les communiqués.
Le jour du premier de l'an 45, tous étaient vivants et déjà repartis, après un trop bref passage.
Autour de la table où ils avaient été conviés, les cinq « bleus » ressentaient la chaleur de ce foyer qui, d'un seul coup, effaçait l'attente, le froid, l'anonymat, l'incertitude en face d'un imprévisible destin. On trinqua à l'année nouvelle et à la fin de la guerre.
À minuit, enfouis dans la paille de la grange, Charles et Lucien durent laisser le sommeil l'emporter sur leur envie de discuter encore.
Dans la nuit glacée, à travers des planches disjointes, ils auraient pu voir scintiller les étoiles. Très haut, grondaient les escadrilles de bombardement en route pour le cœur de l'Allemagne.
Le lendemain, un camion vint les prendre pour la dernière étape. Lucien fût largué à Bitschwiller où il devait rejoindre la 4e compagnie.
Ils se serrèrent la main longuement avant de se dire « Adieu ». Ce n'est pas qu'ils s'attendaient à ne plus jamais se revoir, mais, en gens du sud qui se tutoient, c'était là leur manière de se dire « au revoir ».
Charles claqua les talons et salua « 2e classe Béraud. »
En face de lui le capitaine Guenard, commandant la 7e compagnie, le dévisagea d'un regard rapide, mais habitué à évaluer les hommes.
« Repos... »
Charles se détendit et enleva son calot. Le capitaine se leva. Vêtu, comme tous les officiers en campagne, du blouson américain à soufflets, portant les barrettes en métal doré sur les épaules, il était plutôt grand. Son visage régulier laissait deviner l'énergie comme son regard reflétait autorité et droiture. Charles ne pût s'empêcher de retrouver en lui le souvenir qu'il avait du préfet du collège de jésuites où il avait fait la majeure partie de ses études. La même prestance au service de la fonction.
C'est sur un ton aimable que le capitaine reprit la parole.
— Engagé volontaire, n'est-ce-pas ? Nous avons besoin de gens comme vous, qui savent vraiment pourquoi ils se battent.
Ici c'est, bien sûr, tout autre chose que le C.I.A.M. d'où vous arrivez. L'hiver va être rude, je le crains. Il va falloir vous habituer à vos nouveaux compagnons. Vous serez seul avec les Marocains dans un groupe de dix.
D'où êtes-vous originaire...
— De Bordeaux, mon capitaine.
Les derniers mots de l'officier venaient brusquement de le ramener à cette solitude que l'amitié éphémère de Lucien lui avait permis de briser. Elle allait donc resurgir au milieu de ces hommes venus d'Afrique dont il ne savait rien. Il entendit le capitaine commenter sa réponse.
— Justement, en ce moment, la 3e section est commandée par le sergent-chef Bonnaire pendant la permission de l'adjudant-chef Dabrowa. Et Bonnaire est de Bordeaux, lui aussi.
— Mon capitaine intervint Charles, est-ce-que je pourrais être affecté à sa section ?
— Pas d'objection. En sortant, l'adjudant de service vous fera accompagner au cantonnement de la 3e. Là-bas on vous donnera votre arme et toutes les instructions nécessaires.
Vous verrez. Vous vous ferez vite à nos Marocains. Ce sont de braves types sur qui on peut compter.
Je souhaite que vous gardiez un bon souvenir du 5e R.T.M. Bonne chance...
— Merci, mon capitaine.
Ce dernier tendit la main à Charles, tout surpris de cette marque de cordialité.
Lorsqu'il sortit dans la rue, son sac marin sur l'épaule, il se sentit tout rasséréné. Il était encore sous l'effet d'un entretien bref, mais suffisant pour avoir fait grandir sa confiance dans l'unité où il allait servir.
C'était là l'expression d'une réalité vieille comme le monde, que Charles n'avait rencontrée qu'au collège, sans très bien la percevoir. La valeur d'une troupe est, pour une large part, le reflet de celle de ses chefs.
Une forte odeur « sui generis » frappa Charles lorsqu'il rentra dans le réduit obscur. Quelques bruissements lui confirmèrent qu'il n'était pas seul. Il sentait la présence d'autres hommes dans tous les sens du terme, mais ne distinguait rien.
Peu à peu il s'habitua à la pénombre. Quelqu'un s'approcha de lui et il vit d'abord le blanc des yeux, puis la peau basanée et la barbe hirsute. Un sourire fendit le visage, découvrant une dentition plus blanche encore que les yeux.
« Salam alekoum ! Caporal Brahim. C'i moi l'chef de groupe. L'sergent chef i vient tôdsouite ».
Charles serra la main tendue. Le caporal la porta alors devant sa poitrine à hauteur du cœur.
Charles ne savait pas que c'était la manière des Marocains de compléter une poignée de mains avec un signe de respect pour celui qu'on vient de saluer.
Le sergent-chef survint à son tour, débonnaire et tout heureux d'accueillir un « pays ».
C'était un gradé, certes, mais rien dans son attitude ne révélait le sous-off. Il mit Charles tout de suite à l'aise.
— Vous verrez, on s'habitue vite aux Marocains. Ce sont des braves types, sans histoire. Vous vous ferez à leur comportement et même à leur langage. Dans quelques temps vous connaîtrez le minimum qu'il faut pour se comprendre.
— Le capitaine m'a dit la même chose...
— Ah !... Guenard ! Quel officier formidable !
Dans le regard comme dans la voix flottait l'admiration pour un vrai chef. De ceux qui tiennent leurs hommes en main sans avoir besoin d'artifices ni de coups de gueule.
— Mais vous verrez reprit Bonnaire, quand Dabrowa sera de retour de perm... lui aussi c'est quelqu'un. Petit, mais il faut même pas un jour pour ne plus s'en apercevoir.
— Comment se fait-il que la section soit commandée par un adjudant-chef ?
— C'est bien simple. On manque de cadres dans cette armée. Les pertes ont été lourdes aussi dans les officiers. On a terriblement dégusté devant Montbéliard.
Alors, quand le chef de section est en perm c'est un sergent-chef qui commande.
Il eût un clin d'œil.
— En somme un amateur ! Vous savez, mon vieux je ne suis pas un sous-off de carrière. J'ai rejoint au Maroc. Je suis passé chef pendant la grande cavale, après le débarquement en Provence. Beaucoup d'entre nous sommes là jusqu'à ce que cette saloperie de guerre soit finie. Après, on mettra les uniformes au placard.
Dabrowa, ce n'est pas pareil. Il est sorti du rang et il a commencé à gagner ses galons en Italie. Le Garigliano il y était. Vous vous rendez-compte. Ça fait deux fois qu'il voit fondre le 5e RTM autour de lui. Il a l'air tellement solide. J'ai l'impression qu'il a vraiment la baraka...
Charles l'interrompit
— Qu'est-ce-que ça veut dire ?
— La chance, mon gars, la chance ! Pour nos Marocains c'est un signe du destin. C'est la bénédiction d'Allah. Et ça, croyez-moi ça ajoute au prestige de quelqu'un comme lui.
Dans la pénombre, peu à peu, Charles avait distingué les tirailleurs, couchés dans la paille, reprenant progressivement leurs palabres.
Avec le chef ils passèrent dans la pièce voisine.
— Voilà vos copains français !
Le premier était un grand garçon mince, portant sur son blouson les galons de caporal-chef.
Il s'avança, la main tendue.
— Fourment, du groupe commandement"
La poignée fût brève mais ferme.
— Je suis le seul pied-noir dans la section, originaire de Petit Jean dans le Rharb". Charles se présenta en serrant la main des autres à la ronde.
— Roger Guérineau, 3e groupe
— Jean Ferassier, 2e groupe
— Albert Favier, groupe commandement
C'étaient trois garçons en ne peut plus dissemblables. Guérineau venait de Cannes, la Bocca comme Ferassier. Ils avaient été au lycée ensemble. Le premier était poupin, réjoui, prêt à s'esclaffer de tout. Le second plus calme, mais tout aussi cordial. Ils étaient tout deux de la classe 46. Quant à Favier, c'était un Savoyard. Lorsqu'un sourire faisait remonter ses pommettes rubicondes, ses yeux disparaissaient et son visage prenait un petit air asiatique. Il ne parlait que pour dire l'essentiel, à la différence des deux Cannois toujours diserts et la blague à la bouche.
Leur optimisme et leur bonne humeur faisaient, d'un seul coup, oublier l'hiver et la guerre.
Charles eût d'emblée le pressentiment, qu'en dehors des moments d'isolement dans son propre groupe, il trouverait sûrement une compensation auprès de ses nouveaux compagnons.
Ceux-ci, sans plus attendre, l'entraînèrent au magasin de la Compagnie où, avec une immense satisfaction il se vit remettre un caleçon long, un tricot et des chaussettes de laine.
Il toucha aussi une cartouchière, un bidon, un masque à gaz et un fusil règlementaire américain US 03 avec ses munitions.
Il fit la grimace car il n'avait aucune sympathie pour cette arme lourde et, en quelque sorte, désuète. Même si elle valait, au combat, le mauser allemand elle avait été abandonnée par l'armée américaine. Comme il aurait préféré la carabine dont Ferassier et Favier étaient dotés !
Assis derrière la fenêtre ouverte, Charles scrutait la nuit glacée. C'était sa première garde. Son fusil à côté de lui, il cherchait à percer les ténèbres.
La maison, où son groupe était cantonné, se situait à la lisière de Willer-sur-Thur. Au-delà régnait une sorte de no man's land avant les bois, au sein desquels l'armée allemande tenait position depuis l'automne.
Charles, engoncé dans sa capote, essayait d'oublier le froid et de ne penser à rien. L'urticaire, qui s'était développé sur sa poitrine depuis quelques jours, le démangeait mais il ne pouvait se gratter et il maudissait les conserves américaines qui en étaient la cause.
Un ennui ne venant jamais seul, il avait pris froid en patrouille, du fait du manque d'étanchéité des godasses américaines.
Il s'était rendu au P.S.B., installé dans l'ancien café Riedler, au centre du village.
Le lieutenant toubib étant en permission, c'est l'adjudant Gantois qui s'était occupé de lui. Un joyeux luron cet adjudant, passé des bancs de la fac à la médecine militaire.
Le diagnostic fût rapide et Charles se retrouva allongé à plat ventre sur une civière, le dos boursouflé par une demi-douzaine de ventouses. Il les avait « savourées » en écoutant du Gershwin que diffusait la radio de l'adjudant.
Atmosphère baroque que cet estaminet alsacien où les médicaments s'alignaient sur le zinc, tandis que les boites de pansements s'étageaient entre la bière à la pression et quelques bocks vides.
L'adjudant conseilla à Charles de se nourrir pendant quelques jours de patates, de pommes et de lait, et, contre sa sinusite, il lui donna un flacon de gouttes noirâtres, à base de sels d'argent.
Auprès de ses hôtes alsaciens, il n'avait pas eu de peine à trouver la nourriture, bien légère pour son estomac, qui lui était prescrite.
La goutte au nez, la poitrine pleine de démangeaisons, Charles n'était pas euphorique. Seul, face à ce paysage figé, distinguant à peine les haies sur les prairies englouties par la neige, il devinait la masse sombre, menaçante, de la forêt où l'ennemi guettait comme lui.
C'est là que, deux jours plus tôt, il était parti pour sa première patrouille avec Brahim et les huit Marocains de son groupe. Il gardait un souvenir pénible de cette marche dans la neige poudreuse où ils enfonçaient jusqu'aux genoux, de ce sentiment de danger indéfinissable qui pouvait, brusquement, se changer en déflagrations et en rafales d'armes automatiques.
Il avait redouté l'épreuve du feu dans ces conditions. Il ne s'y sentait pas préparé, car ce n'étaient pas les exercices où, dans l'Esterel, on leur tirait au-dessus de la tête à balles réelles, qui pouvaient tenir lieu d'initiation.
La menace latente qui rodait sous les sapins vosgiens, dans cet univers nappé de blanc, c'était bien autre chose que des exercices, si réalistes fussent-ils.
Charles frissonna. Le froid se coulait jusqu'au plancher par la fenêtre béante. Sa sinusite n'allait pas s'améliorer. Il avait pourtant tout fait pour se protéger au mieux.
Sous sa capote et son blouson, il sentait la douce chaleur entretenue par le chandail que sa mère avait tricoté. Il pensait aux Marocains qui n'avaient pas, comme lui, des gants confectionnés avec la tendresse maternelle et ne pouvaient se réchauffer qu'en enfonçant leurs mains au fond de leurs poches.
Comme ses nouveaux camarades, il s'était taillé un cache-col dans une couverture kaki et même, en faisant appel aux connaissances en couture, qu'il avait acquises lorsqu'il était scout, il avait fabriqué un serre-tête qui lui protégeait les oreilles. Les casquettes de laine qui faisaient partie du paquetage normal américain, étaient restées, disait-on, dans le midi où on n'en avait que faire. Belle occasion de vilipender les incapables de l'intendance !
Il commençait à s'engourdir lorsqu'on lui tapa sur l'épaule. Mohamed, à moins que ce ne fût Lahcen ou Ahmed, (il ne les distinguait pas encore les uns des autres) venait prendre son tour de garde.
Charles prit son fusil, le désarma, et lui céda la place. Cinq minutes plus tard, enfoncé au chaud dans la paille, il rêvait d'un monde meilleur.
Lorsque l'ordre de mouvement arriva, le 15 janvier, la bronchite de Charles ne s'était guère améliorée. La source de son nez s'était tarie mais il toussait toujours.
Les différentes sections de la 7e compagnie s'ébranlèrent, en colonne, à la nuit tombée. Le dîner était déjà loin.
La troupe venait d'atteindre la voie ferrée lorsque des sifflements déchirèrent l'air, suivis presqu'aussitôt d'explosions.
— Tir de mortier, couchez-vous sur les bas-côtés.
L'ordre fût couvert par les déflagrations. Une partie des hommes se replia dans les granges et les maisons les plus proches. Il fallait absolument mettre un abri au-dessus de sa tête. Rien n'était plus dangereux qu'un arrosage au mortier en terrain découvert.
Charles l'avait appris au camp de Caïs. Pour l'instant à plat ventre, le nez sur le ballast du chemin de fer, il priait le ciel de ne pas servir de cible.
Deux hommes hurlèrent, touchés par des éclats. Une pluie de débris, de cailloux, de morceaux de tuiles résonna sur le casque de Charles.
Puis, tout d'un coup, il y eût un silence.
Un ordre retentit « Tout le monde au trot en suivant la voie ferrée. Fissa. »
Les hommes se levèrent et commencèrent à courir. Devant eux, Charles aperçut une énorme tâche noire. C'était l'entrée d'un tunnel. Lorsque le bombardement recommença toute la compagnie était à l'abri et reprenait sa marche.
— Les salauds, il a bien fallu quelqu'un pour les renseigner.
C'était Guerineau qui exprimait avec écœurement ce que d'autres venaient de penser.
— C'est sûr, répondit la voix de Ferassier. Doit y avoir quelque Alsacien qui est resté copain avec les boches.
Charles réalisait soudain qu'après tout, il y avait peut-être bien, ici ou là, en Alsace, des gens qui s'étaient fort bien accommodés d'appartenir au IIIe Reich et étaient prêts à jouer le rôle d'espions pour la Wehrmacht.
Mais ses pensées n'allèrent pas plus loin. Il se sentait gêné pour respirer, après cette course rapide, et il avait l'impression d'avoir avalé un sifflet.
Au-delà du tunnel ils abordèrent une route en lacets, glissante comme une patinoire. Charles peinait de plus en plus. Il avait envie d'envoyer promener son sac, son fusil, ses munitions, pour gravir cette sacrée route, qui, de virages en virages, semblait sans fin.
Le souffle court, il n'osait pas s'arrêter pour ne pas se laisser distancer, habité par une seule hantise : se retrouver avec des inconnus. Son groupe était la dernière communauté à laquelle il appartenait et il ne voulait pas la perdre. Sans le savoir, il était en train d'acquérir une espèce d'esprit tribal qui ressemblait à l'instinct grégaire des chevaux.
À bout de souffle cependant, Charles s'arrêta. Parmi les véhicules qui remontaient le long de la colonne il avisa une jeep tractant une remorque bâchée. Il leva la main. L'officier assis à côté du chauffeur fit arrêter le véhicule.
— Qu'est-ce qui t'arrive ?
— J'ai de la peine à respirer, mon lieutenant. J'ai une bronchite. Vous pourriez me prendre sur votre remorque ?
— Quelle compagnie ?
— 7e
— Grimpe.
Charles se hissa sur la bâche raidie par le gel et ferma les yeux.
Bercé par la route, il ne réalisa plus le nombre des virages ni des kilomètres.
À Traubach-le-Haut il retrouva les siens au cantonnement affecté à la 3e section. La paille près de l'étable, à 4 heures du matin, c'était le paradis.
Le petit village vivait, comme toujours, au rythme des saisons. Blotti sous la chape blanche de l'hiver, il était construit pour affronter un froid mordant qui n'avait pas de prise sur lui.
Sous leurs toits encapuchonnés de neige et frangés de cristal, les maisons paraissaient attendre calmement la belle saison, en soufflant par leurs cheminées un mince filet de fumée, signe de la vie cachée entre leurs murs.
Après des journées mornes, où le service était réduit au minimum, le meilleur moment se situait à la tombée de la nuit, quand réunis dans la salle commune devant l'âtre, les hommes se retrouvaient pour écrire chez eux, bavarder, où simplement réfléchir. Charles envoyait à sa mère lettre après lettre mais, jusque-là, le passage du vaguemestre n'avait été que déception.
À cette heure du crépuscule, où la terre semblait se durcir sous la poigne du gel, beaucoup, comme Charles, avaient la sensation de retrouver un foyer.
Les échanges n'étaient pas faciles avec les Alsaciens car, des familles, il ne subsistait que les aînés. Plusieurs classes avaient été mobilisées par la Wehrmacht et ces soldats, que l'on appellerait les « malgré nous », se battaient à cette heure-là quelque part à la périphérie du IIIe Reich. Combien d'entre eux étaient-ils en train de crever de froid ou de blessures face à l'armée rouge déroulant son implacable mur de feu vers le cœur de l'Allemagne ?
De ce sujet douloureux il n'était jamais question, même si les photos sur la commode ou la cheminée révélaient des fils en uniformes vert-de-gris. Quant aux filles, discrètes, on ne les apercevait qu'au moment des repas.
Les vieux Alsaciens avaient, de toute façon, une certaine peine à parler Français, forcés qu'ils avaient été, depuis plus de quatre ans, de ne pratiquer que l’allemand en dehors de leur dialecte alsacien. La langue française leur avait été interdite.
Mais, même dans le silence, à la lueur des bûches de sapin, Charles se sentait bien, au-delà de la mélancolie qui meublait le fond de son cœur. À ses côtés restait le seul alsacien de la compagnie. Ils s'étaient connus au camp de Caïs puis avaient été bêtement séparés pendant le voyage vers Belfort. L'affectation dans des sections différentes ne leur avait permis de se retrouver que dans les rues de Willer. Ils avaient fait cantonnement ensemble, d'autant plus facilement que le dialecte alsacien de Jean Schmitt était un véritable sésame auprès des autochtones.
Mais Charles commençait à trouver dans ses nouveaux camarades, Jean et Roger, le meilleur antidote contre le cafard. Entre eux trois, commençait à naître une compréhension que l'épreuve du feu forgerait en une amitié, que, même la rouille du temps ne parviendrait pas à détruire.
Affecté à la section le lendemain de leur arrivée à Traubach, un Lorrain du nom d’André, était venu ajouter à la variété de leur petite troupe. Roux comme un écureuil, c'était un taciturne qui parlait peu mais se comprenait fort bien avec les Alsaciens.
Autour d'eux, leurs compagnons marocains subissaient avec fatalisme ce temps de repos, comme ils subissaient leur déracinement, leur mobilisation et cet effroyable changement de climat.
Venus en majorité de la Chaouia ou du Rharb, la plaine côtière marocaine, on les sentait aussi malheureux, sinon davantage, face à ce dur hiver que les gars de la Côte d'Azur.
Seul des Français, Favier évoluait dans cette froidure comme un poisson dans l'eau. Guère plus couvert que dans ses Alpes natales, il regardait ses compagnons frigorifiés avec un large sourire asiatique en commentant : « Faut bien qu'la saison s'passe ».
Mais, parmi les Marocains de la section, il y avait également une exception : Bihi. Petit, nerveux, noir de poil comme un bouquetin de l'Atlas, toujours gai, décidé, il était Chleuh de naissance. Normalement, il aurait eu plutôt sa place dans les goums, mais les hasards de la mobilisation l'avaient affecté à un régiment de tirailleurs. Endurant, solide comme un pied d'olivier, il était toujours là quand on avait besoin de lui. Et surtout, en ce mois de janvier glacial, il était aussi à l'aise que Favier. Au même moment dans l'Atlas, son douar n'était-il pas couvert de neige ? Toute la tribu résistait au froid grâce aux djellabas, aux burnous et aux cheich tissés par les femmes, avec la laine de leurs moutons.
Curieuse cohabitation, tout de même, que celle de ces Africains du Nord ne parlant presque qu'Arabe (ou Chleuh) et ces gens des bords du Rhin s'exprimant, surtout chez les vieux et les tout jeunes, uniquement en dialecte germanique.
Il avait fallu une guerre de plus pour que les premiers soient envoyés pour libérer les seconds du joug d'une Allemagne dominatrice. Celle-ci avait pris ses fils à l'Alsace en les prétendant siens pour aller, dans les steppes de l'immense Russie, détruire un bolchevisme dont les similitudes avec le nazisme expliquaient en partie la hargne d'un Adolf Hitler. On ne supporte pas la concurrence d'une autre nation lorsque la compétition ne peut avoir comme conclusion que l'anéantissement physique.
Cet holocauste se retournait contre Hitler, sa clique et son peuple, cernés désormais par les alliés. Écrasée sous les bombardements, l'Allemagne, telle un fauve blessé, essayait de faire face.
À quelques kilomètres de Traubach-le-Haut, sous leurs casques vert-de-gris, les Fritz attendaient dans leurs casemates que l'on vint leur arracher ce dernier morceau de terre française en-deçà du Rhin.
Le 18 au matin le chef Bonnaire annonça le départ.
— Où allons-nous, chef ? demanda Guerineau.
— Destination inconnue, les gars. Tout ce que je sais c'est qu'on fait mouvement. Tout le monde prêt pour 17 heures.
Dans la nuit la compagnie embarqua en camions. Le trajet fût bref.
À Schweighouse ils découvrirent leur nouveau cantonnement. L'installation devenait une routine.
On leur distribua des rations C, jusque-là inconnues des Boujadi, comme disaient les Marocains pour désigner les bleus.
Six petites boîtes de conserve leur révélèrent l'ingéniosité américaine : les boîtes consistantes comme le chicken-and-rice et le meat-and-noodles étaient complétées par les biscuits, la confiture, les bonbons, les cigarettes, les allumettes, le sachet de jus d'orange déshydraté, le café soluble, les pilules désinfectantes pour l'eau et même le papier Q.
Charles et ses compagnons déballaient ces victuailles concentrées avec l'émerveillement de gamins ouvrant des pochettes-surprises. Ils n'eurent que peu de temps pour en profiter.
Le chef leur annonça qu'ils devaient se préparer pour le lendemain matin, 20 janvier.
Ils ne devaient emporter que leur arme individuelle et ses munitions ainsi que leurs couvertures roulées dans la toile de tente individuelle.
Charles, avec une certaine inquiétude qu'il ne voulait pas montrer, interrogea le chef Bonnaire.
— Qu'est-ce-qui se prépare, chef ? On part à l'attaque ?
— Ça en a tout l'air.
La réponse était laconique et Charles mit du temps à s'endormir.
Le branle-bas eût lieu à 6 heures. Charles fourra dans son sac marin ce qu'il devait laisser derrière lui, autrement dit ces choses peu nombreuses qu'on appelle personnelles mais souvent marquées d'une valeur affective inestimable.
Il enfonça dans les poches de son treillis de combat les 3 boîtes de rations K qu'on leur distribua au dernier moment. Aussi inconnues que les précédentes elles portaient le nom de breakfast, dinner et supper. Enrobées dans de la paraffine, elles pouvaient résister à toutes les attaques de l'eau ou de l'humidité.
Il était 7 heures 30. Charles sentait grandir en lui une sourde inquiétude. Il sursauta lorsque l'air fût déchiré de détonations toutes proches. La préparation d'artillerie commençait.
Il y avait près d'une demi-heure qu'elle durait lorsque le chef Bonnaire surgit.
— Préparez-vous. En colonne par un. On y va.
Ils sortirent dans la cour de la ferme. Le vent soufflait en rafales, se jouant des flocons qui tombaient sans doute depuis longtemps, car le sol durci avait disparu sous un manteau immaculé. Ils passèrent à côté des batteries qui continuaient à tirer sans discontinuer. On n'entendait même pas tomber les douilles fumantes tant la neige était épaisse.
Ils lorgnèrent les artilleurs avec ce regard envieux et toujours un peu méprisant qu'ont les fantassins lorsqu'ils rencontrent ceux qui sont sensés leur préparer le passage mais qui restent toujours derrière et déclenchent le feu, souvent sans le subir.
Bientôt ils furent dans les champs. Devant, s'étalait une étendue vide presque sans arbres et, au-delà, la forêt et son mystère, angoissant.
Au-dessus d'eux les obus sifflaient dans cette direction d'où ne venait, semblait-il, aucune réaction.
Des bruits de moteur montaient de la droite et de la gauche. Charles tourna la tête. Des Sherman avançaient de chaque côté du champ en tirant vers la forêt.
Au même moment des gerbes de terre surgirent du sol. L'ennemi commençait à riposter. Et pour la première fois Charles entendit le crépitement, rapide comme un roulement, des mitrailleuses allemandes.
Il serra son fusil et malgré la boule qu'il sentait au creux de l'estomac il continua à avancer. Pouvait-il faire autrement ? Toute la compagnie était là, autour de lui, progressant sans ralentir, encouragée par les chefs de section.
Passant près d'un tas de pierre, ruine de quelque abri agricole, Charles crût entendre un gémissement. Stupéfait, il aperçut, accroupi contre les pierres, Garassin, qu'il n'avait pas revu depuis leur voyage en train. Sa tête maigre et son nez crochu, sous le casque américain, faisait penser à un petit rapace venant de briser sa coquille. Charles l'entendit marmonner :
— Bonne mère, qu'est-ce-qui m'arrive ? Mais je vais me faire escagasser. Et je suis pas venu pour ça, moi ! Bonne mère !
Charles eût presqu'envie de rire. Mais le cœur n'y était pas. Il continua à avancer. Les bois étaient tout proches.
Un ruisseau barrait le passage. Les uns après les autres les tirailleurs tentèrent le saut, car la glace avait lâché sous les pieds des premiers. Charles comme tous les autres ne pût éviter le bain de pied. Il sentit l'étreinte glacée de l'eau prendre ses pieds et ses chevilles. Ils étaient tous trempés jusqu'aux mollets et allaient le rester pendant trois jours.
Les rafales d'armes automatiques s'étaient rapprochées comme ils rentraient dans les bois. Les ordres se mêlaient aux cris des blessés. Charles poussa la sûreté de son fusil. Mais sur quoi tirer ? Devant lui la masse grise, noire et blanche du sous-bois ne laissait voir aucune silhouette ennemie. Les Fritz étaient là pourtant puisque les balles sifflaient de tous les côtés.
Charles vit le caporal Brahim plier les genoux et s'écrouler dans la neige. Il se pencha sur lui. Son visage était figé, sans expression. Il était mort. Charles n'eût alors qu'une idée : changer son arme contre la sienne.
Il s'empara de la carabine du caporal et de ses chargeurs et abandonna son fusil près du corps.
Autour de lui les tirs continuaient. Il s'appuya contre un arbre et, faute de distinguer une cible, il fit comme les autres. Il tira au hasard vers ces bois menaçants qui crachaient la mort. Au moins, ça lui donnait du cœur au ventre.
Il vida deux chargeurs, lorsqu'à quelque distance il perçut le tir régulier des mitrailleuses de sa compagnie. La section avait dû les mettre en batterie mais il aurait été incapable de dire depuis combien de temps.
Un gémissement monta à ses oreilles. Il tourna la tête. Le chef Bonnaire gisait au sol. Un trou sous sa pommette gauche laissait échapper du sang par à-coups réguliers. Fasciné, Charles restait sans réaction. Brusquement, il se surprit à hurler « Brancardiers, brancardiers. Le chef est blessé. »
Il lui sembla que l'ensemble des hommes se déplaçait vers la droite. Un ordre monta « Cessez le feu. Avancez ». Il distingua les brancardiers s'affairant un peu partout et laissant ceux qui, de toute évidence, étaient morts. D'eux d'entre eux chargèrent le sergent-chef et se dirigèrent vers la lisière du bois. Charles eût un dernier regard pour lui. Il ne le reverrait plus.
Sans chef de section ni chef de groupe il eût, une nouvelle fois, la crainte d'être séparés des siens. Il scruta les lieux et, de dos, reconnut le petit Guerineau ainsi que le caporal-chef Fourment. Il se hâta vers eux. Un étrange silence était brusquement tombé sur les bois. On ne tirait plus et la neige étouffait tous les bruits.
La colonne se reforma et ils s'enfoncèrent dans ce paysage incertain où tous les sentiers, tous les halliers se ressemblaient.
De temps à autre, loin devant, quelques coups de feu éclataient. Souvent ils s'arrêtèrent, parfois quelques minutes, parfois pendant de longues périodes où ils se demandaient ce qui se passait. À chaque halte un peu longue, Charles sentait le froid, telle une main glacée, qui étreignait ses pieds. Comme beaucoup de ses compagnons il piétinait pour tenter de se réchauffer mais seule la marche était de quelque efficacité.
Vers la fin de la matinée il réalisa qu'il n'avait pas touché à ses rations. Il ouvrit la boîte « breakfast » et, manger lui donna l'impression de refaire le plein de courage.
Le danger immédiat s'était éloigné et il pouvait parler avec les rescapés de sa section. Le caporal-chef Fourment en avait pris le commandement avec le sergent Marocain du deuxième groupe qui ne demandait pas mieux que de bénéficier de l'aide d'un Français. Le plus difficile pour lui aurait été la liaison par talkie-walkie avec le commandement de la compagnie.
Les groupes reçurent l'ordre de rester en contact permanent afin que la section gardât son homogénéité à tout moment.
Les heures s'écoulèrent et lorsque le jour commença à baisser ils comprirent qu'avant la nuit ils n'auraient atteint aucun objectif, aucun village, aucun lieu où ils pourraient se mettre à l'abri.
Brutalement, l'air fût déchiré par des tirs où on reconnaissait facilement les rafales roulantes des mitrailleuses allemandes. La forêt sembla se réveiller, secouée par les détonations, les ordres, les cris des blessés.
Tandis qu'on appelait les brancardiers de tous côtés Charles et ses amis virent déboucher des taillis qui, déjà, sombraient dans le crépuscule grisâtre, un groupe de tirailleurs fuyant à toutes jambes. Les balles sifflaient autour d'eux et rien ne semblait pouvoir les arrêter.
Il y eût un instant de flottement. Des hommes de la 3e section tournèrent les talons pour se joindre aux fuyards.
Le caporal-chef Fourment étendit les bras pour s'interposer.
"Arrêtez, demi-tour, bande de salopards !...Les Français avec moi".
Charles, Jean, Roger, André, Favier l'encadrèrent et accrochèrent des tirailleurs au passage, les obligeant à s'arrêter. Sans attendre, ils ouvrirent le feu vers le bois, tirant en aveugles mais faisant le plus de bruit possible. Devant, dans l'obscurité qui s'épaississait, le son rassurant des tirs de la section mitrailleuse acheva de renverser la situation. Les tirailleurs s'arrêtèrent, refoulés par la compagnie qui suivait. Ils regagnaient leur place dans la colonne, quand l'ordre arriva de bivouaquer pour la nuit.
Charles se concerta avec Jean et Roger. Deux toiles de tente boutonnées ensemble faisaient un abri pour deux. En ajoutant une troisième on pouvait fermer une des extrémités. Comme il n'y avait pas de vent, Charles, inspiré par ses anciens camps scouts, proposa d'utiliser la troisième toile comme tapis de sol. Ils seraient serrés mais, avec le froid qui régnait, ce serait le meilleur moyen de se tenir chaud. Ils mangèrent la fin de leur ration "dinner" et burent des rasades de l'eau glacée dont ils avaient rempli leurs bidons à Schweighouse. Au cas où aucun ravitaillement ne leur serait distribué le lendemain matin, la boîte "supper" servirait de réserve.
Ils auraient volontiers bu un café. Il ne leur manquait que le feu pour le faire chauffer, comme remarqua Jean, désabusé. Roger pris un ton railleur : "Si tu nous trouves un vieux numéro du journal local et un fagot de bois sec j'te passe toutes mes cigarettes". Jean grogna quelque chose d'inaudible et la suggestion en resta là.
Les guitounes avaient surgi comme des champignons dans le sous-bois. Allant de l'une à l'autre, Fourment et le sergent Ahmed passèrent la consigne de veiller à tour de rôle.
Pelotonné sous sa couverture, Charles ne ressentait aucune envie de dormir. Sa seule sensation dominante était le froid sournois, pénétrant, qui montait du sol et celui, de plus en plus douloureux, qui empoignait ses pieds et semblait vouloir imperceptiblement remonter vers ses genoux. Le bas de sa capote était mouillé comme ses pantalons, son treillis et ses guêtres.
Il enleva ces dernières, mais ce n'était pas suffisant. Au contraire, même mouillées, elles faisaient un peu obstacle au froid.
Alors il décida de retirer ses chaussures, des godasses de l'armée française qu'il avait obtenues du magasinier de la compagnie à Traubach-le-Haut. Elles n'avaient pas de coutures en travers des orteils comme les Américaines, dont un tel montage lui avait paru rédhibitoire dans la perspective des marches qu'on exigerait d'eux comme fantassins. Il retira aussi ses chaussettes et se frotta les pieds avec sa couverture.
Il mit ses chaussettes sous ses bras contre son blouson. Peut-être sécheraient elles pendant la nuit. Il cala les godasses sous sa capote et exhorta ses deux copains à en faire autant, mais Roger dormait déjà. Quant à Jean, il s'était débrouillé à son arrivée à la compagnie pour ramasser au magasin une des rares paires de snowboots américains qui s'y trouvaient. Grâce à cela il avait embarqué moins d'eau au passage du ruisseau et se sentait peut-être plus à son aise.
Les pieds emmaillotés dans sa couverture Charles chercha le sommeil. Il eût une pensée pour sa mère qui, heureusement ne pouvait se douter dans quelle lutte il était engagé.
Le jour se leva, blafard, sur les guitounes givrées. Rien ne bougeait dans les bois paralysés par le gel. On aurait pu croire que toute la compagnie était passée de vie à trépas.
Des têtes apparurent à l'extrémité des tentes. Le talkie-walkie grésilla du côté où devait être le chef de section.
Il s'extirpa de son abri et sa voix lança les ordres.
« Préparez-vous à plier bagages. Départ dans 10 minutes ».
Personne ne semblait avoir entendu cet appel pour être réveillé ! qui aurait pu encore dormir ?
Charles s'était assis tant bien que mal. Il se sentait courbatu et abruti. Avec découragement, il constata que ses chaussettes dégageaient une chaleur humide. Quant à ses godasses, elles étaient aussi mouillées que la veille au soir. Quand donc pourraient-ils faire un bon feu pour se sécher ?
Il se tourna vers Jean : "Comment est-ce que tu as dormi ?
— Sais pas, répondit l'intéressé. J'ai l'impression de n'pas avoir fermé l'œil et pourtant, il me semble que j'ai rêvé.
— Pécaïre, intervint Roger. Je vais finir par regretter la Bocca. Vous imaginez, là-bas, sur une terrasse au soleil, le café au lait avec les croissants...
— Ta gueule, rugit Jean. Aides plutôt à rouler les toiles".