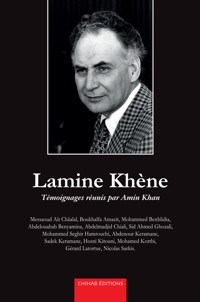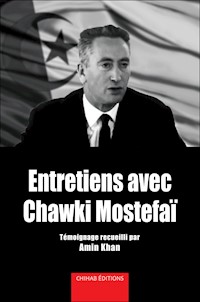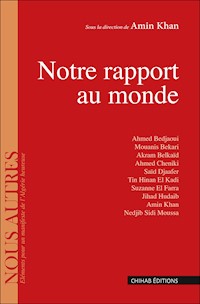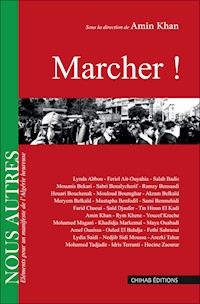
13,99 €
Mehr erfahren.
Dans ce volume, « Nous autres » propose, du point de vue du travail, quelques expériences et réflexions qui contiennent les germes d’avenirs possibles. Nassima Metahri cisèle avec science, délicatesse et haute précision le concept central de l’ouvrage en se saisissant de ses racines psychologiques, philosophiques et historiques, intriquées qu’elles sont dans la conscience et dans la pratique de nos sociétés. Et elle parvient à faire ce travail de déconstruction de « Travailler » dans la perspective particulière de la démarche de « Nous autres » dont l’objectif est la connaissance et le progrès pour la réalisation des valeurs de liberté, de justice et de dignité, par les moyens de Penser !, Travailler !, Lutter !, et Aimer ! Tin Hinan El Kadi nous montre, de façon claire et documentée, la fabrication de mythologies culturalistes qui essentialisent les cultures des peuples au profit de la vision des dominants de l’heure. Vision qui d’une certaine façon les aveugle eux-mêmes et, miracle vertueux de la dialectique, les empêchent parfois de voir et de contrer la libération de ceux qu’ils considèrent comme intrinsèquement faibles et fatalement incapables de révolte et d’émergence historique. Fatima Zohra Oufriha, qui malheureusement nous a quittés le 22 octobre dernier, est la première Algérienne Docteur d’Etat et Professeur agrégé de Sciences économiques. Sa contribution présente les faits et les chiffres du travail des femmes en Algérie. En démontant au passage, objectivement, tranquillement, nombre d’erreurs d’appréciation courantes sur la place des femmes algériennes dans les sphères de l’économie et de la société, elle montre notamment le rapport direct qui existe entre progrès de la scolarisation et de l’urbanisation et progrès social par l’amélioration du statut professionnel des femmes en dépit des distorsions et des obstacles constitués par la gestion bureaucratique et rentière de l’économie.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Amin Khan, né le 18 octobre 1956 à Alger, est un poète algérien contemporain de langue française. Il suit des études de philosophie, d’économie et de sciences politiques à Alger, Oxford et Paris. Il publie sous le nom d’« Amine » ses premiers recueils à Alger en 1980 et 1982. En 1984 il fait partie des poètes réunis par Tahar Djaout dans son anthologie Les Mots migrateurs. Il est plus tard fonctionnaire international à l’UNESCO.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Marcher !
Elémentspourunmanifestedel’Algérieheureuse
SousladirectiondeAminKhan
Marcher !
Elémentspourunmanifestedel’Algérieheureuse
Lynda Abbou, Feriel Ait-Ouyahia, Salah Badis, Mouanis Bekari, Sabri Benalycherif, Ramzy Bensaadi, Houari Bouchenak, Mouloud Boumghar, Akram Belkaïd, Meryem Belkaïd, Mustapha Benfodil, Sami Benmehidi, Farid Chaoui, Saïd Djaafer, Tin Hinan El Kadi, Amin Khan, Rym Khene, Youcef Krache, Mohamed Magani, Khadidja Markemal, Maya Ouabadi, Amel Ouaissa, Ouled El Bahdja, Fethi Sahraoui, Lydia Saidi, Nedjib Sidi Moussa, Arezki Tahar, Mohamed Tadjadit, Idris Terranti, Hocine Zaourar
CHIHAB EDITIONS
© Éditions Chihab, 2019
www.chihab.com
Tél. : 021 97 54 53 / Fax : 021 97 51 91
ISBN : 978-9947-39-347-5
Dépôt légal : mai 2019
Introduction
La dernière innocence et la dernière timidité. C’est dit. Ne pas porter au monde mes dégoûts et mes trahisons. Allons ! La marche, le fardeau, le désert, l’ennui et la colère. À qui me louer ? Quelle bête faut-il adorer ? Quelle sainte image attaque-t-on ? Quels cœurs briserai-je ? Quel mensonge dois-je tenir ? – Dans quel sens marcher ?
« Une saison en enfer »
Arthur Rimbaud1
C’est le 20 mars dernier que Mohamed Magani m’a suggéré de faire un livre sur les évènements actuels. « Travailler ! » venait de paraître, et nous étions engagés dans la préparation du 5e volume de la série « Nous autres, éléments pour un manifeste de l’Algérie heureuse » intitulé « Lutter ! » et dont la parution est prévue pour le premier trimestre de l’année 2020… J’en ai aussitôt parlé à Azeddine Guerfi, directeur des éditions Chihab (qui abritent « Nous autres » depuis 2016), qui m’a tout aussitôt donné son accord enthousiaste pour la réalisation du projet.
Ce livre, c’est donc « Marcher ! ». Il regroupe de nombreux acteurs et témoins de la révolution en cours.
Des photographes, qui aujourd’hui constituent une avant-garde visuelle et documentaire du peuple en mouvement. Sabri Benalycherif, Ramzy Bensaadi, Houari Bouchenak, Youcef Krache, Khadidja Markemal, Fethi Sahraoui, Lydia Saidi, Arezki Tahar, Hocine Zaourar, nous donnent ici un aperçu de leur ample et constant travail de capture des vérités fugaces d’un événement sismique, d’une société en ébullition révolutionnaire. Leur apport est essentiel car ils mettent à jour, chacun avec son talent propre, la dimension esthétique du mouvement populaire.
Dans le même moment, il y a ici aussi l’impossibilité de rendre compte de la toute-puissance de ces évènements et de la richesse incommensurable de l’intelligence et de la créativité du peuple, comme le dit le texte de Saïd Djaafer, « La photo que j’ai ratée ».
Dans ce volume, encore plus divers que les précédents, aussi bien dans la forme que dans le fond, on trouvera des éclairages utiles à l’appréhension de la révolution en cours ainsi que des éléments pour une réflexion sur l’avenir immédiat, des analyses juridiques, politiques, psychologiques, par Idris Terranti, Feriel Ait-Ouyahia, Mouanis Bekari, Mouloud Boumghar ou Tin Hinan El Kadi.
Akram Belkaïd se souvient des années 90, compare les situations et met en évidence les liens entre elles, les liens de la mémoire, les liens de l’expérience, les liens que tisse sans cesse la société, en silence souvent, mais sans cesser de marcher.
Dans ce livre, on voit aussi des sources et des affluents brûlants de ce grand fleuve d’aujourd’hui, majestueux de sagesse, de lucidité, de colère pacifique et de détermination, dans les textes de Farid Chaoui, de Maya Ouabadi, les propos de Mohamed Tadjadit recueillis par Lynda Abbou, ou encore le récit que lui fait Oulid el Bahdja de l’expérience de Ouled El Bahdja.
Depuis l’île de la Réunion, Sami Benmehidi, entre Alger et Paris, Nedjib Sidi Moussa, entre Alger, Tazmalt et Berlin, Amel Ouaissa, nous donnent des témoignages émouvants de la symbiose, malgré l’exil, des Algériens, parties de la totalité de ce vaste mouvement populaire.
La poésie, qui est d’une certaine façon au cœur-même de « Nous autres » et de notre démarche morale, politique et intellectuelle, transparaît à travers tout l’ouvrage, mais elle s’affirme en tant que telle, à la fois éclatante et subtile, dans les textes de Salah Badis, de Meryem Belkaïd, de Rym Khene et de Mustapha Benfodil.
Enfin, nous ne sommes pas peu fiers que ce volume de « Nous autres », se rapprochant un peu plus des expressions émanant du mouvement populaire, sur les pancartes des manifestants, leurs slogans, leurs chants, réunisse, comme à l’occasion de « Travailler ! » des textes et des photographies, mais aussi que les textes y figurent dans leurs différentes langues originales d’écriture, française, arabe, derja ou anglaise.
Amin Khan
La marche souveraine
Amin Khan
Alors que la mémoire de la sublime preuve de l’existence du peuple algérien par la révolution de Novembre semblait fatalement atteinte après avoir été tant et tant malmenée par le régime qui lui a ravi sa liberté dès l’Indépendance, voici qu’aujourd’hui il reprend sa marche souveraine, au soleil de l’infinité des possibles offerts à ceux qui veulent vraiment, à ceux qui sont prêts à l’effort, au sacrifice, à la transcendance. Et alors que la révolution de Novembre avait réalisé l’extraordinaire exploit de faire ressurgir au monde un peuple en voie d’extermination colonialiste, la révolution de Février devrait, elle, le hisser au palier le plus élevé de l’existence des peuples, là où, libres, ils se gouvernent eux-mêmes par eux-mêmes.
La révolution en cours actuellement a pu être rêvée, elle a pu, ardemment, secrètement, de manière insensée, être espérée, elle a pu être pensée dans tel ou tel de ses aspects, mais à son éclosion, à son explosion savoureuse et tranquille, elle a surpris tout le monde, le peuple lui-même, et le monde entier, par son ampleur, en rassemblant à travers tout notre territoire, toutes les générations, toutes les catégories sociales, toutes les tendances idéologiques, toutes les opinions politiques, par son auto-organisation, parfaite, par son caractère pacifique, totalement, par son souffle, long et puissant, par son intelligence acérée et son inépuisable créativité.
Cette révolution que nous avons, nous autres, le privilège inouï de vivre est d’abord terriblement émouvante. Le sentiment qui domine dans les rues, dans les places publiques, dans les cœurs, dans les regards, dans les gestes, c’est l’amour. En toutes ses incarnations, en toutes ses abstractions, en chacune de ses ombres et de ses nuances. C’est l’amour qui étend sa lumière sur les visages et les corps de ces jeunes filles devenues, depuis février, encore plus belles, de ces jeunes gens, devenus, depuis mars, encore plus beaux.
Cette lumière est une lumière qui revient en force, franchissant les décennies obscures et malfaisantes, depuis l’époque de la première révolution. C’est le beau regard et la voix émue d’Annie Steiner qui me reviennent à l’instant. Parlant de ses compagnes de détention, de ces jeunes femmes combattantes pour l’Indépendance, incarcérées dans les geôles coloniales, sa voix, après un profond silence – plongée fulgurante au cœur de la vérité : « … Elles étaient si belles ! » Cette lumière, c’est la lumière gracieuse de la révolution dont je suis mille fois ému que certaines de ces héroïnes du peuple algérien combattant soient encore parmi les vivants, parmi les témoins de la renaissance du peuple algérien douloureux, revenu encore une fois à cette bonne lumière qui veille sur nous et qui lave les outrages et qui nourrit ce qu’il y a de meilleur en nous.
C’est l’amour qui soudain nous étrangle, nous fait venir de nouvelles larmes et nous fait pleurer dans la rue chauffée à blanc à la pensée de ceux qui auraient dû être ici, dans la foule, parmi le peuple dans sa grandiose manifestation. Impossible de connaître ou de citer leurs noms, tous leurs noms. Tous leurs noms sont encore cette matière blanche et noire, magique, indélébile, primordiale, l’encre brute qui servira à écrire dans l’ardeur d’un temps impérieux, le registre sacré des millions de martyrs qui ont donné leur vie pour que vive à travers les siècles ce peuple extraordinaire.
Ce serait étrange de citer leurs noms, comme à une cérémonie commémorative, car ils sont ici, parmi nous, ni marchants ni immobiles, mais finalement heureux, dans cette transparence du temps endeuillé, douloureux, mais finalement serein. Ils sont ici, chacune, chacun avec son regard, avec son geste, avec son sourire, chaleureux, ironique, malicieux, intact, tels que les garde la mémoire. Et l’amour, cet amour-là, fait que nos mémoires s’effleurent, se touchent, font mine de se dissiper, se mélangent, et que cette confusion est délicieuse, comme la confusion de l’amour, justement.
L’amour fait que les gens, les objets, les mots, les symboles tremblent dans la lumière du jour nouveau, et naissent nouveaux aux regards embués, tels des nouveaux nés, des êtres neufs. L’emblème de cette nation lui-même est comme neuf, il vient d’être cousu par mille femmes anonymes aujourd’hui, mais dont le nom figure dans le grand registre sacré, noir et blanc, des nourriciers, des martyrs, des combattants. L’amour fait que je te vois nouvelle, que je te vois nouveau, au bord d’un espace nouveau, d’un temps nouveau, d’une question nouvelle.
L’amour fait qu’au détour d’une phrase, d’un regard parfois, d’une intonation de ta voix, Peuple, des questions jadis tellement difficiles, tellement désespérées, se dénouent soudain comme la respiration réprimée, comme la ceinture de soie d’une nouvelle épouse de ce temps, une nouvelle mariée de cette cause merveilleuse, irrépressible désormais, celle de la résurrection de l’amour, de la liberté, de la justice, de la dignité.
L’amour, c’est cette soif, cet aiguillon de la conscience qui taraude les multitudes, c’est cette soif inextinguible qu’apaise un instant l’eau qu’offre une vieille dame de son balcon de pierre tendre et de fer forgé, la soif, et la faim intrinsèque qu’apaise un instant l’impromptu festin qu’elle fait descendre dans un couffin à l’aide d’une corde infinie. Mais, Bon Dieu ! D’où vient cette corde ? D’où vient ce geste ancestral, tout empreint de la beauté numide d’un peuple souvent assiégé, blessé, dépossédé, d’un peuple souvent pourchassé, mais jamais vaincu, car jamais soumis !
Un peuple libre de femmes et d’hommes libres. Un peuple guidé à travers le brouillard des mensonges officiels et des illusions thérapeutiques, par un sixième sens irradiant, le sens du bien et du mal, car même lorsqu’il faut, pour survivre, ruser avec l’ennemi, l’user dans ses illusions de puissance, car, même si trop longtemps contraints au silence et à l’aphasie, à l’introspection solitaire, à l’anxiété, aux songes mystérieux et aux cauchemars inévitables, les femmes et les hommes libres savent qu’ils ne peuvent par contre jamais ruser avec leur conscience, sous peine du terrible châtiment de la disgrâce mortelle du mépris de soi.
L’amour est la réponse la plus juste à tout ce qui s’efforce de nous en éloigner. L’oppression, l’injustice, l’arbitraire, la corruption, n’y peuvent rien finalement. Ces fléaux associés ne sont pas venus, et ne viendront pas à bout de ce peuple. Certains, nombreux, trop nombreux, ont cru que les Algériens avaient été infectés dans leur chair, corrodés dans leur être, corrompus par les humiliations, décérébrés par l’école, les médias, « la classe politique », domestiqués par le pouvoir… Ils ont eu tort.
Ils ont ignoré la culture profonde de ce peuple de résistants au long cours, ce peuple de combattants du meilleur combat, ce peuple de longue patience, ce peuple doué d’une précieuse mémoire, toujours enfouie, loin des yeux de l’ennemi, une mémoire source primordiale du courage qu’il forge tous les jours, et qui, chaque jour, grandit en une arme miraculeuse, l’arme de l’intelligence, de l’amour, de la liberté, de la justice, de la dignité.
Dans leur mépris primaire et leur pathétique idiotie, ils ont confondu ceux qu’ils voyaient, leurs « frères », avec l’incarnation de ce qu’ils sont incapables de comprendre qu’ils sont eux-mêmes, des épouvantails de saleté historique, de déchéance morale et de tristes vilénies, des scories, molles et froides, malades et malfaisantes que rejette loin de lui le volcan immémorial de la grande dignité humaine du peuple algérien. Ils ont cru que les Algériens étaient soumis alors qu’ils ne faisaient que voir en eux leur propre figure d’être soumis par l’ignorance, l’inculture, la cupidité, accueillants volontiers en eux-mêmes les germes de la prostitution, de l’aliénation et de la trahison.
La révolution de Février est une grandiose insurrection morale. De son bras puissant, elle extirpe la vérité concrète de la vase immonde du marécage matériel et moral, économique et social, politique et intellectuel, psychologique et culturel, où un pouvoir malfaisant s’est efforcé de plonger, pour l’étouffer, un peuple, son histoire et ses valeurs. Par leur attitude, leurs comportements, les Algériens, par millions, dans leur écrasante majorité, sont apparus au grand jour ensoleillé pour ceux qu’ils sont. Aux antipodes de la vile propagande, locale ou étrangère, qui tendait trop souvent à présenter les Algériens comme des gens incapables de discipline, paresseux et incultes, prompts à la violence et autres déclivités psychologiques et morales, les Algériens, par millions rassemblés dans le vaste espace public national et mondial, ont déchiré les clichés dont ils étaient affublés, et ont montré, sans aucune ostentation ni gloriole, le visage de femmes, d’enfants et d’hommes, dignes et fiers, courageux, verticaux, sensibles et généreux, attentifs les uns aux autres, respectueux, ouverts, libres et fraternels.
La révolution de Février est également une majestueuse insurrection esthétique. N’en pouvant plus de vivre dans un environnement produit par la crasse morale, l’indigence intellectuelle, la corruption, l’incompétence administrative de « gouvernants » indignes sous tous rapports, les Algériens, les jeunes en particulier, – sans surprise car ce sont eux, les jeunes gens et les jeunes filles âgés de 20 à 35 ans qui sont l’esprit et le corps de cette grande révolution pacifique et qui ont entraîné avec eux toutes les générations – ont entrepris de nettoyer les rues de leurs villes et de leurs villages, d’embellir leurs quartiers, de restaurer la beauté de leurs paysages et de leur pays. Peintres en bâtiment, ou artistes peintres, ou citoyens inspirés, tous s’y mettent. Escaliers repeints, fresques, poèmes et slogans sur les murs, jardins repris et arrangés, sont autant de marques du bonheur et de la volonté de combattre par tous les moyens la laideur et l’asphyxie.
L’Algérie, humble, majestueuse, dans sa vérité, sa sobriété, son courage, sa patience, sa beauté, retrouve aujourd’hui sa voix, sa voie, sa vocation. Cette révolution que l’on nomme parfois, par pudeur peut-être, révolution du sourire, est déjà, quelle que soit l’issue, une révolution d’essence populaire et démocratique, une révolution de la liberté, de la justice et de la dignité.
xxx
Du rêve à la réalité
Idris Terranti
Les manifestations populaires massives qui ont débuté le 22 février dernier marquent un moment décisif dans l’histoire du pays. Ce fut le moment où, dans un réflexe de sauvegarde, le peuple a repris de manière résolue sa marche vers le progrès. Nous avons assisté, dans une sorte de ravissement et d’inquiétude à la fois, à des manifestations qui, tout en rappelant la dimension libératrice de la révolution de Novembre, ouvrent sur un avenir largement porté par le slogan des années 90, « Algérie libre et démocratique ».
Des millions de personnes, dans un effort gigantesque, se sont livrées à une sorte de « démonstration du futur » dans une transcendance du présent pour donner ainsi à voir ce qu’ils voudraient créer : Une Algérie de citoyens, libres, solidaires, vertueux, fiers de leur passé et résolument tournés vers l’avenir. Un véritable rêve éveillé !
Si des réactions hostiles au cinquième mandat étaient prévisibles, personne à l’intérieur ou à l’extérieur du pays n’avait prévu des manifestations de cette ampleur, dans cette forme, ou avec ce contenu. Qu’est-ce qui a rendu cela possible ?
Il est connu que le seul équilibre possible pour un « système » vivant, comme une société par exemple, est l’équilibre dynamique, c’est-à-dire le fait d’être en mouvement constant. L’arrêt du développement implique à terme une mort certaine. Brutale et violente dans un affrontement autodestructeur, ou bien dans une longue agonie par des adaptations viciées où chaque élément du système essaye de prendre ce qui reste à son voisin.
C’est cette logique que le système de gouvernement a imposée depuis bien plus de trente ans au pays tout entier. La réaction populaire vitale (il y va de la survie de la nation), si elle ne surprend pas par son nécessaire jaillissement, surprend par le dépassement du simple réflexe de la préservation en se projetant résolument dans l’avenir.
Les trente dernières années ont été pour nous une période de délitement et de déconstruction systématique de tout ce qui était issu de la guerre de libération et de l’indépendance. De la conception de l’état démocratique et social, à l’infrastructure économique nationale comme levier du développement indépendant, aux principes de solidarité nationale et internationale, tout a été systématiquement détruit.
De nouvelles valeurs prennent place, générées par une économie rentière prédatrice où prévalent la corruption, le mépris de l’effort et du travail productif. Toutes les institutions de l’Etat ont pour mission principale inavouée ou assumée, la logique distributive de la rente selon le seul critère de la proximité ou de l’allégeance au pouvoir. Plus proche on se trouve du centre, plus grande est la part qui nous échoit.
La terrible épreuve de la violence terroriste des années 90 a profondément marqué du sceau du traumatisme les liens de solidarité, le sentiment de destin commun, la société, la famille, l’école et tous les espaces qui pouvaient servir de protection et de refuge.
Au-delà du désastre économique et du modèle consumériste permis par la rente, ce sont les valeurs négatives portées et promues par ce système qui ont pénétré les pratiques sociales et qui ont généré l’image de « l’Algérien » voleur, incompétent, corrompu, fainéant et violent, cultivée par les colons d’hier, reprise et portée par les pouvoirs d’aujourd’hui.
Cette représentation s’accompagne nécessairement d’une profonde perte de l’estime de soi dont les premiers à souffrir sont les jeunes qui n’ont pas connu d’autre période dans laquelle ils pourraient se réfugier et qui se retrouvent piégés par cette image. Ils n’ont d’autre choix que de confirmer leur assignation en s’identifiant au « dominant », ou de prendre la mer au mépris de leur vie dans l’espoir d’une renaissance. Pour ceux qui restent, ils habitent pour échapper au désespoir, les rêves passéistes de leurs pères et la nostalgie d’une époque qui ne leur appartient pas, comme en témoignent les nombreuses émissions radiophoniques sur « le passé ». Ces pères ayant eu leur heure de gloire dans la libération ou l’édification du pays n’ont quand même pas pu éviter au pays le naufrage, ajoutant ainsi à leurs enfants la honte de leur propre asservissement. Avoir vingt ans à cette époque est tragique.
Mais comment donc des idées et des valeurs qui incarnent le meilleur ont-elles pu survivre au naufrage, être transmises et ressurgir en projet partagé ?
La honte finit par engendrer chez le jeune la colère et la rage envers ceux qui sont responsables de leur humiliation et encore plus de celle de leurs parents. C’est un sentiment qui ne peut être indéfiniment supporté. Cela finit par l’autodestruction ou bien, si des ressorts pour la sublimation persistent encore, par des réactions de survie salutaires.
C’est cette rage sublimée qui est le moteur de cette transcendance. C’est elle qui brise le cercle vicieux pour transformer soudainement un jeune habité par une révolte destructrice en citoyen pacifique, vertueux et policé, soucieux de son voisin et de l’espace public.
Se laver de la honte et reconquérir l’estime de soi, voilà le ressort qui tend la jeunesse vers le mieux en puisant dans le passé et en se tournant vers l’avenir. Cela consiste aussi à rétablir l’honneur bafoué des parents et des grands-parents. C’est ce qui les a résolument mis en marche à travers ces mots d’ordre pour le rétablissement de ce qu’il y a de meilleur pour ce pays :
Liberté
Démocratie
République et non monarchie
Seul le peuple est souverain
Halte au vol et à la prédation
Place aux compétences
Tous les responsables de notre situation doivent partir
Et plein d’autres mots d’ordre, porteurs des mêmes valeurs, exprimés parfois avec humour et toujours avec un incroyable sens créatif.
Ce qui est également remarquable, c’est la réappropriation des figures emblématiques de la guerre de libération nationale (Didouche Mourad, Zighoud Youcef, Larbi Ben M’hidi, Abane Ramdane, et de nombreux autres martyrs), malgré l’appropriation et l’utilisation éhontée de l’histoire et de ses symboles par les pouvoirs successifs.
Une communauté, un peuple, a toujours besoin de récits fondateurs mythifiés qui vont constituer un repère pour l’avenir et un refuge en cas de difficulté. Paradoxalement, ce sont les jeunes et les adolescents tournés vers l’avenir qui en ont le plus besoin. Et même si leurs parents n’ont pas réussi à protéger ces récits de la souillure, ils continueront dans l’expression de leur loyauté à les revendiquer et à les protéger.
Les grandes émotions engendrent les grandes motivations et des dispositions au changement. Mais seule la politique peut en indiquer le chemin. Les moments révolutionnaires qui augurent de changements qualitatifs sont généralement le résultat cumulatif de luttes portées à leur moment critique. Malheureusement, tout ce qu’a connu le pays depuis la fin des années quatre-vingts a été une disqualification à la fois de la politique et de ses moyens (partis, société civile, presse, idéologie, etc.) sur lesquels ce mouvement peut s’appuyer. Il pourra encore moins s’appuyer sur un contexte international dominé par le capitalisme financier guidé par la seule loi de la prédation et du profit.
Nous sommes à un moment grandiose et exaltant de tension vers l’avenir, mais dans un contexte de fragilité extrême. Les forces hostiles à la réappropriation par le peuple de sa destinée et de ses richesses sont nombreuses. Aujourd’hui, la question est de savoir ce qui peut être fait avec et dans ce mouvement populaire, avec les moyens qui sont les siens, pour garder son ancrage dans les principes du long combat pour la libération nationale et se diriger vers le progrès universel. Comment maintenir ce souffle et lui donner les moyens politiques de son aboutissement ?
xxx
Légitimité, je réécris ton nom
Feriel Ait-Ouyahia
Marcher pour la dignité, par millions, pacifiquement et avec ferveur, et réussir à renverser un ordre établi, voilà sans doute une réalité historique qui fera école dans les futurs traités de science politique tant elle se situe d’ores et déjà à l’avant garde d’une nouvelle sociologie politique du 21e siècle qui s’esquisse en Algérie, ici et maintenant.
Alors que s’ouvre un champ épistémologique d’envergure, y compris en termes de portée sur les enjeux de dimension internationale, cette seconde révolution algérienne nous invite, à ce stade, à voir ce qui se passe, mais aussi et surtout, à voir ce qui se pense.
La pensée de la dignité et tout l’espace sémantique que ce terme recouvre à travers le respect, la considération, la majesté ou encore l’honneur, est une pensée engagée et engageante. Et lorsque cette revendication de dignité se hisse à la hauteur d’un peuple, elle se pose au cœur de la dialectique de la légitimité.
La dénonciation de l’imposture, de l’usurpation des titres du pouvoir et de l’arrogance des gouvernants révèle, en creux, les revendications d’un désir de respectabilité et d’une réhabilitation de la majesté du peuple. En d’autres termes, elle pose avec éclat et fracas la question fondatrice de la légitimité.
Question éminemment politique, il s’agit également d’une question éminemment juridique car elle fonde le pacte social nouveau qui doit être scellé, et dont l’une des traductions concrètes consiste en la mise en place d’une Assemblée constituante.
La notion de légitimité, difficilement définissable car à la convergence de multiples disciplines, peut s’appréhender simplement par cette formule : au nom de qui, de quoi, le pouvoir est-il exercé ?