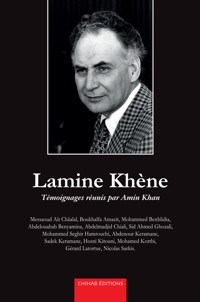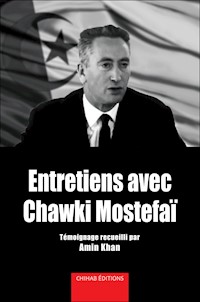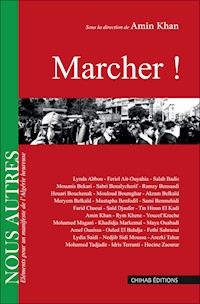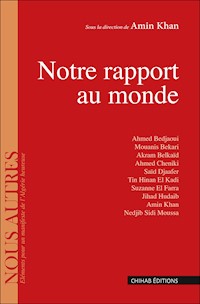15,99 €
Mehr erfahren.
Après la succession dans le temps des épreuves sans bilan, des crises sans leçon, des tentatives sans accomplissement, il nous apparaît que nous autres ne pouvons pas grand chose aujourd’hui pour contrer les flots obscurs de l’époque, les armées vouées à la destruction du monde, les illusions des masses et de leurs élites aliénées, mais que, par contre, nous pouvons créer, de façon artisanale, au cœur-même de la confusion, les points d’ancrage d’une pensée future ; une pensée qui sera finalement produite par l’une ou l’autre des générations d’Algériens qui se succéderont à l’avenir. Une pensée utile à la société algérienne parce qu’elle lui permettra de sortir du doute et du désarroi, de combattre les archaïsmes, l’ignorance et l’aliénation, de remettre en question la fatalité de la domination, d’exercer sa volonté et de maîtriser son destin. Une pensée nécessaire parce que sans elle, sans l’inspiration et le sens qu’elle donne aux actions et aux comportements, la société ne peut qu’errer, prolonger son errance, répéter ses erreurs, sans que le temps qui passe de génération en génération n’y puisse rien. Car l’histoire n’avance que par la connaissance au profit exclusif de ceux qui en ont la maîtrise. Ce n’est qu’avec la connaissance que l’on peut inventer et produire les moyens de survivre, de vivre, de créer, de lutter, de refuser le sort assigné aux faibles et aux dominés.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Amin Khan, né le 18 octobre 1956 à Alger, est un poète algérien contemporain de langue française. Il suit des études de philosophie, d’économie et de sciences politiques à Alger, Oxford et Paris. Il publie sous le nom d’« Amine » ses premiers recueils à Alger en 1980 et 1982. En 1984 il fait partie des poètes réunis par Tahar Djaout dans son anthologie Les Mots migrateurs. Il est plus tard fonctionnaire international à l’UNESCO.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
nous autreS
Eléments pour un manifeste de l’Algérie heureuse
Sous la direction de
Amin KHAN
nous autreS
Eléments pour un manifeste de l’Algérie heureuse
ChawkiAmari, MouanisBekari, AkramBelkaïd,
AhmedBenNaoum, SlimBenyacoub, MouloudBoumghar,
FaridChaoui, SaïdDjaafer, Amin Khan, ZinebKobbi,
NassimaMetahri, MalikaRahal, NedjibSidiMoussa, HabibTengour
CHIHAB EDITIONS
© Chihab Edition, 2016.
ISBN : 978-9947-39-214-0
Dépôt légal : 2e semestre, 2016
www.chihab.com
Introduction Une approche de la connaissance
« J’aivolédesjardinsentiers
Jelesaiportésdansmachambre
Etpuisjesuissorti »,
Kateb Yacine
« L’œuvre en fragments ».
Nous autres est né d’une curiosité fébrile, d’une irréductible obsession, d’une inconstante impatience et d’un espoir tout aussi inconstant de penser notre société, de nous penser nous-mêmes, Algériens à la dérive mais toujours tenaces, Algériens parfois désespérés mais souvent sublimes, Algériens citoyens d’une histoire insondable et d’une indéfectible espérance.
Après la succession dans le temps des épreuves sans bilan, des crises sans leçon, des tentatives sans accomplissement, il nous apparaît que nous autres ne pouvons pas grand-chose aujourd’hui pour contrer les flots obscurs de l’époque, les armées vouées à la destruction du monde, les illusions des masses et de leurs élites aliénées, mais que, par contre, nous pouvons créer, de façon artisanale, au cœur même de la confusion, les points d’ancrage d’une pensée future ; une pensée qui sera finalement produite par l’une ou l’autre des générations d’Algériens qui se succéderont à l’avenir.
Une pensée utile à la société algérienne parce qu’elle lui permettra de sortir du doute et du désarroi, de combattre les archaïsmes, l’ignorance et l’aliénation, de remettre en question la fatalité de la domination, d’exercer sa volonté et de maîtriser son destin. Une pensée nécessaire parce que sans elle, sans l’inspiration et le sens qu’elle donne aux actions et aux comportements, la société ne peut qu’errer, prolonger son errance, répéter ses erreurs, sans que le temps qui passe de génération en génération n’y puisse rien. Car l’histoire n’avance que par la connaissance - au profit exclusif de ceux qui en ont la maîtrise. Ce n’est qu’avec la connaissance que l’on peut inventer et produire les moyens de survivre, de vivre, de créer, de lutter, de refuser le sort assigné aux faibles et aux dominés.
Nous savons cela d’expérience : Après avoir touché le fond à la fin du dix-neuvième siècle, la société algérienne a réalisé, un demi-siècle plus tard, une des plus grandes révolutions du monde contemporain. On devrait donc pouvoir comprendre comment une société aliénée, écrasée, paupérisée, pulvérisée par la domination coloniale a pu trouver en elle les ressources de sa résurrection, les moyens d’une lutte désespérée pour sa renaissance, et atteindre l’objectif de l’indépendance nationale, qui, pour beaucoup, paraissait encore fantasmatique quelques années à peine avant 1962.
La révolution algérienne est encore très largement méconnue. Nous savons toutefois que l’un des facteurs décisifs de l’extraordinaire remontée historique de la nation et de la société algériennes a été la lutte déterminée de l’élite politique du mouvement national, incarnée dans l’Etoile Nord-Africaine, le Parti du Peuple Algérien et le Front de Libération Nationale, pour la mobilisation du peuple algérien autour d’une idée « simple » : l’indépendance nationale. Autour de cette idée, les élites nationales ont élaboré, pas à pas, des décennies durant, la démarche idéologique et politique de la révolution algérienne. C’est cette pensée de la libération qui a permis la pratique de la libération et son succès.
Aujourd’hui, même si la situation de la société n’est pas comparable, le principe demeure. Pour se libérer de l’impasse dans laquelle elle se trouve, la société devra élaborer les instruments de sa libération, et en premier lieu, une pensée politique authentique, endogène, construite sur la base d’une connaissance réelle de l’histoire. Il s’agit là d’une œuvre de longue haleine, d’un travail ingrat, d’une suite d’épreuves difficiles et de douloureuses remises en question. Certes, la construction de la mémoire historique de la société algérienne ressemble plus à un sacerdoce qu’à une partie de plaisir. Mais elle ne sera néanmoins réalisée que par l’enthousiasme, la ferveur, le courage de femmes et d’hommes qui aiment leur peuple passionnément et croient en son avenir.
Ce livre est une très modeste contribution à cet effort. Nous avons souhaité réunir dans cet espace de liberté les réflexions de quelques Algériens libres autour de l’idée que notre société est prise dans l’étau de l’archaïsme et de la domination, qu’il existe un chemin, étroit et difficile, pour sortir de cette situation historique, et qu’il peut être tracé si, en tant que nation, en tant que société, nous sommes capables de faire preuve de raison et de volonté.
En vue de l’élaboration d’un ouvrage dont l’ambition est de former une base, non monolithique mais solide et harmonieuse, de réflexion et de discussion pour ceux qui s’intéressent aux réalités et au devenir de la société algérienne, les contributeurs ont été sollicités pour leur expérience et leur connaissance des sujets qu’ils abordent et, également, pour leur capacité à intervenir sur le sujet de leur choix de façon libre et indépendante, en dehors donc de toute conformité à des discours convenus.
Il ne s’agit là donc ni d’un « Bilan/Perspectives », ni d’un ouvrage académique, ni d’un manifeste « politique », mais d’un ensemble qui fait toute la place exigée par de vraies analyses, à la science, à la politique, à la philosophie, à la littérature, sans autre objectif que celui de donner lieu à une réflexion rigoureuse et à une discussion sereine sur les dynamiques à l’œuvre dans notre société.
Nous avons la conviction que notre société peut sortir de l’impasse qui aujourd’hui empêche le développement de l’Algérie et l’épanouissement des Algériens. Pour cela, il faudra qu’émergent en son sein une nouvelle attitude, une nouvelle position, une nouvelle force, dans quatre domaines essentiels de l’activité sociale et personnelle : la pensée, le travail, la lutte, l’amour. Cette attitude, cette position, cette force prennent leur source dans notre désir et notre capacité de liberté. L’idée de liberté, même occultée ou instrumentalisée par les idéologies en compétition dans l’espace algérien, est une valeur essentielle et un facteur décisif à l’œuvre dans notre longue histoire ainsi que dans la vie actuelle de notre société.
Il faut reconnaître que cet ouvrage n’a pas l’ampleur envisagée au départ. Différentes contraintes ont empêché qu’y figurent des réflexions attendues sur notre rapport au monde, sur l’éducation, les intellectuels, la justice, le travail, l’entreprise, l’urbanisme et d’autres sujets de grande importance dans la perspective d’une appréhension multidimensionnelle de la complexité des dynamiques et des situations qui définissent nos réalités actuelles. Ce livre permet toutefois de donner les premiers éléments d’une vraie réflexion sur l’histoire, la liberté, l’environnement, l’enfance, l’exil, la santé, le Maghreb, la citoyenneté, la mémoire, grâce aux textes de Chawki Amari, Mouanis Bekari, Akram Belkaïd, Ahmed Ben Naoum, Slim Benyacoub, Mouloud Boumghar, Farid Chaoui, Saïd Djaafer, Amin Khan, Zineb Kobbi, Nassima Metahri, Malika Rahal, Nedjib Sidi Moussa et Habib Tengour.
L’ambition de ces textes est de susciter réactions, commentaires, critiques et réflexions qui pourraient former les éléments d’autres livres, à la suite de celui-ci. Et si une telle discussion, durable, productive et sereine, avait effectivement lieu, nous aurons alors écrit ensemble, au profit des Algériens qui viendront, un manifeste de l’Algérie heureuse.
Amin Khan
Nous autres de la voie étroite entre rêves et illusions
Amin Khan
Voilà maintenant bien plus de cinq siècles que la haute civilisation berbéro-arabo-musulmane a sombré, corps et âme, sous les coups de boutoir de la militarisation du pouvoir politique et de la dogmatisation du pouvoir intellectuel ; et alors que l’Europe sortait du Moyen Âge et que Colomb découvrait l’Amérique, Grenade était vaincue, l’Andalousie détruite, et les Etats et les sociétés de notre aire du monde faisaient naufrage en s’enfonçant dans un profond marécage historique où, pour survivre, nous avons, nous autres, par une inexorable dynamique, rapidement et profondément désappris à penser, à travailler, à lutter, à aimer.
Nos historiens se comptent aujourd’hui en unités solitaires, transies dans différents exils, alors qu’en l’an 2016, ils devraient être nombreux, ardents, inspirés, acharnés à comprendre ce que nous sommes, ce que nous sommes devenus, ce que nous pourrions devenir. Mais à ce jour, sur nos rivages devenus inhospitaliers à nous-mêmes, nous n’avons pas encore vraiment entrepris de déchirer les lourdes voiles effondrées, gluantes, sur les épaves des embarcations des aventures passées de la pensée de nos devanciers.
Nos poètes n’ont plus grand-chose des avant-gardes d’antan, de celles, pour prendre un exemple très lointain, des clans antéislamiques, qui avaient la responsabilité, et le pouvoir, par leur talent, leur fougue, leur génie, de dénouer en joutes saisonnières les tensions et les conflits tribaux, de déjouer les complots et les malentendus, d’empêcher, en un mot, le sang de couler. Aujourd’hui, où sont-ils nos poètes ? Inaudibles, ou asservis. Inaudibles parce qu’exilés, ou mis au cachot pour y mourir et disparaître ; ou bien asservis, en courtisans, en bouffons, en fonctionnaires.
Nos philosophes sont encore moins présents dans nos vies que les historiens. On dirait une race disparue dont survivraient quelques spécimens, inconnus de leur société, dont on trouverait la trace par le hasard de la bonne volonté de quelque université du Nord du monde, dans les pages collées d’un ouvrage collectif, ou au cœur d’une très savante anthologie. Parfois un journaliste, à l’occasion de l’anniversaire d’une naissance, de l’anniversaire d’un décès, évoquera le nom d’un de ces rescapés de la mémoire en loques de nos peuples, dans un article que liront quelques-uns de ses anciens collègues, ou peut-être encore de très rares disciples, en tout cas, tous, « des amis du défunt ».
Nos scientifiques ne disposent même plus aujourd’hui du refuge, pourtant soigneusement balisé par des despotes à demi alphabètes, des « sciences exactes » pour exercer leur art. Dans nos sociétés malades, la science, dans toutes ses disciplines, car dans son principe même, souvent devient suspecte de porter, elle, le mal qui nous ronge. Dans nos rues encombrées d’oisifs, de mercantis, de chômeurs, de miséreux, de désemparés, parmi les ondes et les bruits de friture en tous genres, les carillons des carrosses importés, les sonorités exotiques du bric-à-brac idéologique déversé par vagues incessantes sur nos esprits et les harangues des marchands d’illusion, l’appel à la raison n’est plus entendu.
PenserEn ce début du XXIe siècle, nous autres n’avons plus le droit, ou d’ailleurs la force de nous lamenter. Peut-être est-ce parce que nous pressentons que, désormais, il ne nous reste plus que le choix, certes encore obscur, dans un dernier souffle de la conscience collective, de tenter de penser (comme on dirait, en langage militaire, de tenter une percée) ou de disparaître, en tant que réalité pertinente dans le monde d’aujourd’hui, en tant que porteurs d’une charge de vérité significative de la destinée humaine.
Nous autres, que sommes-nous en réalité ? Lambeaux de civilisation, marchés tropicaux, décharge internationale, armée de réserve à la disposition du capital, richesses minières à ciel ouvert, à prendre, à vendre, à livrer contre une tape dans le dos, un semblant de reconnaissance portant, au fond des sourires pour les photographes, la grimace du mépris ? Sommes-nous citoyens, sujets, de qui, de quoi ? Sommes-nous des victimes qu’on ne se soucie plus même de décompter, des bourreaux de nous-mêmes, des supplétifs grotesques habillés de pied en cap, turban, cimeterre et rhétorique inclus, pour le sinistre grand show télévisé du saccage du monde par ses maîtres ?
Plus décisif encore pour notre destin que la réponse à ces questions, est notre capacité à affronter la nécessité logique de commencer par le commencement ; un commencement concevable uniquement par la raison d’hommes libres du joug de la peur et de l’aliénation qui, toutes deux aujourd’hui, agissent comme le liant essentiel, plus ou moins subtil, mais toujours extrêmement puissant et efficace, des structures sociales, des mécanismes économiques, des idéologies de la domination du monde par quelques oligarchies.
Et alors que le monde est pris dans un furieux mouvement d’accélération de sa respiration, de violence de ses syncopes, d’amplification erratique de ses pulsions suicidaires, vouloir « commencer par le commencement » pose un défi pratique, mais aussi un défi à la raison elle-même, car les individus ne peuvent plus désormais embrasser, et encore moins maîtriser, le minimum des connaissances et des savoirs indispensables à la formation d’une pensée à la fois cohérente et efficace, effectivement utile à l’humanité.
Si cette incapacité est évidente pour ce qui est des individus, elle devrait l’être tout autant pour les institutions. Aujourd’hui, non seulement les grandes universités, les grandes entreprises, les grandes organisations, mais les Etats eux-mêmes, y compris les plus puissants d’entre eux, ne maîtrisent plus, seuls ou ensemble, le mouvement du monde ni la « théorie » d’un tel mouvement.
Les dynamiques actuelles de la circulation du capital et des migrants, de la finance et de l’information sont d’une telle force et d’une telle ampleur qu’elles s’imposent comme nécessité et comme accablement d’un monde en proie au chaos. Et aujourd’hui, par le fait d’une conjoncture historique particulière, marquée notamment par l’enchevêtrement des relations entre Islam, pétrole et géographie, nous nous retrouvons, nous autres, au centre du chaos, que nous habitons, précaires, anxieux, démunis, aspirés vers le trou noir de l’acculturation fonctionnelle de nos sociétés au sein desquelles seules de minuscules minorités tentent, par à-coups, de refuser le mouvement « naturel » du monde.
Minorités réduites, ambivalentes, contradictoires, travaillées par les mêmes travers que le reste de la société, elles tentent néanmoins de s’opposer à la domination, principe et pratique constants de l’organisation du monde. Et peut-on alors être surpris que ce faisant, dans l’état où se trouvent nos sociétés, les tentatives révolutionnaires, y compris les plus audacieuses et les plus radicales, demeurent prisonnières de l’archaïsme fondamental qui non seulement survit mais prospère dans la culture des dominés, en tant que matrice de la production simultanée de la résistance à la domination et de la reproduction de celle-ci dans la société ?
Aujourd’hui, la question centrale qui se pose à nos sociétés dominées, concassées, émiettées, évidées de leur mémoire, de leurs forces politiques et intellectuelles est celle de notre éventuelle capacité à penser, à partir d’une position historique défavorable, la stratégie et les instruments d’un combat victorieux, à la fois, sur la domination et sur l’archaïsme, et donc à élaborer une pensée qui soit, à la fois, libre et libératrice.
TravaillerL’élaboration d’une telle pensée est nécessairement liée à l’impératif du travail s’imposant au centre des valeurs et des pratiques de nos sociétés ; non seulement parce que la pensée est une de ses modalités les plus exigeantes, mais aussi et surtout parce que dans l’espace de nos sociétés, le travail, en tant que source de la valeur des choses et des gens, de la richesse, de l’accomplissement, du progrès, de la dignité des hommes, a été, pendant des décennies et des siècles, profondément dévalué et perverti par la domination, externe et interne, à travers l’exercice du pouvoir politique et économique par l’autoritarisme, la corruption et l’usage arbitraire et pervers de la rente.
Dans nos contrées, l’agriculture, la pêche, l’élevage, l’artisanat, l’art, le commerce ont été détruits, ou bien réduits dans les marges de la vie économique et sociale à l’état de misérables vestiges d’époques encore récentes, alors que, par ailleurs, l’industrie (comme mode d’organisation de la production des biens et services, fondé sur la maîtrise de la science et de la technologie disponibles) n’y a pas pris sa place, sauf, parfois, comme segments et excroissances de processus qui nous échappent, ou comme alibis d’une pseudo-volonté de modernité, ou encore comme simples éléments de décor de la vie de nos ruraux déracinés et de l’inspiration des rapports des « partenaires étrangers »… Vaste symptôme que ce triste paysage de la marginalisation du travail et des travailleurs dans des pays livrés aux jeux sinistres de la prédation, de l’importation du vital et du superflu, de la perfusion et de la dépendance.
La situation actuelle est le produit de processus historiques qui ont conduit nos sociétés à l’impasse. En effet, lorsque l’économie n’est pas fondée sur le travail et la production, mais sur la distribution de royalties, le troc du pétrole contre nourriture, l’achat de clientèles, la vente de biens publics, la paresse et la corruption institutionnalisées, il y a un arrêt de mort posé sur le sort de ces pays, certifié par le bon sens et la lucidité du commun des mortels, et daté à la date de l’épuisement de leurs richesses naturelles.
Et là encore, nos sociétés sont aujourd’hui confrontées à un choix radical : continuer, sur le même mode d’un rapport factice au monde, vers leur anéantissement définitif, ou bien rompre avec la logique fataliste de la soumission aux fausses valeurs de l’économie rentière. L’alternative est telle que la sortie éventuelle de l’impasse dans laquelle sont enfermées nos sociétés n’évitera pas la violence. Le choix de la continuité n’épargnera pas aux sociétés l’aggravation des inégalités, l’inexorable montée des frustrations et du ressentiment et le recours inévitable à toute la gamme de la répression et de la destruction à la disposition des pouvoirs en place.
Le choix de la rupture est un choix qui ne peut, non plus, éviter la violence ; la violence nécessaire pour détruire les carcans de l’autoritarisme et de la servitude, pour imposer de nouvelles règles au fonctionnement de l’Etat et de la société, le respect du droit et des lois par tous, sans exception, pour imposer de nouvelles règles au fonctionnement d’une économie au service de l’intérêt général et du bien public, et dont la valeur est, exclusivement, patiemment, durablement, constituée par le travail.
La violence de cette option se distingue de la première en ce qu’elle permet éventuellement un progrès, une perspective de libération, alors que par le choix de la continuité on ne fait que retarder les inéluctables échéances de la dégradation stérile du présent et de l’abolition de l’avenir.
Aujourd’hui, du fait du profond travail de déculturation, d’asservissement, de corruption, subi et approprié par nos sociétés, nous nous trouvons apparemment loin de pouvoir appréhender, en théorie et en pratique, les valeurs fondamentales (la justice, la liberté, le travail) qui sont les références pertinentes de l’entreprise immense de prise en main de notre destin par nous-mêmes. L’appétit de liberté, l’aspiration à la justice, le sens critique ne trouvent pas en eux assez de force, ni de terrain assez stable et fertile pour se développer dans nos sociétés.
Ces valeurs fondamentales de la libération des sociétés restent contraintes et confinées dans les marges extrêmement étroites de communautés fragmentées, régulièrement décomposées, privées des outils primordiaux (dont le travail) de la construction de soi, privées de la possibilité même d’imaginer leur développement et leur épanouissement et celui des individus qui les composent, victimes de l’aphasie profonde de ceux qui ne savent plus vraiment ce qu’ils veulent, réfugiés dans divers langages et comportements d’emprunt, même lorsque, pathétiquement, ils prétendent se rattacher à des identités mythiques, et bricolent des règles de circonstance, des accoutrements idéologiques d’une morale de pacotille, des discours qui incitent à la déresponsabilisation et à l’asservissement, multiplient les fausses pistes, développent le chaos mental et la confusion des perspectives.
LutterUn des problèmes majeurs, et des plus ardus, de la lutte pour la libération de la société aussi bien que des individus est de donner leur véritable sens aux mots. En effet, la domination (quelle que soit sa forme, son espace et son temps) repose, certes, sur la supériorité matérielle des dominants, mais plus fondamentalement encore sur leur capacité de croire eux-mêmes, et de faire croire aux autres à leur discours, à leur parole, à leurs concepts, à leurs vérités, à leurs mots.
De ce point de vue, nos sociétés se débattent au fond d’un immense tourbillon. Nous avons bien des textes, des langages et des langues à notre disposition, nous avons hérité de lexiques savants, d’encyclopédies subtiles et d’épais dictionnaires, nous avons appris à déchiffrer, à lire, à écrire, et certains parmi nous sont même parvenus exceptionnellement à retourner les mots de l’oppresseur contre l’oppression, mais aujourd’hui nous demeurons néanmoins au bas des parois du tourbillon de l’histoire contemporaine.
Malgré quelques tentatives de « renaissance » et de « révolution » au XIXe et au XXIe siècles, nos élites ne sont pas parvenues à renverser ou à se dégager de la domination qui s’exerçait alors aussi bien sur nos territoires que sur nos vies et nos consciences. Ces batailles, malgré tout victorieuses, dans leurs limites historiques, ne nous ont pourtant pas rapprochés de façon décisive de la libération de nos sociétés, car les réactions aux mouvements de renaissance ou de révolution, qu’elles aient été doctrinalement réactionnaires ou bien purement opportunistes, se sont avérées efficaces au point d’objectivement aggraver le chaos et la confusion dans lequel nous sommes pris.
Ce mouvement réactionnaire, qui sévit contre nous depuis près d’un demi-siècle, a agi et continue d’agir en symbiose avec les forces économiques, politiques et culturelles de la domination redéployée dans ses nouveaux atours idéologiques du libéralisme économique, de l’affaiblissement des Etats, du laisser-faire, du laisser-aller, de la revivification des « identités ». Après sa victoire sur le communisme soviétique, la domination a été en mesure de prétendre imposer la « légitimité » de sa vision du monde, un monde « global » guidé par la main ferme du « marché » et de la « démocratie ».
Dans notre aire du monde, les pouvoirs en place se sont empressés de satisfaire aux exigences de la nouvelle servitude : l’arrêt des efforts d’industrialisation là où ils avaient été à peine engagés, le démantèlement des lois, règles et règlements qui régissaient Etats et administrations, l’abandon de la culture et de l’éducation aux forces les plus conservatrices et les plus rétrogrades de la société, le retour légitimé vers la matrice des archaïsmes, le glissement accéléré dans l’irresponsabilité vis-à-vis du bien public et de l’intérêt général.
Pour légitimer la régression de nos sociétés aux yeux du monde et aux yeux de nous autres, il a été nécessaire de reformuler les alliances prévalant entre les centres nerveux de la domination et nos obscures périphéries, et donc de produire, d’adapter et de faire adopter un nouveau langage. Ses mots-clés sont dans les journaux du monde entier et flottent constamment à la surface des eaux grises des écrans de télévision du monde entier : Islam, musulmans, islamiques, islamistes, fondamentalistes, intégristes, salafistes, wahhabites, takfiristes, extrémistes, obscurantistes, terroristes, djihadistes, djihad, Daesh, burqa, fatwa, Qaeda, madrasa, taliban, voile, excision, soumission, etc.
Ce « nouveau langage », sans cesse ressassé, constamment démultiplié, universellement relayé, délayé, combiné, diversifié, agrémenté, tantôt durci, tantôt édulcoré, occupe des esprits devenus incapables de voir et d’analyser la réalité, repoussée loin à l’arrière-plan de ce sinistre théâtre d’ombres en représentation permanente : la réalité calamiteuse et tragique, et pourtant considérée « normale » par la « conscience générale », la réalité de pouvoirs incapables, corrompus et serviles, la réalité de la détresse, de la misère matérielle et morale de millions d’hommes, de femmes et d’enfants, la réalité de l’absence de justice, de l’absence de liberté, de l’absence de travail, de l’absence d’éducation, la réalité de l’état sanitaire désastreux de populations entières, la réalité du mépris et de l’humiliation, la réalité de la misogynie, la réalité de la violence contre les femmes, contre les enfants, contre les pauvres et les démunis, la réalité du racisme et de la ségrégation, la réalité du déni de leur humanité de millions de nous autres.
Ce « nouveau langage », qui puise ses mots et ses concepts dans tous les lexiques à la disposition de la domination, s’efforce sans cesse d’épuiser ces mots et ces concepts de toute substance qui ne lui serait pas utile, renforçant ainsi sans cesse son monopole sur le sens des choses et des situations, sur l’interprétation et l’explication des évènements, enracinant dans les consciences de tous, sans cesse, sa propre vision de l’histoire.
Aussi, afin de pouvoir lutter pour leurs droits, pour leur dignité, pour leur vie, les dominés doivent alors commencer (cela fait partie intégrante de l’impératif du « commencer par le commencement ») par se libérer de l’emprise de la gigantesque machinerie de l’aliénation par le langage, par les discours aux mailles serrées des fausses évidences, par la torsion des concepts, par la trahison permanente du sens réel et véridique des mots.
Pour cela, il faudra qu’émerge au sein de nos sociétés une « capacité de liberté » qui aujourd’hui n’existe qu’à l’état potentiel, au niveau d’individus ou de petits groupes marginaux, mais nullement au niveau « institutionnel ». Certes, les effets « mécaniques » de la présence au monde de nos sociétés (qui ne pourront être indéfiniment maintenues, aliénées, dans les carcans de l’isolement et du particularisme) peuvent produire des conditions favorables à l’émergence d’une telle « capacité de liberté », encore faut-il que la rencontre de la pensée, de la parole, de la volonté de justice, de liberté, de travail, puisse se faire pour que l’on soit en mesure, nous autres, de faire face au monde, de faire face aux autres, de nous faire face à nous-mêmes.
AimerS’il ne doit se réduire à une combustion dans le vide, à un vœu pieux, à une illusion, un effort de cette nature (affronter et assumer le monde, s’affronter à soi et s’assumer entièrement, sans complaisance ni espoir de récompense) ne peut s’accomplir dans la confusion des idées et des sentiments, dans la haine ou le ressentiment, dans la rage stérile et la colère, dans l’esprit de revanche, dans le délire mystique et la volonté de puissance, dans l’angoisse et la peur.
Pour des raisons de substance autant que pour des raisons pratiques, cet effort pour la vie, pour la survie, pour l’existence, doit puiser au plus profond de soi la ressource essentielle ultime de l’humanité de nous autres, l’énergie irrépressible, indénombrable, incombustible, del’amour. Notion engluée dans tant de faussetés, de mensonges et de malentendus, notion sacralisée, commercialisée, dénaturée, mâchée, remâchée, rejetée, reprise à tort et à travers, l’amour est pourtant la première et la dernière ressource des hommes et des communautés confrontés aux circonstances extrêmes de l’histoire et de la vie ; elle est la ressource inaliénable des rêveurs, des combattants, des démunis, des audacieux, des presque désespérés.
Or l’amour nous est, aujourd’hui, une valeur occultée, une valeur paradoxale, qui permet la survie mais gâche la vie, une valeur de résistance mais qui se refuse à la construction, une valeur suprême mais sans traduction réelle, un lien qui déchire.
L’avenir nous sera interdit si, en particulier en référence à la valeur de l’amour, une révolution profonde n’a pas lieu dans nos sociétés, si l’édifice des équilibres suicidaires en place n’est pas renversé de nos propres mains et selon des conceptions pensées et élaborées par nous-mêmes, si, en réalité, l’ordre actuel ne change pas radicalement. Il est vital que nos sociétés s’éveillent à une nouvelle conscience du monde, s’ébrouent et se libèrent de structures, de logiques et de normes qui nous régissent et nous dominent, par où la conscience de notre humanité est frelatée, la nécessité de notre contribution à la valeur du monde incomprise, lorsque la laideur des paysages et des gens prend le pas sur la beauté que l’on nie, que l’on cache, que l’on détruit, que l’on pervertit, lorsque l’amour du peuple est moqué par les serviteurs cyniques de la déchéance de leurs concitoyens, lorsque l’amour du pays est regardé comme une forme de retard mental et intellectuel, lorsque l’amour de la science ou de la poésie est considéré comme une lubie par des ignorants qui se sont arrogé des positions d’autorité dans l’Etat et dans la société et le droit de juger de choses et de gens qu’ils ne sont pas en mesure de comprendre mais qu’ils jugent néanmoins à coups de lois iniques et de sentences ridicules et mortelles.
Il est vital, et aujourd’hui encore possible, de trouver l’espace de notre liberté, le goût du travail, le désir et la force de créer, une esthétique de notre avenir. Pourquoi, en effet, serions-nous condamnés à errer entre les décombres du passé et les horreurs « modernes » de la spéculation financière, entre cités carcérales et bidonvilles pestilentiels, le long d’oueds asséchés ou sur des rivages jonchés de plastique ? Pourquoi serions-nous condamnés à ingérer des aliments malsains, des boissons toxiques, à offrir nos poumons à un air irrespirable ? Pourquoi serions-nous condamnés à trembler pour la sécurité, la dignité et le bien-être de nos enfants ? Pourquoi serions-nous condamnés à la réclusion perpétuelle de nos espoirs les plus banals ? Pourquoi serions-nous condamnés au déni de nos droits humains, au bafouage de nos aspirations les plus modestes ? Pourquoi serions-nous condamnés à baisser la tête, de honte, d’ignorance, de faiblesse ? Pourquoi serions-nous condamnés à l’humiliation, à la blessure de notre dignité d’hommes, de femmes, d’enfants, notre dignité d’êtres humains ? Pourquoi serions-nous condamnés à la servitude, à la répression, à la corruption, à l’assassinat, au mépris, à l’abaissement, à la torture, à l’exil ? Par quel décret serions-nous assignés à un espace dans ce monde où l’on est condamné, dès la naissance, à la privation perpétuelle de justice, de liberté et d’amour ?
Pour quelle raison, en effet, autre que l’usage insuffisant de notre raison et de notre volonté ?
Le blues de la baie d’Alger
Mouanis Bekari
Première époqueLa baie d’Alger paradait sur tout le vitrage du bus. Son élégance captivait le regard, lui épargnant l’agglutination qui dégringolait vers la mer en se cramponnant au moindre pli de la colline. L’amphithéâtre blotti dans son giron était submergé depuis longtemps par l’essaim toujours plus dense de ceux que la baie avait assujettis en leur révélant sa perfection. Repoussés loin derrière les collines, les derniers arrivants lui étaient reconnaissants de s’étirer avec indolence pour leur permettre de s’émerveiller encore.
El Moudjahid nous avait assuré un jour qu’elle était la plus belle du monde après celle de Rio. Les esprits grincheux affirmaient qu’on ne pouvait se fier à un tel verdict étant donné les précédents d’El Moudjahid dont la véracité était régulièrement mise en doute par une incrédulité tatillonne. Mais nous rétorquions imparablement que puisque l’Algérie était l’un des plus beaux pays du monde, quoi de plus logique que la baie d’Alger soit l’une des plus belles baies du monde ? Bien entendu, il fallait maintenant que les infrastructures du pays se mettent au diapason de la Nature, mais les dirigeants, les cadres, ces nouveaux héros, et tous ceux qui aimaient l’Algérie s’affairaient à la couvrir de routes, d’écoles, d’usines, d’hôpitaux et de tout ce qui projetterait le pays dans la lumière.
D’ailleurs, la baie d’Alger, la deuxième plus belle baie du monde, abondait de navires emplis de tout ce qu’exigeait la réussite du nouveau plan quadriennal, le pourvoyeur de nos futurs exploits. Le colonialisme avait mis un soin méticuleux à nous priver de tout et surtout du nécessaire, mais les Algériens, encore inspirés par la lutte qu’ils avaient menée pour l’indépendance, ne comptaient pas lui laisser le dernier mot. Du reste, El Moudjahid, inlassable de sollicitude, nous le répétait à satiété : « Quand la situation l’exige, le peuple algérien sait se surpasser. » Et la situation l’exigeait. Aucun doute à ce sujet. La pénurie régnait en tout et partout. Les étals des marchés étaient vides ou étiques, les classes des écoles étaient surchargées, les transports en commun submergés, les coupures d’eau et d’électricité quotidiennes, les emplois rares et mal payés. Tout ce qui était nécessaire à la production industrielle devait être importé. Compte non tenu de ce qu’imposait la subsistance des Algériens. C’est pourquoi la deuxième plus belle baie du monde était momentanément enlaidie par une armada venue de partout pour contribuer à la réussite du deuxième plan quadriennal.
Le port d’Alger ne pouvant abriter tous les munitionnaires, ils devaient attendre que des emplacements se libèrent avant de décharger leur écot à l’édification de l’avenir. En dépit d’insinuations malveillantes, rien ne permettait de penser que les planificateurs du Secrétariat d’État au Plan, instruits par l’expérience du premier plan quadriennal, avaient ignoré l’exiguïté du port d’Alger, la faiblesse de ses infrastructures, les lourdeurs du système bancaire et l’inertie de l’administration, dans la détermination du rythme des déchargements. D’ailleurs, El Moudjahid nous avait prévenus que des « surestaries » étaient inévitables. Des « surestaries » ? Un mot inconnu jusqu’alors, mais dont la sonorité ésotérique et vaguement menaçante n’en avait pas imposé à nos planificateurs, ni pris leur prescience en défaut. La volonté de nos héros d’illuminer notre avenir faisait jaillir, miracle de la praxis, des vocables merveilleusement abscons que l’on prononçait avec gourmandise. Le « noircissement de la matrice interindustrielle » était en cours et sa complétude inexorable n’était plus qu’une question de temps. Plus précisément à « l’horizon 2000 ».
Tout serait prêt à cette échéance miraculeuse, y compris le futur visage d’Alger que l’Unique nous avait fait découvrir un jour de folle prodigalité. Une maquette existait, les journalistes d’El Moudjahidl’avaient vue. Des photos étaient disponibles au Comédor, un mystérieux organisme qui s’affairait dans l’ombre et qui avait tout prévu, y compris la forme que prendraient les futurs immeubles d’Alger. Comme nous étions reconnaissants à tous ces brillants cerveaux qui travaillaient avec abnégation en attendant que nous prenions la relève ! Car El Moudjahid avait été très clair à ce sujet : La jeunesse est la vraie force de l’Algérie et tout était fait pour promouvoir et accompagner sa maturité. Bien sûr, chacun aurait son lot de difficultés, l’adversité n’épargnerait personne, mais nul ne devait douter que l’avenir se bâtirait avec et pour la jeunesse. C’était écrit en toutes lettres, dans une encre baveuse qui, en imprégnant nos doigts, attestait la promesse qui nous était faite.
Mais, en attendant, il fallait serrer les dents et, pour beaucoup, la ceinture. Et surtout garder la foi. Nos aînés n’avaient-ils pas enduré bien davantage durant la Révolution ? N’avaient-ils pas souffert tant et plus sans autre viatique que l’espoir ? Quel meilleur repère, pour les plus chancelants, que la recension de leurs exploits ? Ceux-là étaient opportunément convoqués à longueur d’articles et de remémorations, d’autant que, grâce à Dieu, leurs auteurs étaient, pour nombre d’entre eux, encore bien vivants. Au surplus, ils continuaient de se sacrifier en occupant tous les postes de décision, s’assurant ainsi que les idéaux de la Révolution resteraient vivaces en attendant que la jeunesse soit en mesure de prendre la relève. Oui, vraiment il fallait rendre hommage à tous ces hommes de perpétuer l’esprit qui nous avait libérés. Aux seuls hommes, il convient d’insister à ce propos, car les femmes qui avaient pris part à la Révolution avaient été poussées par un réflexe atavique à rentrer dans leurs foyers sans qu’aucune force n’ait réussi à les en dissuader.
Au lycée, au quartier, à l’occasion de réunions de famille, les discussions portaient invariablement sur les choix qui avaient été faits au nom des Algériens, puisqu’ils n’étaient pas en mesure de les faire eux-mêmes. Trop occupés à subsister, à satisfaire l’implacable rigueur de l’Administration, à dénicher une dispense ou une prébende, ils n’avaient pas de temps à consacrer à l’examen de la situation du pays, encore moins de la comprendre et moins encore d’imaginer des solutions pour y remédier. C’est pourquoi d’autres, mieux servis par leurs vertus et plus encore par les circonstances, s’en occupaient avec un empressement qui avoisinait le don de soi. Ils étaient reconnaissables aux limousines noires qui les transportaient à travers Alger, indociles aux règles de la circulation, indifférents aux embouteillages, ignorant les priorités. Mais quelle priorité pouvait-elle être plus prioritaire que la préparation de l’avenir de la jeunesse ? Certains, inexplicablement, mettaient en doute le désintéressement de ces architectes des lendemains qui chantent, et même parfois, jusqu’aux choix qu’ils avaient faits pour le compte de tous les Algériens. Mais leur suspicion était sévèrement blâmée par El Moudjahid qui rappelait que ces choix étaient irréversibles, qu’ils avaient été approuvés tacitement par le peuple et haut et fort par ceux qui parlaient en son nom.