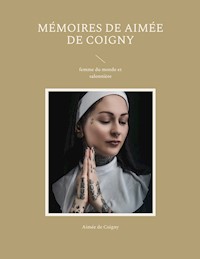
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
RÉSUMÉ : Les "Mémoires de Aimée de Coigny" nous plongent dans l'univers fascinant de la haute société française à la fin du XVIIIe siècle. Aimée de Coigny, femme du monde et salonnière, fut une figure emblématique de son époque, connue pour son esprit vif et sa beauté légendaire. À travers ses mémoires, elle nous offre un aperçu privilégié de la vie aristocratique, des intrigues politiques et des bouleversements sociaux qui ont marqué la Révolution française. Le récit est riche en anecdotes personnelles et en réflexions profondes sur les événements historiques qu'elle a vécus. Aimée de Coigny nous guide dans les salons parisiens, où se mêlent discussions intellectuelles et débats enflammés, tout en partageant ses rencontres avec des figures historiques telles que Marie-Antoinette et Napoléon Bonaparte. Son récit est à la fois une chronique intime et une fresque historique, témoignant de l'élégance et de la décadence d'une époque révolue. L'ouvrage se distingue par son style littéraire raffiné et sa capacité à capturer l'essence de l'esprit français de l'époque. Aimée de Coigny ne se contente pas de relater des faits ; elle les analyse avec perspicacité, offrant ainsi une perspective unique sur les transformations culturelles et politiques de son temps. Ce livre est un témoignage précieux qui éclaire les complexités et les contradictions de la société française à la veille de la modernité. __________________________________________ BIOGRAPHIE DE L'AUTEUR : Aimée de Coigny, née en 1769 dans une famille aristocratique française, est surtout connue pour son rôle de salonnière influente à la fin du XVIIIe siècle. Elle a grandi dans un environnement où la culture et la politique étaient omniprésentes, ce qui a façonné son esprit critique et son goût pour les arts. Durant la Révolution française, elle a traversé des périodes tumultueuses, marquées par l'emprisonnement et la perte de nombreux proches. Malgré ces épreuves, Aimée a su préserver son influence dans les cercles intellectuels parisiens, où elle a côtoyé des écrivains, des philosophes et des politiciens de renom. Son mariage avec le duc de Fleury a renforcé sa position sociale, mais c'est son intelligence et sa personnalité charismatique qui lui ont permis de se démarquer. Aimée de Coigny a laissé une empreinte durable dans l'histoire littéraire et sociale de la France, notamment grâce à ses mémoires, qui offrent un témoignage précieux sur son époque.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
AIMÉE DE COIGNYportrait peint par A. Wertmüller(1797) appartient à Mr de Mandrot
Sommaire
INTRODUCTION
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre X
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
Chapitre XIII
Chapitre XIV
MÉMOIRES
A MONSIEUR LE MARQUIS DE BOISGELIN, PAIR DE FRANCE
APPENDICE
LES COIGNY ORIGINE DE LA FAMILLE
LA BRANCHE AINÉE
LA BRANCHE CADETTE
LES PORTRAITS D’AIMÉE DE COIGNY
INTRODUCTION
I
Il y a un fond de mépris dans la gloire que les hommes réservent aux femmes. Ils ne célèbrent guère d'elles que la beauté. Les dons de l'esprit et de l'âme ajoutent, ornements accessoires, à la parure des privilégiées qui possèdent l'essentiel, la perfection du corps. Faute de beauté, tout obscures et comme éteintes, quels talents ou quelles vertus ne leur faut-il pas pour sortir de l'ombre? Si cette beauté est éclatante, quoi qu'elles en aient fait, elles les absout et leur séduction leur survit. Le moins méritoire des avantages est celui dont on leur sait le plus de gré, et le plus court des triomphes perpétue leur nom.
Aux grandes amoureuses surtout va cette popularité posthume. On dirait que, pour s'être données à quelques hommes, elles aient droit à la reconnaissance de tous. La curiosité du public reste fidèle aux plus in-constantes, il veut posséder les certitudes de leurs caprices, et des écrivains graves mettent les scellés de l'histoire sur des ailes de papillons. A cette sollicitude se révèle «l'éternel masculin», l'attrait permanent de la chair de l'homme pour la chair de la femme. C'est lui qui reconnaît dans les plus femmes des femmes «l'éternel féminin», le chef-d'œuvre de joie offert à l'homme par la nature. Et l'homme pense à lui-même, quand il s'occupe d'elles. La célébrité durable qu'il accorde aux dispensatrices les plus généreuses de cette joie est un encouragement aux vivantes de ne pas se montrer plus avares. Dans ces amours passées, le présent à son tour lit ses amours à venir. Ainsi, par la commémoration des disparues qui pratiquèrent la religion du plaisir, le culte de la volupté survit jusque dans le culte de la mort.
Une autre gloire avait, à la fin du XVIII e siècle, commencé pour «la jeune captive» dont les plaintes inspirèrent André Chénier. Sœur d'Iphigénie et non moins touchante, elle représentait, comme la vierge antique, et contre la même cruauté de la politique meurtrière, les droits d'une vie qui s'ouvre au bonheur. Le plus grec de nos poètes semblait l'avoir parée pour le sacrifice qui est la destinée de l'innocence et de la faiblesse dans les querelles des hommes. La puissance du génie créant une légende, les premiers de ceux qu'avait émus la plainte de la jeune captive crurent pleurer sur une victime des justices révolutionnaires. Et cette existence si tôt et si cruellement tranchée paraissait complète, privilégiée, puisque, assez longue pour connaître tous les bonheurs en es-pérance, il lui avait manqué seulement les années des désillusions, et puisque la morte avait obtenu du génie l'immortalité.
La légende, comme à l'ordinaire, était plus belle que l'histoire. La jeune fille était une jeune femme, mariée depuis huit ans: elle échappa à l'échafaud, et mourut en 1820 dans son lit. Pour Aimée de Coigny, du-chesse de Fleury, la renommée virginale et héroïque se continua en une de ces réputations moins austères qui ne se sacrent pas, mais caressent. Les temps si divers où elle vécut s'accordaient à lui reconnaître une double puissance: tant de beauté qu'on lui eût permis d'être sotte, et tant d'esprit qu'on lui eût pardonné d'être laide. La beauté de traits n'a qu'une beauté, la beauté d'expression a autant de beautés que de sentiments. Tous ceux d'Aimée se reflétaient sur son visage et passaient dans ses attitudes. Le charme même de son corps était fait aussi de pensée. Et cette pensée profonde, variée, imprévue, hardie en ses examens, soudaine en ses ripostes, redoutable dans ses ironies, irrésistible dans sa gaieté, tirait de sa mobilité même un charme de plus et paraissait toujours nouvelle. Il y avait en elle trop de femmes pour qu’on se défendît contre toutes: qui résistait à l'une cédait à l'autre. Voilà le secret de l'empire exercé par elle et par celles qui lui ressemblent. Cette surabondance, si elle multipliait les séductions de son corps et les activités de son intelligence, précipitait aussi les mouvements de son cœur. Et, comme aucune passion ne tient ses promesses et que la lie de chaque joie épuisée donne la soif d'autres joies, l'amour de l'amour avait fait, disait-on, à travers la diversité des expériences, l'unité de sa vie.
Sa mort parut d'abord délivrer de ces faiblesses éphémères ses mérites dignes d'un souvenir durable. Ils reçurent aussitôt un hommage public, et presque officiel, en un article que publia le Moniteur et qu'avait signé Népomucène Lemercier. Aujourd'hui, l'on ne connaît plus de cet écrivain que les défauts; en 1820, on n'avait d'yeux que pour ses qualités. Ce qui s'appelle maintenant la lourdeur de son style s'appelait alors le poids de ses jugements. A cet âge de disgrâce où la tradition du XVIII e siècle était épuisée, où la fécondité du XIX e ne se parait encore que de Chateaubriand, Lemercier, honnête homme, avec du goût pour la pensée noble, quelques visions du sublime, et qui gâtait ses idées en les exprimant, était le prince des médiocres, comme Chapelain durant la jeunesse de Corneille. Chef d'école, il consacrait en ces termes le talent de la disparue:
«Egalement familière avec les belles-lettres françaises et latines, elle avait tout l'acquis d'un homme; elle resta toujours femme, et l'une des plus aimables de toutes. Sa conversation éclatait en traits piquans, imprévus et originaux. Elle résumait toute l'éloquence de madame de Staël en quelques mots perçans. On a lu d'elle un roman anonyme qui, sans remporter un succès d'ostentation, attacha parce qu'elle l'écrivit d'une plume sincère et passionnée. Elle a composé des Mémoires sur nos temps et une collection de portraits sur nos contemporains les plus distingués par leur rang et par leurs lumières, qui réussirent mieux, étant plus vivement tracés et plus sincères encore [1] .»
[1] Moniteur universel, 25 janvier 1820.
Le public apprit comme une bonne nouvelle que cette remarquable femme, non contente de répandre en une compagnie de privilégiés l'éclat sans lendemain de sa pensée parlée, avait songé à survivre par sa pensée écrite. Il espéra, grâce à la publication de ces œuvres, connaître à son tour la séductrice dont F. Barrière, huit ans après Lemercier, disait: «L'esprit, l'instruction, la grâce et tous les attraits réunis plaçaient la du-chesse de Fleury au premier rang parmi les femmes de son temps [2] .» Mais, bien qu'une mode de curiosité pour la fin du XVIII e siècle et le commencement du XIX e suscitât partout les fureteurs d'inédit, les pages annoncées demeurèrent introuvables. Il a fallu accepter l'hypothèse de Charles Labitte: «Par malheur, le roman dont parle Lemercier, et dans lequel les admirateurs du poète eussent cherché avec charme quelques accents de la jeune captive, n'a pas été imprimé; et remis, ainsi que des Mémoires sur la Révolution, entre les mains du prince de Talleyrand, il paraît avoir été détruit [3] .»
[2] Barrière, Tableaux de genre et d'histoire , in-8° , p. 231. Paris, Paulhan, 1828.
[3] Ch. Labitte, Études littéraires , t. II, p. 184.
En revanche, à mesure que les «Souvenirs» et les «Correspondances» de cette époque venaient au jour, ils montraient Aimée de Coigny vivante, suivie par l'attention anecdotière de ses contemporains, surtout de ses contemporaines, et lui faisaient une autre renommée.
Ces sortes d'écrits ne sont guère des jugements sur l'essentiel des choses et des personnes; ce sont des bavardages sur les détails les plus propres à distraire la curiosité de chaque jour. Aussi le succès actuel de cette littérature ne prouve-t-il pas un retour au sérieux. Nos oisifs, à la lire, se flattent d'avoir perdu leurs goûts frivoles; ils l'aiment, au contraire, parce qu'ils y retrouvent leur propre façon de comprendre et de vivre la vie: ces grands enfants croient s'intéresser à l'histoire et continuent à n'aimer que les histoires. Surtout les mémoires et billets où des femmes s'occupent de femmes ne racontent-ils pas l'omnipotence des riens et l'obsession de plaire? Pour elles, qu'est regarder l'une d'elles? Mesurer l'importance de leur contemporaine à l'étendue du cercle mondain où, par consentement général, elle est la première; mesurer son pouvoir au nombre et aux mérites des hommes qui, non contents de l'entourer, ont vécu sous son charme; enfin, puisque la preuve suprême du charme est l'amour, chercher par qui elle a été aimée, et si, comment, pourquoi, et par qui la conquérante des cœurs se serait laissé prendre le sien. Voilà précisément ce que ces voix du passé racontaient d'Aimée. Unanimes à célébrer son esprit, mais seulement cet esprit des mots qui est le fard de la pensée, elles appréciaient surtout ses dons intellectuels comme auxiliaires, faits pour rendre plus complets ses triomphes de beauté, et elles médisaient de ces triomphes où elles surprenaient ses faiblesses.
En 1825, parurent les Mémoires de madame de Genlis. Personne n'avait été mieux placé pour connaître le monde de l'ancien régime à la veille de la Révolution: elle écrivait qu'il avait suffi à la jeune duchesse de paraître pour conquérir la société, on pourrait dire la cour du duc d'Orléans [4] . Mais madame de Genlis était née institutrice pour faire la leçon aux succès des autres. Dès 1804, hâtive comme l'envie, dans un livre qu'elle ne signa pas et où les victimes de sa mémoire étaient, sans être nommées, enlaidies avec assez d'art pour demeurer reconnaissables, elle avait dit Aimée «légère, étourdie, avec des accès de gaieté qui ressemblent un peu à de la folie», et «quelque chose d'indécent [5] ».
[4] «Madame de Fleury était fort jolie. M. le duc de Chartres l’aimait tellement qu'il l'appelait sa sœur; elle l'appelait son frère.»—Madame de Genlis, Mémoires, t. IV, p. 348. Paris, Lavocat, 1825.
[5] Souvenirs de Félïcie, p. 180.
Bien autres furent les sentiments inspirés par la duchesse à madame Vigée-Lebrun. La grande artiste qui a rendu impérissables pour nous les dernières grâces de l'aristocratie française avait aussi une plume, bien qu'inégale à son pinceau. Ses Souvenirs , publiés en 1828, présentent ainsi la femme qu'elle avait connue durant la Révolution: «La nature semblait s'être plu à la combler de tous ses dons. Son visage était enchanteur, son regard brûlant, sa taille celle qu'on donne à Vénus;... le goût et l'esprit de la duchesse de Fleury brillaient par-dessus tout.» C'est l'œil difficile du peintre qui juge cette beauté du corps: les autres mérites ont gagné le cœur de l'amie. Elle est d'autant moins suspecte quand elle ajoute: «Cette femme si séduisante me semblait dès lors exposée aux dangers qui menacent tous les êtres doués d'une imagination ardente. Elle était tellement susceptible de se passionner que, en songeant combien elle était jeune, combien elle était belle, je tremblais pour le repos de sa vie; je la voyais souvent écrire au duc de Lauzun, qui était bel homme, plein d'esprit et très aimable, mais d'une grande immoralité, et je craignais pour elle cette liaison, quoique je puisse penser qu'elle était fort innocente. .. La dernière passion qu'elle prit s'alluma pour un frère de Garat [6] .» La bienveillante observatrice admet, il est vrai, qu'aimer n'est pas faillir. Mais, bientôt après, les Souvenirs d'une autre contemporaine, la baronne de Vauday, donnaient des détails peu platoniques sur l'aventure avec Garat [7] , et le caprice pour Lauzun n'avait pas semblé plus pur à un autre témoin, Horace Walpole.
[6] Madame Vigée-Lebrun, Souvenirs, t. II, pp. 60-62.
[7] Souvenirs du Directoire et de l'Empire , par madame la baronne de V ..., Paris, Cosson, 1847.
Les lettres de celui-ci furent connues du public en 1864. L'une, datée de Paris, en 1794, quand Lauzun venait de mourir et la duchesse de Fleury d'être arrêtée, se scandalise que «notre jeune étourdie, notre gentille petite malicieuse», ne fit que «chanter toute la journée. Puisqu'elle chantait au lieu de sangloter, je suppose qu'elle était fatiguée de son Tircis et qu'elle est bien aise d'en être débarrassée». Supposer à la fois en une personne le désordre et l'insensibilité, c'est rendre plus inexcusable chacun des deux vices: le glacial ami de madame du Deffant semblait mal qualifié pour cette rigueur de vertu. Est-ce bien de la vertu? Elle n'a pas cet accent, elle est triste du mal qu'elle constate, elle n'en triomphe pas. Cet homme était une coquette. Il s'était mis à visiter la société de l'Europe comme ses compatriotes en visitent aujourd'hui les paysages. Mais lui voyageait pour être connu en plus de contrées, et il tenait pardessus tout à passer pour spirituel à Paris. L'attention qu'on prête à Ai-mée de Fleury lui semble volée à Horace Walpole. De là, peut-être, sa malveillance. C'est une antipathie de nature: c'est une rivalité entre la chaleur sans rayons de sa houille anglaise, et la flamme claire, gaie, pétillante, d'un sarment français.
Mais, si les insinuations d'un jaloux sont suspectes, comment récuser les aveux de l'accusée? Ces aveux sont venus de nos jours. Les archives diplomatiques de l'Empire n'occupaient pas tellement le prince Loba-noff, ambassadeur ou ministre, qu'il ne trouvât du temps pour se faire des archives moins graves avec les correspondances où l'aristocratie du XVIII e siècle, à la veille de mourir, avait si bien écrit sa joie de vivre. Admis à puiser dans cette collection, M. Paul Lacroix publia, en 1884, une partie de ces lettres [8] , quelques-unes d'Aimée. Elles ne laissent pas de doute qu'elle n'eût rien refusé à Lauzun, et, les aveux allant plus loin que les soupçons, elles attestent d'égales bontés pour un jeune lord, dont nul encore n'avait parlé. On a aussi, en ces dernières années, découvert d'autres billets d'elle à Mailla Garat, et ceux-là, tant s'y dévoile l'indécence des caresses, doivent demeurer dans le musée secret des curieux [9] .
[8] Lettres de la marquise de Coigny et de quelques autres personnes appartenant à la société française de la fin du XVIII e siècle, publiées sur les autographes, avec notes et notices explicatives, par Paul Lacroix.—Jouault et Sigaux, 1884.
[9] Ces quatre lettres à Mailla Garat sont dans la collection de M. Gabriel Hanotaux.
A chercher ses livres, on n'avait trouvé que ses amants. Les lettrés eux-mêmes se sont mis à servir la seule de ses réputations qui eût laissé des traces. Autour de cette tombe le myrte repoussait toujours, ils n'ont entretenu que lui. Ils ont présenté les aventures de cette femme comme son originalité et semblé croire que le plus charmant de ses ouvrages était ses faiblesses. Il ne leur a plus suffi de celles qui étaient connues, ils se sont ingéniés à en découvrir de nouvelles. Elle est devenue le type de ces femmes portées de caprice en caprice, comme ces jolies guêpes qui, sur chaque fleur où elles puisent sans se poser, gardent leurs ailes étendues pour repartir plus vite. Cette butineuse d'amour aurait volé de Lemercier à Jouy [10] , et, hier encore, on la montrait, passant de Garat en Garat, comme de rose en rose sur le même buisson [11] . Elle a donné de l'imagination aux dictionnaires mêmes et il n'est pas jusqu'à Larousse qui n'ait voulu dire sur elle du nouveau. Elle gardait encore une gloire pure, les vers d'André Chénier. La sympathie que la jeunesse du malheur inspira à la jeunesse du génie n'a été qu'un roman de prison: «Dans quelle salle, derrière quelle grille fut-il donné à Léandre de dire de sa bouche à la belle Héro les vers qui ont éternisé le souvenir de ce lien charmant tranché par la guillotine?» Mais si la grille et la salle restent incertaines à cet historien scrupuleux, sans hésiter il nous transporte «sur le balcon où Roméo dut posséder sa Juliette [12] ». Ainsi presque tous ceux qui ont parlé d'elle se sont piqués d'honneur à la déshonorer un peu plus, et sa gloire a fini par n'être plus faite que de sa mauvaise réputation.
[10] Lettres, etc., p. 202.
[11] Garat, par Paul Lafond: in-8° , Calmann-Lévy, 1900, pp. 287-297.
[12] Larousse, Grand Dictionnaire, au mot: André Chénier.
Plus ces affirmations se sont multipliées, plus elles ont déçu. On en savait à la fois trop et pas assez. Entre cette existence de succès passagers et vulgaires, et l'aristocratie de goûts, d'allures, d'intelligence à la-quelle était rendu un hommage unanime, il y avait contradiction. Le sou-venir trop conservé de tous ses amours rendait plus regrettable la perte de toutes ses œuvres, et qu'ainsi tout en cette femme eût été fragilité.
II
Les amis des livres et des manuscrits savent que le feu marquis Raymond de Bérenger passa une partie de sa vie à compléter et à mettre en ordre les riches archives de sa maison, réunies depuis des siècles à Sassenage. Les amis de la bonne musique et de la conversation aimable n'ont pas oublié la marquise sa femme. Elle m'avait toujours témoigné de la bienveillance, je lui prouvais ma gratitude en rendant à son jeune fils la sympathie dont elle m'honorait, et mes relations avec celui-ci avaient survécu à la mort de la mère.
Un jour de l'an dernier, il entra chez moi, posa sur ma table de travail un petit paquet et me dit: «Voici deux manuscrits que j'ai trouvés à Sassenage. Tous deux sont des Mémoires, l'un de la duchesse de Dino, l'autre sans nom d'auteur. Si la curiosité vous en dit, lisez-les; si vous les jugez intéressants, publiez-les. Je vous fais maître de leur sort.»
Le nom de madame de Dino, sa vie toujours si proche de la politique, dans une condition qui lui permettait de tant voir, et son aptitude célèbre à tout comprendre, disaient d'avance que, pour elle, se souvenir était intéresser. Mais, si la renommée a son attraction, le mystère aussi a la sienne, et j'ouvris d'abord le manuscrit dont l'auteur semblait se ca-cher.
La belle reliure de maroquin rouge, lisse et souple qui enfermait, entre ses gardes de soie bleue, un cahier de vélin carré et épais comme un volume; le large ruban d'un bleu plus pâli qui servait de signet; l'or solide des tranches et des petites stries qui zébraient l'épaisseur des plats, avaient une élégance joliment fanée par le temps. La date était tracée sur la première page: «Mémoires écrits en l'année 1817.» Entre deux grandes marges, le texte suivait, d'un trait épais et d'une régularité pâteuse. Tous les experts en écriture, malgré les désaccords qui font la doctrine de leur science, auraient sans hésiter reconnu dans celle lourdeur appuyée une main masculine. Deux citations, l'une de Sénèque, l'autre de Montaigne, accompagnaient le titre. Ce latin et ce vieux français semblaient aussi révéler le lettré. Mais, après les citations, venait une dédicace:
«A M. le marquis de Boisgelin, pair de France.
«Vous avez désiré vous rappeler un temps où le projet de changer le gouvernement nous occupait. Ce temps m'est cher, puisque je l'ai passé près de vous dont l'amitié honore et intéresse ma vie.
«Acceptez donc les efforts de ma mémoire. S'ils manquent d'exactitude, mes erreurs demandent de l'indulgence, car elles sont accompagnées de bonne foi. Je suis payée de la peine que me coûte ce travail par le plaisir que j'éprouve à retracer l'époque où nous espérions voir s'accomplir les vœux ardens que nous formions pour le bonheur de notre patrie.»
«Je suis payée.» La plume avait-elle, par mégarde, changé le sexe de son maître? Mais un homme eût pu dire à un autre homme: «Votre amitié honore,» il n'eût pas ajouté «et intéresse ma vie». Ceci est d'une femme. Et que, malgré le latin et la virilité de l'écriture, l'œuvre fût d'une femme, cela était marqué dès le début des Mémoires .
«Restée en France..., cachée dans un coin obscur de cette grande machine appelée tour à tour République, Empire, Royaume..., je pourrais me croire dépouillée de mon rang et de ma fortune, si mes habitudes de très pauvre citoyenne ne dataient de si loin que mon titre de duchesse, ma situation de grande dame ne me semblent plus qu'un point dans ma vie, un point si loin et si effacé que les rêves ont plus de consistance et de réalité.»
L'ancien régime ne comptait pas en France autant de duchesses que n'en ont depuis faites nos gouvernements révolutionnaires, les grâces tarifées des chancelleries étrangères, et la badauderie des sociétés démocratiques à accepter la fausse monnaie de la noblesse. Une duchesse qui n'eût pas émigré était une rareté plus grande; une duchesse qui, en 1817, fût encore «pauvre citoyenne» et ne participât, ni par elle, ni par les siens, aux «restaurations» accomplies par la royauté dans les emplois, les prérogatives et les fortunes de ses partisans, était une exception plus in-solite encore: et cela, pensais-je, enfermait l'inconnue en cercles de plus en plus étroits. Un peu plus loin, racontant un séjour à Vigny, elle disait: «Je retrouve à Vigny tout ce qui, pour moi, compose le passé et j'acquiers la certitude d'avoir été aussi entourée d'intérêt doux dans mon en-fance et de quelques espérances dans ma jeunesse. Voilà la chambre de cette amie qui protégea mes premiers jours; je vois la place où je causais avec elle, où je recevais ses leçons.» Vigny, depuis la fin du XVI e siècle, était aux Rohan. Dans les dernières années de l'ancien régime et sous la Révolution, il appartenait à Armande-Victoire-Josèphe de Rohan-Sou-bise, devenue par son mariage princesse de Rohan-Guéménée. Cette princesse, fort remarquable d'esprit et très liée avec le comte de Coigny resté veuf, s'était offerte à élever la fille de celui-ci. Cette fille était Aimée; Aimée, par son mariage, était devenue duchesse, elle n'émigra pas, elle ne reprit pas de rang à la Cour à la Restauration. Ces indices semblaient trahir le nom de l'auteur. L'auteur lui-même le livrait plus loin, comme enfoui au milieu de son texte, dans le récit d'une conversation avec M. de Talleyrand. «Il se leva, fut à la porte de son cabinet de tableaux et, après s'être assuré qu'elle était fermée, il revint à moi en me disant: Madame de Coigny...» Ce nom se trouvait signé à chaque mot par l'écriture des Mémoires : entre ces pages et les lettres autographes d'Aimée, l'identité d'aspect est évidente. Qu'enfin ce manuscrit se trouvât dans la maison de Bérenger, rien de plus naturel. M. de Boisgelin, pour qui il avait été fait, avait une fille qu'il maria à un Bérenger [13] ; le manuscrit recueilli par celle-ci dans la succession de son père entra ainsi dans les archives de Sassenage.
[13] Raymond-Gabriel de Bérenger, officier de cavalerie, aide de camp de Murat, puis officier d'ordonnance de Napoléon, mourut, le 30 août 1813, d'une blessure reçue à la bataille de Dresde.
La plus imprévue des circonstances mettait donc en mes mains cette œuvre que l'on croyait détruite.
S'il eût été fâcheux qu'elle restât inconnue, les lecteurs en décideront. Mais comme ces Mémoires , suite de témoignages et d'opinions, doivent inspirer la même confiance que mérite le caractère d'Aimée, et comme ce caractère reçoit une clarté nouvelle de ces souvenirs, il ne faut pas séparer ce qu'elle dit de ce qu'elle fut. Au moment où celle dont on a tant parlé va parler elle-même, il est temps de la juger. Sa vie est une préface de son œuvre. C'est ainsi que j'ai été amené à étudier à mon tour cette femme célèbre et mal connue.
Il y a pour un historien deux joies: découvrir ce qu'ignorent les autres et renverser ce qu'ils croient savoir. Les familiers du cœur humain prétendent que de ces deux joies la plus délicieuse est la seconde. L'une et l'autre m'ont été données. Presque tous ceux qui se sont occupés d'Aimée sont inexacts: inexacts même sur les dates de sa naissance, de ses mariages, de son arrestation, de sa mise en liberté, tous événements constatés par pièces officielles et à propos desquels il suffisait de cher-cher pour trouver [14] . On reconnaît dans leur faire l'artifice grâce auquel trop d'historiens, semblables à certains marchands, donnent l'apparence du fini à des matières médiocres et médiocrement travaillées. Le goût du public pour le nouveau dirige, mais précipite, leurs recherches. Ont-ils mis la main sur quelque document, au lieu de le contrôler, de le compléter, d'étendre avec patience la certitude sur tout un sujet, ils veulent se faire un immédiat honneur de leur bonne fortune, et se servent du détail authentique qu'ils ont trouvé pour donner de l'autorité au reste, qu'ils inventent ou qu'ils copient sur d'autres aussi peu scrupu-leux. A plus forte raison en ont-ils pris à l'aise avec les caprices du cœur. Aimée était un de ces riches à qui l'on prête: ils lui ont prêté parfois sans garantie aucune des accusations qu'ils avançaient, tant ils avaient confiance en sa mauvaise renommée, et leurs jugements ont été plus légers encore que ses mœurs. Ils ont introduit dans les livres le même oubli de conscience, la même intrépidité de soupçons qui, si souvent, dans la causerie mondaine, sacrifie, sans preuves, les réputations à la joie de médire et à la gloriole de paraître informé. Aimée de Coigny fut étrangère à plusieurs des intrigues qui ont fait sa légende, et celles de ses faiblesses, qui ne sont pas contestables, eurent un caractère moins méprisablement banal. Mais, de ces galanteries, il reste trop pour sa mémoire, il y eut trop pour son bonheur. Dire ce que sont ces amoureuses, de quel prix elles paient leurs triomphes, montrer l'envers de leur gloire, n'est pas la moindre vérité à servir par le récit de cette vie.
[14] Je puis parler de ces recherches, car presque tout leur mérite appartient à d'autres qu'à moi. Une fois tracé le plan des questions à résoudre, il a fallu demander les réponses à la bonne volonté de plusieurs personnes que je citerai avec les documents fournis par elles. Mais je tiens à nommer à part et tout d'abord M. Charles Baille. Je lui dois les plus importantes précisions sur la vie d'Aimée de Coigny, surtout la date de l'écrou à Saint-Lazare et de la mise en liberté. L'hommage que je rends à son art de découvrir et d'interroger les pièces historiques n'étonnera aucun érudit de Franche-Comté: là le mérite de M. Baille a depuis longtemps fait ses preuves. Une vie passée presque tout entière en province, l'intérêt local des travaux, et le dédain de toute réclame avaient longtemps enfermé cette réputation en des frontières trop étroites. Elle les a franchies et depuis quelques années le Correspondant, la Revue Hebdomadaire , la Quinzaine et la Revue de Pans font goûter au public la science, l'esprit et le style de ce lettré.
III
Les Franquetot de Coigny avaient d'abord été de robe. Au XVII e siècle, ils prirent l'épée. La couronne de comte, puis celle de duc et le bâton de maréchal récompensèrent leur courage. On ne parvenait pas à ce rang dans la noblesse d'épée sans compter dans celle de cour. Là aussi, la faveur du prince avait assuré aux Coigny une importance croissante. Sous Louis XVI, la famille était représentée par deux frères. L'aîné vivait dans la société la plus intime de Marie-Antoinette. Madame Elisabeth avait pour chevalier d'honneur le second, qui fut le père d'Aimée. Elle naquit le 12 octobre 1769 [15] , au moment où l'aristocratie française, la plus brillante d'Europe, avait achevé de transformer ses vertus en élégances. Elle sembla éclore comme un tardif bouton de cette rose trop épanouie qui, déjà penchant sur sa tige, effeuillait ses plus doux, ses der-niers parfums. Son intelligence fut précoce comme sa beauté, et non moins soignée que son corps. Les penseurs, les historiens, les philosophes français lui devinrent non seulement connus, mais chers, mais compagnons. Savoir le latin n'était pas pour les jeunes filles de son rang une rareté, mais elle le posséda jusqu'à la familiarité avec les maîtres de cette langue. Son temps lui apprit beaucoup de ce qu'il savait, il n'avait pu l'instruire de ce qu'il ignorait, et ce qu'il ignorait était le devoir.
[15] M. de Lescure, dans l'Amour sous la Terreur, fait naître Aimée de Coigny en 1776, M. Paul Lacroix donne l'année exacte, mais non le jour. La date complète se trouve dans l'acte baptistère inscrit le 13 octobre 1769 au registre de la paroisse Saint-Roch à Paris. L'hôtel qu'habitaient le comte et la comtesse de Coigny, rue Saint-Nicaise, et où naquit Aimée, était dans la circonscription de cette paroisse. Je dois communication de cet acte baptistère et de tous ceux qui, relatant les mariages et divorces ont modifié l’état civil d'Aimée de Coigny, à l'obligeance de M. Orville. Ces pièces avaient été déposées par Aimée de Coigny dans son château patrimonial de Mareuil-en-Brie, et oubliées là quand, en l'an X, elle vendit le domaine. Les premiers acquéreurs respectèrent ces archives. M. Orville, dernier acheteur de la terre, les a examinées et classées, comme il entretient le château, avec un affectueux et intelligent respect du passé.
Cette aristocratie, destituée de ses fonctions utiles, oisive et riche, ne vivait que pour le plaisir. La foi, incommode aux passions et humiliante pour l'orgueil de l'esprit, était dédaignée, et, échappées à ce frein, les mœurs étaient libertines comme les pensées. La vertu de Louis XVI fut le premier ridicule qui diminua à la cour la majesté du souverain. Dès l'enfance, Aimée, tout près d'elle, trouva cette école d'immoralité; la pudeur des regards et la sainteté de l'ignorance furent blessées en elle par des visions précoces du mal. A six ans, elle perdait sa mère [16] : la femme distinguée qui éleva l'enfant était, comme on disait alors, «l'amie» de son père. Un autre titre lui est donné dans la page où Aimée parle de Vigny. «Voilà les petits fossés que je trouvais si grands et le saule que mon père a planté au pied de la tour de sa maîtresse.» Si aristocrate soit-elle d'esprit et de naissance, comment la maîtresse du père apprendrait-elle à la fille la supériorité du devoir sur l'attrait? Une telle éducation était faite pour enseigner tout ce qui pare la vie, rien de ce qui la dirige.
[16] La comtesse de Coigny, née Anne-Joséphine-Michelle de Boissy, mourut à Paris, en l’hôtel de la rue Saint-Nicaise, le 23 octobre 1775. Fort originale, elle aurait eu une passion pour l'anatomie, jusqu'à emmener avec elle, quand elle voyageait, un squelette, et elle serait morte d'une piqûre qu'elle se serait faite en disséquant. Ceux qui aiment à suivre la persistance et les transformations des goûts héréditaires, sont libres d'attribuer à cet intérêt de la mère pour les squelettes, l'origine des curiosités de la fille pour les vivants. L'inventaire dressé à la mort de la comtesse donne à ceux qui se plaisent aux renseignements plus sûrs, sur la demeure, l’ameublement et le luxe d’une famille riche à la fin du XVIII e siècle, des détails curieux. Il est publié à la fin du présent volume.
Il est vrai, l'éducation d'une fille n'est qu'une préface. Quand elle semble achevée, un dernier maître succède, le plus persuasif, assez puissant pour abolir l'œuvre antérieure à lui et changer l'âme en prenant le cœur: c'est le mari. S'il est aimé, un mari peut faire aimer à sa femme tout ce qu'il aime, y compris la vertu. Mais il s'agissait bien de cela dans les alliances d'alors! L'époux et l'épouse étaient les personnages les moins consultés dans l'affaire menée par leurs familles, et, pourvu que le reste convînt, il allait de soi qu'ils se convinssent. Pour les Coigny, une alliance avec un Fleury, petit-neveu du cardinal et qui serait duc, était un beau parti. Pouvait-on le prendre trop vite? Ainsi Aimée épousa en 1784 un mari d'un mois plus jeune qu'elle et qui n'avait pas quinze ans [17] ! Dans ce ménage de poupée, c'est la fillette qui est l'expérience et la raison. Avec un éveil hâtif de ses sens, la voilà du monde, elle devient un atome de cette brillante poussière qui danse dans un rayon de soleil.
[17] Le mariage fut célébré le 5 décembre. Leurs Majestés et la famille royale signèrent au contrat. André-Hercules-Marie-Louis de Rosset de Rocozel, marquis de Fleury, était fils du duc et de Claudine-Anne de Montmorency-Laval.
Elle était à l'âge où l'on s'amuse de tout; elle joua à la vie. Elle se plut à la gaieté des autres, elle y ajouta la sienne, se trouvant deux fois libre de tout dire, et parce qu'elle était déjà femme, et parce qu'elle était encore enfant; enfant par la turbulence, l'audace, l'imprévu et cette acidité de fruit vert qui plaît aux palais blasés. Versailles, bien qu'il n'eût plus de sérieux, avait encore de l'étiquette. Aimée n'y parut guère. Paris offrait aux fantaisies de ses allures un théâtre plus libre, et partout le même spectacle: l'universel et public rapprochement des hommes et des femmes par des attractions spontanées; le mariage déshabitué de dé-fendre ses droits contre les caprices qui séparaient, avec un parti pris d'ignorance et de libertés réciproques, les époux. 1789 fut pour elle aussi la date où, sur la ruine des vieilles mœurs, commença la tentative de la liberté. Elle avait tout disposé pour goûter en une aventure beaucoup de plaisirs: elle voulut non seulement satisfaire sa passion, mais l'amuser, l'illustrer et l'accroître par le chagrin causé à d'autres. Elle se donna tout cela en se donnant à Lauzun.
On distingue d'ordinaire la noblesse d'épée et la noblesse de robe. On y pourrait joindre la noblesse de jupes, celle qui faisait sa fortune par les femmes. Les Lauzun étaient la plus célèbre des familles illustres en cet art. Au Lauzun de la Grande Mademoiselle [18] avait succédé le Lauzun de toutes les dames, à la ville comme à la cour roi de la galanterie. Cette allure conquérante et rapide qui promettait à chaque femme si peu de son vainqueur, au lieu de les mettre en défiance contre un bien si partagé et si court, les rendait follement avides de ce qui était si disputé. Sa renommée lui permettait de changer le rôle des sexes dans ce que Montesquieu appelle «la muette prière». Ce sont les femmes qui la lui adressaient, pas toujours muette; c'est lui qui avait à se défendre, inviolablement respectueux des laides. Il touchait d'ailleurs la quarantaine, et, à une femme dont le mari n'avait pas vingt ans, eût dû paraître presque vieux. Mais il avait gardé la séduction la plus irrésistible de la jeunesse, tant chacune de ses passions semblait être la première, tant il donnait à chaque femme et avait l'impression qu'au moment où il la désirait, elle comptait seule pour lui. Surtout il était un causeur d'une variété, d'une verve, d'une drôlerie sans pareilles. Après plus de trente ans, un roi, et qui se connaissait en esprit, gardait encore vivante l'impression de cette parole. En 1820, au moment où furent annoncés les Mémoires de Lauzun, Louis XVIII, qui savait don Juan féroce comme la vanité et capable de soutenir, fût-ce par le mensonge, son renom d'irrésistible, redoutait des insinuations offensantes pour la mémoire de Marie-Antoinette. Il confiait cette inquiétude à Decazes et l'un de ces billets qu'il lui écrivait chaque jour, sur le ton d'un père à son fils, dit de Lauzun: «Il était impossible d'être plus amusant qu'il n'était: moi qui te parle, je serais resté vingt-quatre heures à l'écouter [19] .»
[18] Le premier Lauzun était un Nompard de Gaumont. Ces Gaumont avaient une baronie qui devint comté en 1570, et, par lettres de mai 1692, François de Gaumont fut créé duc de Lauzun. Il mourut sans postérité en 1723 et le duché échut à sa nièce, Marie Baudron de Nogent, mariée à Charles-Armand Gontaut, duc de Biron. L'ami d’Aimée et de bien d'autres était Gontaut et portait le titre de Lauzun comme cadet. Ce fut son nom de galanterie. Il prit celui de Biron, dès qu'il en eut le droit, pour faire la guerre et mourir.
[19] Cité par M. Ernest Daudet, dans son livre Louis XVIII et le duc Derates . Plon, in-8° , 1899.
Qui plaît aux princes n'est pas loin de plaire aux duchesses. Aimée fut délicieusement fière d'attirer cette manière de héros: elle était femme à lui renvoyer le volant des légèretés spirituelles. Ils s'étonnèrent, lui de trouver tant d'à-propos dans tant de jeunesse, elle tant de jeunesse dans tant de renommée, et leurs coquetteries se conquirent.
Enfin, tout ce que Lauzun avait de cœur appartenait à une cousine d’Aimée, la marquise de Coigny, à la femme dont Marie-Antoinette disait: «Je suis la reine de Versailles, mais c'est elle qui est la reine de Pans.» Prendre le plus séduisant des hommes à la femme la plus à la mode, c'était triompher à la fois de l'un et l'autre sexe. Ce sont là de ces raisons auxquelles il faut beaucoup de raison pour ne pas se rendre, et il était difficile de débuter mieux dans le mal.
On a dit que la marquise avait su maintenir Lauzun dans la discrétion passionnée d'un amour tout idéal. Une seule chose le donnerait à croire, c'est la constance de Lauzun pour cette femme: la fidélité d'un tel homme est de la gourmandise qui attend. Mais, s'il accepta le jeûne avec la marquise, il le rompit avec la duchesse. Il avait à Montrouge une de ces «folies» qui servaient aux rendez-vous et qu'Aimée, dans une lettre, appelle «mon pauvre Montrouge». Leurs rencontres n'y eurent aucune originalité.
L'extraordinaire fut le sérieux du sentiment que la plus évaporée des femmes vouait au plus frivole des hommes. Lasse d'avoir jusque-là porté seule le poids de ses pensées et de ses actes, que, ni son père ni son mari n'ont dirigés ou soutenus, elle goûte le repos délicieux de confier non seulement son cœur, mais son intelligence et sa volonté. C'est une docilité qui cherche son joug. Rien jusqu'alors n'avait été plus étranger à la jeune duchesse que la politique. Lauzun est opposant, la voilà constitutionnelle. Elle dédaigne sa propre intelligence pour prendre par imitation celle de son héros. En quoi elle perd l'une sans acquérir l'autre, comme le prouvent ses lettres à son ami. Ce sont des idées de Lauzun qu'elle délaie, des mots de Lauzun sur lesquels elle renchérit, rien de spontané ni de libre; de la lourdeur, de l'artificiel, de la prétention. Mais ce renoncement au moi dans une nature si originale, cette déférence poussée jusqu'à l'abdication dans une âme si indépendante, cette idolâtrie jusqu'au manque de goût dans un esprit si délicat, prouvent du moins sa sincérité à se donner tout entière.
Il lui fallut mesurer aussitôt quel peu elle était à cet homme devenu tout pour elle. Lauzun a pris la duchesse sans quitter la marquise, il n'a entendu ajouter qu'un caprice à une habitude. Quand on croit deux existences fondues en une, apprendre, et de l'être choisi, que le don du corps est sans importance, la confusion des âmes sans intérêt, invraisemblable la constance, quelle leçon d'amour! Tout ce qu'elle rêvait d'idéal dans le désordre est chimère, tout ce qui l'instruit la déprave. L'élève souffre d'abord de ces leçons: après deux ans, elle en profite.





























