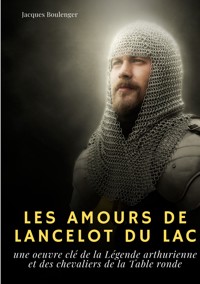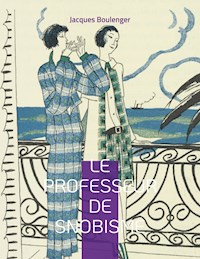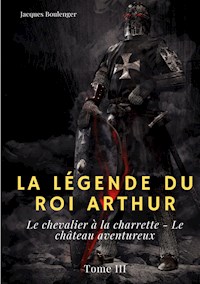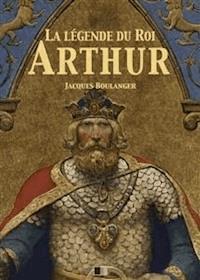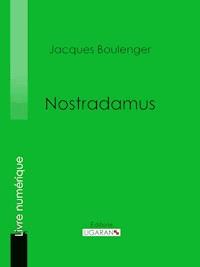
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "Au XVe siècle, les Juifs de Provence et surtout du Comtat Venaissin, domaine papal, suivaient leur religion en toute liberté. Sans doute, là comme partout, le peuple les goûtait peu et il ne manquait pas de bonnes gens pour raconter qu'ils avaient tous les écrouelles ou des flux de sang, et que, s'ils tenaient la tête basse, c'était pour cacher une haleine fétide. Mais on les laissait vivre hors du ghetto, s'ils le voulaient."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Au XVe siècle, les Juifs de Provence et surtout du Comtat Venaissin, domaine papal, suivaient leur religion en toute liberté. Sans doute, là comme partout, le peuple les goûtait peu et il ne manquait pas de bonnes gens pour raconter qu’ils avaient tous les écrouelles ou des flux de sang, et que, s’ils tenaient la tête basse, c’était pour cacher une haleine fétide. Mais on les laissait vivre hors du ghetto, s’ils le voulaient, et respecter à leur guise leurs mille et un tabous alimentaires, observer les fêtes et le sabbat, étaler sur la table les vases d’or et les chandeliers à sept branches, couvrir leurs têtes du taliss rituel, revêtir la chemise blanche, bénir la coupe de vin et la faire circuler à la ronde. Réunis tout le jour sous la gaule du maître d’école comme un sage petit troupeau de canards, nul n’empêchait leurs enfants de rabâcher la Tora sans la comprendre (exactement comme les petits musulmans le Coran), jusqu’à se rendre capables de réciter imperturbablement ces quelque six mille vers.
Les plus remarquables étudiaient ensuite le Talmud et ils s’épuisaient à discuter combien de poils blancs peut avoir une vache rousse sans cesser de l’être, ou si l’on peut tenir quelque chose en main le samedi, puisque la loi défend de rien porter le jour de Sabbat et, par exemple, comment l’on doit conduire son cheval, sa mule ou ses vaches. Et à ces disputes absurdes, peut-être s’aiguisaient-ils l’esprit, car ils faisaient fortune beaucoup plus souvent que les chrétiens, et non seulement au commerce de l’or, mais à beaucoup d’autres. Certains même occupaient les fonctions publiques auxquelles, en ces pays-là, on leur laissait l’accès, comme celles de procureur fiscal et de péager. D’autres étaient médecins, car c’était alors la médecine arabe et orientale qui triomphait et telle était la barbarie qu’on préférait Avicenne à Hippocrate et à Galien. Et il ne manquait pas de Juifs qui, par ce moyen ou autrement, avaient su si bien se pousser auprès des grands qu’ils en avaient conquis la confiance. Ceux-là n’aunaient plus les étoffes derrière leurs comptoirs, ne pesaient plus les pièces d’or au trébuchet, ne déballaient plus de leurs longs doigts maigres les précieux ballots d’épices des Indes et du Cathay ; ils n’allaient même plus de maison en maison examiner d’un œil soucieux la couleur des urines, et quand ils passaient, montés sur leurs belles mules, les courants d’air du mistral pouvaient agiter les pans de leurs houppelandes noires au coin des rues étroites et faire flotter leurs longues barbes et leurs boucles, il n’était plus guère que les gamins aux pieds légers pour oser leur crier, de loin : Retaillons ! ou d’autres noms plus mal sonnants encore.
Tel était maître Pierre de Nostra-Donna, ou Nostra-Dame, ou Nostre-Dame, car, venu d’Italie en France, il avait francisé son nom. Médecin, il s’était établi dans la ville d’Arles, où son habileté lui avait valu une belle clientèle. Mais les apothicaires ne pouvaient le souffrir et ils y avaient quelque raison, car, soit qu’il les jugeât (comme fera plus tard son fils Michel) trop « avares et corrompus » pour mettre dans les drogues ce qu’il fallait, ou trop ignorants pour connaître les bonnes recettes, il mêlait, concassait et composait de sa propre main les médicaments qu’il ordonnait, après quoi il les vendait lui-même, joignant ainsi les bénéfices du « pharmaceutre » à ceux du médecin. Ce que les apothicaires trouvaient fort mauvais. Aussi finirent-ils par accuser maître Pierre, devant les consuls de la ville, de falsifier ses drogues, et l’on ne sait trop comment les choses auraient tourné, si notre homme n’était entré sur ces entrefaites au service du duc de Calabre, lequel le céda à son père, le roi René d’Anjou.
Or le roi René avait déjà un autre médecin juif, nommé Jean de Saint-Rémy, du nom de la ville, où il était natif. Celui-là était fort versé dans l’astrologie, si bien que le roi l’avait nommé conseiller et le tenait en grande faveur, car ce bon seigneur n’avait nulle haine pour les enfants d’Israël et, bien loin de les persécuter, il les laissait vivre et commercer à leur guise (moyennant qu’ils lui donnassent beaucoup d’argent, cela va de soi)… Hélas ! voilà qu’il mourut ! Et le comte du Maine, qui avait hérité de lui, mourut à son tour, de manière qu’en 1481 le roi de France devint enfin comte de Provence, à grand honneur pour cette dernière contrée qui enfin fut française, mais à grand chagrin pour les Juifs qui l’habitaient, car dès 1488 le roi Charles VIII, qui était fort démuni de pécune, leur ordonna de se convertir sous peine de voir leurs biens confisqués.
Ce qui atténuait à l’ordinaire l’importance des ordonnances royales, c’est que (telles celles de nos préfets de police d’à présent) elles n’étaient guère exécutées. Celle-ci d’ailleurs ne fixait pas de délai, en sorte que la plupart des Juifs firent comme si elle n’existait pas. Mais cinq ans plus tard, comme les besoins d’argent du roi n’avaient pas diminué, bien au contraire, de nouvelles lettres patentes leur fixèrent un délai de trois mois pour s’exécuter ; puis, le 26 septembre 1501, le roi Louis XII, qui avait remplacé Charles VIII, revint à la charge une fois encore. Finalement la plupart des Juifs, tous les riches du moins, préférèrent le baptême à l’exil, et s’en trouvèrent fort bien, car ils purent désormais acheter à beaux deniers comptants des fiefs, des châteaux, des lettres de noblesse, des dignités et firent souche de seigneurs : c’est ainsi que les Puy-Michel, les La Tour, les Cadenet, les Arlatan-Lauris et beaucoup d’autres familles nobles de la Provence descendent en droiture des tribus d’Israël.
Maître Pierre de Nostredame et maître Jean de Saint-Rémy, hommes savants et, comme nous dirions, éclairés, s’étaient convertis à la première sommation, je pense, car ils avaient du bien et y trouvaient leur avantage. Maître Pierre s’empressa d’acheter dans la petite ville de Saint-Rémy en Provence (d’où son confrère tirait son nom) une charge de notaire pour son fils Jaume, ce qui lui était devenu parfaitement licite. C’était là une profession fort honorable, que des cadets de famille noble ne se jugeaient pas déchus d’exercer. Ayant ainsi établi Jaume, il le maria à Renée de Saint-Rémy, fille de son confrère et ami ; et qui sait si, après la cérémonie à l’église des chrétiens, il ne s’en déroula pas ailleurs une plus secrète où la fiancée, les cheveux dénoués et flottants, tourna sept fois autour de son futur époux vêtu par-dessus ses habits de la chemise blanche qu’il devait porter dans son cercueil, puis reçut à son doigt l’anneau d’or, puis but dans la même coupe que son époux, qui la brisa ensuite en mémoire du deuil de Jérusalem ?…
Il faut toutefois reconnaître que les enfants de Jaume de Nostredame et de sa femme, baptisés comme leurs parents, se montrèrent toujours bons chrétiens. Nous en connaissons deux : Michel, né le jeudi 14 décembre 1503 « environ les douze heures de midi », dont nous contons la vie, et Jean qui fut procureur au Parlement d’Aix, qui publia à Lyon en 1575 les Vies des plus célèbres et anciens poètes provençaux qui ont fleury du temps des comtes de Provence, ouvrage plein de fantaisie, et qui mourut en 1590 après avoir survécu vingt-quatre ans à son frère aîné. Michel fit toujours grand étalage de piété ; quant à Jean, on dut le mettre en prison pour ses violences contre les huguenots, lors des troubles d’Aix. En sorte que rien ne permet de croire qu’ils ne fussent pas bons catholiques l’un et l’autre. Toutefois, il est bon de savoir que les temps heureux des Juifs provençaux étaient finis. En 1512, le roi, qui regrettait d’avoir tari une source de revenus en les supprimant, imposa les nouveaux chrétiens, ceux qui en Provence s’étaient convertis selon son édit : ils durent verser au trésor six mille florins, pas un sol de moins, sans compter les dépens et frais. Gervais de Beaumont, sieur de Mondésir, chargé de recouvrer la somme, choisit douze notables parmi les intéressés pour répartir la taxe, et la famille de Nostredame n’en fut pas exempte. Quant à ceux des enfants d’Israël qui étaient arrivés depuis 1501 ou qui étaient revenus au pays après un faux départ, ils se voyaient maintenant si fort tracassés par le peuple, qu’en 1542 le Parlement d’Aix dut prendre un arrêt condamnant ceux qui les insulteraient à avoir la langue coupée la première fois, à être fouettés au sang la seconde et à avoir leurs biens confisqués la troisième. Et tout cela laisse à imaginer que, tout notaire qu’il était, Jaume de Nostredame devait avoir parfois quelques ennuis. Son fils Michel put apprendre de bonne heure qu’il valait mieux être chrétien décidément.
Saint-Rémy est une petite cité méridionale qu’entourent des champs de fleurs et de cardères ; c’est dans une de ses maisons que Gounod donna la première audition de Mireille ; c’est à une lieue de là, à Maillane, qu’a vécu Mistral. Sur la place, lou Planat, on montre une demeure de la Renaissance qui passe pour avoir été celle des Nostredame. Le notaire y avait fait inscrire sur le linteau de la porte la devise : Soli Deo. C’est là-dedans que le petit Michel regardait son grand-père piler et repiler ses poudres, malaxer ses pâtes, mêler ses élixirs, triturer ses onguents et composer ses opiats, toutes choses auxquelles le vieux médecin était expert comme j’ai dit ; et le futur Nostradamus tenait apparemment de lui cette connaissance de l’apothicairerie par où il se distingua plus tard.
Mais son éducation fut faite, paraît-il, par son aïeul maternel, Jean de Saint-Rémy, et cet astrologue ne manqua point de lui donner, « comme en se jouant, un premier goust des célestes sciences ». Sans doute apprit-il dès lors à l’enfant à nommer les planètes qu’il montrait du doigt dans les nuits transparentes et dont les conjonctions influencent notre vie et décident de notre destin ; puis dans la journée il lui faisait étudier les mathématiques et l’hébreu peut-être, mais ce latin surtout qui était la clé par où l’on ouvrait les portes de la science, tout entière contenue dans les livres anciens. Car l’observation n’y avait alors aucune place. Et, d’ailleurs, nous pouvons être sûrs que c’est en vain que le soleil brûlait, que la poussière enfarinait les chemins, que les Alpilles odorantes dominaient la petite ville ; en vain même que l’ornaient l’arc de triomphe et le mausolée romains (et comme elles devaient paraître plus vivantes qu’aujourd’hui, ces ruines latines, plus précieuses aussi, en ce temps où la Renaissance commençait à florir et où l’on ne connaissait pas les monuments grecs) ! Quel intérêt le vieux médecin et son élève eussent-ils pris à tout cela ? Leur race, leur tradition, leurs préjugés ne devaient leur inspirer que mépris pour ces beautés de la nature et de l’art. J’imagine que tout le jour le jeune visage restait penché à côté des longues barbes juives et doctorales sur les pots de pharmacie et les in-folios précieux.
Lorsque son grand-père mourut, Michel fut envoyé à Avignon pour faire ses humanités, « Avignon sur sa Roque géante, Avignon la sonneuse de joie qui, l’une après l’autre, élève les pointes de ses cloches tout semées de fleurons, etc. » (il ne faut jamais traduire les vers de Mistral : ils n’y gagnent pas). C’était alors une vraie île sonnante que cette cité papale, et le « tapage renforcé » des cloches que balançaient ses cent églises était tel à certaines heures qu’il y fallait (à ce qu’on dit) élever la voix pour s’entendre. Le peuple de Provence, qui a le verbe haut, ne s’en privait pas et son langage sonore cascadait par les portes et les fenêtres ouvertes. Il grouillait surtout dans les minces rues malodorantes qui s’emmêlaient au centre de la ville, dévalant du rocher des Dons au pont Saint-Bénézet et à l’île de la Barthelasse, et où l’ombre des maisons maintenait quelque fraîcheur. Les clameurs des enfants, les bruyants palabres des ménagères, les cris des marchands de légumes et de pastèques, les refrains des petits métiers y retentissaient tout le jour. Parfois tout se taisait pour le passage d’une procession somptueuse et dramatique : les pénitents bleus, noirs ou gris, tenant leurs gros cierges et leurs bannières, défilaient en chantant des cantiques et le peuple s’agenouillait au passage des croix d’argent, en respirant l’odeur de l’encens. Mais le tumulte reprenait vite et ce n’était qu’au grand soleil qu’on trouvait un peu de silence.
Il régnait, absolu, sur le Rhône presque désert et sur le pont étroit, déjà rebâti plusieurs fois, qui joignait la rive de l’empire à celle du royaume. Parfois son dos bombé résonnait sous les fins sabots des mules et les pieds lourds des chevaux de bât, et la litière d’un prélat, entourée de serviteurs montés, gravissait par les ruelles vers le palais du pape, où les Suisses jaunes, rouges et bleus faisaient sonner leurs hallebardes sur les dalles. Le gouvernement du légat était arbitraire et doux, les peines criminelles relativement peu rigoureuses, l’inquisition indulgente, les impôts moins lourds qu’au royaume. Les gentilshommes volaient le héron et brisaient des lances dans les lices à leur guise. Dans les cabarets, le vin du pape emplissait les verres. Les jeux de paume et autres maisons de jeu, les maisons mal famées des baigneurs faisaient de bonnes affaires. Les filles de la rue de la Madeleine couchée menaient paisiblement leur commerce. « Il n’est bourdeau que d’Avignon », s’écrie le Dict des pays, et au début du XVIIe siècle encore Zinzerling recommandera aux voyageurs de prendre dans cette ville beaucoup de précautions. Quant à Pantagruel, il n’était pas en Avignon depuis trois jours qu’il était déjà amoureux : « Les femmes y jouent volontiers du serre-croupière parce que c’est terre papale », constatait-il ; mais Jean de Boyssonné les a célébrées en termes plus galants. J’estime, dit-il :
C’était le cas des Avignonnaises. À en croire Garganello, les chambrières du palais même étaient fort complaisantes ; mais au bal (les danses en ce temps-là étaient fort licencieuses) on trouvait « les dames les plus parfumées du monde et des baisers » autant qu’on en voulait, des baisers dont il vante la douceur.
« À Avignon il ne s’agit pas d’être occupé de soucis, mais de vivre autant que possible dans la joie et l’oisiveté. » C’est ce que pensaient les étudiants aussi et ils étaient renommés pour leur dissipation et bragardise. Chaque jour, au coup de cloche qui en annonçait l’ouverture, le jeune Michel de Nostredame se rendait aux écoles avec eux, sur la place des Estudes. La tradition, recueillie par ses anciens biographes, rapporte qu’il s’y distingua extrêmement : pourquoi pas ? L’Université d’Avignon était peu brillante, et telle était la mémoire de notre homme, paraît-il, qu’il récitait mot à mot sa leçon dès qu’il l’avait lue une fois, et qu’il n’oublia jamais rien de ce qu’il avait appris : Memoria pene divina prœditus erat ; rien n’empêche de le croire. Le soir, lorsque les autres garçons, ses camarades, voyaient ces petites traînées de feu en l’air que les philosophes appellent astres errants et que nous nommons étoiles filantes, ils croyaient que les étoiles se détachaient du ciel : il les détrompait et leur expliquait ce que maître Jean, son grand-père astrologue, lui avait appris : que c’étaient là des exhalaisons sulfureuses que le vent allume comme il embrase le charbon. « Il leur enseignait aussi que les nuées ne puisent pas dans la mer avec des pompes, ainsi que le croit communément le vulgaire ignorant, mais qu’elles étaient formées d’un amas de vapeurs que l’on voit s’élever de terre par les temps de brouillard. Il leur disait encore une autre chose merveilleuse : que la terre était ronde comme une boule et que le soleil qu’ils voyaient à l’horizon en éclairait l’autre hémisphère. Enfin il parlait si souvent et avec tant de plaisir des météores et des astres, qu’on l’appelait le jeune astrologue. »
Les arts libéraux qu’il étudiait comprenaient alors trois parties : grammaire, rhétorique et philosophie. Lorsqu’on avait passé les examens, on était proclamé maître ès arts, quelque chose comme ce que nous appelons aujourd’hui bachelier, premier grade sans lequel on ne pouvait accéder aux études supérieures. La tradition rapporte que, lorsque Michel de Nostredame eut entrepris la philosophie (c’est-à-dire l’étude des ouvrages d’Aristote, de Pline et autres savants de l’antiquité), il y excella si bien qu’il advint plus d’une fois que son régent le laissât faire la leçon à sa place. C’est fort possible : élevé par un docteur en médecine renommé, petit-fils d’un autre, il avait bien pu être instruit par eux de beaucoup de choses que ses condisciples apprenaient, eux, pour la première fois.
Quoi qu’il en soit, c’est à Montpellier, et non plus en Avignon, qu’il apprit la « philosophie et théorie de médecine ». Pourquoi cela ? Parce que l’Université d’Avignon n’était pas brillante : le droit seul y était enseigné avec quelque lustre ; or notre héros devait être médecin comme ses deux grands-pères qui s’étaient distingués dans cet état : telle était la tradition de sa famille. Nos ancêtres, en effet, n’avaient pas les mêmes idées que nous sur la vocation et n’étaient pas individualistes le moins du monde : il était d’usage que le fils suivît la même profession que son père, et c’est ainsi qu’on voyait des générations de bouchers, de gens de loi ou de savants, voire d’artistes, de peintres ; aux XVIIe et XVIIIe siècles, on en verra même de secrétaires d’État, de ministres comme nous disons, ce qui de nos jours peut paraître étonnant. Le principe d’hérédité ne s’appliquait pas aux familles royales et seigneuriales seulement : il s’appliquait à toutes les familles, et en fait cela réussissait fort bien.
Donc le jeune Michel de Nostredame conquit le grade de maître ès arts. Il ne lui restait plus qu’à se faire inscrire régulièrement à la Faculté de médecine ; mais auparavant il voulut faire un voyage d’étude dans les villes et Universités du midi, s’appliquant à la « pharmaceutrie » ou pharmacie, et à la « cognoissance et perscrutation des simples par plusieurs terres et pays (…), incessamment courant pour entendre et savoir la source et origine des plantes ». C’était, vraisemblablement, un usage assez répandu alors chez les étudiants, que d’aller écouter dans les diverses Universités l’enseignement des humanistes réputés afin de se perfectionner dans les litteræ humaniores, exactement comme les compagnons ouvriers faisaient leur tour de France. C’est, en tout cas, ce que fit Rabelais entre 1527 et 1530, comme Nostradamus entre 1525 et 1529, et il est fort possible qu’ils se soient rencontrés à Toulouse et à Bordeaux avant de s’inscrire tous deux à l’École de médecine de Montpellier.
Pour vivre, les écoliers qui n’avaient pas d’argent s’arrangeaient comme ils pouvaient, et ceux qui apprenaient la médecine ne se privaient pas de soigner les malades moyennant finances. C’est que la profession médicale était bien loin d’être réglementée comme aujourd’hui. Certes le grade de maître ès arts ne donnait pas le droit de l’exercer ; pourtant beaucoup de maîtres ès arts, sous prétexte de familiarité avec Hippocrate et Galien, se faisaient médecins traitants. Jules-César Scaliger n’eut jamais le moindre titre médical : cela ne l’empêchait point d’exercer la médecine, et même de couvrir de sarcasmes et d’invectives les « produits de Montpellier ». Ne nous étonnons donc pas si Nostradamus, comme le dit son premier biographe, pratiqua la médecine bien avant d’avoir commencé à l’apprendre officiellement. Cette science, d’ailleurs, n’était pas alors affaire de spécialistes uniquement : tous les érudits estimaient s’y entendre.
La Renaissance des lettres, en France, est avant tout un mouvement philologique (comme on parle aujourd’hui). C’est un simple retour aux « sources ». L’intelligence pure n’a pas grand-chose à voir là-dedans, et il n’est pas un philosophe durant la Renaissance qui puisse entrer seulement en comparaison avec les métaphysiciens de la grande école scholastique du Moyen Âge. D’ailleurs on est bien loin, au fond, de rompre avec le Moyen Âge : le credo de l’autorité garde toute sa force et l’on continue d’admettre que certains génies quasi-divins du passé ont mis dans leurs ouvrages l’essentiel de toute pensée, de toute science. Seulement leurs textes se sont corrompus et ont été obscurcis par cette « brodure de gloses » dont parle Rabelais. Il faut l’écarter et revenir à la source. Voilà tout.
C’est faute de bien entendre cela qu’on se fait souvent une idée si fausse des rapports de la Renaissance et de la Réforme française, au moins de la première Réforme, avant Calvin. Au début du XVIe siècle, tous les humanistes ou, comme nous dirions, les intellectuels, souhaitaient une réforme de l’Église. C’est d’abord que certains abus ecclésiastiques étaient vraiment par trop choquants pour le bon sens. C’est aussi que l’esprit critique et, en l’espèce, philologique renaissait : on voulait revenir aux sources, aux textes sacrés, à la Bible, et faire disparaître cet amas de commentaires, philosophiques plus ou moins, dont on les avait obscurcis de siècle en siècle. Au début la Réforme n’est guère qu’un état d’esprit. Puis de 1536 à 1550 l’influence de Calvin s’établit, triomphe et la Réforme change de caractère. Le libre examen, l’esprit critique était son principe : l’homme de Genève brise avec tout cela et établit un dogme : en somme, Michel Servet fut par lui brûlé en tant que schismatique. Les gens qui avaient gardé, comme Rabelais, l’esprit de la première Réforme ne sont plus aux yeux de Calvin que des « libertins » (le mot est de l’époque), les plus haïssables des hommes.
On peut donc dire, en gros, que pour les intellectuels de la Renaissance toutes les sciences se résument en une science qui n’a pas encore son nom : la philologie. En effet, puisque l’essentiel s’en trouve dans les livres des anciens, il n’est que de déchiffrer ceux-ci. Ce n’est pas facile : les manuscrits qu’on possède sont corrompus, défigurés par les interprétations, les commentaires, les développements ; il faut mettre au jour les bonnes copies, corriger les mauvaises leçons, établir des textes purs. Mais pour cela il faut connaître pleinement les langues antiques, rompre avec le latin du Moyen Âge, revenir au latin pur ; il faut apprendre le grec, et que de difficultés à cela, sans grammaires, sans dictionnaires, ou peu s’en faut ! Songez que si peu de gens le savent encore ! D’ailleurs, il est si suspect à l’Église que Rabelais a dû quitter son couvent de cordeliers parce qu’il l’étudiait, et qu’environ le temps où Nostradamus séjourne à Bordeaux, une simple lettre en grec (signée d’Érasme, il est vrai) suffira à faire arrêter et emprisonner par le Parlement de Toulouse un personnage illustre et fort bien en cour comme l’évêque de Rieux, Jean de Pins, excellent prêtre et ancien ambassadeur du roi.
La médecine, comme le reste, n’est qu’une branche des litteræ humaniores. L’observation directe, en effet, n’y a encore qu’un rôle infime. On étudie la physique, la physiologie, l’anatomie en étudiant Aristote ; en étudiant Pline et Théophraste, on étudie l’histoire naturelle ; c’est dans Hippocrate, Galien et autres qu’on apprend la médecine. Car connaître les ouvrages des anciens, c’est la connaître. Voilà pourquoi tous les humanistes sont compétents en médecine et au point que beaucoup prennent leur doctorat. Jusqu’au XVe siècle, la médecine arabe avait régné absolument à Montpellier, et au temps de Nostradamus la moitié des cours, ou peu s’en faut, se faisait encore sur Avicenne ; mais tous les « jeunes », comme nous dirions, l’attaquaient et reprochaient aux Arabes, en général, d’avoir corrompu les préceptes des anciens : là, comme ailleurs, la Renaissance voulait revenir aux sources. En tout cas, il n’était personne pour qui une référence à un manuscrit grec bien écrit n’eût infiniment plus de poids que les enseignements de l’expérience ; « l’autorité » restait le souverain critérium. Au début du XVIIe