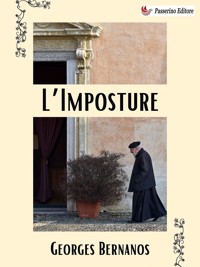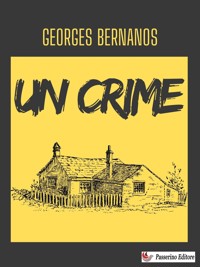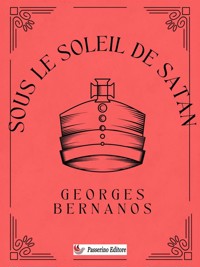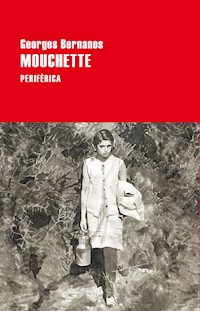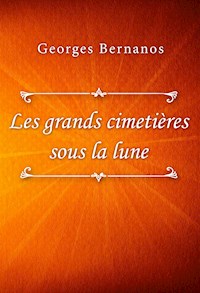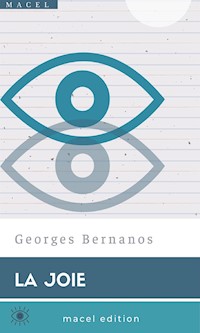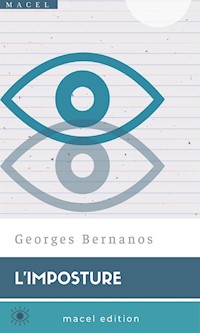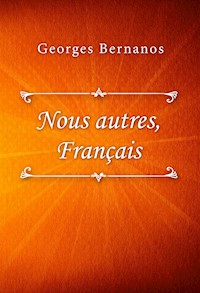
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Classica Libris
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Sous le titre Nous autres, Fran çais sont réunis des pamphlets de Georges Bernanos écrits en 1938 et 1939.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Copyright
First published in 1939
Copyright © 2021 Classica Libris
PARTIE I
Septembre 1938.
Il y a quelque part dans le monde, je le sais, à l’heure où j’écris ces lignes, un jeune Français qui se demande : « Mon pays vaut-il la peine d’être sauvé ? A quoi bon ? »
* * * * *
Dieu me garde de lui répondre ! Car en ce moment même, à des milliers de milles, de l’autre côté de la terre, je me pose la même question. Je me la suis toujours posée. C’est parce que je me la pose que je suis français. Lorsque je ne me la poserai plus, je serai mort. J’aurai bien mérité ce repos.
* * * * *
Il n’y a aucun orgueil à être français, mais beaucoup de peine et de travail, un grand labeur. Quand le soir tombe, la journée faite, le cœur nous manque pour aller danser autour du feu sacré, comme des nègres, en évoquant le Grand Esprit totalitaire, au roulement de mille tambours. La communion avec la force obscure de la Race, que voulez-vous, c’est très joli, mais nous savons trop bien comment finissent ces sortes de messes. Car si les pauvres hommes disposent d’un grand nombre de moyens pour atteindre au paroxysme nerveux, il n’y a qu’une sorte de spasme pour les détendre, rien qu’un, ce n’est pas beaucoup. Tôt ou tard, nous retrouverons ces gens-là couchés dans le sang et la boue, ronflant pêle-mêle, avec les oriflammes et les guirlandes. Au pis aller, nous préférons nous saouler chacun chez nous, avec du vrai vin.
* * * * *
Il n’y a pas d’orgueil à être français. Nous sommes toujours une chrétienté en marche, nous sommes une chrétienté en travail. L’orgueil est le vice de ceux qui se croient arrivés. Nous ne sommes que trop tentés de douter que nous soyons jamais partis. La vie est à la fois si simple et si compliquée, si facile et si difficile. Tant mieux pour le gaillard de grande imagination et de petit esprit, tant mieux pour les échauffés qui s’en font un dieu et l’adorent. L’eau est trop précieuse et le temps aussi, nous ne nous chargerons pas de les éteindre. Qu’ils fument ensemble vers le ciel indulgent, jusqu’à la prochaine averse ! Nous ne voulons connaître que la vie quotidienne et elle nous est aussi familière que les bons arbres de nos champs et les autres animaux domestiques. Elle a été la compagne de notre jeunesse et nous avons fait ensemble nos folies. Ensemble nous vieillirons côte à côte. Et nous la regarderons en mourant, la vieille Mère pensive, nous prendrons honnêtement sa main, pour tâcher de rester tranquilles jusqu’au bout, afin de ne pas troubler le travail d’autrui. Sa main, pleine des secrets de la terre, sa main pécheresse qui n’en finit pas d’expier, depuis le commencement du monde. C’est cette main dure que le Christ a tenue dans les siennes, c’est au creux de cette paume usée qu’il a béni la peine et la joie des hommes, leur patience, leur espérance, leur faim et leur soif de chaque jour, le pain et le vin. Nous ne rougissons pas d’elle, nous ne demandons pas mieux que de l’honorer. Mais il ne faut pas qu’elle nous en fasse accroire, elle n’en sait guère plus long que nous, elle n’est pas meilleure que nous. Elle a la tête plus dure que la nôtre, elle nous fait payer très cher une expérience de qualité douteuse, dont nous ne tirons qu’un petit profit et qui se gâte en vieillissant, comme le mauvais grain. Si nous prétendions lui donner ce qu’elle exige de gratitude, nous n’en finirions pas, elle se moquerait de nous. Elle est cruelle, orgueilleuse, capable de gaspiller en une heure le travail de cent journées. On nous accuse volontiers d’avarice, mais nous sommes moins avares qu’elle n’est prodigue, sa prodigalité nous écœure. Tant pis pour ceux qui trouvent en cette prodigalité monstrueuse un sujet d’exaltation ! Ils la croient pure, alors qu’elle porte en elle le principe de toutes les souillures. Tant pis pour ceux qui la méprisent ! Elle a le secret de toutes les expiations.
Nous ne sommes ni des Allemands, ni des Espagnols, nous ne nous sentons pas plus à l’aise dans la forêt germanique que dans un cimetière castillan brûlé de soleil, hanté d’hommes noirs et tristes, qui sentent le jasmin et le cadavre. Nous aimons mieux être chez nous, dans nos maisons. Chez nous la vie montre son vrai visage, son visage d’aïeule qui rassure nos enfants. Nous la retrouvons à l’aube telle que nous l’avons laissée la veille. Qu’elle aille danser sur la plage, au clair de lune, ou plus loin encore, vers ces villes furieuses, éclatantes, qui s’appellent et rugissent entre elles, toute la nuit, comme des bêtes, nous n’en avons pas de souci. Que dire à cette pécheresse, nous, pécheurs ? Nous faisons semblant de ne pas voir son regard creux, ses lèvres mordues et le peu de fard qui reste à sa joue. Que nous importe! Il y a du travail assez jusqu’au soir pour racheter les fautes de la nuit. Lorsqu’elle se tait, nous ne troublons pas son silence. Lorsqu’elle parle, nous voulons que ce soit dans notre langage, avec des mots éprouvés, des mots dont nous sommes sûrs, aussi sûrs que de nos outils. Car elle a du miel sous la langue, et tout à coup ce miel devient je ne sais quoi, qui tombe sur nos cœurs comme du feu. Nous ne discuterons pas avec elle. Pourquoi? Comment? Et après? Voilà les formules qu’il faut, et avant que d’être dans la bouche de nos garçons et de nos filles, elles sont déjà dans leurs yeux clairs. Nous posons ces questions à la vie, non dans l’espoir qu’elle y réponde, mais parce que la dignité de l’homme est de les poser. Dieu lui-même se les pose, Il les pose, et y répond d’un même acte, et c’est ainsi que nous nous imaginons la création.
Les peuples fanatiques, au foie engorgé, nous accusent de nier le mystère. Nous ne nions pas le mystère, nous désirons seulement faire la distinction du mystère et du mystérieux, du vrai mystère et de l’inconnaissable ou de l’indéterminé. Nous croyons que c’est un grand malheur de prétendre s’approcher de Dieu non par désir de la lumière, mais par goût de l’obscur, car la Nuit est toujours plus ou moins complice de la part honteuse de nous-mêmes : après tout, ce sont les vierges folles qui laissent éteindre leur lampes. Pourquoi ? Comment ? Et après ? Ce sont des mots que la vie ne prononce jamais, nous les prononçons pour cela. Et s’ils sont effroyables dans la bouche d’un sot, c’est qu’ils témoignent effroyablement de l’incompréhensible, de la surnaturelle dignité des sots en face de la vie. Le sot qui délibère et juge peut encore attendrir les Anges, il déraisonne dans la pitié de Dieu, comme un petit enfant se soulage dans ses langes. Au lieu que la brute cynique, en extase, qui ahane et se travaille pour entrer dans le grand Tout, consterne la terre et le ciel. Car nous croyons, nous autres, nous autres Français, que la vie est faite pour l’homme et non pas l’homme pour la vie.
* * * * *
Il n’y a pas d’orgueil à être français. Nous savons trop ce qui nous reste à faire, que nous ne ferons peut-être jamais, qui n’est même pas commencé. Ou plutôt nous savons que tout est toujours à refaire et toujours à recommencer. Nous avons été élevés par de trop bonnes mères, trop patientes, trop courageuses, si dures à la besognes, si dures et si douces, avec leurs tendres cœurs vaillants, inflexibles. « On n’en a jamais fini ! » disaient-elles. C’est bien vrai qu’on n’en a jamais fini. Quand les jours sont trop courts pour le travail de tous les jours, il n’y a pas de quoi être fiers ! Pour elles comme pour nous, le mot d’ordre est un mot simple, un mot de la semaine, ce n’est pas un mot du dimanche. Il n’exalte pas l’imagination, ni ne nous apparaît comme un dieu, descendu des cieux sur la terre, qu’on célèbre par des rassemblements et des chansons. Nous sentons ce mot-là dans nos bras, dans nos épaules, ainsi que la fatigue accumulée des ancêtres, leur sainte patience. La mauvaise herbe repousse à mesure, et si l’homme s’arrêtait une fois dans sa tâche, elle recouvrirait tout. Nous ne haïssons pas la mauvaise herbe, nous ne rêvons pas de l’exterminer. Il nous suffit de la distinguer de la bonne, et c’est un grand plaisir de la regarder avant de prendre la bêche, en crachant dans ses mains. Comme me le disait un jour une vieille paysanne rouée de coups par un compagnon ivrogne et paresseux : « Que voulez-vous, Monsieur, il faut de tout pour faire un monde. » Il faut de tout, même des imbéciles et des paresseux, même des prodigues. Nous regardons ces gens-là dans les yeux, comme des phénomènes et ils nous donnent plutôt envie de travailler. L’ordre n’est pas qu’ils disparaissent, mais que ce qui doit être fait, soit fait, malgré eux. Ils ne représentent, en somme, qu’une faible part, une part presque négligeable des forces hostiles qui détruisent à mesure l’effort de nos bras, vent, pluie, grêle, gelées. Nous ne permettrons pas que les Réformateurs du monde, les Nouveaux Maîtres, entreprennent de les exterminer, par les méthodes rationnelles de la chirurgie sociale : « Qui ne travaille pas n’a pas le droit de manger. » C’est là un axiome fait pour nous, à notre usage, pour la satisfaction de nos consciences. Sitôt dit, nous n’y pensons plus. Nous honorons trop le travail, nous savons qu’un travail qui n’est plus librement accompli est un travail déshonoré. Au fond, nous ne demandons pas mieux que les parasites vivent à nos dépens, il suffirait qu’ils nous disent merci, s’asseoient au bout de la table, en silence. Mais nous ne pouvons absolument pas admettre qu’ils se croient meilleurs que nous, car une telle prétention est contraire à la justice. Bref, nous admettrons tout ce qu’on voudra, sauf qu’il y ait de l’honneur à ne rien foutre. C’est déjà trop que l’homme français, brusquement arraché jadis à la tradition millénaire des hiérarchies de la profession ou de la naissance, ait dû subir plus d’un siècle, au nom de la science et du progrès, l’apothéose d’un type social présentement anéanti, plus démodé aujourd’hui que celui du seigneur féodal, le Rentier-roi, le Rentier-prêtre, le Rentier-dieu.
* * * * *
Il n’y a pas d’orgueil à être français. Nous tirons vanité de beaucoup de choses auxquelles nous ne tenons nullement, et dont le seul avantage est de déconcerter les imbéciles et surtout d’affliger les hypocrites, car le Pharisien semble bien la seule espèce d’êtres vivants que nous puissions réellement haïr. L’hypocrisie ne blesse pas seulement nos consciences. Elle agit puissamment sur nos nerfs, parce qu’elle provoque en nous le mépris, alors que nous étouffons dans le mépris, que le mépris nous intoxique. Nous ne sommes pas une race méprisante. Le mépris nous donne la jaunisse. Or, l’orgueil n’est qu’une forme de l’hypocrisie, ou plutôt c’est l’hypocrisie généralisée, comme le cancer, l’absorption par le mensonge des plus hautes facultés de l’homme, le jugement et la volonté. Les peuples qui se proclament vertueux ne sont encore qu’au premier stade de l’hypocrisie. L’hypocrisie de la grandeur témoigne d’une espèce d’endurcissement à quoi sans doute, il n’est pas de remède. C’est en ce sens que les nations totalitaires nous inspirent un sentiment complexe qui nous paralyse et qu’elles prennent pour la terreur. Elles devraient nous faire rire et nous ne pouvons plus rire, parce que nous y reconnaissons une sorte de grandeur funèbre. Ce n’est pas assez dire qu’elles sont inhumaines. Elles sont démesurées, sans mesure, énormes pour la minuscule part d’humanité qu’elles contiennent et qui va se diminuant chaque jour. Devrons-nous demain faire face à des hommes ou à des insectes géants? Nos pères de la guerre de Cent ans se laissaient jadis impressionner par le terrible « Hurrah ! » des Anglais, qu’ils nommaient d’ailleurs Godons. A ce cri formidable, trois fois répété, scandé par mille poitrines, les pauvres gens, habitués à se battre comme on fait l’amour, deux par deux, front à front, se demandaient si ces diables tenaient ensemble, ne formaient pas qu’une seule bête... Et puis l’Ange de la France, la sage petite bergère du pays de Greux, si « bonne à voir et à entendre », avec sa huque de drap d’or sur son armure blanche, et son regard sans peur, est entrée là-dedans la première. Elle ne se souciait pas plus de ces « hurrah » ! que d’une mira belle. La France sera toujours sauvée par les enfants.
* * * * *
Il n’y a pas d’orgueil à être français. Au fond de tout orgueil, il y a ce vieux levain d’idolâtrie. Nous ne sommes pas un peuple d’idolâtres. Nous sommes le moins idolâtre de tous les peuples. C’est d’ailleurs pourquoi les idolâtres nous accusent de n’être pas un peuple religieux. Nous ne sommes nullement tentés de diviniser quoi que ce soit. Nous sommes le seul peuple qui en plein délire homicide ait dressé non contre Dieu, mais contre lui-même, ainsi qu’un tragique témoignage de sa folie, un autel à la Raison Universelle. Diviniser la raison n’est peut-être pas un acte d’idolâtrie. Mieux vaut diviniser la Raison que la Nature, ou la Race ; mieux vaut diviniser la Raison que se diviniser soi-même. Nous ne sommes pas un peuple orgueilleux. Nous ne désirons pas d’être craints. La crainte des autres ne nous inspire ni sécurité ni fierté. A toute minute, la crainte peut s’enflammer ainsi que le courage et devenir sous le nom de panique, plus folle que la plus folle témérité. La crainte des autres empoisonnerait notre air et notre pain. Les peuples qui se réconfortent de la terreur qu’ils inspirent nous paraissent travaillés des mêmes démons de la peur. Ils ressemblent à ces vieilles filles qui par zèle pour la vertu, ont toujours le nez dans les draps ou le panier à linge.
* * * * *
Les deux plus puissants ressorts de la grandeur impériale ont été l’avarice et la peur. Chaque nation conquise ajoutant une crainte de plus aux autres craintes, exaltait le réflexe de défense jusqu’à ce que l’immense corps pourri, la moelle fondue, rendît par tous les orifices le sang et l’or. Les petites tantes nationales, qui excitent à travers tant de siècles, la puanteur musquée de ces hommes velus, voudront me convaincre d’injustice envers l’histoire romaine. C’est le signe d’une grande pauvreté d’esprit de prétendre que la puissance d’un peuple se fonde sur les vertus qui font la noblesse de l’homme. La puissance de l’Empire ne réhabilite pas l’homme romain. Que la distraction nationale d’un peuple héritier — quoique indigne — de la plus humaine des civilisations — ait été le cirque avec ses fastes sauvages, il y a là cependant de quoi faire réfléchir même les cuistres. Personne ne songerait à nier que l’étude des sports britanniques n’apporte aux historiens de l’avenir quelque lumière sur la psychologie de l’Anglo-Saxon. Qu’un citoyen d’ailleurs étranger à toute pratique désintéressée d’un sport quelconque, partageant d’ordinaire ses loisirs entre la table et l’étuve ait été le plus souvent possible s’asseoir sur les bancs du cirque et se distraire à toutes ces saloperies, il m’importe peu qu’il ait construit des ponts, des routes, des aqueducs, nous savons qu’il est un porc. L’idée d’enfermer une jeune fille dans un filet pour la voir plus commodément éventrer par un taureau ne peut absolument sortir que de méninges en bouillie.
Je ne parle nullement ainsi pour affliger les professeurs d’humanités, mais parce que l’Empire m’apparaît, précisément comme à eux, ainsi que le type achevé d’un certain ordre de grandeur temporelle. Les dieux d’aujourd’hui ne feront pas mieux, ni de demain. Il n’est inutile d’affirmer qu’un tel ordre de grandeur, en dépit de la propagande scolaire, n’inspire aucun respect aux jeunes Français. L’histoire romaine assomme les jeunes Français. Parmi les livres innombrables écrits pour l’amusement ou l’exaltation des jeunes Français, il n’en est pas un seul à retracer les aventures des fils de Romulus. Ce fait peut rester ignoré parce que la plupart des tâcherons de lettres qui passent pour exprimer, aux yeux de l’étranger, l’opinion nationale, sont d’anciens « forts en thème », fiers de leur qualité de « secondaires ». Pauvres diables ! On ne trouverait pas un petit Français sur cent, sur mille qui n’ait fait des vœux pour Annibal et l’éléphant Gétule, pris du contrepoison avec Mithridate, pouffé de rire avec les Gaulois, au nez des sénateurs chauves. Le nom de Rome évoque instantanément la silhouette obèse de Néron, les cuisses épilées d’Héliogabale ou le cheval de Caligula. Ce parti pris n’est pas si absurde qu’on pense. Un petit Français bien né va d’instinct non pas aux institutions, mais à l’homme, juge une civilisation par l’homme qu’elle a formé. Il ne supporte pas dans celle-ci la disproportion du mérite au prestige. Que ce petit Français soit capable ou non d’exprimer un tel jugement — qui n’est d’ailleurs pas le sien, mais celui de ses aïeux, une sorte de réflexe héréditaire — qu’importe ? Qu’importe s’il ignore la distinction essentielle entre la puissance et la gloire pourvu qu’il se défie de l’une et souhaite l’autre, de toutes les forces de son cœur ?
* * * * *
Il n’y a pas d’orgueil à être français. Nous aimons trop la gloire. Faute de gloire, nous nous contentons très bien, hélas ! d’une vie tranquille et douce éclairée par la sympathie, comme nos paysages par un ciel délicat, rayé du tendre argent de l’averse. « Les Français aiment la gloire » disait Bonaparte, et il n’est pas sûr que ce Corse de sang génois, encore plus politique que soldat, ait donné à ce mot de gloire le même sens que ses grenadiers. Comme tous ceux de sa race, il méprisait les hommes. Qui méprise les hommes ne saurait aimer la gloire, car c’est d’eux que nous la tenons, et elle vaut ce qu’ils valent, après tout. Il n’est pas de gloire sans admiration, pas de véritable admiration sans amour, ni d’amour sans liberté. Cette forme de grandeur qu’on dit impériale n’a besoin ni d’admiration ni d’amour. Nous n’avons jamais été, nous ne serons jamais, grâce à Dieu, un peuple impérial. Lorsqu’il écrit ces choses, apparemment si banales, un Français peut poser la plume, se recueillir un moment, en silence. On voudrait traduire sa rêverie par quelques phrases un peu triviales car c’est ainsi que nous avons coutume d’exprimer entre nous ce qui doit rester impénétrable aux indifférents ou aux étrangers. L’idée que nous formons de la gloire, si nous réussissions par impossible à l’enfermer dans une de ces définitions logiques dont nous ne sommes que trop prodigues, nous justifierait devant tous, ferait connaître à tous avec le secret de notre vocation temporelle, celui des desseins de Dieu sur notre nation. Mais un Français n’aime pas prononcer le nom de gloire sans sourire, il l’engage trop gravement, lui rappelle d’une manière trop pressante le devoir qui nous incombe et pour quoi nous sommes nés. Il préfère parler d’elle comme de l’amour, avec cette grimace hélas ! un peu canaille, qui déconcerte les pharisiens. Quand nous disons gloire, l’étranger parvenu, le manant couronné, l’esclave armé jusqu’aux dents, traduisent instantanément : Puissance. Richesse, Domination. Aussitôt les hommes pieux, nous invitent à mépriser ces vanités. Que répondre ? Nous savons bien que la gloire à laquelle nous pensons n’est ni vanité, ni mensonge. Nous le savons, mais cette conviction n’est malheureusement pas de celles qu’un Français quelconque puisse justifier en face des théologiens, des moralistes, des politiques ou des philosophes. Dès qu’il évoque ce mot sacré, il est dans le sanctuaire de sa race, à l’abri sous les vastes voûtes et ses pieds de brave homme foulent — parfois, hélas ! à son insu — les dalles de pierre qui protègent ses morts. Il se trouve bien là-dedans, il est chez lui, soit, mais il s’ennuie un peu, il tourne sa casquette entre ses doigts, il a honte de montrer ces vieilles pierres aux étrangers qui construisent des bâtiments, si modernes, si confortables... Non ! Ah ! non, non certainement, il n’y a pas d’orgueil à être français.
Nous tenons au passé par des liens plus forts et plus étroits que ceux d’aucune autre nation, mais ils restent pour nous invisibles. Les nations conservatrices se croient plus fidèles que nous parce qu’elles se passent de génération en génération, ainsi que des curiosités respectables, des bibelots de famille, la perruque du lord- maire ou celle du bourgmestre, des traditions que nul ne discute. A quoi bon les discuter ? En quoi gênent-elles ? Il est vrai que nous n’avons pas ce sens du passé qui d’ailleurs se confond en Angleterre avec le sens de l’humour. Nous ne sommes pas portés à croire que nous nous concilierons les morts, par ces sortes d’égards dont les gens du monde, entre eux, sont prodigues, ni par des familiarités. Nous ne nous jugeons pas quittes envers le passé parce que nous le traitons de « bon vieux temps », avec une indulgence protectrice. Si nous le diffamons parfois, c’est à la manière qu’un chrétien blasphème. Ce passé ressemble trop à notre propre conscience, il est notre conscience même.
Par la grâce de Dieu, les révolutions successives et l’effort des politiciens ont fait bon gré, mal gré, de notre patriotisme une religion sans rites, un culte dépouillé, où la part de l’habitude est réduite à l’extrême. Il y a un honneur français, nous le savons ; mais il n’informe plus les institutions ni les lois, il n’a plus d’établissement temporel, nous gardons sa tradition en nous-mêmes moins pour en pratiquer toujours les règles que pour en tirer la plupart de nos propos sur les hommes, car il est comme la mesure de notre jugement moral. Nous ne nous flattons pas de valoir ce qu’il vaut, nous ne l’invoquons pas volontiers contre autrui. C’est un trait bien remarquable de notre psychologie que, conscients de nos différences, nous répugnons à en tenir compte, comme si elles devaient nécessairement témoigner contre nous. Comme nous répétons volontiers par politesse « qu’un homme en vaut un autre » nous disons aussi bien que notre honneur en vaut un autre. C’est pourquoi les journalistes italiens de langue française, qui font la loi dans la presse nationale, peuvent impunément soutenir que les campagnes coloniales ne diffèrent pas entre elles, que la conquête de l’Ethiopie honore autant la nation bâtarde qui l’a faite que la nôtre celle du Congo, par le cher Savorgnan de Brazza, seulement armé de sa trousse médicale, ou la pacification du Maroc, par Lyautey, le dernier des seigneurs français.
Aussi les moralistes et les bigots ont beau jeu quand ils nous prêchent le détachement de la gloire. Qu’ont-ils à faire avec notre gloire, imbéciles ! « Que sert à l’homme de gagner l’univers s’il vient à perdre son âme. » On a beau se dire que tous les chemins sont bons qui mènent à Dieu, il est difficile de ne pas sourire en pensant qu’une telle phrase, incessamment répétée, a pu faire de l’officier de Pampelune, un saint. Qui de nous, farceurs, songe à conquérir l’univers. Quelle drôle de conception de la gloire ! Il n’est que trop facile, sauf la grâce de Dieu, d’imaginer, l’espèce de réception, que le gentilhomme castillan, sec comme un sarment, jaune comme la bile, hanté par la mort et l’enfer, eût faite à Jeanne d’Arc, si la pauvre bergerette fût née assez tard pour lui confier ses projets ambitieux. Délivrer Orléans, mener le dauphin jusqu’à Reims, jeter les godons à la mer, vanité des vanités ! Tenir tête aux docteurs, faire des réponses insolentes à l’Inquisiteur de la Foi, s’en « remettre à Dieu plutôt qu’aux gens d’Eglise », tenir la parole donnée, s’instituer juge de la légitimité des princes, quand le Saint-Siège lui-même se garde de prendre parti, quelle présomption sacrilège ! Cette présomption est la nôtre. Ce n’est pas aux gens d’Eglise qu’a été confié l’honneur français. Si nous avions jamais pensé faire de l’honneur français l’une des vertus théologales, les gens d’Eglise auraient beau jeu contre nous, non sans raison. Mais l’honneur ni la terre française n’ont pas été commis à la garde des gens d’Eglise, notre terre et notre honneur ne font qu’un. A nous ce temporel ; à pleines mains ! Que ce soient là des biens périssables, nous l’accorderons volontiers. Que nous en chaut ? Que nous en chaut qu’ils soient périssables, puisque Dieu nous a faits aussi mortels et qu’il ne dépendra toujours que de nous de mourir avant eux ?
* * * * *
Il n’y a pas d’honneur à être français, nulle gloriole. Et qu’on veuille bien me permettre une fois de le dire, dans le même sens : il n’y a pas non plus d’honneur à être chrétien. Nous n’avons pas choisi. « Je suis chrétien, révérez-moi » s’écrient à l’envi les Princes des Prêtes, les Scribes et les Pharisiens. Il faudrait plutôt dire humblement : « Je suis chrétien, priez pour moi ! » Nous n’avons pas choisi. Lorsqu’on a déjà tant de mal à être français, le moindre retour complaisant vers nous-mêmes, le plus furtif regard jeté sur l’abîme des siècles qui, à notre droite et à notre gauche, nous sépare des aïeux, risque de nous donner le vertige. Quoi ! nous sommes déjà si loin, si seuls ? Ils ne peuvent plus nous entendre, le cri d’angoisse que nous jetterions vers eux, serait à l’instant pris sur nos lèvres, englouti. Eh bien ! ne crions pas, serrons les dents. Gardons-nous de mesurer la largeur de la route. Ce que nous tentons aujourd’hui, d’autres le firent, en leur temps, en leur lieu, et ils n’en savaient pas plus long que nous. Qu’une nation naisse et demeure, ce n’est qu’un miracle de Dieu, un doux miracle. Nous sommes dans cette grande aventure, parce que Dieu nous y a mis. Au fond de nos cœurs, nous aurions probablement préféré qu’on nous laissât tranquilles, qu’on ne nous parlât jamais, un jour de notre enfance, un jour entre les jours, un jour comme les autres, alors que nous attendions confusément on ne sait quel prodige, une voix si simple, d’un accent si humble, si quotidien, avec l’accent de notre province natale, une voix à peine distincte des autres voix familières, qui nous disait : « Tu es français. Et maintenant marche, mon bonhomme, va de l’avant, ne t’arrête pas. Je t’expliquerai après. Tu me retrouveras à l’heure de la mort. Et à ce moment-là, regarde-moi bien en face : je ne te faillirai pas, mon garçon... »
PARTIE II
Il y a quelques semaines je partais pour le Paraguay, ce Paraguay que notre dictionnaire Larousse, d’accord avec le Bottin, qualifie de Paradis Terrestre. Je n’ai pas trouvé là-bas le Paradis Terrestre, mais je sens bien que je n’ai pas fini de le chercher, que je le chercherai toujours, que je chercherai toujours cette route perdue, effacée de la mémoire des hommes. J’appartiens probablement de naissance à ce peuple de l’attente, à la race qui ne désespère jamais, pour laquelle le désespoir est un mot vide de sens, analogue à celui de néant. Et c’est nous qui avons raison ! Lorsque j’avais dix ans, des Messieurs très sages et généralement décorés, éprouvaient le besoin de me souffler à la figure l’odeur de leur cigare en feignant de s’attendrir sur les charmantes illusions de l’enfance. Hé bien ! le temps est venu pour moi de m’attendrir sur les leurs. Je vois le monde qu’ils ont fait, j’y ai vécu, j’y vis encore et la seule disgrâce à laquelle je ne me résigne pas est d’y mourir. Mais il mourra peut-être avant moi.
* * * * *
De telles paroles, lorsqu’on les comprend mal, me font souvent passer pour un révolté. Or je ne suis nullement un révolté. Je crois fermement que dans sa vie privée comme dans sa vie publique, un homme digne de ce nom doit d’abord accepter honnêtement, virilement, les conditions particulières qui lui sont imposées par son milieu et par son temps. Le simple catéchisme auquel il faut toujours revenir dès qu’on veut rentrer dans le bon sens, échapper aux doctrinaires de l’un ou l’autre bord, aux Bêtes à Morale et aux Bêtes à Statistique, nous enseigne qu’un chrétien doit, n’importe où Dieu l’ait placé, « faire son salut ». Faire son salut, se sauver. Il y aura toujours, hélas, un certain nombre de chrétiens pour donner à cette expression le sens de « sauve qui peut !» — « Tirons-nous de là comme nous pourrons ! » Mais un chrétien ne se sauve pas seul, il ne se sauve qu’en sauvant les autres. J’ai connu un vieux militaire retraité, tombé dans la dévotion comme un vieux bourdon d’arrière-saison dans un pot de miel. Venu trop tard à la religion pour se résigner facilement aux études élémentaires indispensables, habitué par son ancienne profession à résoudre les problèmes d’un point de vue extrêmement concret, il avait entrepris de noter sur un registre, chaque soir, le total des indulgences gagnées au cours de la journée, trente jours par-ci, cinq cents par-là. Il était arrivé au bout de peu de mois à un total impressionnant, d’autant que son expérience lui permettait de choisir les combinaisons les plus avantageuses, évitant les pertes de temps et dédaignant les petits profits. Par bonheur, il eut l’idée de faire vérifier sa comptabilité par un religieux que je connais bien aussi et qui, après l’avoir doucement sermonné, jeta au feu son livre de comptes.
* * * * *
On va dire encore que, en racontant cette histoire, je fais du tort aux vrais dévots. On disait déjà cela du temps de Molière. Les vrais chrétiens disposent d’un moyen très efficace de se distinguer des autres, ils n’ont qu’à pratiquer la charité, celle du cœur, la seule que Tartuffe ne puisse feindre, car s’il est capable de faire l’aumône, il ne sait pas aimer. Le don de soi-même est un témoignage assez éclatant de la vérité qu’on prétend servir. Et puis quoi ! Mieux vaut que cent dévots passent pour Tartuffes, qu’un seul Tartuffe pour dévot. Car, dans le premier cas, l’erreur ne saurait compromettre que l’honneur de cent chrétiens. Au lieu que l’imposture d’un seul Tartuffe engage l’honneur même du Christ.
* * * * *
Je répète qu’en énonçant des vérités aussi simples, à la portée de n’importe qui, je ne me crois nullement un révolté. Il y a dans l’esprit de révolte un principe de haine ou de mépris pour les hommes. Je crains que le révolté ne soit jamais capable de porter autant d’amour à ceux qu’il aime que de haine à ceux qu’il hait. Les vrais ennemis de la société ne sont pas ceux qu’elle exploite ou tyrannise, ce sont ceux qu’elle humilie. Voilà pourquoi les partis de révolution comptent un si grand nombre de bacheliers sans emploi. Je n’ai aucun sujet d’animosité personnelle contre la société, et si je souhaite qu’elle se réforme ou qu’elle périsse, ce vœu est parfaitement désintéressé. A vrai dire, elle a rempli mon attente, car l’idée ne m’est pas venue de lui demander ce qu’elle ne saurait me donner, l’honneur et le bonheur. Elle dispense les décorations et l’Académie, je ne désire ni les unes ni l’autre. Quant à la fortune, n’en parlons pas : Je suis absolument incapable de m’enrichir sous n’importe quelle espèce de régime. Je crois donc avoir respecté les règles du jeu. J’ai même eu la coquetterie d’élever six enfants à une époque où les pères de famille méritent plus que jamais le titre insolite que leur décernait Péguy, lorsqu’il les appelait « ces grands aventuriers du Monde moderne ». N’est-il pas un peu comique de m’entendre traiter de dangereux perturbateur par de graves personnages comme si je n’avais moi-même rien à défendre ? Ils parlent de cette société comme de leur chose parce qu’ils lui ont donné à garder des monnaies de papier dont la spéculation règle le cours. Et moi, ce que je confie à la société, ou du moins ce que je vois, avec angoisse, se dissiper peu à peu entre ses mains, ce sont des valeurs spirituelles qui n’ont, grâce à Dieu, pas cours au marché des banques mais qui gagent en réalité toutes les autres et sans lesquelles les solennels imbéciles qui me critiquent ne seraient rien.
* * * * *
Ils ont sans cesse le mot d’ordre à la bouche. Quel ordre? Il y a un ordre chrétien. Notre ordre est un ordre de justice. Je prie les incrédules de bien vouloir un moment ne considérer que le principe même de cet ordre, d’oublier les échecs répétés de sa réalisation temporelle. Cet ordre est celui du Christ, et la tradition catholique en a maintenu les définitions essentielles. Quant au soin de sa réalisation temporelle, il n’appartient pas aux théologiens, aux casuistes, aux docteurs, mais à nous chrétiens. Or, la plupart des chrétiens paraissent absolument oublier cette vérité élémentaire. Ils croient que le royaume de Dieu se fera tout seul, pourvu qu’ils obéissent aux règles morales communes d’ailleurs à tous les honnêtes gens, se gardent de travailler le dimanche (si toutefois les affaires n’en souffrent pas trop), assistent le même jour à une messe basse et par-dessus tout respectent les ecclésiastiques, c’est-à-dire obéissent aux conseils de prudence dont les gens d’Eglise sont naturellement prodigues, s’efforcent enfin d’ignorer ou même nient effrontément ce qui pourrait « faire le jeu de l’adversaire ». Autant dire qu’à la guerre une armée répond assez à l’attente de la nation si les hommes en sont bien astiqués, marchent au pas derrière la musique et saluent correctement leurs supérieurs.