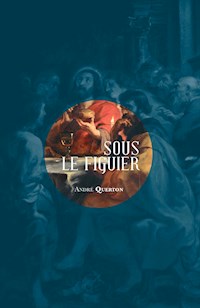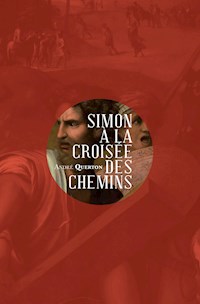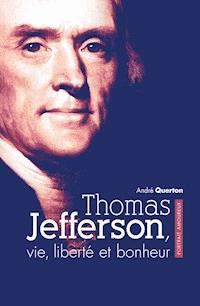Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mardaga
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Trois évangélistes mentionnent qu’une femme lava les pieds de Jésus avec un précieux parfum de grand prix. Deux d’entre eux précisent qu’il s’agissait d’une pécheresse : serait-ce une femme adultère ? Jésus accepte tout naturellement ces marques de respect et d’affection. Est-ce une forme de pardon ? Mais qu’est-ce que le pardon ? Un effacement ? Un cheminement ? La femme adultère que Jésus a sauvée de la lapidation en fera l’expérience. Comment se reconstruire après un faux pas sans reconnaître que l’on a trébuché ? Se pardonner est une épreuve.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 56
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
La confiance qui vient de toi t’as sauvée
Matthieu 9, 22
Pour les évangélistes, les noms particuliers ne comptent pas, mais bien plutôt la structure symbolique.
Benoit XVI
Parfum de vignes
As-tu senti le parfum des feuilles de vigne tandis que tu montais la colline ? N’est-il pas merveilleux ? Malgré le froid des petits matins, je laisse ma fenêtre ouverte toutes les nuits en cette saison ; Shimon, mon mari, n’en est pas trop heureux, je l’avoue, mais me le pardonne avec tendresse.
J’aime ce précieux cadeau de la vigne ; il est comme une soie chatoyante qui recouvre les champs autour de nous, comme la robe légère d’une jeune mariée. Il annonce le renouveau de la terre. Et pourtant, ces fleurs sont si petites.
Mon fils vient de t’apporter une cruche d’eau pour te rafraîchir ; je vous laisse un moment. Il te conduira sur la terrasse où tu pourras te reposer de la route. La tonnelle y laisse passer un peu de soleil. Je fais monter quelques fruits que t’apportera ma fille. Shimon viendra sans doute plus tard te saluer et nous prendrons alors une collation.
Je vois bien ta surprise. Tu t’attendais à rencontrer une très jeune femme avec de beaux et longs cheveux, mais tu sais bien sûr que de nombreuses années ont passé depuis que le Maître est mort. Je suis presque une vieille femme aujourd’hui et ma fille est proche de se marier, mais je crois que Shimon me voit toujours telle que j’étais quand nous nous sommes mariés. Nous vivions alors dans le village que tu as traversé ; nos maisons y étaient voisines et je le connaissais depuis ma petite enfance. Dans notre village, les familles sont très proches et les enfants courent toujours d’une maison à l’autre, s’y sentent partout chez eux. Je crois que nous devons tous être cousins ; seuls les vieux retiennent les liens de sang qui nous unissent et décident alors des mariages permis. Quand j’étais petite fille, je croyais que tous les enfants étaient frères et sœurs et que tous les adultes étaient nos oncles et tantes.
J’aime me souvenir de ce temps et le raconter devant mes enfants ; mon histoire est belle. J’ai toujours été choyée et adorée par mes frères. Très joyeuse, très joueuse : mes parents me reprochaient de trop rire et courir avec les garçons, mais s’en amusaient. J’étais exubérante, toujours active, et j’ai gardé cet enthousiasme même quand je suis devenue femme et que je me suis mariée.
J’étais mariée depuis quelques semaines, l’hiver s’achevait. Je venais d’emménager dans la maison de mes beaux-parents, où vivaient aussi leurs autres enfants ; j’étais d’ailleurs encore à peine plus qu’une enfant. Shimon me disait que j’étais très belle et tu te doutes qu’une jeune fille aime entendre de telles paroles ; il y ajoutait des poèmes très amoureux où il m’appelait « ma sœur, ma fiancée » et chantait mes yeux, mes cheveux, la blancheur de mes dents, ma jeune poitrine qu’il comparait aux faons d’une gazelle ; je ne savais pas qu’il répétait les mots d’un grand poème qu’il avait entendu à la synagogue. J’étais un peu gênée, mais aussi ravie et fière d’attirer tant ses attentions ; ma peau était très mate et sombre, déjà toute brûlée par le soleil. Je lui répondais avec des émotions enjouées ; j’aimais son sourire et ses éclats de rire, son corps toujours bondissant comme celui d’un cabri un peu fou. L’hiver de nos fiançailles nous fut un printemps radieux. Il me semble que nous jouions tout au long du jour et je me sentais débordante de bonheur. Et, je le dis sans rougir, nous dormions bien peu, éblouis d’autres découvertes.
Ce bonheur plein de charme m’a sans doute étourdie. J’aimais Shimon, mais je restais l’amie et la petite sœur de tous. Un jour, un ami de mon mari passa à la maison ; je le connaissais très bien, car il y venait presque toutes les semaines. En le laissant entrer dans la maison, je n’avais pas réalisé que j’y étais seule. Nous rîmes tandis que je lui offrais une galette et il me prit soudain dans ses bras avec fougue. Nous étions comme de petits chiens qui se disputent un morceau de bois, sans penser à rien ni à mal, tout à leurs jeux rieurs.
Et puis je ne sais plus ce qui s’est passé. Une tante entra dans la maison et commença à hurler ; je ne comprenais pas ce qu’elle disait tant elle criait, soudainement hystérique, et les enfants qui l’accompagnaient en firent autant, aussi terrifiés que moi. La tante nous agrippa, toujours vociférant, nous traîna dehors ; l’ami de mon mari lui saisit violemment le bras et parvint à se dégager ; en une seconde, il avait sauté par-dessus le muret, courait dans le champ, deux jeunes chiens à ses trousses, jappant joyeusement. Moi, j’étais tétanisée sous les injures, les malédictions et les grands coups et gifles de la tante en furie. En deux minutes, avec tout ce vacarme strident, plusieurs voisins sortirent de leur cour, les femmes et quelques vieux surtout puisque la plupart des hommes étaient aux champs. Et bien sûr, une horde d’enfants piaillant, hurlant eux aussi. Même les chiens se mirent à aboyer et à montrer les crocs. Tout le monde fit cercle autour de moi et d’autres voisines se joignirent à la tante avec leurs cris et hululements ; elles me frappaient, me jetaient au sol, me relevaient pour me secouer et me refaire trébucher ; plusieurs me griffèrent et elles me tiraient les cheveux. J’étais comme évanouie, même si je restais debout sur mes jambes, mais enfermée en moi-même, incapable de parler, cherchant juste à éviter ces bras qui me frappaient. Un vieillard encore vif arriva enfin et ordonna d’une voix ferme à ces femmes de se calmer ; il crut comprendre ce qui s’était passé et décida qu’il fallait aller chez le rabbin.
Il était veuf depuis peu, assez triste, et sa réputation d’austérité lui valait des amitiés jusqu’à Jérusalem, où il se rendait fréquemment. Il écouta les femmes, qui lentement se calmaient, puis m’interrogea mais j’étais devenue muette et presque idiote de terreur ; j’étais comme morte. Le rabbin, sans vraiment questionner ma tante, prit les choses en main d’un air décidé ; il envoya des gamins chercher les hommes de ma famille, et surtout mon mari, et décida que nous irions tous immédiatement à Jérusalem. Je l’entendais qui parlait de choses très graves, d’adultère, de profanation de la Loi et je ne comprenais pas ce qu’il voulait dire, mais plusieurs vieillards lui donnèrent raison.