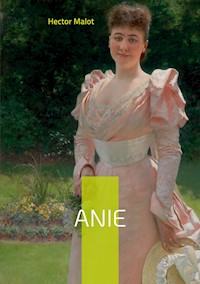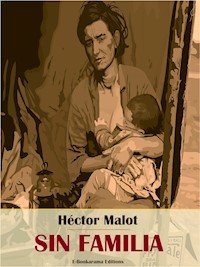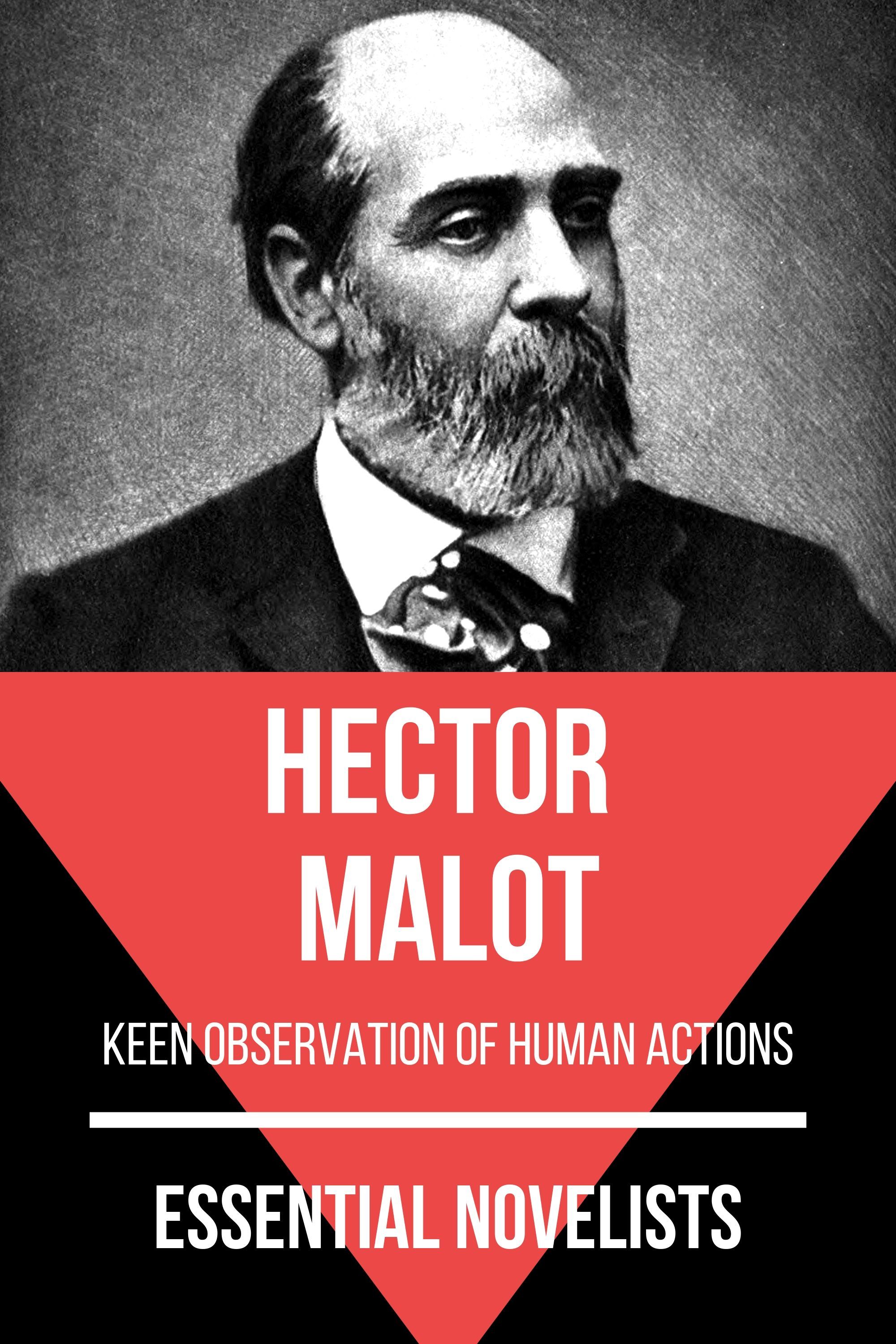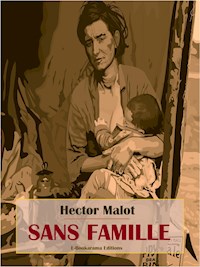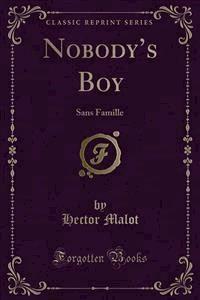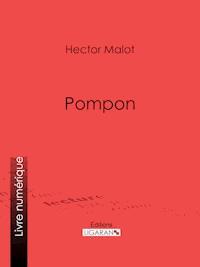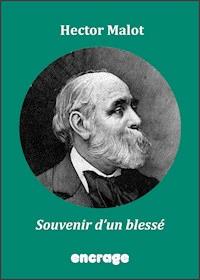
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encrage Édition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Encrage Romans
- Sprache: Französisch
L'un des tout premiers romans de guerre publiés à l’issue du conflit franco-prussien de 1870
Le 3 novembre 1870, Hector Malot note le projet d’un roman à faire :
Le voyage en France est en ce moment lugubre ; dans les gares et en wagon on ne rencontre que des blessés qui sortis des hôpitaux retournent à leur pays : jambes coupées, bras amputés, balafres au visage. Et tous ces éclopés jeunes et vaillants. Que vont-ils faire dans la misère où nous entrons. Comment vont les accueillir celles qui les aimaient. Il y a là un roman à faire : le Blessé, volontaire par amour revenant estropié après avoir vu tout ce qu’il y a de caractéristique dans cette guerre, et remercié par celle qu’il aime.
Ecrit dans sa maison de Fontenay-sous-Bois encore occupée par l’ennemi,
Souvenirs d’un blessé paraît dès novembre 1871.
Découvrez les oeuvres d'Hector Malot, publiées par Encrage Edition. Des romans réalistes et sociaux pour plonger au coeur du 19e siècle
EXTRAIT
Mon nom est Goscelin, ou plus justement pour être exact, Louis Goscelin d’Arondel, car s’il faut en croire la tradition, je descends des Goscelin d’Arondel qui accompagnaient Guillaume le Bâtard dans la conquête de l’Angleterre, et qui ont encore aujourd’hui des représentants à la Chambre des lords.
Malgré cette noble origine, mon père consentit à donner son nom à une bourgeoise, fille d’un simple fabricant de papiers à Courtigis, sur les bords de l’Eure ; il est vrai que la bourgeoise était riche, tandis que le gentilhomme était pauvre.
A PROPOS DE L'AUTEUR
Hector Malot, né à la Bouille (près de Rouen), le 20 mai 1830, mort à Fontenay-sous-Bois, le 17 juillet 1907, devint, après des études de droit et des emplois de clerc de notaire puis de journaliste, l’auteur d’environ soixante-dix romans de veine réaliste, dans lesquels il offre un panorama fidèle de tous les milieux de la société de son siècle.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 647
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Œuvres d’Hector Malot - 2
collection dirigée par Francis Marcoin
Hector Malot
Souvenirs d’un blessé
1871
Encrageédition
© 2012
ISBN 978-2-36058-935-7
Préface
de Christa Delahaye
« Ceux qui voudraient étudier l’histoire intime de notre époque devraient l’étudier dans son œuvre [celle de Malot] ». — Théodore de Banville 1
Publié en feuilleton dans le journalLe Tempsdès novembre 1871,Souvenirs d’un blesséest un des tout premiers romans de guerre qui paraissent à l’issue du conflit franco-prussien de 1870. Durant la période qui s’étend de 1872, année de parution du recueil de poèmesL’Année terriblede Victor Hugo, à 1892, qui voit la publication deLa Débâclede Zola, nombreux sont les écrivains de la « génération 1870 » — comme ils ont été souvent désignés — qui cherchent à rendre compte du traumatisme de la guerre et de la défaite. Maupassant est de ceux-là, qui a vingt ans lors de la déclaration du conflit et qui ne publiera pas moins d’une vingtaine de nouvelles de guerre 2. Mais on peut citer aussi Alphonse Daudet, J.-K. Huysmans, Henri Céard, Léon Hennique, Paul Alexis, et à la suite de Claude Digeon 3, George Sand, Théophile Gautier, Alexandre Dumas fils, Juliette Lambert, Francisque Sarcey, Ludovic Halévy, Vincent d’Indy, Camille Lemonnier 4qui, tous, ont contribué à nourrir la bibliothèque de la guerre franco-prussienne. Mais, par leur focalisation souvent réduite à la volonté « de cacher la défaite sous de petites victoires 5 », aucun de ces récits n’a l’envergure de celui de Malot qui cherche à donner une chronique des hostilités dans leur totalité et dans leur vérité 6.
Malot a quarante ans à la déclaration de la guerre. Il vit des jours heureux à Fontenay-sous-Bois auprès de sa femme Anna et de leur fille Lucie, âgée de deux ans. Après avoir travaillé pendant cinq années dans des rédactions parisiennes, il a fui l’agitation de la capitale pour se consacrer entièrement à l’écriture de son œuvre. Mais, dès septembre, « voyant sa maison placée sous les feux du fort de Nogent, Fontenay-sous-Bois déserté 7 » et alors qu’Anna a épousé un Allemand en premières noces et que le fils né de ce premier mariage, s’est engagé dans l’armée prussienne, Malot « choisit, à contre cœur […] d’emmener femme et enfant en Suisse. Le statut d’Anna nécessite cette sécurité. En France, elle pourrait être accusée d’avoir des affinités avec l’ennemi […], comme du côté allemand on peut, à l’inverse, lui reprocher ce mariage avec un Français8 ».
En novembre 1870, Malot revient à Tours, siège du gouvernement de la Défense Nationale de Gambetta, où officient ses amis Jules Simon, Jules Ferry… Il pense s’engager dans la garde nationale ; il propose ses services, ne reçoit aucune réponse. Partout il ne voit que désordre et contradiction. Que fait Gambetta ? Que cherche-t-il à faire ? Dès ce moment, Malot critique sévèrement le gouvernement provisoire : « Au reste nous n’avons que ce que nous méritons puisqu’après la dictature de Napoléon, nous subissons celle de Gambetta. Il serait injuste de ne pas reconnaître que celui-ci n’est pas celui-là. Dans la situation où nous étions il a eu la force, la grande force de ne pas désespérer, ce qui est beaucoup ; et de cela il faut lui savoir gré. Le malheur est qu’avec de l’audace et de l’enthousiasme il ne s’est pas trouvé en lui le sens politique». Aussi Malot renonce-t-il à son projet.
Dès le début des combats, Malot doute des chances de la France. Cette lucidité extraordinaire, finalement assez inconcevable au moment où le pays entier croit en une guerre éclair, Malot la doit tout d’abord à un déplacement en Allemagne effectué quelques années plus tôt, en 1866. A cette occasion, il a pu constater « la remarquable organisation militaire prussienne ». L’armée allemande est non seulement bien supérieure en nombre à celle de la France, mais elle est surtout mieux préparée et mieux encadrée. De plus, Malot est très critique envers Napoléon III : « L’Empire qui a tout désorganisé chez nous ne doit pas avoir amélioré l’armée, tout se tient en décadence comme en pourriture ; peut-être en est-il de notre armée comme de tout et n’a-t-elle que l’apparence, une surface, un vernis. Alors où allons-nous ? »
Et après Sedan, il note en date du 20 novembre 1870 :
« Nous avons mérité l’Empire pour nous être laissés gouverner par un homme que nous savions un gredin ; que méritons-nous maintenant pour nous laisser entraîner par des gens que nous savons des cervelles creuses, des tambours qui n’ont que le son. Accepter pour directeurs des hommes qui ont si bien tourné et retourné le pour et le contre qu’ils ont perdu le sens du juste et de l’injuste ; ils plaident de leur mieux l’affaire de la France, mais pour eux, c’est une affaire, et en fin de compte, pourvu qu’ils aient bien plaidé l’honneur est sauf ; s’ils perdent c’est que l’affaire était mauvaise et puis ils ne l’ont pas choisie, ils ont été nommés d’office. Aussi, si nous sommes condamnés à mort, ce sera notre faute, non la leur ; ils nous ont donné tout ce qu’ils avaient : “des phrases”. »
Ces lignes sont extraites d’un Cahier9, inédit à ce jour dont de larges extraits ont déjà été publiés dans un article intituléHector Malot, chroniqueur de guerre engagé 10. Car, dans ceCahierqui débute le 5 août 1870 pour s’achever le 5 février 1871, Malot tient en effet la chronique du conflit : « Il va se passer ici le plus formidable spectacle de ce temps». A défaut de servir directement le pays, il entreprend un tour de France en train qui passe par Orléans, Lyon et, suivant l’armée de Bourbaki, gagne le Jura puis la Suisse. Au contact des acteurs de la guerre qu’il rencontre dans les wagons de troisième classe, lieu propice aux conversations informelles, il consigne avec précision dans sonCahierles bruits et les rumeurs qui courent dans la population. Ses annotations témoignent de la justesse de ses analyses. Souvent, il est pris pour un espion et frôle l’arrestation. Après la capitulation, il revient chez lui : sa maison est sans dessus-dessous. Sa correspondance avec Hugo a disparu, de même que la presque totalité de son manuscrit deSans famille 11.
C’est dans ce contexte qu’en 1871 il débute l’écriture des Souvenirs d’un blessé, sous l’œil des Prussiens qui occupent sa maison. L’idée de ce roman lui est venue pendant son voyage. Emu par le grand nombre de blessés encombrant les gares en attente de trains pour retourner dans leurs familles, il écrit, le 3 novembre 1870, l’idée d’un « roman à faire » :
«Le voyage en France est en ce moment lugubre ; dans les gares et en wagon on ne rencontre que des blessés qui sortis des hôpitaux retournent à leur pays : jambes coupées, bras amputés, balafres au visage. Et tous ces éclopés jeunes et vaillants. Que vont-ils faire dans la misère où nous entrons. Comment vont les accueillir celles qui les aimaient. Il y a là un roman à faire : le Blessé, volontaire par amour revenant estropié après avoir vu tout ce qu’il y a de caractéristique dans cette guerre, et remercié par celle qu’il aime.»
Pour être au plus près de la réalité, Malot complète ses notes personnelles en demandant aux maires de La Bouille et d’Etrépagny de retranscrire les combats qui ont eu lieu dans leurs communes. Il puise aussi des faits dans la lecture des journaux étrangers.
A sa publication en deux volumes intitulés Suzanne et Miss Clifton chez Michel Lévy en 1872, l’ouvrage fait l’objet d’une analyse de Zola publiée dans le journal La Cloche le 23 mai de la même année. Zola s’intéresse à Malot depuis que Taine a attiré son attention sur cet auteur débutant. En 1865 Taine a en effet encensé les deux premiers volumes des Victimes d’amour : ses ouvrages, écrit-il, « sont excellents de tout point, et, si l’on excepte Madame Bovary, égaux aux meilleures œuvres de fiction qui aient paru depuis dix ans » 12.Souvenirs d’un blesséenthousiasme à nouveau Taine qui juge le roman « excellent, plein de faits, non encore exploité, instructif au possible 13 ». Dans la foulée, Zola souligne que beaucoup de romans de guerre qui paraissent à l’époque, ont peu d’intérêt parce que, regrette-t-il, ils collent trop à l’événement. En revanche, il écrit à propos du roman de Malot :
«Ce qui m’a ravi dans les Souvenirs d’un blessé, c’est la méthode littéraire. L’auteur s’est imposé un cadre immense. Il entendait promener son héros sur tous les points de la France pillée et brûlée, afin de donner un tableau complet de l’invasion. […] L’esprit de M. Malot se prêtait merveilleusement à cette résurrection d’un vaste ensemble par l’exactitude des petits détails. C’est […] le système employé par Stendhal dans son récit de la bataille de Waterloo. L’armée est on ne sait où ; on se bat quelque part ; à l’horizon, le canon gronde. Et sans nous mettre au milieu de la bataille, l’écrivain fait passer sur nous un vent de mort, l’effarement de la défaite, l’écroulement de tout un monde, la débandade du troupeau humain.»
Pour Zola, Souvenirs d’un blessé est un roman qui sort du lot. On peut même lire dans son jugement le projet d’un de ses propres romans à venir La Débâcle qui paraîtra vingt ans plus tard en 1892. Ce n’est pas la première fois que l’œuvre de Malot nourrit celle de Zola. Henri Mitterand a retrouvé dans le dossier préparatoire de La Conquête de Plassans, une remarque de Zola concernant un certain « roman de Malot 14» et a ainsi pu attester l’influence décisive de l’abbé Guillemittes dans la genèse de l’abbé Faujas. Mais on pourrait aussi signaler l’intérêt pour le monde minier que Zola puise dansSans famillepour écrireGerminal15…
S’il souligne « la force du propos » due pour l’essentiel à la relation dans ses détails les plus insignifiants de la vie d’un simple soldat, Zola avance néanmoins une critique : quelquefois, déplore-t-il, « le récit tombe dans le bavardage » un peu comme si le romancier « s’était trop pressé ». DansLeRoman de mes romans 16, Malot veut bien reconnaître que la faiblesse du roman peut venir de son engagement et de sa volonté à vouloir dire la vérité, loin des préoccupations esthétiques de l’art pour l’art : « Je passe volontiers condamnation sur le reproche que vous m’adressez d’avoir été trop vite, mais j’ai voulu que mon roman servît à aviver et entretenir la haine de l’Empire, et de pareilles visées sont toujours contraires à l’art ». Mais pour sa défense, il insiste sur la force du ressenti qui, à ses yeux, est primordiale.
Dans les Souvenirs d’un blessé, le ressenti est porté par le récit à la première personne de Louis Goscelin d’Arondel durant l’année du conflit qui s’étend de juillet 1870 à juillet 1871. Elevé dans le mépris de l’Empire par un précepteur honnête homme, républicain, Louis s’engage sans conviction dans des études de droit à Paris. Il mène alors la vie de bohème des riches héritiers entre l’amour des courses hippiques, celui du jeu et des actrices. Quatre ans plus tard, alors qu’il gagne Tarbes pour officier dans l’administration des haras, il rencontre la belle Suzanne Bordenave. C’est une jeune fille de Cauterets, Mlle Lacaze de Libourne, qui servit de modèle à cette bourgeoise aguicheuse, à l’imagination romanesque dont Louis tombe follement amoureux. Sur un coup de tête, il décide de faire la guerre pour les beaux yeux de Suzanne qui soutient l’Empire et qui déclare de manière formelle qu’elle n’épousera qu’un militaire, un héros !
Louis s’engage sans tarder et part alors à la recherche de son régiment. Mais tous ses déplacements, tous ses efforts pour le retrouver sont contrecarrés par une armée en déroute, des officiers qui ne sont pas à la hauteur de la situation, qui n’ont pas de cartes ou qui ne savent pas les lire, qui ignorent tout de la géographie, qui ne prennent pas en compte les conditions climatiques, et qui se ridiculisent dans des ordres et contre-ordres en cascades… C’est la quasi-totalité des opérations qui marquèrent les grandes phases du conflit — à l’exception du Paris assiégé et de la Commune — qui sont données à voir du point de vue du personnage engagé dans l’action et qui ne peut que constater que les troupes sont lancées à la mort pour un improbable sauvetage de l’Empire 17. L’écriture, au plus près des événements qui ont réellement eu lieu, s’enracine dans leCahieret restitue le désarroi et la souffrance du soldat, le désarroi et la souffrance d’une armée martyre.
Néanmoins, dans la chronique de ce qu’il faut bien appeler la débâcle de nos armées, le romanesque n’est pas oublié. Présent dans les deux rencontres amoureuses qui ouvrent et ferment le récit, il se niche aussi dans des scènes qui combinent le tragique de la guerre au picaresque de l’aventure : l’errance du soldat Louis à la recherche de son régiment introuvable ; l’odeur de la mort qui voisine avec celle du boudin ; la méfiance des paysans qui se manifeste dans la contradiction de leurs propos ; le suspense du franchissement des lignes ennemies pour tenter d’entrer dans Paris assiégé… La scène du soldat espion aussi est des plus savoureuses. Pour ne pas attirer l’attention et être sûr d’obtenir un laissez-passer délivré pour la circulation des animaux de boucherie, Louis n’hésite pas à revêtir le costume d’un conducteur de bestiaux : et, tout en prétextant un déplacement pour le ravitaillement des troupes, il peut transporter des messages codés sans attirer l’attention 18. Ainsi, de nombreuses situations semblent plus fictionnelles que réelles. Pourtant elles se composent de la juxtaposition d’une multitude de petits faits qui sont, comme Malot le fait dire à son personnage, au plus près de la réalité.
Les scènes qui se déroulent la nuit, comme les visions de Paris assiégé du haut d’une colline, sont très poétiques. Parce que la nuit, doublée du silence, est encore plus inquiétante que la bataille. Mais aussi parce que le ciel étoilé rougi par les balles est un spectacle fascinant. C’est d’ailleurs la nuit, au cours d’un incendie, que Louis fait la connaissance de miss Harriet Clifton, cette riche anglaise passionnée de voyages et d’explorations lointaines. Miss Clifton met sa fortune au service des blessés en suivant les armées dans une solide voiture aménagée en pharmacie et portant la croix rouge de Genève. Il la retrouvera en Suisse où elle l’assistera lors de l’amputation de son bras. Il y aura de nouvelles rencontres au Havre et des projets d’avenir. Le Cahier montre combien Malot est sensible à la nouvelle société qui naîtra de tous ces événements tragiques. Après la Commune de Paris, il faudra consolider la République naissante sur de grands projets sociaux et sur une école à repenser. S’appuyant sur les travaux des pédagogues Pestalozzi et Froebel, Louis et Harriet se tourneront alors vers l’éducation des plus jeunes. Le chemin accompli par notre héros, en partie avec son ami Homicourt rencontré par hasard à Sedan, pour poursuivre la résistance coûte que coûte en tentant de semer le désarroi dans les lignes ennemies, permet à Malot de justifier son projet en déclarant d’une formule définitive : « Si j’avais attendu, j’aurais pu, il est vrai, mettre dans mon roman ce qui est dans l’histoire ; j’ai préféré essayer que pour une part si faible qu’elle fût, on mît dans l’histoire un peu de mon roman19 ».
1Cité par E. Flammarion in « Avertissement »,Clotilde Martory,1895.
2La nouvelle qui lui apportera célébrité et consécration estBoule de suif, nouvelle qu’il fait paraître dans le recueil coordonné par ZolaLes Soirées de Médan(1880).
3Claude Digeon,La Crise allemande de la pensée française(1871-1914), Paris, PUF, 1959.
4L’ouvrage du Belge Camille Lemonnier parut sous le titreSedanà Bruxelles en 1871 ; puis sous le titreLes Charnierschez Lemerre en 1881. Il a été republié en 2011 chez Mémorielles.
5La Crise allemande de la pensée française, op. cit.
6Malot revient encore sur le conflit dans les deux derniers tomes deL’Auberge du monde : dans le dernier chapitre d’Ida et Carmélitaet surtout dans le dernier volumeThérèse(1875). «Ce dernier volume, où nous assistons aux terribles événements de 1870 et de 1871, sans perdre un instant de vue le héros ni les acteurs essentiels du drame, est traité avec une mâle vigueur qui ne s’interdit point toujours l’attendrissement. Il laisse dans la mémoire une impression forte et durable », Jules Levallois,Echo, 17 février 1876 in Malot, Hector,Le Roman de mes Romans, Flammarion, 1896, Réédition in Cahiers Robinson, n°13, 2003, p. 217.
7Thomas-Maleville, Agnès,Hector Malot, L’Ecrivain au grand cœur, Editions du Rocher, 2000, p. 141.
8Ibid.
9La ponctuation et les soulignements des extraits duCahiersont ceux de Malot.
10Agnès Thomas-Maleville, « Hector Malot, chroniqueur de guerreengagé » inHistoria, novembre 1996, p. 30-33.
11InLe Roman de mes romans, 2003, op. cit. p. 50 et 97.
12Cité par F.W.J. Hemmings in « La critique d’un créateur : Zola et Malot »,Revue d’histoire littéraire en France,janvier-mars 1967, p. 55-67, p. 56.
13Lettre inédite du 27 février 1872.
14Un curé de provinceetUn miracle.
15Ida-Marie Frandon,Autour de « Germinal » : la mine et les mineurs. Genève : E. Droz/Lille : Librairie Giard, 1955.
16Op. cit.
17Pour une analyse détaillée des opérations militaires présentes dans le roman voir Thierry Chevrier, « Souvenirs d’un blessé », inDiversité de Malot, Cahiers Robinson, n°10, 2001, p. 181-199.
18L’anecdote figure dans leCahier.En date du 3 novembre, Malot écrit : « J’insiste d’autant plus pour aller à Paris et il est décidé qu’on me donnera tous les moyens dont on dispose. En même temps on me met en rapport avec M. Flèche ancien consul à Mogador qui a tenté l’entreprise et qui est revenu à Tours après avoir échoué. Le soir un conseil de guerre est tenu. M. Flèche ayant perdu la femme qu’il avait épousée depuis un an s’est engagé par désespoir dans les éclaireurs à cheval ; avant d’entrer en campagne il a voulu aller à Paris embrasser ses parents. En même temps il porte deux lettres du gouvernement de Tours au gouvernement de Paris, l’une roulée dans un vieux cigare, l’autre avec laquelle il a fait une cigarette. Il se rase et s’habille en conducteur de bœufs. Il va jusqu’à Chartres en chemin de fer, de là à pied par les chemins détournés […]. Pendant huit jours il cherche à percer les lignes prussiennes de Versailles à Longjumeau muni d’une carte de circulation achetée 40 francs à un piqueur de bœufs. Il est arrêté à Châtenay enfermé avec 12 Bavarois pour être jugé comme espion le lendemain, dans la nuit il enjambe par-dessus les Bavarois endormis et se sauve. N’ayant plus d’argent (il a dépensé 500 francs) il revient par le même chemin à Chartres où le préfet le reçoit et le renvoie à Tours ».
19InLe Roman de mes romans,op. cit.p. 50.
Première partie
Suzanne
L’histoire que je veux raconter — la mienne — n’embrasse pas un laps de temps bien long ; elle commence en juillet 1870 pour se terminer en juillet 1871, c’est-à-dire qu’elle se passe pendant cette période funeste où la France et la Prusse ont été en guerre. S’il était encore convenable de parler latin, j’écrirais en tête de ce récit : « Et quorum pars magna fui » ; mais puisque la mode des citations est finie, je veux avertir mon lecteur qu’il ne trouvera ici que les aventures d’un soldat inconnu. J’ai assisté à plusieurs batailles, mais comme je ne les ai pas vues, je ne les expliquerai pas ; j’ai chevauché pendant plusieurs jours à la suite de Napoléon III, mais comme je n’ai point été appelé dans ses conseils, je ne sais ni ce qu’il voulait ni ce qu’il pensait, si tant est que ce sphinx providentiel devenu vieux voulût et pensât quelque chose. Nos ministres de la défense nationale ont plus d’une fois empli mon oreille du bruit de leur parole, mais ils ne m’ont pas initié à leur plan, si toutefois ils en avaient un. J’ai vu le comte de Bismarck, mais je n’ai point surpris ses projets. Mon histoire n’est donc pas de l’histoire, et je n’ai d’autre prétention que celle du pigeon :
Je dirai : J’étais là, telle chose m’advint.
Vous y croirez être vous-même.
Par malheur pour vous, je ne suis pas écrivain, mais nous venons de voir tant de généraux se faire journalistes et tant de journalistes se faire généraux, que leur audace me gagne ; seulement, si j’ose prendre la plume après mes chefs, je leur laisse le plumet : les grandes phrases, comme les grands panaches, ont fait leur temps.
1.
Mon nom est Goscelin, ou plus justement pour être exact, Louis Goscelin d’Arondel, car s’il faut en croire la tradition, je descends des Goscelin d’Arondel qui accompagnaient Guillaume le Bâtard dans la conquête de l’Angleterre, et qui ont encore aujourd’hui des représentants à la Chambre des lords.
Malgré cette noble origine, mon père consentit à donner son nom à une bourgeoise, fille d’un simple fabricant de papiers à Courtigis, sur les bords de l’Eure ; il est vrai que la bourgeoise était riche, tandis que le gentilhomme était pauvre.
Lorsque ce mariage se fit, mon père revenait d’Algérie où il avait difficilement conquis le grade de capitaine aux chasseurs d’Afrique, et il avait pour tout patrimoine son grade, sa croix et son nom. Naturellement on voulut empêcher ma mère de faire ce qu’on appelait une sottise : épouser un gentilhomme ruiné, un militaire, un homme sans position, sans avenir, qui n’avait pour lui qu’une élégante tournure et un esprit distingué, ce fut un concert d’observations charitables et d’avertissements effrayants dans le monde bourgeois. A ceux de ses amis qui la prévinrent que mon père n’avait que des dettes, ma mère répondit qu’elle était assez riche pour deux. A ceux qui l’avertirent que le climat d’Afrique avait ruiné sa santé, elle répliqua qu’elle serait heureuse de le soigner. A ceux enfin qui insinuèrent délicatement que le capitaine d’Arondel avait eu des aventures de Don Juan, elle fit comprendre qu’elle désirerait n’être point éclairée sur ce sujet, dont elle n’avait ni souci ni crainte, car, au cas où ces aventures seraient vraies, elle se croyait assez de tendresse dans le cœur, assez d’indulgence dans le caractère pour retenir ce séducteur et le fixer près d’elle.
En présence d’une obstination aussi malheureuse, les observations cessèrent, et il fut généralement accepté que les Dallery, qui, jusqu’alors, avaient eu la réputation d’honnêtes gens, simples et pratiques, étaient des vaniteux que l’ambition affolait.
Et cependant jamais accusation ne fut plus injuste, car ma mère était la femme la moins ambitieuse qui fût au monde, et les raisons qui la décidèrent en faveur de mon père prirent leurs causes dans des sentiments absolument opposés à la vanité.
La tradition littéraire a représenté la haute bourgeoisie du règne de Louis-Philippe comme mesquine et niaise, n’ayant d’intelligence que pour gagner de l’argent, de caractère que pour s’enfermer étroitement dans son égoïsme. Je ne sais ce qu’il y a de vrai dans ce tableau, mais il est certain que mon grand-père, le « père Dallery », comme on disait dans le commerce parisien, ne ressemblait en rien aux bourgeois de ce modèle. Bien qu’il eût été le seul ouvrier de sa fortune gagnée lentement d’abord et toujours laborieusement, il ne considérait pas l’argent comme le seul dieu qu’on dût adorer ; il avait fondé de ses deniers, à Courtigis, une école, un hospice, et quand sa fille avait commencé à grandir, il avait pris l’habitude de lui répéter comme une leçon : « Si je pensais que l’argent que je gagne ne doit servir qu’à attirer d’autre argent, je fermerais la fabrique ; ne te laisse donc pas guider par la fortune dans le choix de ton mari. » Ces paroles et cet enseignement avaient développé chez ma mère d’autres idées que celles qu’on attribue aux bourgeoises riches, et elle s’était fait un idéal de mariage qui, mieux que toutes les explications, montre en quelques mots ce qu’était son cœur.
Puisque je suis riche, se dit-elle, il faut que ma fortune serve aux autres, et je n’épouserai qu’un inventeur, un travailleur, un artiste auquel l’argent seul manquera pour réaliser ses idées.
Combien de fois nous a-t-elle raconté en souriant tristement les difficultés de ce projet romanesque ! Si la recherche d’une dot est une grosse affaire ; il paraît que celle d’un caractère en est une plus grosse encore. Et puis il y avait les embarras de mon grand-père qui ne pouvait se faire comprendre lorsqu’il refusait la main de sa fille aux prétendants n’ayant d’autres titres à faire valoir que leur fortune ou leur position : il était gai, mon grand-père, fin, railleur, il faisait de ces histoires de mariages manqués, de véritables comédies pleines de rire et de bon sens ; l’intrigue était pauvre, mais combien les types étaient réjouissants !
Mais je ne veux pas m’attarder dans ces détails ; bien que ce que j’aurais de mieux à faire probablement pour mettre un peu d’intérêt et de tendresse dans ce récit fût de parler de ma mère, je passe, puisque ce n’est pas là mon sujet. Ce que je veux dire seulement au moment où son nom se trouve sous ma plume, c’est que si j’ai pu me dégager du monde étrange au milieu duquel j’ai vécu durant quelques années, c’est à son souvenir que je l’ai dû. Quoi qu’on fasse et quoi qu’on devienne, si l’on a été élevé par une mère femme de tête et de cœur, il arrive toujours une heure où l’on s’en souvient, et alors cette heure-là suffit souvent pour éclairer notre route.
L’inventeur ou l’artiste ne s’étant pas présentés de manière à rendre leur succès possible, ce fut mon père qui prit leur place ; mais la fatalité ne permit pas que ce mariage, dont les premières années furent pleinement heureuses, eût une longue durée.
Mon père avait donné sa démission et s’était établi à Courtigis ; tandis que mon grand-père continuait à diriger les papeteries, il s’appliquait à acquérir les connaissances pratiques qui lui avaient jusque-là manqué. Pour cela il visitait les fermes des environs, les établissements industriels ; il assistait aux congrès et aux comices ; il inspectait les écoles ; il tâchait d’être utile, en un mot, à lui-même ainsi qu’à ceux qui l’entouraient. Déjà la considération lui venait et dans le pays on pensait à lui ouvrir la vie politique. Mais de son éducation militaire et de son existence toujours active, il avait gardé l’habitude et le besoin des fatigues corporelles ; il montait à cheval, et tout le temps qu’il avait de libre il le donnait à la chasse. Un soir on le rapporta à la maison tué par l’un de ses compagnons qui, dans une battue, l’avait frappé d’une balle.
J’avais alors quatre ans et c’est le premier souvenir qui me soit resté, souvenir terrible, qui a toujours flotté dans ma mémoire comme le voile de deuil qui rappelle à la veuve qu’entre elle et le monde il y a un mort.
On avait déjà annoncé deux fois que le dîner était servi, mais nous ne nous étions pas mis à table, attendant mon père. Un domestique vint dire à mon grand-père qu’on avait besoin de lui. Il rentra bientôt et sa figure était si bouleversée, que ma mère en reçut le coup de son malheur.
— Oui, dit mon grand-père répondant à son cri, il a été blessé… c’est grave.
— Il est tué ! s’écria ma mère.
Ma mère, qui avait le respect de l’enfance, ne me parla jamais de cette mort. Mais j’avais une bonne Allemande, qui n’observa pas la même réserve.
Elle était à mon service spécialement pour m’apprendre l’allemand, mais comme elle était fervente catholique, elle m’apprenait aussi des prières qu’elle croyait d’autant plus utiles à mon éducation, que ma mère et mon grand-père, fort peu dévots de cœur ou d’habitude, me laissaient dans une complète ignorance des choses de la religion. Elle jugea convenable de me tirer de cette ignorance coupable, et ce fut elle qui m’apprit ce que c’était que la mort : « Je ne verrais plus mon père, il était enterré dans un trou comme Brillante, une chienne que j’avais perdue, et même il était probablement en train de brûler dans l’enfer, un horrible endroit, plein de crapauds et de diables noirs, d’où je ne pourrais le tirer qu’en disant bien mes prières allemandes. » Quand je lui demandais pourquoi mon père était en enfer avec les méchants, lui qui était si bon, elle me répondait que c’était parce qu’il n’avait jamais voulu aller à la messe.
Je ne sais trop ce que je serais devenu avec ces intelligentes leçons, car ma mère les interrompit avant leur fructification. Peu de temps après la mort de mon père, je perdis encore mon grand-père, et ma mère trouvant de lourdes affaires que la Révolution de 1848 avait embarrassées, dut en prendre la direction pour ne pas procéder à une liquidation immédiate qui lui aurait été très onéreuse. Comme elle était vaillante et pleine d’activité, cela ne l’effraya pas trop, mais elle fut obligée cependant de ne plus s’occuper de moi comme au temps où elle était pleinement libre, et elle me donna, quoique bien jeune encore, un précepteur qui neutralisa les leçons de ma bonne.
Ce qui détermina ma mère dans le choix de ce protecteur fut une raison qui eût peut-être éloigné une femme d’un esprit moins ferme et d’un jugement moins M. Chaufour, professeur au collège de Blois, avait donné sa démission après le coup d’Etat, ne voulant pas prêter serment ; elle pensa que pour m’élever dans les idées de justice et de droiture qui étaient les siennes, elle ne pouvait mieux choisir que l’honnête homme qui à cinquante ans, sans un sou de fortune, n’avait pas hésité à sacrifier à sa conscience une position laborieusement acquise. Le malheur est que j’ai peu profité de l’éducation que cet excellent homme s’est efforcé de me donner, car si j’avais suivi ses principes, j’aurais très probablement échappé à la vie que je me suis créée, et ayant vécu paisiblement sous mon toit, n’ayant rien vu, je n’aurais rien à raconter, à moins de faire l’histoire de mon éducation elle-même. Quel portrait plein de bonhomie dans le caractère, de solidité dans le jugement, d’élévation dans l’esprit, de générosité dans les idées, je pourrais tracer du « petit père Chaufour » ! et aussi quelles drôles de caricatures alors que me donnant une leçon de géographie politique, il se laissait aller à dessiner la carte de l’univers « suivant les lois de l’humanité ». Il avait en effet inventé une géographie idéale, et chaque fois qu’une question politique se présentait en Russie, en Turquie, en Italie, bien vite il remaniait la carte de l’Europe, et en belles teintes plates roses, bleues et vertes, il fixait définitivement les limites des Etats, « de manière à concilier les intérêts matériels et moraux de chaque peuple, aussi bien que la paix du monde ».
Jusqu’à vingt ans, guidé par M. Chaufour, je n’eus qu’à suivre la route de tout le monde. Mais lorsque j’eus terminé mes classes à Bonaparte, une difficulté se présenta dans ma vie jusqu’alors si facile. Que faire ? Quelle carrière prendre ?
A vrai dire, cette difficulté n’existait pas pour moi. A quoi bon telle ou telle carrière ! Pourquoi en choisir une, celle-ci ou celle-là ? Celles qui ne m’étaient pas antipathiques m’étaient indifférentes. Je savais que je serais maître un jour d’une belle fortune, pourquoi m’imposer les ennuis et les fatigues d’un métier ? Etait-il possible que moi, Louis Goscelin d’Arondel, je prisse la maison de commerce de mon grand-père ! Mettre mon nom sur des factures, qu’auraient dit mes aïeux ? Entrer à l’Ecole polytechnique, je n’aurais osé ; à Saint-Cyr, je n’aurais daigné. D’ailleurs, ma mère avait une telle horreur de la vie militaire que je n’aurais pas voulu lui faire le chagrin de me voir soldat. Il restait encore les fonctions du gouvernement, le Conseil d’Etat, les sous-préfectures, le ministère des Affaires étrangères. Mais ce n’est pas impunément qu’on vit en contact journalier avec un précepteur honnête homme et républicain. A cette école, j’avais appris le mépris de l’Empire ; je me serais déshonoré à mes propres yeux en devenant un de ses fonctionnaires actifs.
Si les papeteries eussent été en prospérité, ma mère avec son solide bon sens m’en eût peut-être imposé la direction ; mais comme elle s’était contentée de les faire marcher tant bien que mal sans essayer de lutter contre la concurrence, elle ne voulut pas me charger, à mon entrée dans la vie, d’une affaire qui se soutenait difficilement. Après bien des conseils tenus, bien des avis donnés et discutés, on s’arrêta donc à une solution qui n’en était véritablement pas une : on attendrait, et en attendant je ferais mon droit.
Qu’un garçon de vingt ans, livré à lui-même, travaille lorsqu’il sait que chaque effort qu’il fait le rapproche d’un but déterminé, cela est tout naturel et se comprend facilement ; mais lorsque ce but manque, lorsqu’on doit travailler pour travailler, pour rien autre chose que pour le plaisir, et que ce plaisir se trouve tout au fond du Digeste et du Code civil, cela est bien différent, et ceux qui se plient volontiers à cette règle sont, je crois, assez rares.
En tout cas, je ne fus pas de ceux-là. Ma mère, en m’établissant à Paris, avait voulu laisser près de moi « le petit père Chaufour » ; mais bien que le bonhomme fût, en réalité, fort peu gênant, je n’en voulus point ; j’avais soif d’une liberté complète. Et après avoir longuement protesté contre l’injure qu’on me faisait en m’imposant un surveillant, je finis par convaincre ma mère que je devais m’habituer à me conduire moi-même et à user de ma responsabilité : on n’est homme que par le libre-arbitre.
Pendant que M. Chaufour restait à Courtigis, où il se fixait, je m’installais dans un appartement de la rue Auber, avec le confortable d’un garçon qui peut se passer toutes ses fantaisies. C’était, il est vrai, un peu loin de l’Ecole de droit, mais les étudiants de mon espèce n’étaient pas faits pour le Quartier latin.
Etudiant, je le fus bien peu, et seulement par la grâce de ma première inscription, car je n’allai pas au cours plus de quatre ou cinq fois. Tous les soirs, il est vrai, je recommandais à mon valet de chambre de m’éveiller le lendemain matin, mais s’éveiller et se lever sont loin l’un de l’autre, surtout lorsque se rendormir se trouve entre les deux.
J’avais fait, au collège Bonaparte, connaissance avec quelques jeunes gens qui, comme moi, n’avaient d’autre but dans la vie que de continuer leurs parents. Riches, inoccupés de corps comme d’esprit, nous nous liâmes, et nous mimes en commun nos relations ; bientôt je fus lancé en plein dans le high life parisien.
En moins de deux années, je m’y fis un nom, je ne dis pas célèbre, mais au moins connu. Qu’on ouvre un journal de sport de cette époque, qu’on mette la main sur un vieux programme de courses, on me trouvera parmi les gentlemen qui s’illustraient à la Marche, à Porchefontaine, à Chantilly ; qu’on interroge la petite Chose des Folies, la grosse Machin des Bouffes, et bien que de terribles événements se soient passés depuis ce temps-là, elles se souviendront de moi, car les meilleures mémoires sont, comme chacun le sait, celles qui s’exercent le plus, et celles de ces dames ont beaucoup travaillé.
Quelle existence que celle de ce monde pendant les dernières années de cette époque prospère qu’on appelle le Second Empire, et comme elle était faite pour former les caractères, élever les esprits et enrichir le cœur ! Cependant combien souvent j’ai vu de jeunes commis de magasin ou de clercs de notaires me regarder avec envie lorsque le dimanche je montais les Champs-Elysées dans mon phaéton, au grand trot de mes pur-sang, pour me rendre à Longchamp, ma carte de pesage voltigeant à une boutonnière ; ou bien encore lorsqu’un soir de première représentation, j’entrais dans une avant-scène des Variétés ou des Folies pour honorer de ma présence et de mes applaudissements les trois mots dits à faux par la petite Chose ou la grosse Machin ! mon gilet en cœur et la fraîcheur de mon gardenia tiraient les regards ; on se parlait à l’oreille, et j’étais une curiosité.
Comme ces pages peuvent tomber sous les yeux de ceux qu’alors j’ai éblouis, je veux leur dire ce qu’était la journée de ce mortel fortuné qu’ils enviaient.
Seulement je ne sais trop par où commencer, soir ou le matin. Pour me conformer à l’usage, je commence par le matin, bien qu’en réalité ma journée ne s’ouvrît guère qu’à l’heure où le soleil disparaît. Levé entre midi et deux heures, selon la fatigue de la veille, je déjeunais, puis ensuite je faisais une courte visite à celle de ces dames qui m’intéressait pour le moment. Pour ce que nous avions à nous dire, il fallait peu de temps :veni, vidi, vici ; le sentiment seul se perd dans les bavardages, et c’est pour cela que les honnêtes femmes, qui ont une faiblesse, regardent comme fabuleuses les histoires qu’on leur raconte sur le monde des drôlesses : « Où trouveraient-elles du temps pour tout cela ? » se demandent-elles naïvement. Libre de ce côté, je m’en allais aux Champs-Elysées où je me faisais donner les jeunes chevaux difficiles qui venaient d’arriver ; car c’est un préjugé de croire qu’on monte un cheval de course comme un poney ; il faut pour le tenir des bras solides, et ces bras ne s’acquièrent que par un travail régulier. Pendant plusieurs années, je n’ai jamais manqué ce travail, et c’est à lui que je dois mes succès sur le turf ; en même temps, je lui dois aussi ma bonne santé que rien n’a pu déranger. C’était après dîner que ma vraie journée commençait, si j’allais au théâtre vers minuit, sinon vers dix heures. Alors jusqu’à cinq heures, six heures, sept heures du matin, je restais assis devant le tapis d’une table de jeu, et si j’en étais encore au temps de ma gloriole, je dirais que je restais là sans jamais me lever et sans jamais avoir besoin de demander ces ustensiles que dans les cercles les mieux tenus on présente sérieusement aux joueurs qui ne veulent pas quitter la place. Les dimanches seulement ce programme subissait une modification : ces jours-là, pour aller aux courses, je me levais à onze heures, de là l’air si profondément endormi que je portais auring.
Pendant cinq années, je menai cette vie régulière, qui est beaucoup plus absorbante qu’on ne pourrait le croire. Qu’on me demande ce qui, pendant ces cinq ans, s’est passé dans les sciences, les lettres et les arts, la politique, je n’en dirai pas un mot ; tout ce que je sais, c’est à quelle saison Altaras a fait sauter la banque d’Allemagne, combien le prince Lemenof a perdu, et combien de fois Blanc-de-Perles a vendu son mobilier.
Enfin, au bout de ces cinq ans, il fallut s’arrêter. Au mois de mai 1869, après un hiver où j’avais été horriblement malheureux, j’espérai me rattraper en me mettant sur l’écurie Lagrange, et ce fut l’écurie Schickler qui gagna.
J’allai trouver ma mère.
— Il faut payer, me dit-elle sans un mot de reproches ; seulement, mon cher enfant, je crois que tu devrais t’arrêter ; en cinq ans tu as dépensé près d’un million, il ne nous reste que notre maison de la rue de Rivoli qui rapporte 40.000 francs et les usines de Courtigis : que veux-tu ?
Je déclarai que je voulais quitter Paris et entrer dans les haras. A ce mot, ma mère se récria. Mais je n’étais propre à rien ; la seule science que je connusse, si science il y a, était celle du cheval ; je voulais ne m’employer qu’à ce que je connaissais. Quelle chute pour ce fils qu’elle avait tant aimé et caressé de tant d’espérance ?
Nous fîmes agir nos amis, et deux mois après j’entrais dans l’administration des haras, en résidence à Tarbes.
En arrivant dans cette ville, je trouvai mon prédécesseur en proie à la fièvre du départ.
— Si vous comptez vous amuser dans cette noble cité, me dit-il, il faudra en rabattre, Tarbes n’est pas gai ; cependant, si vous êtes de complexion sentimentale et amoureuse, vous pourrez passer encore quelques bonnes soirées dans la maison Bordenave.
2.
Qu’était la maison Bordenave ?
Ce fut la première question que j’examinai lorsque j’eus pris pied dans la ville. Sans avoir tout à fait la complexion dont avait parlé mon prédécesseur, j’avais un certain empressement à connaître cette maison où l’on s’amusait. Pour un Parisien qui a mené la vie à grandes guides, une arrivée à Tarbes n’est guère rassurante. J’étais décidé à ne plus faire de folies, mais je n’étais pas résigné à m’ennuyer en expiation de mes fautes, et je ne trouvais pas que contempler de mes fenêtres les cimes bleuâtres ou neigeuses des Pyrénées fut une récréation suffisante.
Ce qu’on appelait la maison Bordenave était une famille composée de trois personnes : Mme Bordenave mère et Mlles Suzanne et Laurence Bordenave. Mme Bordenave étant d’un âge qui lui permettait d’avoir une fille de vingt-deux ans et une autre de vingt ans, je m’en occupai peu et fus satisfait sur son compte quand je sus qu’elle appartenait à la meilleure bourgeoisie de la ville, qu’elle avait une assez belle fortune, et que son salon, libéralement ouvert à tous les fonctionnaires jeunes, était le seul où l’on pût aller tous les soirs après dîner. Elle aimait à recevoir, tout au moins à voir du monde autour d’elle, et grâce à ses filles, elle se trouvait encore dans un milieu jeune et bruyant, comme au temps où sa beauté lui attirait une cour. En province, de pareilles maisons sont rares, mais Mme Bordenave avait la prétention de n’être point provinciale ; elle venait tous les ans passer un mois à Paris au moment du Grand prix ; elle faisait une saison à Biarritz en septembre, et durant l’hiver elle allait tantôt à Pau, tantôt à Nice pour une quinzaine de jours. Si elle habitait Tarbes, c’était seulement pour surveiller ses propriétés.
Avec les filles ma curiosité fut naturellement moins facile à contenter. La première fois que je les rencontrai ce fut au jardin Massey, cette délicieuse promenade qu’arrosent les eaux dérivées de l’Adour. Elles étaient l’une et l’autre assises sous un massif de grands magnolias, et en passant plusieurs fois devant elles, je pus les étudier à loisir : toutes deux jolies, elles avaient un caractère de beauté tout à fait différent ; l’aînée, brune, svelte de taille avec quelque chose de résolu et de dur dans la physionomie ; la cadette, au contraire, blonde et grasse avec un charmant sourire un peu triste et des yeux d’une douceur pénétrante. Ce fut plus tard que je sus la cause de cette tristesse qui était réelle : alors qu’elle était enfant, une bonne maladroite lui avait démis la jambe et elle était resté boiteuse ; de là, pour elle, une sorte de honte en public : aussi s’effaçait-elle le plus qu’il lui était possible et laissait-elle la première place à sa grande sœur ; c’était elle qui toujours au piano faisait danser dans les soirées intimes ; c’était elle aussi qui surveillait la machine domestique, tandis que la belle Suzanne ne s’occupait que de sa toilette ; pour tout dire en un mot une Cendrillon, moins « les méchants habits ».
Je me fis présenter, et je fus accueilli comme si je portais avec moi un reflet brillant du monde dans lequel j’avais vécu ; on connaissait mon nom, et Mlle Suzanne se rappelait m’avoir vu courir à Longchamps : casaque blanche, manches bleues, toque jaune ; sous ces couleurs tricolores, je ne lui avais pas paru ridicule. Au contraire, à ses yeux j’étais une sorte de personnage célèbre ; chaque semaine, les journaux de sport avaient parlé de mes exploits ou de mes « déplacements », et les journaux à indiscrétions parisiennes avaient raconté mes aventures avec les drôlesses connues. Pour une jeune fille qui vivait dans la religion de la mode, j’étais quelqu’un, et c’était une bonne fortune pour son salon que de me recevoir. On fut pour moi plein d’attention, et, trois jours après mon entrée dans la maison, Suzanne m’appela un soir dans un coin et me mit dans les mains un album de portraits des actrices de Paris : j’y trouvai à la première page Blanc-de-Perles ; à la seconde Flore, des Bouffes ; à la troisième Raphaële, des Variétés. Elles étaient rangées dans l’ordre où elles avaient été mes maîtresses.
— Vous voyez qu’on vous connaît, me dit Suzanne en riant de mon embarras.
Quelle belle chose vraiment que la presse ; et comme les journaux qui n’ont pas voulu infecter la province d’une politique dangereuse ont su la moraliser !
Si j’avais eu une once de cervelle saine dans la tête, je me serais prudemment éloigné de cette charmante personne et me serais rapproché de sa sœur Laurence. Mais ce fut le contraire qui arriva. Laurence avait une tête et un cœur d’ange, mais elle boitait, tandis que Suzanne, droite dans sa taille cambrée, était souple comme une couleuvre. Ce fut Suzanne qui m’attira et je me mis à l’étudier.
C’était vraiment une curieuse jeune fille, et assurément le produit le mieux réussi d’une éducation mondaine qui s’était faite un peu partout, au hasard des rencontres d’une existence décousue : je ne dis pas qu’elle soit un type qui résume une époque, mais je dis qu’elle n’est pas non plus une exception, car ce que j’ai vu en elle, je l’ai remarqué aussi dans plus d’une autre. Soit intuition naturelle, soit sagacité reçue de l’expérience, elle avait jaugé la vie et le monde et elle s’était dit qu’elle ne pourrait s’y faire la place qu’elle désirait que par un beau mariage. Et un beau mariage pour elle, c’était celui qui lui donnerait un mari puissant par le nom, la fortune ou la position : c’était la vie à Paris, en vue sur le théâtre du monde, avec son nom et la description de ses toilettes dans les journaux spéciaux ; c’était l’occasion de paraître et d’éblouir. Cela s’accomplissant, elle se croyait assurée de ne bâiller jamais et de ne jamais avoir des retours de tristesse, de déception ou d’ennui. Elle avait vu la cour ou plus justement elle avait été reçue dans une demi-intimité à Biarritz, et ce que Massillon, dans un sermon que j’ai appris lors de mon baccalauréat, a dit des exemples des grands et des princes de la terre « placés pour le salut comme pour la perte des peuples » s’était réalisé chez elle. Pourquoi elle aussi ne ferait-elle pas un mariage extraordinaire ? Cela était possible ; tout est possible à qui sait vouloir avec continuité ; elle disposait d’une arme irrésistible, la beauté ; elle n’avait qu’à s’en servir froidement ; si elle restait belle jusqu’à trente ans, et c’était probable, car elle était parfaitement décidée à ne tomber dans aucune de ces faiblesses qui altèrent la beauté, la tendresse, la passion, le dévouement, combien de chances favorables pouvait-elle rencontrer avant cet âge, alors qu’elle saurait les faire naître et les suivre ! Si un homme n’est qu’un jouet aux mains d’une innocente petite fille de dix-sept ans, que ne peut sur lui une femme de vingt-cinq ans, belle, libre, expérimentée, sachant ce qu’elle dit et ne dit pas ! Les imaginations romanesques qui s’emportent à froid et calculent vont loin ; Suzanne avait une imagination de cette espèce.
Son modèle trouvé, elle en devint fanatique. Que n’avions-nous en France un journal comme le Court-Journal, de Londres ! A défaut de cette feuille éminemment utile, elle se donna un correspondant qui dut la tenir au courant de ce qu’elle voulait savoir : c’était un jeune écuyer qu’elle s’attacha, sans doute, par de vagues promesses qui n’auront jamais été exécutées, j’en suis bien certain ; peut-être aura-t-il touché de légers, de très légers acompte sur son traitement ; mais quant à en avoir été soldé, c’est une autre affaire. Avec cette correspondance à laquelle elle adjoignit la lecture régulière du Sport et de la Vie parisienne ; avec ses conversations et ses interrogations chez Worth ; avec les relations qu’elle s’était créées dans les villes d’eaux, elle arriva à savoir à Tarbes les nouvelles du monde parisien tout aussi bien que si elle eût habité Paris et eût vécu dans ses salons, ses clubs et les coulisses de ses théâtres. Combien de fois m’a-t-elle étonné en me racontant, dans leurs détails, des niaiseries que je croyais connues de ceux-là seuls qui en avaient été les auteurs ! Mais il n’y avait point de niaiseries pour elle, dès qu’elles s’étaient passées dans le monde qu’elle adorait. Une pareille éducation ne dispose point à la bégueulerie ; aussi Suzanne n’était-elle ni prude ni bégueule ; avec elle on pouvait tout dire ; et c’était même là une des causes de l’attrait qu’elle exerçait sur certains hommes ; près d’elle, ils se sentaient à l’aise comme avec un camarade. Ce que j’appelle « tout dire » doit s’entendre largement, car bien souvent le sujet de ses conversations était le dernier article de la Vie parisienne, et l’on sait que si ces articles étaient le plus souvent remarquables par l’esprit, l’observation ou le style, ils étaient rarement écrits pour les petites filles « dont on coupe le pain en tartine ». Un soir qu’elle me fit lire tout haut dans son salon une fantaisie ayant pour titre : « Le Melon », je faillis rester court, tandis qu’elle riait aux éclats. Cela la mit de si belle humeur que contrairement à son habitude, elle remplaça sa sœur au piano et, pendant toute la soirée, nous joua et nous chanta la partition des Turcs.
— Si je laissais Laurence jouer ses pleurnicheries ou ses sentimentaleries ordinaires, dit-elle, ou bien encore sa musique sérieuse, M. d’Arondel serait capable de se convertir tout à fait : rions un peu.
Et l’on rit beaucoup, et je rentrai chez moi à une heure du matin, un peu plus troublé, un peu plus ému que tous les soirs.
Bien entendu, je ne connus pas Suzanne, telle que je viens de la peindre, du jour au lendemain ; mais du jour au lendemain, pour ainsi dire, je fus irrésistiblement attiré vers elle, et il y eut cela de particulier dans cette attraction, qu’elle s’exerça avec d’autant plus de puissance que je fis des découvertes dans la nature ou le caractère de Suzanne qui me blessaient. Explique cela qui pourra, je ne m’en charge pas.
Cependant, je sus me renfermer dans une prudente réserve, car les gens qui ont la réputation d’être des mauvais sujets sont ceux que doivent le moins craindre les honnêtes femmes : habitués aux facilités de la galanterie, ils ont, lorsqu’ils sortent de leur monde, des timidités, des scrupules, des hésitations qui feraient rire un père de famille. Et il est très probable que je serais resté longtemps momifié dans cette réserve, si Suzanne elle-même n’était venue me prendre par la main pour m’en tirer.
Quand je dis par la main, cela n’est pas très juste, je devrais plutôt dire par le pied ; mais enfin peu importe, l’essentiel à savoir est qu’elle m’en tira. Voici dans quelles circonstances.
Plusieurs fois j’avais accompagné la famille Bordenave dans ses promenades ; elle en calèche, moi en voiture. Il fut décidé un soir que nous irions le lendemain visiter le célèbre pèlerinage de Bétharram ; seulement comme une course de soixante kilomètres était un peu longue pour mon cheval, on m’admit dans la calèche.
Me voilà donc en route pour Bétharram, dans la même voiture que la belle Suzanne ; j’étais assis juste en face d’elle et j’avais Laurence à côté de moi. C’est un chemin un peu monotone que celui de Tarbes à Bétharram, toujours des bois, des landes et des bois, mais on a dans le lointain la chaîne des Pyrénées comme un immense entassement de nuées bleues ; et puis je dois dire que j’étais beaucoup plus attentif aux yeux de Suzanne qu’au paysage. Tout à coup, en traversant la lande d’Ossun, il me sembla sentir un frôlement contre mon pied. Je reculai. Le frôlement me suivit. Je reculai encore, mais très peu. Alors une bottine fine et souple se posa sur mon pied.
Je levai les yeux et regardai Suzanne en face ; elle était souriante.
— Pourquoi pas ? dit-elle.
Et son pied pressa le mien : je crois que je n’ai jamais éprouvé émotion si vive et si rapide ; c’en fut fini de mes timidités et de mes scrupules. Les vingt kilomètres qui nous restaient à parcourir avant d’arriver à Bétharram se firent pour moi en quelques minutes. Elle m’aimait donc, cette belle Suzanne que j’avais si ardemment désirée.
A peine étions-nous descendus de voiture, qu’à mon grand étonnement elle se dirigea vers la chapelle, tandis que sa mère et sa sœur restaient sur la rive du Gave à regarder les longues guirlandes de lierre qui, du pont, pendent jusque dans l’eau. Je la suivis rapidement, croyant qu’elle m’offrait une occasion de me trouver seule avec elle. Quand j’entrai dans la chapelle, elle était déjà agenouillée sur un prie-Dieu. Un moment j’hésitai à avancer ; car, sans être dévot, je crois que les églises ne sont pas faites pour des conversations d’amour. Cependant une force à laquelle je ne pus résister me poussa en avant, et je m’approchai d’elle pour lui prendre la main. Ah ! qu’elle était belle agenouillée sur son prie-Dieu, la taille cambrée, la tête renversée en arrière, les yeux perdus dans la contemplation de la lune, du soleil et des étoiles qui forment le ciel de cette chapelle. Mais au mouvement que je fis, elle se retourna vers moi, et m’arrêtant d’un regard indigné :
— Vous ne sentez donc pas, dit-elle à mi-voix, que je finirai dans un couvent ?
Je sortis hébété. Dévote ! Elle était dévote ! Mais alors ? Et je me mis à chercher une explication à ces inconséquences de caractère. Après tout, ce n’était pas plus fort que de la voir, du matin au soir, lire la Vie de Marie-Antoinette.
Il me fallut bien vite en rabattre des espérances que cette caresse m’avait inspirées ; et, par ce que je vis, par ce que j’entendis, je compris que je n’étais pas le seul mortel heureux qui eût reçu cette faveur. Quelques jours après notre promenade, elle fit avec sa mère et son notaire un petit voyage à Bordeaux pour affaire. Le notaire, jeune et beau garçon, me déplaisait ; mais je ne le redoutais pas beaucoup, ce n’était qu’un notaire, c’est-à-dire un brave homme condamné au mariage et à la médiocrité. Le lendemain soir, il vint faire sa visite ; j’étais là.
— Ce bon notaire, dit Suzanne, comme je lui suis reconnaissante de ses attentions ! sans lui, mon cher d’Arondel, je gagnais le rhume, car il faisait un froid de loup dans notre wagon, mais pendant la nuit il a pressé mes bottines sur son cœur, et vous savez, les pieds étaient dans les bottines. Qui aurait cru qu’un cœur de notaire était si chaud que ça ? un calorifère. Laurence, si tu en trouves jamais un, uses-en.
Il n’est pas nécessaire, je crois, de parler de la mine du pauvre garçon ; mais, avant son départ, elle trouva moyen de raccommoder les choses : elle avait voulu se donner la satisfaction de se moquer de lui après s’être donné le plaisir des bottines, mais il n’entrait pas dans sa politique de le renvoyer fâché. A un moment où elle crut qu’on ne pouvait pas l’entendre, elle s’approcha de lui, et à mi-voix rapidement :
— Maman vous avait vu, dit-elle. Il fallait tout expliquer. Comprenez-vous ?
Je ne sais pas s’il comprit, mais moi je compris parfaitement. Tous les hommes lui étaient bons pour ce qu’elle voulait d’eux. La femme qui aime et se donne a des délicatesses de choix et des exigences qui importent peu à la femme maîtresse d’elle-même, sans tendresse comme sans faiblesses. Avec les femmes de ce caractère, si l’on a le malheur d’être jaloux, ce n’est pas de celui-ci ou de celui-là qu’il faut l’être, mais de tout le monde.
Je le fus, bien que j’eusse la conviction qu’elle avait toujours été invulnérable pour les autres comme elle l’était maintenant pour moi. D’ailleurs sa réputation n’avait jamais reçu une sérieuse atteinte, et dans cette ville de province où tout se sait, personne ne formulait contre elle un reproche net et précis : légère, coquette plus que femme au monde, mais c’était tout. Le but qu’elle poursuivait la mettait à l’abri du danger. Si j’avais douté de cela, les indiscrétions du public indifférent, et aussi celles que j’obtenais par hasard de mes amis, m’eussent rassuré.
Ainsi, un matin, je reçus une dépêche m’annonçant que deux amis de Paris passant par Tarbes arriveraient chez moi à onze heures pour déjeuner et repartiraient le soir par le train de six heures. Je leur improvisai le meilleur déjeuner que je pus, et, comme ma cave était bonne, lorsqu’ils se levèrent de table, ils étaient gris, mais de cette ivresse joyeuse qui porte sur la tête et non sur l’estomac.
Ils voulurent alors visiter mon appartement en détail, et, en furetant dans ma chambre, ils poussèrent tous deux en même temps un cri de surprise devant un portrait de Suzanne qui était posé sur ma cheminée.
— Tiens, Suzanne Bordenave ! Tu connais donc Suzanne, la belle Suzanne, la belle des belles ?
Il fallut s’expliquer : j’étais surtout anxieux de savoir où et comment ils l’avaient connue. A Cannes, chez un ami commun, ils avaient passé un mois avec elle.
— Hein ! quelle fille étonnante ! Et qu’elle ressemble peu aux modèles de jeunes filles que nous montrent les théâtres ! Cela me remue de la revoir. Voilà bien ses yeux brûlants, voilà ses lèvres charnues et sanguines.
Je voulus les faire causer, ce qui ne fut pas difficile, dans l’état d’épanchement où ils étaient.
— Le plus drôle dans notre histoire, c’est qu’elle était entre nous deux à table. Au bout de quelques jours, voyant qu’elle nous honorait également de son amitié, nous fîmes une convention. Puisque tu la connais, tu sais avec quelle facilité elle se prête à certaines caresses qu’on dit innocentes. Nous arrêtâmes donc que nous lui prendrions chacun un pied sous la table, et qu’à chaque pression de sa part nous nous avertirions. C’était à mourir de rire ; jamais elle n’a fait de jaloux : à droite, à gauche, et puis à droite et à gauche sans jamais se tromper. Tous les hommes qu’elle rencontre sont à elle : elle en joue comme on joue du piano ; ça l’amuse. Puisqu’elle habite Tarbes, nous allons aller lui faire visite.
— Vous êtes gris.
— Ça ne la fâchera pas.
— Je ne vous conduirai pas.
— Nous irons seuls ; pourvu que nous soyons à six heures au chemin de fer, c’est tout ce qu’il nous faut.
Je finis par céder, car j’aimais encore mieux être près d’eux que de les laisser aller seuls ; et puis j’avais l’inquiète curiosité de voir comment elle les recevrait.
Elle les reçut avec une joie très vive. Depuis deux ans, elle les avait oubliés. C’était presque de nouveaux adorateurs.
Contrairement à ce que j’avais espéré, plus ils causèrent plus ils se grisèrent. Mme Bordenave, qui aimait la dignité, riait jaune de leurs plaisanteries ; Laurence était mal à l’aise ; seule, Suzanne prenait un plaisir extrême à cette visite.
Lorsque nous étions entrés, elle était en train de confectionner, avec le goût et l’adresse qu’elle apportait à ce genre de travail, des chapeaux italiens pour des cousines de province.