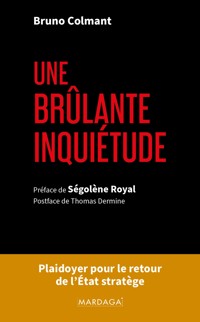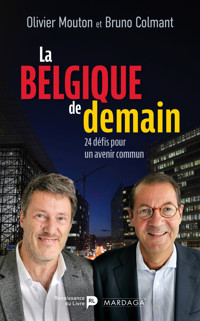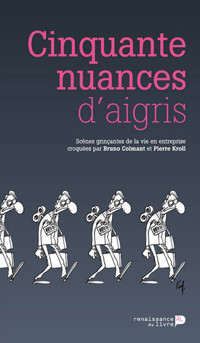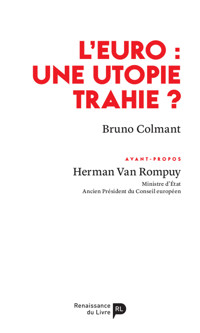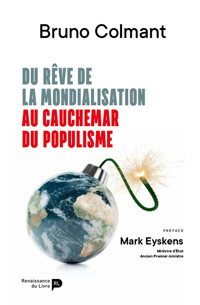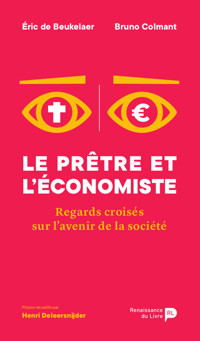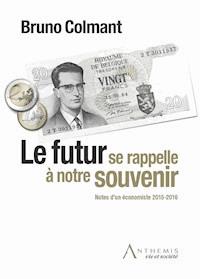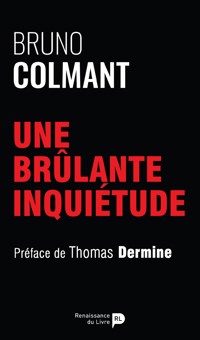
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Renaissance du livre
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Französisch
Pour le titre de son livre, Bruno Colmant s’est inspiré de l'Encyclique de Pie XI contre le nazisme en 1937 qui traduisait à l’époque une grande angoisse face à notre capacité de répondre aux enjeux majeurs du moment. Après quelques années de malaises, les réalités climatiques, militaires, énergétiques et économiques sont les premières secousses de multiples chocs sociétaux d’une envergure titanesque. Tous les déséquilibres vont s’embraser et se conjuguer avec rapidité et violence. Il en résultera des conflagrations écologiques et socio-économiques dont les premières détonations sont aujourd’hui audibles. Face à ces défis stupéfiants, il faut immédiatement rebâtir l’efficacité stratégique des États européens tout en clôturant l’hégémonie du néolibéralisme anglo-saxon. S’il existe des périodes politiques, il faut désormais un temps étatique.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Une brûlante inquiétude
Renaissance du Livre
Drève Richelle, 159 – 1410 Waterloo
www.renaissancedulivre.be
Édition : Valérie Calvez Relecture : Catherine Meeùs Impression : Arka (Pologne) Photo Thomas Dermine : Nathan De Fortunato
e-ISBN : 9782507057831
Dépôt légal : D/2023/12.763/05
Tous droits réservés. Aucun élément de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans une banque de données ni publié sous quelque forme que ce soit, soit électronique, soit mécanique ou de toute autre manière, sans l’accord écrit et préalable de l’éditeur.
Bruno Colmant
Une brûlante inquiétude
Préface de Thomas Dermine
Miraris quia deficit mundus?Senuit mundus, pressuris plenus est.
Tu es étonné parce que le monde meurt ? Le monde vieillit, il est rempli de malheurs.
Sermon sur la chute de Rome prononcé en l’an 410 dans la cathédrale d’Hippone par saint Augustin (354-430)
PRÉFACE
L’humanité n’a probablement jamais été confrontée à un défi aussi important et pressant que celui du changement climatique. Les rapports du GIEC se succèdent, se ressemblent et nous renvoient, année après année, à notre incapacité collective à agir. Le scénario d’une limitation de la hausse de la température globale à 1,5 °C nécessitait d’agir rapidement et d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Ce scénario semblait encore possible il y a quelques années, mais s’avère aujourd’hui quasiment hors d’atteinte. Le scénario le plus probable serait, selon le rapport du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), celui d’une augmentation de la température moyenne du globe de 2,6 à 2,8 %. Cette trajectoire implique une multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes et des effets d’entraînement potentiellement dévastateurs. Paraphrasant le groupe de rock australien AC/DC, le secrétaire général de l’ONU António Guterres a averti, à l’ouverture de la COP27, que nous étions « sur une autoroute vers l’enfer climatique » (We are on a highway to climate hell).
Depuis l’émergence de la première révolution industrielle, l’humanité a accumulé une dette envers la nature. Cette dernière est aujourd’hui abyssale. Or, contrairement à la dette financière, la dette environnementale n’est ni renégociable ni annulable. À chaque inondation et à chaque période de sécheresse, c’est l’huissier qui vient frapper à la porte et vient nous rappeler que notre dette climatique est maintenant « exigible », pour reprendre le terme avancé dans cet essai.
Une part croissante de la population, tout particulièrement chez les jeunes, ressent aujourd’hui une angoisse profonde par rapport au futur et à notre incapacité à prendre les actions nécessaires pour inverser la tendance. Selon la très sérieuse revue The Lancet, 45 % des jeunes de 16 à 25 ans dans les pays du Nord comme du Sud souffriraient d’écoanxiété, qui se traduit par une impossibilité de se projeter au-delà de 2030. Je suis moi-même père de deux petites filles qui ont aujourd’hui 2 et 6 ans. Et j’avoue que, même en me battant tous les jours pour engager sans attendre la société dans une transition en faveur de sources d’énergie décarbonées, je suis incapable de les imaginer à l’âge adulte vivant dans un monde stable, apaisé et qui ne serait pas en proie à la violence des chocs qui seront générés par le réchauffement climatique.
À l’échelle de l’histoire récente de l’humanité, la transition d’une source énegétique dominante vers une autre n’est toutefois pas sans précédent. Loin de là, même. À l’aube du XIXe siècle, la source d’énergie dominante était encore la force de l’homme et de l’animal. Au tournant du XXe, le charbon a pris cette place et entraîné une envolée de la consommation énergétique. Au milieu du XXe siècle, la houille a à son tour été supplantée comme source énergétique principale par le pétrole et le gaz. Nos sociétés ont donc été capables, au gré des découvertes scientifiques et des ruptures technologiques, de remplacer des sources énergétiques par d’autres, sur un espace de temps relativement réduit. Je perçois dans ces évolutions historiques une once d’espoir pour le futur. D’aucuns argueront, à raison, que nous sommes aujourd’hui bien plus nombreux sur Terre. Et beaucoup clameront qu’il nous faut agir à l’échelle de quelques années, alors que les précédentes transitions se sont déroulées sur plusieurs décennies. Il est bon de rappeler, cependant, que nos capacités de développement et de dissémination technologiques ont elles aussi été décuplées.
Comprendre les moteurs de ces transitions énergétiques passées nous permet d’appréhender les raisons pour lesquelles nous n’arrivons pas (encore) à nous engager pleinement dans la transition qui s’impose à nous aujourd’hui. Premièrement, force est de constater que la technologie joue un rôle majeur. L’avènement du charbon comme énergie première est concomitant avec celui de la machine à vapeur. Et l’arrivée du pétrole est intimement liée à l’apparition du moteur à explosion. La dissémination des technologies énergétiques récentes (renouvelables, hydrogène vert, nucléaire de nouvelle génération) est une composante essentielle de la transition écologique de la société. La modification de nos comportements individuels – de production comme de consommation – en est une autre. Force est cependant de reconnaître que les ajustements de comportements passés n’ont jamais été le fruit de la vertu. Ils ont toujours été induits par la norme ou à travers des variations du signal prix. L’évolution du cadre réglementaire et des mécanismes de fixation des prix, de manière à y intégrer le prix du carbone, constitue dès lors une dimension clé de la transition écologique à venir.
Le problème politique actuel est qu’on assiste à une polarisation stérile et contre-productive du débat politique. D’un côté, nous avons les « techno-optimistes », qui défendent la thèse selon laquelle de nouvelles solutions technologiques (dont certaines ont encore une maturité incertaine) résoudront « par elles-mêmes » la question climatique. D’un autre côté, nous retrouvons des promoteurs de changements sociétaux radicaux minimisant parfois l’impact profond de ces changements sur les catégories sociales les moins favorisées et sur le financement de nos modèles de sécurité sociale (par exemple, le financement d’un système de pension par répartition qui repose intrinsèquement sur une hypothèse de croissance). Or, l’histoire nous enseigne qu’il ne faut pas choisir entre ces deux approches. Elle nous indique, bien au contraire, qu’il y a lieu de les embrasser de concert : nous devons parallèlement nourrir une foi inébranlable dans le progrès technologique et modifier de manière drastique nos comportements, qu’il s’agisse de notre manière de nous nourrir, de nous déplacer ou encore de nous loger. Sur ces deux leviers – la technologie et l’ajustement des modes de vie –, la puissance publique a un rôle majeur à jouer, de sorte qu’aucun des deux ne soit relégué entièrement au court-termisme des marchés.
L’histoire nous enseigne aussi qu’une troisième composante – actuellement largement éclipsée du débat public – est absolument essentielle à toute transition énergétique : le développement ou l’adaptation des infrastructures. Toute transition énergétique s’est historiquement accompagnée – c’est une condition sine qua non – du déploiement massif d’infrastructures nécessaires au transport de l’énergie, des marchandises et des personnes selon le paradigme énergétique en vigueur. Ainsi, la « révolution charbon » s’est accompagnée du creusement de milliers de kilomètres de canaux pour transporter des barges de houille. La Belgique et, singulièrement, la Wallonie ont constitué l’épicentre de ces développements. L’exploitation du charbon a par ailleurs induit des investissements phénoménaux dans le chemin de fer, pour le transport des marchandises et des personnes. Le réseau belge de voies ferrées a d’ailleurs longtemps figuré parmi les plus denses au monde. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, nos infrastructures ont été redessinées afin d’être en phase avec le nouveau paradigme basé cette fois sur le pétrole et le gaz. Notre pays a été quadrillé d’autoroutes pour automobiles, tandis que les capacités de nos infrastructures portuaires ont été démultipliées de manière à pouvoir accueillir d’importants terminaux gaziers. Des réseaux énergétiques d’une ampleur inédite (que ce soient des lignes à haute tension pour l’électricité ou des conduits gaziers) ont progressivement relié nos quartiers et nos sites industriels.
À chaque moment important de notre histoire énergétique, des efforts titanesques ont été réalisés en quelques années. Ils ont durablement modifié la nature même de nos villes, de nos villages et de nos paysages. On estime qu’au plus fort de la transition en faveur du charbon, au milieu duXIXe siècle, ٧ à ٨ ٪ de notre richesse nationale (PIB) était investie chaque année dans la construction d’infrastructures collectives (canaux, chemins de fer…). Et durant les « Trente Glorieuses » (entre ١٩٤٥ et le début des années ١٩٧٠), ٥ à ٦ ٪ de notre PIB était investi annuellement dans nos réseaux énergétiques et de transport pour s’adapter au nouveau paradigme énergétique basé sur le pétrole et le gaz.
À compter du début des années ١٩٨٠, dans un contexte marqué par le virage néolibéral des années Thatcher-Reagan, le taux d’investissements publics a rapidement chuté. En Belgique, il est passé largement en deçà de ٣ ٪ et n’est jusqu’à nos jours plus jamais remonté au-dessus de ce seuil.
Là se trouvent tout le paradoxe de notre époque actuelle et, probablement, l’une des principales causes de notre angoisse collective et de l’écoanxiété des jeunes : depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais un défi sociétal n’a été aussi pressant et n’a fait l’objet d’une prise de conscience aussi large que le défi climatique. Pourtant, collectivement, nous n’avons jamais consacré aussi peu de ressources à construire notre futur et, singulièrement, à adapter nos infrastructures aux impératifs de la transition qu’il nous faut conduire. Les investissements en infrastructures que nous devons mener à bien concernent tant les réseaux verts de mobilité que la démultiplication des capacités de production d’énergies renouvelables, la construction de réseaux énergétiques d’un genre nouveau (ceux-là mêmes qui permettront de transporter de l’hydrogène vert ou du CO2 capté pour être enfoui) ou encore des projets de rénovation énergétique ou de reconstruction du bâti existant.
L’ouvrage de Bruno Colmant nous permet de mieux comprendre ce paradoxe entre cette prise de conscience climatique et notre incapacité collective à mobiliser les ressources afin de s’engager résolument en faveur d’une transition écologique. Il diagnostique une incompatibilité fondamentale entre la capacité de nos sociétés à prendre le virage nécessaire afin d’assurer leur viabilité à long terme et le fonctionnement néolibéral de nos économies. Ces dernières sont en effet dominées par un court-termisme aveugle qui dissout les structures collectives et solidaires susceptibles d’impulser la transition nécessaire. Le néolibéralisme n’est pas tant une idéologie qu’une pratique gouvernementale et une conception du rôle de l’État qui étendent la rationalité de marché à la relation qui unit les hommes entre eux ainsi que les hommes à la nature. Se faisant, il sape la solidarité qui relie instinctivement les humains entre eux ; il renie la hiérarchie des valeurs qui fonde l’humanité et détruit l’harmonie qui a, durant des milliers d’années, caractérisé la cohabitation des humains et du vivant. Pis encore : il rend impossible tout pilotage actif de nos structures collectives par rapport à des enjeux sociaux ou environnementaux qui échappent à la rationalité des marchés.
Bruno Colmant initie à travers cet essai une réflexion visant à réhabiliter une forme d’« État stratège » : un État fort qui refuse d’être subordonné au marché, qui parvient à canaliser sa puissance et à l’utiliser pour amplifier son action. Il n’est pas question, comme dans la doctrine communiste, d’un effacement total de la logique de marché, laquelle demeure le mécanisme le plus efficace pour allouer des ressources rares selon les préférences variables des individus. Il en va plutôt de la reconnaissance des limites évidentes de cette logique, que ce soit pour des biens dits « stratégiques » (énergie, ressources naturelles, biodiversité, qualité de l’air, de l’eau, des sols, etc.) ou pour des champs collectifs qui lui échappent (enseignement, santé, mécanismes de solidarité et de prévention). Pour reprendre une formule consacrée, « le marché sans la règle de droit, c’est la jungle néolibérale ; la règle de droit sans le marché, c’est la bureaucratie communiste ». Il n’y a pas à choisir entre l’une et l’autre. Il s’agit de les combiner habilement en s’assurant que l’État, en tant que garant et représentant de l’intérêt général, conserve les leviers indispensables pour pouvoir agir, en particulier dans des situations qui exigent de subordonner le fonctionnement de l’économie de marché à des impératifs urgents et vitaux, comme c’est le cas dans des situations de crise, que celles-ci soient sanitaires, sécuritaires ou environnementales.
Témoin de premier plan des deux conflits mondiaux du XXe siècle, John Maynard Keynes est probablement l’économiste praticien le plus génial que le siècle dernier ait porté. Il a notamment théorisé le concept d’« économie de guerre » : lorsqu’une menace impérieuse met en joue les intérêts ultimes de la nation, le fonctionnement classique de l’économie devient inopérant, car les mécanismes de fixation des prix ne permettent pas une mobilisation suffisante de ressources humaines et matérielles pour répondre à l’urgence du péril. Il revient alors à la puissance publique de se substituer temporairement au marché afin que les efforts et les ressources soient démultipliés et concentrés sur ce seul objectif. La définition par Keynes d’« économie de guerre » ne prenait alors de sens qu’en opposition à l’« économie de paix », alors identifiée à l’économie classique libérale. L’« économie de guerre » impliquait donc un rôle fort de l’État pour suppléer aux forces du marché de telle sorte que l’économie soit totalement mobilisée à des fins militaires. Il faut certainement réhabiliter ce concept d’« économie de guerre » dans le contexte actuel – ce qui prend davantage de sens encore aujourd’hui, depuis l’invasion russe en Ukraine – et plaider pour une mobilisation totale de l’économie en faveur de la transition écologique. Promouvoir un État fort qui assume son rôle avec efficacité et qui oriente les ressources sociétales vers la transition est aujourd’hui la seule option afin de s’engager de manière crédible en faveur d’un paradigme décarboné et espérer rencontrer – autant que faire se peut – l’objectif poursuivi à travers l’accord de Paris, à savoir limiter le réchauffement climatique à un niveau bien inférieur à 2, de préférence à 1,5 °C, par rapport au niveau préindustriel. Keynes renvoyait au rôle de l’État en « économie de guerre » ; Bruno Colmant réhabilite le concept en définissant les contours d’un « État stratège ».
Cet essai esquisse les possibilités, mais aussi les limites de cet « État stratège » réhabilité, notamment lorsque l’auteur y décrit la cohabitation complexe entre cette ambition et la mondialisation actuelle des flux économiques, qui écartèle le pouvoir politique et conduit « à l’effondrement du pouvoir d’achat des bulletins de vote ». Le ton de cet ouvrage peut parfois paraître excessivement pessimiste dans sa formulation, voire catastrophiste dans son intuition, mais il est selon moi d’un intérêt de salut public. Il est en effet impératif de conscientiser sur ces enjeux et d’éveiller les esprits (jeunes et moins jeunes) sur le rôle essentiel de l’État. Ce dernier, alors qu’il est tant décrié, joue en effet un rôle clé dans l’activation des leviers collectifs face aux problèmes climatiques. S’indigner est un prérequis nécessaire, agir individuellement est indispensable, mais tout changement majeur à l’échelle de la société, depuis l’acquisition des droits individuels jusqu’à la construction de la sécurité sociale, a toujours requis une adaptation de la norme et du périmètre de l’action de l’État. Sans être certain qu’il témoignerait du même optimisme aujourd’hui, le président Kennedy avait pour habitude de dire qu’« il n’y a pas de problème créé par l’Homme qui ne peut être résolu par l’Homme ». La seconde partie de la phrase, moins connue, est pourtant plus pertinente : « la nature de la solution doit être proche de celle du problème ». Il serait donc illusoire de croire aujourd’hui que, face à des problèmes qui sont, par essence, de nature collective, on puisse imaginer d’autres solutions que des solutions collectives, qui s’imposent à tout un chacun et qui transcendent les ajustements laissés au gré des volontés ou des capacités, financières ou autres, des individus. L’épidémie de Covid-19 en offre un bel exemple : la réponse à un problème collectif qui touche les interdépendances entre individus ne peut être trouvée que dans des solutions collectives qui s’imposent à tous avec le moins d’exceptions possible.
L’intuition que je porte sur le monde, partiellement forgée par mon expérience au sein du gouvernement fédéral belge, reste porteuse d’espoir. Je décèle des signes, que j’espère avant-coureurs, de ce virage vers un « État stratège » auquel nous aspirons. En matière d’investissements publics pour la transition verte, la Commission européenne vient, pour la première fois de son histoire, de créer un instrument, « Next Generation EU », afin de rassembler des ressources européennes en faveur de la transition écologique. Ces investissements massifs ne peuvent en effet être financés qu’au seul niveau qui dispose des leviers monétaires. Au niveau belge, après près de quatre décennies de baisse continue, les investissements publics viennent de repartir à la hausse. Ils atteindront 3,5% du PIB en 2024 et 4% en 2030. Alors que la notion de politique industrielle était quasiment devenue un « gros mot », l’Europe a pris conscience de ses vulnérabilités par rapport au reste du monde. Ainsi, pour la première fois depuis sa création, des politiques industrielles coordonnées ont été déployées dans des secteurs aussi stratégiques que celui des batteries, des semi-conducteurs ou du matériel médical. Au niveau belge, le holding de l’État fédéral (la Société fédérale de participations et d’investissement ou SFPI) a vu ses missions étendues pour participer à l’ancrage d’entreprises stratégiques, en particulier dans les secteurs qui contribuent à la transition. Pour la première fois depuis le dépeçage du secteur financier belge des années 1980 et 1990, l’État fédéral réinvestit dans le capital d’institutions financières belges de premier plan. Même en ce qui concerne la mondialisation, nous sommes en train d’assister à une convergence salariale et réglementaire rapide entre parties du monde qui va diminuer l’intérêt de la délocalisation. Dans le même temps, la possible instauration à court terme d’une taxation carbone aux frontières ouvre de nouvelles perspectives, notamment en matière de réindustrialisation afin de recouvrer un volant stratégique européen plus large.
Lire cet essai de Bruno Colmant, c’est traverser le temps et se rappeler une époque, pas si lointaine, où le « culte de l’intérêt général » nous a permis de construire une société meilleure. Lire cet essai, c’est traverser des océans et découvrir que les Iroquois intégraient déjà la nature et les générations futures dans leurs prises de décision collectives. C’est aussi voyager au gré d’une intuition qui nous promène, de Marx à Beveridge, chez les penseurs modernes de l’action de l’État avec une vivacité inattendue et un lien urgent au présent. Mais lire cet essai, c’est aussi découvrir les contours d’un projet humain à même de remobiliser face aux défis de notre temps et de redonner un gouvernail à un monde qui peut parfois sembler à la dérive. Selon la formule, durer en politique, c’est perdre toutes ses illusions en gardant son idéal. Malgré certaines illusions perdues, cet essai m’aura à tout le moins permis de renforcer cet idéal.
Thomas Dermine
L’INSPIRATION D’UNE ENCYCLIQUE
J’ai intitulé cet essai Une brûlante inquiétude en référence à l’encyclique Mit brennender Sorge de PieXI, rédigée en allemand, transmise clandestinement dans l’Allemagne nazie de 1937 pour être lue le jour des Rameaux.
Ce titre usurpé m’a inspiré, car l’encyclique de ce pape, même tardive, fut son legs dans un monde happé par l’histoire. Il y mettait en garde contre les forces du mal qui allaient se déchaîner deux ans plus tard et dont les premières manifestations étaient déjà audibles. La même année, en 1937, Paul Valéry (1871-1945) écrivait «le temps du monde fini commence ».
« L’odeur du monde a changé », comme l’avait auguré l’académicien français Georges Duhamel (1884-1966), cité par Charles de Gaulle (1890-1970, président français entre 1958 et 1969), entre les deux conflits mondiaux.
Je crains que nous ne soyons, comme en 1937, à l’aube de gigantesques basculements sociétaux, notamment climatiques et environnementaux. Nous sommes à un moment essentiel de l’histoire et peut-être devant des temps catastrophiques. Pour citer le philosophe, écrivain et théoricien politique italien Antonio Gramsci, décédé cette même année1937, l’ancien monde est en train de mourir et le nouveau a du mal à naître.
J’ai voulu, au travers de ce court essai, partager une inquiétude et des intuitions, sans sombrer dans un pessimisme stérile.
Au terme de quarante années d’économie de marché, je réalise que pour le climat, l’énergie, la protection du pouvoir d’achat et le respect des équilibres sociaux, le néolibéralisme anglo-saxon de Ronald Reagan (1911-2004, président des États-Unis de 1981 à 1989) était une prostituée, un triste mensonge et une illusion manipulée. Même le Fonds monétaire international (FMI) l’a dénoncé. Quelle tragédie! Parce que le néolibéralisme, contrairement au libéralisme, place le marché au-dessus de l’individu et le postule comme l’origine de la liberté. Mais la liberté de quoi? Un marché est une négociation, donc une prison qui enserre ses acteurs dans une frénésie mortifère! Dans son essai Il faut dire que les temps ont changé1, publié en 2018, l’économiste français Daniel Cohen (1953-) rappelait que le capitalisme est le résultat d’un pacte faustien entre la science et la monnaie, ce qui pose incidemment la question de l’utilité sociale de l’innovation financière. On n’est pas loin des thèses de l’économiste hongrois Karl Polanyi (1886-1964) qui soulignait l’absence de naturalité et d’universalité du marché.
Et, lorsque je relis les postulats du néolibéralisme des années1980, promu par une technocratie spéculative, auxquels j’ai pourtant cru, je me dis aujourd’hui: quelle vulgarité intellectuelle! Quelle pauvreté de la pensée! Dans le discours inaugural de sa présidence, Ronald Reagan avait affirmé en 1981: «The government is not the solution to our problem; government is the problem. » Comment n’avons-nous pas compris l’ignominie de ce postulat? Au reste, je crois que nous avons trop vite cédé à l’idée que l’économie de marché entraînait l’atrophie des conflits sociaux, comme si la pseudodémocratisation du capitalisme anglo-saxon avait dilué les classes sociales et les idéologies. C’était une imposture, car il se passe quelque chose.
Mon texte traite de l’impérieuse nécessité de réhabiliter de manière épistémique des États stratèges. En effet, je constate la perte des valeurs supérieures qui contraignent la pensée socio-économique. Il y a quelques décennies, l’État s’imprégnait d’une vision communautaire qui fondait un aménagement des richesses nationales. Aujourd’hui, il n’est plus une configuration naturelle.
Ma conviction est que l’avenir européen, le seul crédible, est dans la réhabilitation de l’État stratège, unique ancrage sociétal. Je voudrais qu’à l’avenir, le rôle de l’État relève d’une alliance constituée pour mettre chacun à l’abri de l’injustice, notamment économique, mais aussi sociale, médicale, culturelle, digitale et évidemment environnementale. L’État devrait aussi moduler plus efficacement la répartition des revenus vers les plus démunis. Les orientations politiques devraient s’ajuster à la perte d’homogénéité de la communauté afin d’adapter, de manière plus étendue, les réponses socio-économiques. Il s’agirait aussi de restaurer la puissance publique et de soustraire les aspects sociaux et environnementaux aux lois du marché. Il convient également de faire de la place à la société civile et de réhabiliter la médiation dans le temps long.
Sensibilisé aux défis climatiques et environnementaux et aux déséquilibres sociétaux, et certainement en rupture avec les idées que j’ai pu défendre il y a deux décennies, car trop influencées par mon contexte familial et académique américain, ce livre m’anime depuis des années.
Après tout, un livre n’est jamais qu’un dialogue intime transformé en échange collectif.
D’aucuns pourraient néanmoins s’étonner, et donc mettre en doute l’authenticité des idées défendues dans cet opuscule, de me voir mettre en cause le néolibéralisme anglo-saxon après avoir exercé des fonctions dirigeantes dans plusieurs institutions financières, dont la présidence de la Bourse de Bruxelles et la participation au comité de direction de la Bourse de New York.
Mais c’est peut-être ce chemin professionnel qui m’a permis d’observer le système économique avec une prise de conscience différente d’une approche épistémologique. Au reste, cet essai est précédé de deux ouvrages qui l’ont amorcé, à savoir Du rêve de la mondialisation au cauchemar du populisme et Hypercapitalisme: le coup d’éclat permanent, publiés respectivement en 2019 et 2020.
Une lecture séquentielle du livre révélera quelques répétitions. C’est volontaire. J’ai délibérément décliné l’essai autour de chapitres qui sont indépendants les uns des autres.
Après cette mise en contexte, le deuxième chapitre pose les jalons de la réflexion en introduisant l’idée de restauration de l’État stratège qui est le fil conducteur de l’essai. Le troisième chapitre est sans conteste le plus important : il s’attache à l’alerte environnementale. Le quatrième chapitre rappelle les acceptions différentes du capitalisme et l’opposition entre ses versions anglo-saxonne et rhénane. Le chapitre suivant s’interroge sur l’aggravation des fractures (sociales, démographiques, etc.) dans un contexte néolibéral. Le sixième chapitre traite de l’affaissement du sentiment européen. Le septième chapitre se concentre sur la formulation idéologique de l’euro tandis que le chapitre suivant insiste sur la nécessité de la réécriture de la mission de l’État. Le neuvième chapitre offre à la critique des pistes de réflexion dans les objectifs de l’État stratège, tandis que le dixième chapitre conclut le travail d’écriture.
Cet essai est né d’humbles circonstances.
Il est bref et reprend des croquis de réflexions. Il ne traite pas de tous les sujets importants, car j’en ai laissé beaucoup de côté. Il est incomplet et disparate. Il ne sera jamais abouti, car chacun a besoin d’une vie pour trouver les mots pour dire son temps.
Au surplus, le véritable risque de l’économiste est de s’assurer qu’il prend la bonne distance focale par rapport aux événements qu’il circonscrit et tente de qualifier. Or, le temps et la distance manquent toujours, le recul historique aussi, souvent. En économie, il faut s’éloigner des explications déterministes ou séquentielles. Il faut aussi écarter les enchaînements systématiques, les invariants, les ressemblances et les répétitions de scénarios. Il n’y a jamais de référents parfaits, et encore moins de lois économiques intangibles. Au mieux l’économiste peut-il trouver des affinités électives ou des congruences liées à certains contextes. Il lui faut alors les étançonner de manière empirique et donc réfutable. Il court néanmoins le risque de confondre un problème avec ses symptômes, illustrant le sophisme « post hoc ergo propter hoc » qui consiste à confondre un antécédent avec une cause. En économie, il y a moins de séquences de causes à effets que d’événements complexes qui s’entrelacent et s’entrechoquent.
J’ai rédigé cet essai avec enthousiasme et passion et un profond sentiment de liberté d’écriture retrouvée.
Mais j’ai aussi écrit ces quelques pages dans l’inconfort et l’intranquillité. Et surtout à l’écoute de nombreuses femmes et de nombreux hommes politiques et intervenants de la vie civile, dans la consultation d’études et d’ouvrages, la nuit très souvent, d’étés ensoleillés en pluies de novembre, de renoms en pressentiments, d’inquiétudes en résignations, d’abandons en sursauts, de doutes en convictions et surtout de soumissions en révoltes.
À « au commencement était l’action » duFaust de Johann Goethe (1749-1832), l’écrivain François Mauriac (1885-1970) ajoutait qu’« écrire, c’est agir ». Chaque page est pourtant empreinte d’hésitations, de pusillanimités et d’insatisfactions du manque d’aboutissement des idées.
L’écriture reflète l’urgence de témoigner. Offrir un texte à la critique est pourtant une démarche fragilisant son auteur. Un essai, c’est d’abord une offrande à la contradiction et une tentative hasardeuse, mais que j’espère féconde, de déchiffrage de l’avenir. Cette réflexion ne constitue rien d’autre qu’un faisceau de frôlements intellectuels.
J’espère que ces quelques pages lanceront des flèches qui feront vibrer quelques objections, idées, débats et doutes.
Bruno ColmantBruxelles, 2022-2023
1 D. Cohen, Il faut dire que les temps ont changé – Chronique « fiévreuse » d’une mutation qui inquiète, Paris, Albin Michel, 2018.
I. POURQUOI CETTE RÉFLEXION?
Depuis plusieurs années, l’économie planétaire est mondialisée, c’est-à-dire qu’elle est caractérisée par un phénomène d’ouverture des économies nationales sur un marché mondial, entraînant une interdépendance croissante des pays. Contrairement aux mondialisations occidentales partielles et précoces (l’Empire romain, l’épopée viking, la route des Indes, la découverte des Amériques et le très critiquable temps des colonies en étant des illustrations), la mondialisation contemporaine est globalisée. De surcroît, la globalisation est bien plus puissante que l’internationalisation, qui se limitait à des ouvertures entre pays, alors que la globalisation permet à des entreprises privées d’être planétaires.
Mais ce n’est pas tout: la mondialisation occidentale s’est effectuée dans le contexte d’une économie de marché néolibérale, dont l’instabilité est à la fois son danger et son dynamisme.
Dans ce cadre, mon intuition était qu’il fallait restaurer des États que j’avais qualifiés, il y a une quinzaine d’années, dans les premiers textes que j’y avais consacrés et sans que je n’en sois aucunement l’inventeur du terme, de stratèges.
Il me semble aujourd’hui que cette exigence s’accentue dans la séquence des multiples crises que nous traversons et dont les différentes composantes (environnementale, sanitaire, militaire, monétaire et énergétique) sont devenues inextricables. Sans désavouer aucune espérance ou me prévaloir d’une arrogance historiale, les crises vont atteindre leur paroxysme dans les cinq prochaines années.
C’est cela qui m’a poussé à rassembler des idées dans cet essai.
L’état stratège
L’État stratège est un concept polysémique et syncrétique: chacun en aura une définition.