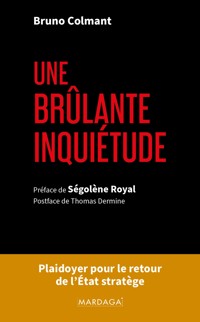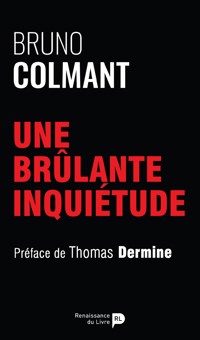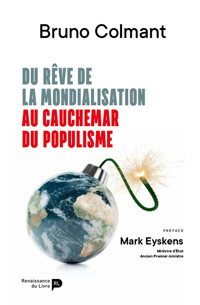Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mardaga
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
À quelques mois des élections fédérales qui mettront la Belgique face à d'importants choix politiques, Olivier Mouton et Bruno Colmant passent en revue les 24 défis de la Belgique de demain. Les sujets traités sont très divers et vont de la monarchie à l'enseignement, en passant par une réflexion sur l'expression démocratique, la jeunesse, les pensions, l'environnement ou encore l'énergie et la fracture linguistique. Leur échange sur ces défis se veut positif et orienté vers des solutions. Pour chacun des sujets traités, ils tentent d'apporter des idées novatrices et un regard nouveau. Leur objectif est ainsi d'alimenter le débat et d'instaurer un dialogue ouvert à la critique, exempt de toute allégeance politique.
À PROPOS DES AUTEURS
Bruno Colmant est membre de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. Docteur en économie appliquée, il enseigne à l'ULB, l'UCLouvain et la Vlerick Business School.
Olivier Mouton – après avoir travaillé pour La Libre Belgique, Le Soir et Le Vif – est journaliste à Trends Tendances. Il est l'auteur de plusieurs livres politiques, dont des biographies de Guy Verhofstadt, Charles Michel et Carles Puigdemont.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Belgique de demain
Olivier Mouton et Bruno Colmant
La Belgique de demain
24 défis pour un avenir commun
Olivier dédie cet ouvrage à Frédérique, Ashley et Molly. Bruno le dédie à sa fille Julie.
Introduction
La Belgique, un pays aux multiples facettes, fait face à une conjoncture critique. Des élections imminentes jettent une lumière crue sur des défis de taille et sur une période de transformation radicale. Nous avons décidé de briser le silence et de mettre en lumière 24 thèmes révélateurs de ces réalités, de la monarchie à l’expression démocratique, des fractures linguistiques aux réalités socio-économiques, en passant par l’enseignement. Ils instaurent ici un débat sans filtre, exempt de toute allégeance politique.
La destinée du pays se dessine à travers une série de thèmes variés qui représentent le cœur du débat public. Les idées exposées ici ne visent pas à offrir une solution unique, mais à stimuler la discussion, à questionner nos préjugés et à encourager une réflexion collective plus approfondie.
L’avenir du pays, la Wallonie et Bruxelles, les élections, la démocratie, les élus du peuple, le dialogue Nord-Sud, la fiscalité, la carrière, les pensions, les allocations sociales, Bruxelles en tant que ville, l’environnement, l’énergie, la monarchie, l’enseignement, le néolibéralisme, la vision à long terme, l’économie, l’innovation, la politique internationale, la défense, le budget, la jeunesse et la justice : tous ces thèmes sont scrutés, analysés et discutés dans les pages qui suivent.
En abordant l’avenir du pays, l’ambition est de clarifier un système de plus en plus complexe, d’encourager une plus grande autonomie et d’oser sortir des sentiers battus. La Wallonie et Bruxelles sont considérées comme des priorités absolues en matière de rénovation et de responsabilisation. En matière d’élections, l’objectif est de repenser les circonscriptions fédérale, wallonne et bruxelloise. En matière de démocratie, il est question d’encourager une plus grande participation citoyenne et un recours accru à l’expertise.
La question des élus du peuple est également abordée, avec une réflexion sur l’arrêt des carrières politiques sans fin, sur l’efficacité et la responsabilisation de l’administration. L’attention est ensuite portée sur le dialogue Nord-Sud, la fiscalité, la gestion des carrières, les pensions et les allocations sociales.
Bruxelles, l’environnement, l’énergie et la monarchie sont autant de sujets qui font l’objet d’une réflexion approfondie. L’enseignement est perçu comme un besoin de révolution culturelle, avec un pacte d’excellence accéléré et une nouvelle approche de l’apprentissage intégrant les technologies.
Chacun des thèmes susmentionnés se voit attribuer un chapitre dédié, débordant d’idées innovantes, de critiques constructives et de propositions audacieuses.
Dans les pages suivantes, nous vous invitons à un dialogue ouvert, libre de toute contrainte et toute conformité. Il s’agit d’une invitation à redéfinir ensemble la Belgique de demain. Car si le défi est grand, l’espoir l’est tout autant. Les défis présents ne sont pas une fatalité, mais une opportunité de construire un avenir plus juste, plus équilibré et plus dynamique pour la Belgique.
DÉFI N° 1 L’avenir du pays
Olivier Mouton – Nous allons vivre une période importante et déterminante pour l’avenir de la Belgique. On sous-estime parfois les tensions, les polarisations, le fossé Nord-Sud, les extrêmes qui montent, autant de phénomènes qui généreront ces six années prochaines des discussions cruciales pour notre pays. En 2030, la Belgique fêtera son bicentenaire et ce rendez-vous symboliquement important peut cristalliser beaucoup de sentiments. La nécessité d’une réforme de l’État est dès à présent invoquée par les partis flamands – Vlaams Belang et N-VA en tête –, mais les autres partis traditionnels, affaiblis, pourraient ne pas être en reste, on le voit déjà avec le CD&V. Ce sera un des enjeux majeurs des élections en 2024, mais aussi au-delà. Ce sera une période existentielle.
Selon moi, le système fédéral tel qu’il existe aujourd’hui ne fonctionne pas encore de manière optimale. On ne peut se soustraire à une vraie discussion sur l’avenir du pays. Il s’agit également de mener cette réflexion sur une base différente de ce qui a été fait par le passé, avec l’efficacité de fonctionnement de l’État réellement au centre des préoccupations. Le gouvernement d’Alexander de Croo a initié une consultation populaire baptisée « Un pays pour demain ». Elle intègre d’autres considérations que les strictes questions institutionnelles, notamment en évoquant la nécessité d’un renouveau démocratique. Cela a, au moins, le mérite de sortir des idées reçues. C’est indispensable.
La NV-A et le CD&V répètent qu’il faut déplacer le centre de gravité du pays. C’est une petite musique qu’on entend depuis le début du siècle. Elio Di Rupo (PS), quand il était Premier ministre, s’était félicité de l’avoir fait lors de la sixième réforme de l’État. Mais le chemin n’est pas fini. Il reste une discussion à avoir sur davantage d’autonomie et de responsabilisation des entités fédérées, ainsi que sur des réformes de fond au niveau fédéral. Il me semble qu’on doit mener ce grand chantier avec un seul souci, celui de l’efficacité. C’est un terme qu’on a souvent utilisé, mais sans lui donner corps. Aujourd’hui, même certains ministres ne savent pas dans les détails dans quelles matières ils sont compétents. À mes yeux, c’est désormais la priorité de veiller à des paquets de compétences homogènes.
La gestion de la pandémie de Covid-19 a été intéressante à cet égard. Un Comité de Coordination fort, rassemblant le gouvernement fédéral et les entités fédérées, fut l’endroit où se rencontrent les aspirations de tous. Un tel Comité devrait fonctionner en permanence : je ne comprends pas que l’on n’en ait pratiquement plus entendu parler après la pandémie. Cela devrait être un cénacle où se discutent tous les enjeux importants.
Oui, il faudrait repenser l’avenir du pays, sans tabous.
Bruno Colmant – La Belgique, à mes yeux, est un pays dont le fonctionnement n’atteint plus son optimalité. Je me suis souvent interrogé sur les raisons qui ont l’ont conduite à devenir un pays si complexe, encombré d’institutions tortueuses et paralysantes, incapable de se réinventer ou d’exprimer une vision sociétale claire, au sein d’un État alourdi par une administration pesante. La réponse réside probablement dans le défi que représente la gestion de populations appartenant à quatre régions linguistiques aux inclinaisons culturelles, sociales et politiques divergentes.
Toutefois, l’explication pourrait également se trouver dans la nature artificielle de l’existence du royaume. La Belgique a dû s’inventer une existence, étant un territoire incertain, à peine délimité par 60 km de côtes et dépourvu de l’estuaire de l’Escaut. Mis à part les deux guerres mondiales, qui ont vu son territoire, pourtant neutre, servir de champ de bataille à l’armée allemande, aucun événement majeur n’a altéré son existence. C’est un pays aux frontières géographiquement ambiguës qui ne possède de légitimité qu’en tant que zone de transit entre ses partenaires économiques.
Pour exister sans devoir résoudre ses contradictions, la Belgique s’est placée dans l’incapacité de se renouveler. Le pays s’est volontairement complexifié de l’intérieur, puisqu’aucune barrière, géographique ou géologique, ne lui permet de se distinguer.
De plus, la prise de décision politique décisive est presque impossible en raison d’une représentation proportionnelle exigeant des compromis constants. Cette complexité institutionnelle assure, malgré une inefficacité évidente et une gestion sous-optimale alourdie par l’administration, l’obligation permanente du consensus. Les réformes, donc, sont rares et toujours marginales. La Belgique est, il faut en accepter le constat, un pays d’immobilités et de droits acquis, et je le regrette.
Sur le plan économique, le sud du pays a mis des décennies à se débarrasser de l’ombre d’une révolution industrielle obsolète, tandis que le nord a choisi, en s’appuyant sur un projet régionaliste, de devenir l’une des régions les plus prospères d’Europe.
Deux visions de l’avenir du pays se dégagent. Soit la Belgique est perçue comme un non-pays et devient une zone administrée, un assemblage de ses partenaires économiques, nul besoin alors d’une direction autonome puisqu’elle serait dictée par ces derniers à travers les flux économiques. Ou, et c’est l’option que je préconise, on mise sur une régionalisation plus poussée, qui reconnaît les particularismes tout en refédéralisant les compétences régaliennes.
Par ailleurs, l’entrée dans la zone euro a dépossédé le pays d’un attribut de sa souveraineté : la mesure de sa performance monétaire. Simultanément, le contrôle de notre dette publique, qui constituait l’une des conditions d’entrée dans la zone euro, s’est trouvé dilué au sein du vaste marché des capitaux mondiaux. On sous-estime d’ailleurs la corrélation qu’ont peut établir entre l’absence de décisions politiques et l’immersion dans la zone euro. Si le franc belge avait toujours cours, sa parité de change serait un baromètre de la qualité de la décision politique. Et il serait, à mon estime, bas.
O. M. – Ce serait une Belgique à quatre : Flandre, Wallonie, Bruxelles, Communauté germanophone.
B. C. – À quatre, avec une évidente proximité linguistique et institutionnelle entre Bruxelles et la Wallonie. Il est vraiment temps de repenser le pays, de manière apaisée, lucide, constructive et dans l’écoute des représentants de toutes les Régions et Communautés. Le fait régional est circonscrit, mais il n’est pas assumé. Avec effectivement, comme tu le disais, un Comité de Coordination qui serait un organe de synthèse. On pourrait institutionnaliser le Comité de Concertation en étendant ses pouvoirs. Ce serait une dynamique qui épouse beaucoup mieux la réalité contemporaine du pays parce que les frontières géographiques ont moins de pertinence aujourd’hui qu’auparavant. Cette configuration signifie que Bruxelles doit être une Région autonome comme les autres Régions et Communautés, mais qu’il faut renforcer les synergies entre les Régions et revoir la distribution de l’impôt des personnes physiques selon le lieu de travail, ce qui est d’ailleurs une tendance européenne. Dans cette perspective, l’État fédéral est garant des matières régaliennes en tant que responsable du fonctionnement d’un fédéralisme coopératif. Le secret n’est pas dans le morcellement des compétences, mais dans leurs modularités et leurs complémentarités.
O. M. – La Belgique fait en effet partie intégrante de la dynamique européenne. Notre pays a été créé comme une espèce de tampon entre les puissances. Il est devenu, au fil du temps, un lieu de rencontre des deux grandes cultures continentales, latine et germanique. Il a, naturellement, accueilli à Bruxelles les institutions européennes. On n’apprécie pas assez ces dimensions qui sont un privilège et une force. Au fond, c’est un laboratoire de cohabitation. Je me rappelle qu’à une époque, dans les années 1990, des délégations venaient notamment d’Israël pour voir comment on avait réussi à organiser une gestion pacifique de Bruxelles, afin de s’inspirer de cet exemple pour Jérusalem. Ce modèle de cohabitation pacifique existe toujours, mais il doit être réinventé. Car les forces centrifuges sont de plus en plus importantes.
B. C. – Ce qui est assez singulier dans ce pays, c’est qu’on a des forces qui sont à la fois centrifuges en termes régionalistes, mais également une retenue centripète, car on a rendu le pays trop complexe pour le déliter. C’est à ce niveau qu’on n’a pas réussi à faire la synthèse. On ne peut pas avoir une administration et une structure institutionnelle tellement complexes que personne ne les comprend, pour conserver une cohérence apparente au pays et, en même temps, annihiler ou contrarier les forces centrifuges. Ce qui crée l’immobilisme dans le pays, ce sont ces forces opposées, antagonistes, de nature administrative d’une part, de nature régionaliste d’autre part. C’est pour cette raison qu’un choix doit être fait. On peut très bien simplifier les choses en acceptant ces forces centrifuges,en renforçant l’autonomie régionale, tout en déterminant ce qu’on veut absolument conserver au niveau fédéral.
O. M. – Je te rejoins évidemment sur le fait que des choix doivent être faits. Je pense que Bruxelles est un élément important du lien qui nous unit, si pas le plus important. La capitale est vraiment ce qui rend la séparation du pays impossible, en raison de son importance internationale et de son rayonnement économique. Les uns et les autres en ont besoin. Un autre élément fondamental, davantage pour les francophones que pour les néerlandophones en l’occurrence, c’est le lien de solidarité, institutionnelle, mais aussi individuelle, la sécurité sociale. Ce lien doit être soigné. Moi, j’ai souvent regretté que les francophones disent toujours aimer le pays, vouloir la Belgique, mais sans accepter qu’on vive avec la Flandre et qu’il y ait une responsabilité à son égard. Nous devons assumer le fait que ce lien de solidarité implique des responsabilités, aussi. Cela doit être mis sur la table, dans une vraie discussion.
Ce n’est pas évident, surtout quand tu discutes avec des nationalistes. On a eu le CVP, le CD&V pendant longtemps, on a tergiversé, maintenant la N-VA et peut-être demain, si on tergiverse encore, le Vlaams Belang. Cela me semble indispensable de crever l’abcès. Même si, quand on parlera de la responsabilisation budgétaire pour la Wallonie et Bruxelles, on ne va pas s’amuser.
Des choix clairs doivent également être posés en termes de répartition de compétences. C’est incroyable qu’on ait autant de ministres de la Santé : huit ou neuf ! La prévention se trouve au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les hôpitaux au niveau régional et toutes les normes au niveau fédéral : cela n’a pas de sens. Le CD&V veut regrouper toutes ces compétences au niveau des Communautés. Je trouve que ce serait plus logique de faire une vraie plateforme pour la santé au niveau fédéral. En revanche, en matière d’emploi, une autre compétence complètement morcelée, on pourrait regrouper cela au niveau régional : cela permettrait de tenir compte de nos sensibilités différentes.
B. C. – Je suis d’accord avec toi. En matière de sécurité sociale, il faut garder une solidarité parce que c’est bien plus qu’une solidarité statique : c’est l’essence même de la trame sociopolitique du pays que certains partis veulent déconstruire. Elle ne peut pas s’exprimer en termes linguistiques et son point de départ est ancré dans le passé. Tous ces transferts intra et intergénérationnels sont des liens de solidarité qui se sont construits au cours du temps. Donc, on ne peut pas dire à un moment qu’on va régionaliser les pensions, par exemple, alors qu’en réalité, celles-ci sont dues à des personnes qui ont construit la Belgique dans sa globalité, dans une autre formulation et des temps révolus. En revanche, tu as raison, on pourrait le faire en matière d’emploi et certainement aussi, à mes yeux, en matière de fiscalité, avec l’impôt des personnes physiques, mais aussi l’impôt des sociétés. On devrait avoir des logiques qui sont différentes parce qu’on ne parle pas de solidarité, on parle de capacité contributive des travailleurs, des rentiers, des entreprises. D’ailleurs, de manière morphologique, le pays n’est pas le même. Quand on voit les industries flamandes et wallonnes, on ne parle pas de la même chose. C’est une logique qui est à la fois une reconnaissance de forces centrifuges qui ne sont pas basées sur la solidarité, mais bien sur la contribution à la croissance de demain.
Dans ce cadre, je suis étreint par une préoccupation plus profonde. En 2030 – c’est-à-dire demain –, nous aurons probablement fait face à un krach écologique qui s’accompagnera de grandes fissures dans l’économie. J’entends par là des fractures générationnelles, sociales, patrimoniales, éducatives, et bien sûr professionnelles avec l’implosion sociétale plausible qu’apporte l’intelligence artificielle. L’homogénéité de notre société occidentale s’est incontestablement dégradée, et des pans entiers de la population vivront un décrochage, si ce n’est un effondrement social. De nombreux citoyens du monde, écartés de la mondialisation par une sphère marchande oppressante et alimentant l’image de désirs qu’ils ne peuvent matériellement assouvir, sont en perte de dignité humaine. Les réseaux sociaux enflent les pulsions narcissiques de personnes qui deviennent malheureusement les victimes d’une économie irradiante, mais inaccessible. Cette précarisation s’inscrit elle-même dans une désagrégation sociale plus large, caractérisée par une atomisation de la société, une individualisation résignée, un émiettement culturel, la disparition des corps intermédiaires, une désinstitutionalisation des pouvoirs, la fatigue des institutions, etc.
Dans un marché, chaque individu est un mobile qui doit, par oscillations et itérations, trouver son chemin. Nous sommes très loin du modèle social d’après-guerre, modèle qui a pourtant apporté de la cohésion, favorisé une éthique collective très importante, et surtout, donné des chances à chacun. La dérive que nous vivons aujourd’hui est néfaste à l’intelligence collective.
O. M. – Tu parlais de « non-pays » tout à l’heure. En fait, j’ai toujours été fier d’appartenir à un « non-pays ». Je sais que le monde évolue vers des tensions régionales croissantes, la constitution de blocs de puissance, beaucoup de replis sur soi, etc. Or, je trouve que c’est le sens de l’avenir d’avoir un pays fluide, qui se dilue, qui n’a pas une identité forte. Au contraire, c’est précisément une identité forte de dire qu’on intègre toutes les dimensions. Accueillir l’Europe, c’est un atout, tout comme cette capacité à générer du compromis. On a fait du compromis quelque chose de moche, qui est même devenu pratiquement impossible avec la complexité actuelle. Alors que c’est fantastique d’être un pays qui génère cela. Tout comme c’est magique de donner naissance à des artistes de l’absurde. Je ne pense pas à cette notion galvaudée de « surréalisme à la belge », mais par exemple à notre humour qui triomphe pour l’instant en France.
Il faut qu’on puisse donner corps à cette identité. À ce titre, le bicentenaire de 2030 est une perspective importante. Que devrions-nous mettre en avant ? Notre diversité, bien sûr, mais aussi le fait que nous sommes un laboratoire de cohabitation, un laboratoire de paix. Nous sommes un pays qui peut faire de ses faiblesses autant de forces. Il est évidemment important que cette idée soit partagée au Nord et au Sud, et je sais que c’est un enjeu qui ne va pas de soi. Mais il faut aller vers l’autre Communauté, lui parler droit dans les yeux et… dans sa langue. On pourrait présenter un projet qui fait sens : « OK vous avez plus d’autonomie, nous assumons davantage nos responsabilités, mais en même temps, on veut donner cette image au niveau international. C’est peut-être naïf de l’exprimer comme cela, mais cela vaudrait la peine d’essayer.
B. C. – Non, ce n’est pas naïf. Cette réflexion est justifiée parce que cela veut dire qu’on doit modifier le narratif et l’identité collective du pays. La Flandre a mené une réflexion à ce sujet dont le résultat est très équilibré, contrairement à ce que certains appréhendaient, ce qui illustre d’ailleurs la rémanence de préjugés infondés. Cela confirme cette idée que le narratif géographique est désuet, d’autant que la Belgique est une singularité territoriale, ce qui rend d’ailleurs sa pérennité et sa stabilité institutionnelle d’autant plus remarquables. Il faut rappeler que l’administration Roosevelt avait fugacement imaginé créer un nouveau pays qui se serait dénommé Wallonie, en regroupant la partie sud de la Belgique, le Nord – Pas-de-Calais français, et, je crois, le Grand-duché de Luxembourg.
La singularité territoriale est d’autant plus criante qu’à l’intérieur du pays géographique, d’autres géographies se sont imposées. On pourrait donc profiter de la perspective du bicentenaire du royaume pour déterminer ce que sont les attributs non géographiques du pays. Et c’est vrai qu’on peut voir les choses différemment, considérer la Belgique comme un pays d’une certaine qualité et reconnaître en effet le compromis, certes inabouti, comme un instrument positif de plasticité du pays plutôt qu’un attribut détestable.
Quand on voit d’ailleurs ce que le roi exprime comme vision depuis dix ans maintenant, il incarne un monarque des temps modernes. Le roi Philippe est détaché de la période de la guerre et de la Question royale, portant sur le retour du roi en Belgique en 1950 après diverses interprétations de ses actes entre 1940 et 1944, qui mit la monarchie, ou plutôt la personne du roi, au vote. Contrairement au roi Baudouin ou au roi Albert II, il n’est pas accablé par ce traumatisme. Il parle bien sûr de patriotisme dans le sens d’aimer son pays, mais il lui affuble des notions de qualités de solidarité et de liens sociaux : c’est important. Les faveurs nobiliaires récentes reflètent d’ailleurs ce tournant monarchique.
O. M. – C’est vrai, bien que cette représentation reste symbolique. C’est important, mais il s’agira de veiller à l’incarnation politique d’un tel projet. Le modèle confédéral de la N-VA, par exemple, propose un mini-gouvernement composé de ministres des Régions, avec une tête tournante. Pourquoi pas ? La Suisse, qui est un modèle confédéral, fonctionne de cette manière-là.
Ce pourrait être l’incarnation de cette Belgique à quatre dont tu parlais.
B. C. – La question est de savoir si l’Europe va se retrouver dans une Belgique dont la morphologie est moins patriotique. Comme disait Charles de Gaulle, le patriotisme, c’est aimer sa patrie, le nationalisme, c’est détester les autres. L’Europe va-t-elle se retrouver dans une configuration différente en termes institutionnels ? Je ne le sais pas. Heureusement, le royaume reste la capitale de l’Europe et le siège de l’OTAN, ce qui assure un barycentre international. C’est d’ailleurs parce que le pays est une géographie ouverte que des centres décisionnels s’y implantent. Le manque d’ambition nationale ne fait pas d’ombre aux puissances étrangères qui y délèguent une partie de leur souveraineté.
O. M. – Je me rappellerai toujours cette idée, venant du socialiste flamand Louis Tobback, consistant à faire de Bruxelles un district européen. Derrière cela se cachaient évidemment d’autres considérations, notamment la volonté d’obtenir une contribution financière plus importante de l’Europe. Mais une caractérisation plus forte de chacune des quatre Régions serait judicieuse. Cela pourrait aussi renforcer le statut de Bruxelles au sein de l’État. Je n’ai même pas de problème avec le fait de parler d’une Belgique confédérale.
B. C. – Moi non plus.
O. M. – Pour le moment, du côté francophone, on se dit plutôt : « Au secours, un État confédéral ! ». Mais la Suisse est un État confédéral qui a beaucoup de qualités. En raison de la présence en Belgique de deux grandes Communautés principales, c’est plus compliqué d’atténuer les tensions, mais à quatre, ce serait davantage gérable.
B. C. – En Suisse, on constate une domination numérique et financière de la partie alémanique. C’est parfaitement assumé d’ailleurs. Mais ma préférence me conduit à l’accentuation du modèle régionaliste à quatre avec une rétention fédérale des compétences régaliennes et qui fondent le lien de sécurité sociale. Et une connivence naturelle entre les Régions bruxelloise et wallonne qui permet de respecter l’attachement linguistique. C’est d’autant plus important que la Belgique va vivre une période importante avec des tensions, des polarisations, et des enjeux cruciaux. Le système fédéral actuel doit être réformé pour une efficacité de fonctionnement de l’État dans une reconnaissance accrue du fait régional tout en conservant certaines compétences régaliennes au niveau fédéral.
DÉFI N° 2 La monarchie
O. M. – Je voudrais débuter ce chapitre consacré à la monarchie par un souvenir. J’ai eu la chance d’interviewer à de nombreuses reprises Wilfried Martens, qui fut quand même un Premier ministre incarnant la Belgique durant plus d’une décennie, dans les années 1970-1980. C’était un personnage attachant, mélange d’austérité pragmatique et de charisme par défaut. C’était un Flamand convaincu, dont la conviction flamande très marquée s’était forgée à la KULeuven (ou UCLouvain, Université catholique de Louvain) lors du Walen Buiten (ou « Affaire de Louvain ») de 1968. L’affaire de Louvain est un moment fondateur de la Belgique actuelle. Cette querelle linguistique, au cours de laquelle les partisans de la Région unilingue flamande ont littéralement chassé les francophones de l’université, a donné naissance à l’UCLouvain, un foyer de dynamisme en Wallonie. Régulièrement, Wilfried Martens répétait dans ses interviews : « Je serai républicain partout, sauf en Belgique ». Selon moi, cela résume tout.
Sur le principe, pour l’incarnation démocratique d’un État, un président est sans doute plus sexy, plus moderne, plus cool, plus juste… Mais chez nous, la monarchie est le garde-fou, asexué politiquement et linguistiquement, de notre melting-pot. Le roi gère les choses d’une manière relativement stable et consensuelle. C’est incontestable, même s’il y a de quoi se poser des questions de principe sur le fondement de ce régime. C’est exactement ce qu’exprimait Wilfried Martens.
Quand le roi Philippe a été intronisé, il y avait des questionnements sur sa capacité à apprendre et à débuter son règne, mais il a parfaitement répondu aux critiques. C’était et cela reste un roi surmotivé, qui est même sorti de son rôle de neutralité et de représentation : il a quand même pris la parole à la tribune des Nations unies, au nom de la Belgique ! Mais en même temps, il est apprécié en Flandre et les courants républicains sont pour ainsi dire inexistants. Du moins, on ne les entend guère…
B. C. – J’ai la conviction que cette monarchie est indispensable pour le pays parce que depuis le début de son existence, c’est un pays qui était déchiré par des courants linguistiques et communautaires antagonistes et parce que surtout c’est un pays qui a été créé ex nihilo, qui n’a pas d’existence ancestrale.
Il faut tout d’abord se souvenir de l’origine de la Belgique. Elle est née dans un contexte de monarchies et à part l’expérience de la Révolution française qui a pétrifié tout le reste de l’Europe et qui s’est terminée par la Restauration en 1815, le xixe siècle s’est majoritairement caractérisé par des régimes monarchiques ou impériaux. La Belgique a été créée dans le sillage du contexte de l’époque, puisqu’elle est née dans la poursuite de la révolution monarchique française de Juillet. Louis-Philippe, l’Orléaniste, non plus roi de France, mais des Français, dont notre premier roi épousa la fille, mit fin au règne des Bourbons. Et je pense qu’il n’y avait à l’époque pas d’autres souhaits que de faire de la Belgique une monarchie d’extraction prestigieuse.
Le récit national qui veut que la Belgique existe depuis le fond des âges et que sa naturalité soit confirmée par l’existence de neuf tribus gauloises correspondant exactement aux neuf provinces d’antan ne convainc plus grand monde. On admettra que la fameuse phrase de Jules César dans son récit de la guerre des Gaules : « Horum omnium fortissimi sunt Belgae », littéralement traduite en français par « De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves », est une preuve très légère de l’origine ancestrale de la Belgique. Il en est de même pour l’indépendance embrasée par la représentation de La Muette de Portici en août 1830 donnée en l’honneur de l’anniversaire de Guillaume Ier des Pays-Bas.
La Belgique n’est donc pas un pays qui est issu du fond des âges : c’est un pays qui a été créé de manière théorique même si les premières traces d’homogénéité existent depuis trois ou quatre siècles, comme le brillant historien Henri Pirenne l’a documenté. Et donc il a fallu renforcer l’artifice par le fait d’en faire un royaume. Et, à part en 1950, quand il y a eu la Question royale, et en 1991 quand il y a eu l’interruption de règne du roi Baudouin au sujet de l’avortement, la monarchie n’a jamais été fondamentalement remise en question. On pourrait disserter à l’infini de l’impossibilité de régner de Baudouin. Ce fut une abdication éphémère grâce à laquelle il affirma, à tout selon moi, que s’il n’existait que par les hommes, il gardait le privilège de ses convictions. Même quand le roi Léopold III est resté en Suisse pendant cinq ans, entre 1945 et 1950, une régence a été assurée. Tous les sondages portant sur les préférences des Belges indiquent l’attachement de la population à la personne du roi.
En d’autres termes, le pays n’a pas voulu autre chose qu’une monarchie. Et même si le rôle du roi est devenu essentiellement protocolaire, il est important d’avoir une figure centrale qui incarne une source d’inspiration ou de consensus domestique dans un pays qui est animé par des forces centrifuges. L’État ne peut pas se satisfaire d’être un reflet immédiat de la société. La monarchie ne peut pas être abandonnée à nos fluences politiques ou culturelles au milieu des variations et des ingratitudes. Parce que les pères fondateurs du pays l’ont choisie et surtout que nous l’avons personnifiée, cette monarchie nous discipline dans un incontestable rassemblement. Cette fédération, c’est celle des valeurs morales supérieures qui fondent les peuples et bâtissent les solidarités.
O. M. – Je le pense aussi. Mais cette fonction royale ne doit-elle pas évoluer ? Malgré tout, la monarchie en Belgique conserve des pouvoirs importants. La signature royale des lois ou des arrêtés est purement symbolique, même si on a vu lors de l’obstruction temporaire du roi Baudouin à la légalisation de l’avortement, en 1990, que cela pouvait provoquer une crise.
Cependant, le rôle du roi au moment de la formation du gouvernement reste central : après consultation c’est lui qui désigne les missionnaires chargés de trouver une majorité pour gouverner. Même si je constate que lors des dernières formations, on a court-circuité le palais à plusieurs reprises : l’information est venue des partis eux-mêmes, ce qui aurait été inimaginable quelques années auparavant. L’annonce, par exemple, de la nomination d’un informateur ou d’un missionnaire royal devait venir du palais. En court-circuitant le roi, on a clairement laissé entendre que c’était au niveau politique que se décidaient les choses. C’est une évolution fondamentale, même si cela n’est pas encore reconnu comme tel.
Pourrait-on, par exemple, se dire qu’après les élections, le premier parti sorti des urnes est celui qui mène la danse, comme cela se fait dans un certain nombre d’États ? Chez nous, cela reste le palais qui prend la main.
B. C. – Il faut évoluer en ce sens. À partir du moment où l’on sort d’une « particratie », c’est-à-dire un système politique dans lequel les partis politiques détiennent la plupart des pouvoirs,pour dégager une meilleure respiration démocratique, cela devrait être une émanation parlementaire. Il faut combattre la dérive de la particratie lorsqu’elle enraie la démocratie représentative.
O. M. – Pas le président du premier parti, alors ?
B. C. – On pourrait, en effet, imaginer que le roi commence par rencontrer des élus, puisque ces derniers émanent directement du vote populaire.
O. M. – Cela resterait un rôle important. Pour le moment, en cas de crise ou de chute du gouvernement, les présidents de parti défilent chez le roi qui temporise et rend possible une reprise d’initiative. Le roi joue un rôle d’apaisement, de consultation, d’orientation… Cela resterait utile, selon moi.
B. C. –Pour la formation d’un gouvernement, cela devrait être du domaine du Parlement. En cas de crise, le roi peut conserver ce rôle d’apaisement, de conciliateur, de temporisateur, tu as raison. Il y a aussi le Conseil de la Couronne qui est un organe consultatif se composant des ministres d’État, sous la présidence du roi. Il s’est peu réuni, puisqu’il fut appelé en 1870 (déclaration de la guerre franco-allemande), en 1914, en 1919 lors du Traité de Versailles, en 1950 au moment de la Question royale et en 1960 lors de l’indépendance du Congo. Ce Conseil pourrait être mieux et plus utilisé, notamment lors de crises politiques importantes.
O. M. – Un autre domaine d’influence du palais, c’est le colloque singulier, ces rencontres régulières avec les dirigeants ou avec la société civile. C’est a priori impensable qu’on dévoile le contenu d’une discussion entre le Palais et ses interlocuteurs. Ce cénacle permet d’apaiser, de s’informer, de tempérer…
B. C. – Cela rassure la population qui associe un attribut de confiance plus important dans le roi que dans les partis politiques. Les citoyens considèrent que le roi, ou plutôt la monarchie, c’est le javelot qui a été planté il y a deux siècles pour former ce pays et que la lignée royale est importante. L’évanescence et la nervosité du monde politique ne s’accommodent pas d’une gestion rassurée du pays. La monarchie est un facteur de tranquillité qui est essentiel.
O. M. – Quand le roi Baudouin est décédé, le 31 juillet 1993, il y avait eu un élan populaire incroyable. Dans les rues de Bruxelles, les citoyens étaient venus par milliers se recueillir. Je me demande si ce serait encore le cas aujourd’hui. Le roi Baudouin était évidemment une figure particulière au vu de la longueur et de l’intensité de son règne, même si cela n’a pas toujours été sans controverse, notamment en raison de sa position religieuse très conservatrice.
B. C. – Le roi Baudouin clôturait une période difficile de la Belgique qui avait commencé par la contestation politique de son propre père, avec la mort d’Astrid en 1935 et l’indécision monarchique pendant la Seconde Guerre mondiale. Le roi Baudouin était aussi associé à la décolonisation. Si l’ombre de la Question royale a ombragé le début de son règne, son influence sur la Belgique a été considérable. La disparition d’un roi laisse un pays sous le choc, car la monarchie accompagne les générations et nos histoires personnelles.
O. M. – Pour la période dont on parle, entre 2024 et 2030, qui sera une période charnière pour la Belgique, la monarchie sera-t-elle appelée à jouer à nouveau ce rôle de stabilisateur ou pourrait-on assister à une nouvelle rupture ? C’est une question que je me pose souvent. Même les milieux nationalistes flamands sont étonnamment indulgents à l’égard du roi. Mais en cas de crise grave, on risque de voir ressurgir leurs ressentiments.
B. C. – C’est vrai que tout peut arriver entre maintenant et 2030. Si une partie du pays se déclare constituante et met en œuvre une réorientation politique majeure, alors on devra discuter du rôle du roi. Mais c’est improbable. La monarchie a traversé beaucoup d’épreuves, notamment tous les bouleversements des pays adjacents. Quelle différence avec l’Allemagne qui, en moins de deux siècles, fit trois fois la guerre à la France, commit sa réunification, connut deux Reichs et deux républiques, tout en étant occupée, divisée et réunifiée ! Pendant la même période, la France connut une monarchie, un empire, quatre républiques et une période innommable, l’État français, entre 1940 et 1944.
C’est pour ces raisons que le démantèlement de la monarchie est le dernier souhait de la population. Le roi Philippe joue un rôle d’ailleurs de guide moral qui est très appréciable. La reconnaissance par le roi Albert II de sa fille naturelle contribua à renforcer l’acceptation bienveillante de la fonction royale.
O. M. – Et son abdication. Cela a été un moment majeur pour le pays : on a reconnu pour la première fois que la monarchie n’était pas éternelle, dans le sens de son attachement jusqu’à la mort. Il n’en reste pas moins qu’en termes de légitimité démocratique, de pouvoir moderne, nous sommes quand même à mille lieues de ce qui devrait être. Je reviens à ma phrase du départ : « Je suis républicain dans n’importe quel pays, sauf en Belgique ».
B. C. – Je souscris à la phrase de Wilfried Martens. La monarchie en Belgique est indispensable en raison de l’histoire complexe du pays, déchiré par des courants contraires. La Belgique est un pays géographiquement flottant et la monarchie a été mise en place pour contrarier cette réalité. La présence de la figure centrale du roi incarne une source d’inspiration ou de consensus domestique dans un pays animé par des forces centrifuges. C’est un facteur de tranquillité et de stabilité qui contribue à une gestion rassérénée du pays. De manière paradoxale, le roi garantit l’impartialité de la res publica.
DÉFI N° 3 La démocratie
B. C. – Lorsque le sujet de la démocratie surgit, je me questionne sur l’état actuel de la Belgique : peut-on encore la considérer comme une démocratie pleine et entière, et à tout le moins parfaitement transparente, telle qu’on peut imaginer que les pères fondateurs aient pu l’envisager, dans un contexte certes très différent que les circonstances contemporaines ? En effet, ces derniers, à l’instar de presque toutes les démocraties parlementaires, avaient pour ambition d’établir un équilibre entre les trois pouvoirs : législatif, exécutif et judiciaire. Cependant, à la suite de diverses dérives et au fil des réformes constitutionnelles, combinées à des renoncements de visions à long terme en faveur de compromis immédiats, le pouvoir législatif a été partiellement dénaturé et le pouvoir judiciaire structurellement appauvri. Nous avons ainsi silencieusement glissé d’une démocratie parlementaire vers un système gouvernemental exécutif, et pire, particratique.
Selon moi, une partie de l’action collective a été discréditée, ce que je déplore. Je ne peux pas ignorer ce constat sans le mettre en relation avec le contexte politique actuel qui domine depuis quatre décennies. Le système capitaliste néolibéral a pour objectif de dépolitiser tout en instrumentalisant l’État pour satisfaire les exigences des marchés. Dans une économie de marché, tout est sujet à la négociation, y compris la valeur d’un capital, d’un individu, d’une femme, d’un homme… et cette valeur fluctue constamment. Toutefois, nous vivons dans une