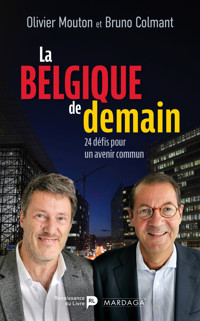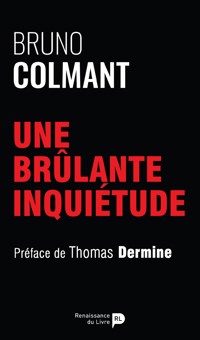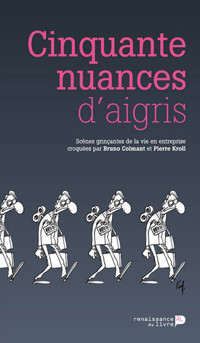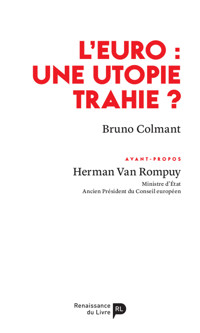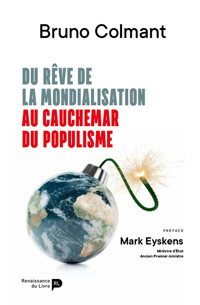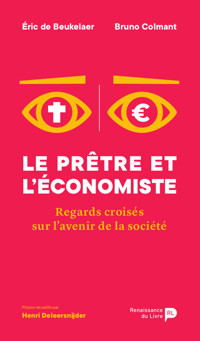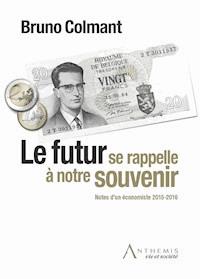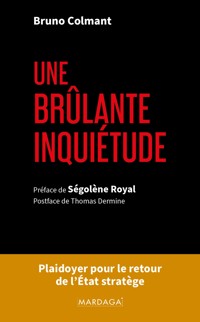
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mardaga
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Depuis quelques années, les réalités climatiques, militaires, énergétiques et socio-économiques se manifestent comme les premières secousses de chocs sociétaux d’une envergure titanesque. D’ici 2030, tous les déséquilibres vont s’embraser, entraînant de lourdes conflagrations environnementales et socio-économiques.
Face à ces défis systémiques, il est indispensable de réhabiliter des États stratèges, capables de proposer un projet de société cohérent et solidaire, associant ouvertement leurs citoyens à la gestion de la Cité. Ces États doivent être capables d’anticipation, d’actions coordonnées, transversales et de long terme. Ils doivent non seulement répondre aux besoins immédiats, mais aussi préparer un avenir durable pour les futures générations.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Docteur en économie appliquée de l’Université libre de Bruxelles,
Bruno Colmant est membre de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. Ancien CEO de la Bourse de Bruxelles et de plusieurs institutions financières, il est professeur dans divers établissements universitaires et auteur de nombreux ouvrages économiques et monétaires.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
En souvenir de mes grands-parents, nés avant Sarajevo
À mes parents, nés avant l’Anschluss
À ma fille, Julie, dans le partage du combat pour un monde meilleur
Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde.
La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas.
Mais sa tâche est peut-être plus grande.
Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. […]
Devant un monde menacé de désintégration, […]
elle sait qu’elle devrait […] restaurer entre les nations une paix qui ne soit pas celle de la servitude […], et refaire avec tous les hommes une arche d’alliance.
Albert Camus (1913-1960), prix Nobel de littérature, extrait du « Discours de Suède », 10 décembre 1957
Préface
Une brûlante inquiétude, est à la fois un témoignage en raison d’un itinéraire professionnel qui a vu la machine économique et financière de l’intérieur, observé de près le fonctionnement du système néolibéral, et une analyse nourrie par la connaissance et l’érudition des théories économiques du passé et du présent, associée à l’observation minutieuse des évolutions géostratégiques.
Fin connaisseur des mécanismes financiers, en raison de ses responsabilités dans les bourses de New York et de Belgique, de ses années bancaires, mais toujours accompagnées de l’engagement de transmission des savoirs par l’enseignement, le diagnostic de Bruno Colmant est unique car il associe le savoir-faire et le faire-savoir, dans un domaine complexe et évolutif.
Il a su y voir clair et se forger une opinion d’autant plus pertinente qu’il a dans un premier temps adhéré à ce modèle dominant. Puis il en a mesuré les limites et les perversités. Et c’est courageusement qu’il a affronté intellectuellement ses anciens pairs, et écrit avec authenticité ses analyses qui ne lui ont pas valu que des amis, dans le monde feutré de la finance. Ce qui en fait justement toute la valeur.
Cette analyse implacable de l’hypercapitalisme nous trace le chemin pour comprendre les dégâts de l’économie prédatrice globalisée. Le besoin de frénésie et d’atomisation par la peur rejoint les constats que j’ai développés dans mes livres notamment le dernier sur le refus de la cruauté du monde.
Les conséquences en termes de réflexion sur le rôle de l’État en particulier par l’analyse de la crise financière de 2008 qu’il a directement vécue de l’intérieur de la bourse de New York, ont changé ses illusions initiales, tout en intégrant les nouveaux défis : l’urgence climatique et la maîtrise de l’intelligence artificielle.
Il en déduit une réflexion sur les différentes options concernant le rôle d’un État stratège, mais aussi une analyse pertinente et rare sur les enjeux européens et les évolutions indispensables.
Ce livre n’est pas péremptoire comme le sont trop souvent les essais économiques. Il ouvre des pistes et invite au débat. Une contribution originale et brillante, bienvenue en ces temps de bouleversements qui ont besoin de repères.
Ségolène Royal
Chapitre 1
J’avais 20 ans et j’y croyais
J’ai intitulé cet essai Une brûlante inquiétude en référence à l’encyclique Mit brennender Sorge1 de Pie XI, rédigée en allemand, transmise clandestinement dans l’Allemagne nazie de 1937 pour être lue le jour des Rameaux.
L’encyclique de ce pape, même tardive, fut son legs dans un monde happé par l’Histoire. Il y mettait en garde contre les forces du mal qui allaient se déchaîner deux ans plus tard et dont les premières manifestations étaient déjà audibles. La même année, en 1937, Paul Valéry (1871-1945) écrivait : « le temps du monde fini commence ». Malgré cette encyclique papale, pourtant écrite avant le déferlement du nazisme dans un conflit épouvantable assorti d’un innommable génocide, le Vatican adopta une attitude passive et donc gravement coupable lors de la Seconde Guerre mondiale, et commis un aveuglement vis-à-vis des persécutions et des camps d’extermination. Pie XI était une vigie : il voyait un monde s’effondrer en pressentant des drames. Son successeur n’en fut pas à la hauteur. Ce rappel historique nous apprend qu’il faut s’extraire des enchaînements d’alertes suivies d’inertie et d’indifférence, comme si nous avancions comme des somnambules.
« L’odeur du monde a changé », comme l’avait auguré l’académicien français Georges Duhamel (1884-1966), cité par Charles de Gaulle (1890-1970), entre les deux conflits mondiaux.
Depuis les guerres récemment déclarées et à quelques mois de possibles changements institutionnels majeurs aux États-Unis, nous sommes, comme en 1937, à l’aube de gigantesques basculements sociétaux, notamment climatiques et environnementaux. Nous sommes à un moment essentiel de l’Histoire et peut-être devant des temps catastrophiques. Le philosophe, écrivain et théoricien politique italien Antonio Gramsci, décédé cette même année 1937, écrivait que l’ancien monde était en train de mourir et le nouveau avait du mal à apparaître, et que c’est dans ce clair-obscur que surgissait les monstres.
J’ai voulu, au travers de cet essai, partager une inquiétude et des intuitions, sans sombrer dans un pessimisme stérile.
Une immense faillite morale
Comme le conflit israélo-palestinien, la guerre russo-ukrainienne aggrave un changement de paradigme d’une horreur absolue, démontrant que l’homme n’a rien retenu de ses souffrances passées. Plus particulièrement, l’attaque de l’Ukraine par la Russie en février 2022 est un fait décisif, car elle rompt l’architecture de sécurité européenne. Elle viole l’Acte final d’Helsinki de 1975, la Charte de Paris de 1990 et la Charte des Nations unies de 1945, qui prévoient l’inviolabilité des frontières, le non-recours à la violence et l’égalité souveraine des États dans le choix de leurs alliances. Ce virage historique est qualifié par les Allemands de Zeitenwende, littéralement, « un tournant d’époque ».
Après des décennies de mondialisation promise et heureuse, le monde occidental assiste impuissant à la fragmentation de l’Europe. Nous devions chercher la paix, mais c’est un conflit larvé, mouvant, sinueux et vicieux qui s’installe. Une guerre dont l’issue semble être l’enlisement. Ses contours resteront imprécis, mais une chose est certaine : le continent européen se fracture et sa partie orientale se rapproche de l’Asie.
Nous errons dans les méandres silencieux d’une faillite morale. En soulevant les strates de l’histoire occidentale du XXe siècle, nous sommes happés par les guerres israélo-palestinienne, ukrainienne et toutes les autres qui sont médiatiquement solubles. Nous revenons à l’année 2001, marquée par l’essor irrésistible de la mondialisation, puis à la rupture néolibérale de 1980, et en franchissant les sinuosités des années 1970, nous arrivons aux Trente Glorieuses, cette période de croissance et de décolonisation, avant de sombrer dans les abîmes des deux guerres mondiales. La seconde, tragique écho d’une paix imparfaitement scellée après la première, laisse une empreinte indélébile.
La loi du genre humain n’est pas l’union, mais la désunion et la dictature. Les empires et les royaumes se sabordent et sont engloutis dans le néant de l’Histoire. Au XXe siècle, des compositions ancestrales ou éphémères européennes se sont effondrées : Empire austro-hongrois, Reich, Union soviétique avec l’éclatement subséquent de ses affiliées, Chine maoïste, etc. Rien ne dure, rien n’existe, disait François Mauriac. Tout sera bouleversé par les mains hasardeuses du temps, renchérissait Henry de Montherlant. Le XXe siècle a été le témoin silencieux de centaines de millions de vies sacrifiées. En additionnant les victimes des deux guerres mondiales aux morts des régimes stalinien et maoïste, nous atteignons le chiffre effarant de 200 millions d’âmes, mortes pour rien, emportées par les vents de l’Histoire.
Il y a un siècle, l’hégémonie européenne s’effaçait au profit des États-Unis. Cette prééminence, bien que toujours incontestée, voit désormais émerger de nouveaux empires dans le nord de l’hémisphère. Au cours de ce siècle tumultueux, la population mondiale s’est quadruplée, passant de deux à huit milliards d’âmes. Ce même siècle a été le théâtre de révolutions technologiques vertigineuses et d’un enrichissement certes inégalement réparti. Mais sommes-nous devenus plus vertueux, plus civilisés que nos ancêtres ? Il n’en est rien. La prédation, la folie consumériste, et la cruauté, qu’elle soit individuelle ou collective, continuent de hanter notre temps. C’est d’ailleurs pire : nous saccageons notre planète.
Aujourd’hui, tel un spectre du passé, le monde est de nouveau saisi par des régimes totalitaires, des guerres génocidaires et des tendances fascisantes. L’éphémère apaisement de l’après-guerre, conjugué à la fin progressive de certains totalitarismes, se dissipe comme une brume au matin. Nous avons commencé à épuiser notre Terre nourricière, la grattant jusqu’à la rendre stérile, tels des animaux affamés. Des déflagrations militaires, sociales, politiques et financières commencent à arracher notre apaisement futur, comme un shrapnel qui déchire la surface du sol. Nous avons été de mauvaises sentinelles de notre futur. Et je crains même que nos gouvernants ne soient pas conscients de la fragilité de leur légitimité, car la démocratie sera immanquablement mise en danger si les événements se précipitent.
Dans le tumulte des événements qui voient l’extrême droite et le totalitarisme s’épanouir dans le creuset des nationalismes et autres souverainismes, je crains que le monde ne perde sa paix. Mais vers quelles guerres avançons-nous ? Charles de Gaulle écrivait que pour assurer la direction de la guerre, il fallait des esprits d’une capacité synthétique absolument exceptionnelle. Nous sommes incapables d’opposer aux événements une réponse cohérente parce que la synthèse des menaces n’est pas clairement formulée. La situation est nouvelle. Des forces titanesques sont engagées. Ce sont peut-être les premières escarmouches d’une confrontation de modèles de société. Peut-être s’agit-il d’un rejet d’un prétendu impérialisme occidental ou de l’économie de marché. Dans nos pays, il ne s’agit pas d’une guerre de religion, mais d’une formulation nihiliste où les symboles régaliens et d’épanouissement individuel sont usurpés par une rhétorique. Est-ce une guerre civile ? Je le crains.
À cet égard, depuis des années, je me demandais quelle serait l’étincelle qui nous réveillerait de la torpeur sociale dans laquelle le néolibéralisme anglo-américain nous avait plongés. Nous voyions les inégalités s’aggraver sous les lois du marché, nos communautés se dualiser, la rancœur sociale couver sous la braise dans une atomisation complète de la société. Les mouvements protestataires des gilets jaunes français, qui combattirent le délitement du lien social et contestèrent violemment la mondialisation, conduisirent à la domination du Rassemblement national français. Ce fut un cri assourdissant de l’Histoire, s’exprimant dans l’un des pays les plus prospères du monde qui, plus qu’un autre, a tiré profit de cette mondialisation, au travers de son ancien passé colonial et aujourd’hui de sa désindustrialisation.
Le danger mute, de manière virale, dans une escalade du symbole qui culminera à un point non pas de découragement, mais d’exaspération. Ce jour-là, les pacifistes seront écartés. Et un combat rampant, de nature subversive, commencera. Seule prévaudra, ce jour-là, la vengeance en substitut de justice. Alors, la pensée sera perdue. C’est cela qu’il faut éviter à tout prix.
Allons-nous laisser la paix à la séquence du hasard ? Non. Derrière une capitulation morale, ce sont l’Humanisme, la Réforme, les Lumières et la Révolution française qui s’affaissent. C’est un combat d’un demi-millénaire qui serait anéanti. Ce combat, c’est celui de la reconnaissance de la conscience humaine, au-delà de la peur et de la tutelle des religions. Il faut refuser la tétanie face au néant et à l’anéantissement. C’est aujourd’hui que les hommes qui nous dirigent doivent être audacieux et clairvoyants. Le monde vieillit, disait saint Augustin. Je fais partie de cette génération qui a connu l’appel sous les drapeaux et a trop écouté l’écho des morts de la dernière guerre pour manquer aujourd’hui de lucidité et d’intuition.
Le conflit russo-ukrainien de février 2022 marque donc un tournant historique en violant les accords internationaux, fracturant la sécurité européenne et entraînant un bouleversement géopolitique majeur. Cette crise met en lumière l’échec humain à tirer des leçons du passé, exacerbant la fragmentation de l’Europe et ressuscitant les spectres du totalitarisme et des conflits anciens. La mondialisation et les révolutions technologiques n’ont pas apporté plus de vertu, mais ont plutôt intensifié les inégalités et les crises environnementales. Face à cette situation, une restauration des valeurs collectives et une solidarité sociale sont cruciales pour éviter un avenir chaotique. Bien conscientisés et préparés, nous serons légitimes pour pacifier nos communautés. Il faut restaurer des valeurs collectives et rebâtir la place de nos États, car ils se sont affaiblis depuis quarante ans. Et il faut retrouver l’apaisement, la tempérance économique et la solidarité sociale.
L’imposture du néolibéralisme anglo-américain
Au terme de quarante années d’économie de marché, je réalise que pour le climat, l’énergie, la protection du pouvoir d’achat et le respect des équilibres sociaux, le néolibéralisme anglo-américain de Ronald Reagan (1911-2004, président des États-Unis de 1981 à 1989) était un triste mensonge et une illusion manipulée. Même le Fonds monétaire international (FMI) l’a dénoncé. Quelle tragédie ! Parce que le néolibéralisme, contrairement au libéralisme, place le marché au-dessus de l’individu et le désigne comme l’origine de la liberté. Mais la liberté de quoi ? Un marché est une négociation, donc une prison qui enserre ses acteurs dans une frénésie mortifère ! Dans son essai Il faut dire que les temps ont changé2, publié en 2018, l’économiste français Daniel Cohen (1953-2023) rappelait que le capitalisme est le résultat d’un pacte faustien entre la science et la monnaie, ce qui pose incidemment la question de l’utilité sociale de l’innovation financière. On n’est pas loin des thèses de l’économiste hongrois Karl Polanyi (1886-1964) qui soulignait l’absence de naturalité et d’universalité du marché.
Et, lorsque je relis les postulats du néolibéralisme anglo-américain des années 1980, promu par une technocratie spéculative, auxquels j’ai pourtant cru, je me dis aujourd’hui : quelle vulgarité intellectuelle ! Quelle pauvreté de la pensée ! Dans le discours inaugural de sa première présidence, Ronald Reagan avait affirmé en 1981 :« The government is not the solution to our problem ; the government is the problem ». Comment n’avons-nous pas compris l’ignominie de ce postulat ? Au reste, je crois que nous avons trop vite cédé à l’idée que l’économie de marché entraînait l’atrophie des conflits sociaux, comme si la pseudo-démocratisation du capitalisme anglo-américain avait dilué les classes sociales et les idéologies. C’était une imposture, car il se passe quelque chose.
Il se passe quelque chose, car derrière le néolibéralisme anglo-américain s’est tapi un autre concept, à savoir l’économie de marché.
De nos jours, on assimile le capitalisme à l’économie de marché. Mais rien n’est plus faux : il y a différents types de capitalisme. Il suffit de penser à la différence de typologie entre les contextes américain et européen.
L’économie de marché est une autre modalité. Elle correspond au fait que l’allocation des biens et des services, ainsi que leur prix, est déterminée par la confrontation de l’offre et de la demande comme établi par le libre jeu du marché. Mais ce n’est pas tout : l’économie de marché, qui est fondée sur la déstabilisation permanente, est considérée comme supérieure. En effet, dans un monde parfaitement articulé, le prix des biens et des services correspond, à tout moment, aux conditions des échanges. Si le marché donne une valorisation plus exacte aux biens et services que des impulsions publiques, pourquoi s’embarrasser des obstacles imposés à sa fluidité ?
C’est ainsi que le terme d’économie de marché s’est popularisé dans les années 1980. La porte était donc ouverte sur un autre ordre politique que celui qui avait prévalu après la Seconde Guerre. Il fallait déréguler et déréglementer pour qu’enfin la loi de l’offre et de la demande s’épanouisse librement. L’économie néolibérale est alors devenue normative lors de sa consécration par le Consensus de Washington de 1990. Celui-ci affirma proprio motu la suprématie idéologique du capitalisme américain en formulant dix principes dérivés des enseignements de l’École de Chicago, dont la privatisation et la déréglementation de l’économie. Parmi les dix affirmations péremptoires de ce consensus de Washington, on lit les revendications suivantes : une réorientation des priorités de dépenses publiques vers des domaines offrant à la fois une rentabilité économique élevée, l’abaissement de la fiscalité, la libéralisation du commerce extérieur, les privatisations des monopoles ou participations de l’État ou entreprises publiques, la déréglementation des marchés et de l’économie, etc. Il ne faut pas être un grand clerc pour constater que ce référentiel de marché ne promouvait en aucune manière les droits du travail ou la protection de l’environnement. Et force est de constater que si le combat contre les monopoles publics était déclaré, ce sont aujourd’hui des monopoles privés, dans le domaine technologique, digital et commercial, qui submergent la sphère politique et économique.
Quel changement avec l’esprit du Sherman Anti-Trust Act de 1890 qui constitua la première tentative du gouvernement américain de limiter les comportements anticoncurrentiels des entreprises et de donner naissance au droit de la concurrence moderne ! Le Sherman Anti-Trust Act est lui-même dérivé du Boston Tea Party (conduisant au fameux « No taxation without representation »), mouvement de rébellion des Américains contre les Anglais qui imposèrent le Tea Act de 1773, confirmant le monopole d’achat des thés à l’East India Company. Cette Tea Party marqua le point de départ de l’indépendance et de la démocratie américaines.
Une plongée dans l’économie de marché
Dès ce moment, tout devint « marché » : marché de l’emploi et marché des capitaux, dans l’effervescence étourdissante d’une salle d’enchères. Ceci ramène aux théories de Léon Walras (1834-1910), un des plus illustres mathématiciens de l’économie. Il postulait qu’une économie s’oriente vers l’équilibre dans le cadre d’une concurrence parfaite. Ce postulat conduit à la théorie du « tâtonnement walrasien » qu’on peut résumer, à l’instar d’une bourse, comme un lieu d’échanges où les prix se forment par essais et erreurs, ou plutôt par itérations, jusqu’à ce que les intentions d’offre et les intentions de demande coïncident.
Mais il fallait une justification vaguement scientifique à cette supériorité du marché. Elle est venue par la finance moderne, qu’on commença à enseigner dans les années 1970 sous le vocable CAPM pour Capital Asset Pricing Model. Sous certaines conditions (qu’on ne vérifie jamais), le rendement espéré d’un actif financier est intimement lié à celui du marché. Tout est marginal et dilué par rapport à ce dernier. Il ne sert à rien d’imaginer un prix et une rentabilité pour un actif hors du marché puisque celui-ci englobe cet actif. Comme tout est dans tout, il n’y a pas d’échappée. On comprend la puissance politique de cette affirmation si on l’applique à l’économie réelle. Mais ce fameux CAPM, enseigné depuis un demi-siècle, dit autre chose d’encore plus prépondérant : le risque diversifiable n’est pas rémunéré par les marchés. Il faut donc diversifier. Et cela conduit naturellement à l’émiettement de tout, dont le travail que le néolibéralisme anglo-américain veut voir dispersé et fracturé, et surtout sans capacité de négociation collective.
Mais il eut encore plus, à savoir l’hypothèse d’une efficience du marché, c’est-à-dire que les prix des facteurs de production reflètent toute l’information disponible qui les concerne. L’efficience des marchés financiers, essentiellement développée par le mathématicien français Louis Bachelier (1870-1946) et l’économiste américain Eugène Fama (1939 —), prix Nobel d’économie en 2013, constitue le socle de la finance moderne. Si les marchés sont efficients et disposent de toute l’information disponible, leur supériorité est établie puisqu’aucun individu ne peut affirmer qu’il détient, de manière continue, des informations qui ne seraient pas connues des autres intervenants. Chacun est « dans le marché » dont il ne peut s’extraire pour le battre.
On comprend le caractère schizophrénique de ce concept puisque les agents économiques savent qu’ils doivent affronter le marché par leurs actes spéculatifs tout en sachant qu’il leur est impossible d’en battre systématiquement les performances. Les hommes luttent contre une perfection et un aboutissement qui leur est interdit. Est-ce que tout cela est très solide d’un point de vue intellectuel ? Très honnêtement, et bien que je l’enseigne depuis trente ans, je n’en sais plus rien. Cela ressemble à un horoscope ou à l’aruspicine, c’est-à-dire l’art divinatoire de lire dans les entrailles d’un animal sacrifié pour en tirer des présages quant à l’avenir. Quoiqu’il en soit, cet axiome d’efficience fut idéologiquement capturé pour légitimer la supériorité de l’efficacité de l’économie néolibérale.
C’est dans ce cadre que jour après jour, de manière inexprimable et insidieuse, par de micro-oscillations et d’infimes rotations de l’Histoire, nos États sociaux se détériorèrent. Construit après la guerre sur un modèle homogène de solidarité, alignant travail et capital, c’est aujourd’hui le capital qui prédomine à l’échelle mondiale. Le néolibéralisme anglo-américain et la mondialisation ont certes apporté de nombreux bienfaits, mais pas pour ceux dont l’immobilité du travail les ancre localement. Cette réalité a été exacerbée par la numérisation, qui a mené à une dominance extraterritoriale d’entreprises principalement américaines et à une centralisation des gains de productivité autour de plateformes à forte densité de capital. Il est évident que cette tendance sera amplifiée par le déploiement rapide des intelligences artificielles, majoritairement d’origine étrangère, posant la question du partage des gains de productivité, probablement au détriment du travail. Cette évolution sociétale s’inscrit dans un contexte démographique défavorable, caractérisé par le vieillissement de la population, qui entraîne non seulement un ralentissement de la croissance économique, mais aussi une augmentation des dépenses de soins de santé, de maladie-invalidité et de retraites.
Mais s’il est compréhensible de parler d’un marché des capitaux, il est inqualifiable de parler du marché du travail, sauf à réduire l’humain à un mobile fongible productif de manière éphémère. Pourtant, cette objection fut balayée par la pensée dominante au motif que le travail devait être flexibilisé et mobile pour s’ajuster aux gisements de croissance, comme on le constate aux États-Unis.
De surcroît, l’idée se développa qu’il fallait gérer un État comme une entreprise qui agit dans le marché. Cette idée fut fondée sur l’échec avéré des politiques publiques dans les années 1970, au cours desquelles les industries de services supplantèrent les entreprises manufacturières. Bien sûr, certains rappelèrent que, malgré ce que le postulat néolibéral s’évertue à affirmer, on ne gère pas un État comme une entreprise, à commencer par le fait que le mode de décision de cette dernière n’est pas démocratique. Une entreprise est en quête de monopole et obéit aux lois de rentabilité qu’elle essaie d’influencer. L’État est une formulation morale qui s’exprime dans le subtil équilibre de la prospérité collective. On écarta rapidement ces esprits chagrins.
Alors, que penser de cette économie de marché ? Elle est ambivalente. Elle attire par sa capacité à générer le progrès et à démultiplier la richesse. Mais, en même temps, elle est effrayante, voire suffocante, à cause de son narcissisme. Dénuée de mémoire, elle ne s’accommode que d’utilités financières. Elle ne tolère pas l’immobilisme et se révèle aussi volatile que les cours de bourse qu’elle anime. Une chose semble néanmoins claire : l’économie de marché est un modèle dans lequel le travail est, de manière inqualifiable, parfois une externalité, voire une variable d’ajustement. Et cela conduit résolument à l’idée que le marché et l’État, responsable des équilibres sociaux, doivent être l’avers et le revers de la même pièce.
Face à ces réalités, nos États se sont désagrégés et dilués dans des structures plus imposantes (l’Union européenne, l’euro, etc.) et dissous dans l’économie de marché, dont la formulation est explicite, à savoir que tout doit être un marché. Et nos responsables politiques n’ont pas de vision, et pour la plupart, aucune expérience internationale dont ils peuvent se prévaloir. Ils ramènent les choses à leur échelle, c’est-à-dire celle du terroir, alors que la mutation économique est mondiale. Devant ces constats, toutes les réactions des États sont envisageables : la résignation, le refus du progrès (ce qui ramène aux thèses pétainistes et maurrassiennes), le repli identitaire, la révolution réactionnaire. Et je vais plus loin en affirmant qu’un déploiement débridé d’hypercapitalisme, les déséquilibres que je pressens, sont porteurs de conflits, civils ou autres, de régimes autoritaires, et d’un désordre social qui, déjà, est brûlant sous la cendre. Et pourquoi ? Parce que le capitalisme non régulé – et il n’est plus régulé, et le sera de moins en moins – porte dans son essence l’inégalité, puisque c’est un système qui prône, au-delà de tout, l’enrichissement personnel au détriment de la cohésion sociale et de la solidarité. Les États appauvris sont incapables de domestiquer de grands groupes internationaux qui les dominent déjà.
Ces réalités exigent d’ouvrir le débat politique. Est-il trop tard pour rétablir une solidarité telle que conçue par ceux qui ont refondé l’État après la Seconde Guerre mondiale ? Assurément non, car si l’inverse se produisait, les conséquences pourraient être désastreuses. Je me dis souvent – et peut-être à tort – que les exclusions sociales créent un climat potentiellement propice à une rupture sociale, dont le désengagement citoyen n’est qu’un premier symptôme. La solution ne réside donc pas dans la répression sociale, comme le préconisent certains aux accents autoritaires, mais dans la promotion de valeurs morales supérieures qui transcendent la logique de la prospérité individuelle immédiate. Mais ce n’est pas tout. Il faut revoir la fiscalité, en particulier pour les jeunes et les faibles revenus, et mettre en œuvre des politiques innovantes d’accès au logement. Il est même nécessaire d’aller plus loin et de restaurer une solidarité fiscale et sociale, sans compter la confrontation aux défis écologiques et environnementaux, dont la restitution des équilibres est de nature systémique et existentielle.
On ne peut pas dissocier ces réalités écologiques du contexte socio-politique. À côté des guerres, les violences multiples et stupéfiantes qui assaillent l’Europe ne sont que les révélateurs de fractures sociales profondes qui se conjuguent et s’embrasent. Tout cela est le résultat intermédiaire d’une absence d’intérêt véritable par un personnel politique qui n’est plus à l’écoute que de lui-même dans un débat inaudible. Et tout cela s’aggrave dans un contexte profondément contradictoire, d’une part, d’un consumérisme effréné destiné à apaiser l’angoisse sans jamais assouvir le désir et, d’autre part, des contraintes climatiques et sociétales qui devraient nous contraindre à la sobriété et à l’apaisement. Quel en serait le triste aboutissement : sans pause politique et respiration démocratique, le glissement vers des sociétés fascisantes. Faute d’être respectée parce que plus à l’écoute démocratique, l’autorité risque de devenir autoritaire et répressive. Ce serait l’échec de quarante ans de déresponsabilisation politique et citoyenne. De quarante ans de silencieuse technocratie néolibérale camouflée par autant d’années d’agitations politiques domestiques. Et ce serait l’échec de la pensée longue que ne possèdent pas les tribuns éphémères destinés à être oubliés de l’Histoire.
Et, finalement, quelle est la vision dystopique de la Silicon Valley ? Probablement celle d’États épuisés à combler des inégalités sociales et dominés par un nouveau capitalisme hors de contrôle. Nous entrons donc dans l’hypercapitalisme, avec des entreprises privées qui, plus qu’avant, dominent les États, des marchés financiers d’une puissance inégalée et omnisciente, et avec des inégalités qui vont s’accroître. C’est d’ailleurs pour cette raison que certains penseurs de la Silicon Valley prédisent que l’intelligence artificielle risque de détruire nos civilisations, à tout le moins sous leur forme actuelle. Au reste, la vision apocalyptique de la Silicon Valley, c’est un avenir sans humanité.
Les principes de la finance moderne ont donc été dévoyés pour promouvoir un capitalisme d’anticipation, transformant tout en marché : emploi, capitaux, etc. Basée sur les théories de Léon Walras et le modèle CAPM, cette vision soutient que les marchés sont efficients et que le risque diversifiable n’est pas rémunéré. Ce cadre idéologique a justifié la supériorité du néolibéralisme anglo-américain, menant à l’érosion des États sociaux et à la centralisation des gains de productivité autour des plateformes numériques. Aujourd’hui, l’hypercapitalisme menace la cohésion sociale et environnementale, exigeant une révision profonde de nos politiques économiques et fiscales.
La fin de l’hypermondialisation
Mais, après des années de capitalisme universel, les années 2020-2024 marquent la fin de l’hypermondialisation. Cette dernière puise ses racines dans la Pax Americana instaurée en 1944 et les accords monétaires de Bretton Woods, qui établirent le dollar comme devise de réserve mondiale, bien que ces accords fussent abandonnés en 1971. Les deux contre-modèles au capitalisme américano-européen s’effondrèrent en 1976 (avec la mort de Mao) et en 1989 (avec la chute du mur de Berlin). L’ouverture des frontières et les avancées technologiques, telles que l’énergie nucléaire civile et Internet, ont alors conduit à une mondialisation non seulement économique, mais aussi politique.
Il y a trente ans, Francis Fukuyama (1952 —) publiait un article intitulé « La fin de l’histoire » où il prédisait le triomphe du modèle démocratique sur toute la planète. Il s’est trompé. C’est Samuel Huntington (1927-2008) qui avait raison en imaginant le concept de « choc des civilisations », présenté pour la première fois dans un article de 1993 et développé dans son livre de 1996, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order3. Cet auteur avançait que les conflits futurs seraient principalement culturels plutôt qu’idéologiques ou économiques. Selon lui, les civilisations, définies par des critères tels que la religion, l’histoire, la langue et la culture, seraient les acteurs principaux sur la scène mondiale. Il identifiait huit civilisations majeures, dont l’Occident, le monde islamique, et la civilisation chinoise, et prédisait que les conflits les plus probables se produiraient entre ces blocs culturels. Huntington suggérait également que la mondialisation, loin d’homogénéiser les cultures, exacerberait les différences et les tensions entre elles.
Le monde se désintègre à nouveau : l’homogénéité politique ne fut qu’une transition historique circonstancielle. Le regroupement de pays disparates selon l’acronyme BRICS+ illustre cette multipolarité. Pourtant, deux empires se font face : les États-Unis et la Chine. Au-delà de leurs protections géographiques, trois domaines concurrentiels les mettront en concurrence : l’intelligence artificielle, la biotechnologie et la cybernétique. Cette polarité conduira à disqualifier le rôle des organisations internationales (ONU, OMC et OMS). La Russie n’aurait jamais dû avoir joué un rôle géopolitique majeur, si ce n’était pour l’étendue de son territoire, ses ressources naturelles et ses ambitions militaires. Elle restera une menace militaire, mais subira probablement un étouffement intérieur, comme dans les années 1980.
Dans les prochaines décennies, les tendances démographiques varieront considérablement : l’Afrique connaîtra une forte croissance démographique, l’Asie et les États-Unis verront une croissance modérée, tandis que l’Europe fera face au vieillissement de sa population, et donc à une croissance faible, avec l’immense coût qui pèsera sur ses finances publiques et sa compétitivité.
Partout, l’autoritarisme et la fermeture des frontières s’imposeront. Les États-Unis deviendront de plus en plus isolationnistes et axés sur leur protection militaire domestique, ce qui pourrait entraîner un affaiblissement rapide de l’influence du dollar, conduisant à un choc financier indescriptible. Cet isolationnisme, conjugué à quarante ans de néolibéralisme et d’inégalités sociales domestiques, pourrait être accompagné temporairement de l’irruption d’un ordre républicain fascisant issu d’un populisme de nature mussolinienne ou péroniste.
L’Europe, en proie à un manque d’homogénéité politique et au vieillissement de sa population, pourrait également devenir protectionniste et nationaliste afin de défendre ses États sociaux. Elle serait peut-être encline à choisir une finlandisation (faisant référence à l’influence que peut avoir un pays puissant sur la politique extérieure d’un autre pays) chinoise, car l’idée gaullienne d’une Europe de l’Atlantique à l’Oural est désormais exclue.
La Chine étendra son influence militaire en Asie. La Corée du Sud, le Japon et Taïwan seront abandonnés par les États-Unis, comme le furent l’Afghanistan et le Vietnam. Cela ne signifie pas nécessairement qu’ils entreront en guerre avec la Chine, mais ils seront encerclés par cette dernière, comme dans un jeu de go.
Malgré l’émergence de sa classe moyenne, l’Afrique, en raison de sa diversité, de ses problèmes de pauvreté et de ses défis démographiques et climatiques, ne formera pas un bloc d’influence majeur, mais elle subira des bouleversements politiques, et certainement migratoires, importants. Elle sera une terre de prédation pour les États-Unis, la Russie et la Chine. Le Moyen-Orient pourrait également devenir, comme le suppute Jacques Attali (1943 —), l’un des prochains cœurs du monde, encore que son homogénéité ne soit pas acquise. L’Amérique du Sud ne devrait, quant à elle, pas jouer un rôle majeur.
La fin de l’hypermondialisation sera alimentée par des problèmes de surpopulation, des flux migratoires et des chocs climatiques et environnementaux peut-être insoupçonnables.
Nous dirigeons-nous vers une guerre mondiale ? Seul un effondrement climatique et environnemental global pourrait la déclencher. Cependant, les frictions entre les grandes zones d’influence et les plaques tectoniques idéologiques, bien qu’elles ne s’affrontent jamais directement, pourraient entraîner de multiples guerres… démondialisées. Ces guerres seront autant des conflits cybernétiques que la réponse à des problèmes environnementaux, alimentaires et hydriques. La rivalité sino-américaine déterminera évidemment la configuration des alliances régionales.
Quelles sont les prévisions que l’on peut esquisser, sachant que l’Histoire est rusée et que les intuitions sont souvent dissipées par les mains hasardeuses du temps ?
Et qui sera le perdant de cette prochaine décennie ? Sans un sursaut politique et un projet continental ouvert vers la diversité ethnique et culturelle, ce sera l’Europe, abandonnée par les États-Unis et incapable de se réinventer. Son risque résidera dans sa lente désintégration, résultant de l’utopie d’une expansion géographique qui ne repose plus sur aucune trame historique ou civilisationnelle solide. Elle a été le berceau de toutes les synthèses philosophiques et religieuses, et donc d’une richesse de pensée inégalée. Elle sera vulnérable. Peut-être pour cette raison.
En résumé, les années 2020-2024 marquent donc la fin de l’hypermondialisation, initiée par la Pax Americana et les accords de Bretton Woods. Cette période a vu l’ouverture des frontières et des avancées technologiques, entraînant une mondialisation économique et politique. Cependant, contrairement aux prédictions de Fukuyama sur le triomphe du modèle démocratique, Huntington avait raison de prévoir un « choc des civilisations », où les conflits seraient culturels. La multipolarité mondiale émerge avec les États-Unis et la Chine comme principaux rivaux, tandis que la Russie, bien que géopolitiquement influente, est menacée de déclin interne. Les tendances démographiques et le retour de l’autoritarisme façonnent un futur incertain où l’Europe, en déclin démographique et politique, risque de devenir protectionniste et vulnérable. La fin de l’hypermondialisation, exacerbée par des problèmes de surpopulation, migrations, et crises climatiques, pourrait entraîner des conflits démondialisés, avec des rivalités sino-américaines dictant les alliances régionales. Sans un sursaut politique, l’Europe, autrefois berceau de la pensée philosophique et religieuse, pourrait être le grand perdant de cette nouvelle ère.
Le décrochage social
Par ailleurs, je crains que les élites politiques et économiques aient, par cynisme ou indifférence, perdu l’écoute, la compréhension et l’interaction suffisante avec une partie de la population, précarisée et marginalisée sous différents angles et dont les réalités deviennent inaudibles.