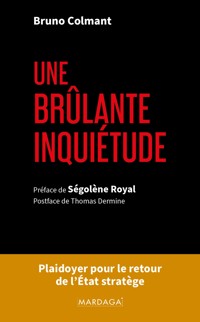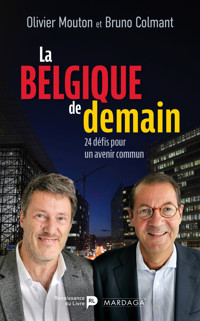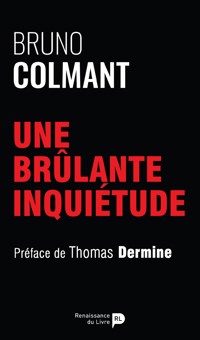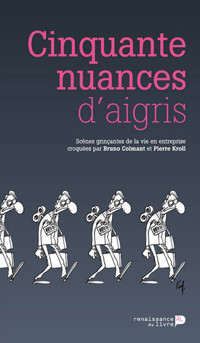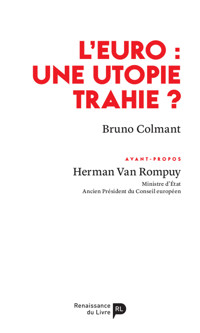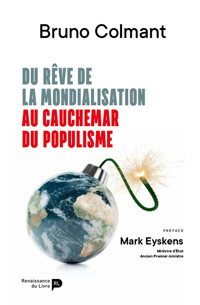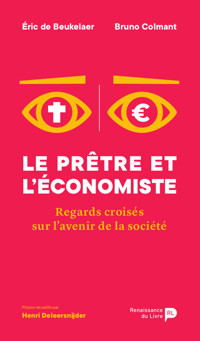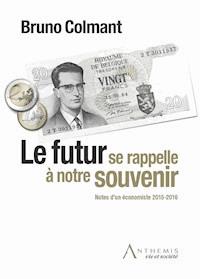Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Renaissance du livre
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Französisch
La sphère marchande, désormais mondialisée et digitalisée, entre en violente collision avec les politiques de nombreux pays européens. En effet, le néo-libéralisme américain apporte une incontestable croissance économique et une extraordinaire élévation du niveau de vie. Il exige cependant une mobilité parfaite et une individualisation du travail. En revanche, les États-providences européens furent bâtis, à l’opposé du néo-libéralisme, sur la stabilité et la solidarité du travail. L’euro lui-même est fondé sur ce même postulat, non encore vérifié, de l’amplification de la mobilité du travail. Il pourrait en résulter une conflagration socio-économique dont les premières détonations sont aujourd’hui audibles. Sans une refondation de nos orientations politiques européennes, la rancœur sociale pourrait gravement s’amplifier. Il faut rebâtir l’efficacité stratégique des États européens. S’il existe des périodes politiques, il faut désormais un temps étatique. 2019, l’année de tous les périls politiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 181
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hypercapitalisme
Drève Richelle, 159 – 1410 Waterloo
www.renaissancedulivre.be
Hypercapitalisme : le coup d’éclat permanent
Brunot Colmant
Photo couverture : ©Michel Choffray
e-ISBN : 9782507056926
Dépôt légal : D/2020/1276 3/07
© Éditions Renaissance du Livre, 2020
Tous droits réservés. Aucun élément de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans une banque de données ni publié sous quelque forme que ce soit, soit électronique, soit mécanique ou de toute autre manière, sans l’accord écrit et préalable de l’éditeur.
Bruno Colmant
Hypercapitalisme
Le coup d’éclat permanent
À ma merveilleuse fille, Julie, qui fête ses vingt ans cette année
La vie est une tragédie quand on la voit en gros plan,
mais une comédie
quand on la regarde
sur le long terme.
Charlie Chaplin (1889—1977)
I.
Il pleuvait sur wall street
En novembre 2007, à peine nommé au comité de direction de la Bourse de New York, je me revois, un dimanche, devant le péristyle de Wall Street, dans l’hébétude de rejoindre le saint des saints du capitalisme mondial.
1. L’étudiant étranger
Je connaissais un peu New York, en été, comme touriste. Mais mes États-Unis, c’était Chicago, ville de naissance de ma grand-mère maternelle. C’était, plus précisément, celle de mon arrière-arrière-grand-mère qui émigra de la région d’Ypres en Belgique vers le Canada avant de s’installer à Chicago et de prospérer dans l’hôtellerie. La prohibition anéantit tout, mais mon arrière-grand-père y laissa une recette, les Shrimps DeJonghe, qu’on sert encore, de Chicago à New York en passant par Washington.
Cette Amérique, c’est celle qui accueillit mes aïeux, des paysans flamands orphelins de père, que la bourgeoisie bien-pensante de la Belgique du roi Léopold II laissait crever de faim.
Mon Amérique, c’est donc celle de ma grand-mère qui, à Chicago, pendant et après la Première Guerre mondiale, collectait des fonds pour le Relief for Belgium avant que, rentrée en Belgique avec la Red Star Line, elle n’héberge son cousin, enrôlé dans l’armée américaine lors de la libération de Bruxelles en 1944. Ma grand-mère aimait son pays natal. Elle m’a dit qu’elle l’avait pleuré, de tristesse et de fierté, le 22 novembre 1963 et puis le 21 juillet 1969. Je me souviens du mot, préimprimé, des trois astronautes, arrivé à la Noël 1969.
Mon Amérique, c’est celle des années ١٩٧٠, du concert de George Harrison pour le Bangladesh au Madison, de Crosby, Stills & Nash et d’Hotel California. C’est surtout celle du film The Paper Chase, un film sur des étudiants en droit d’Harvard qui, dans la trame de Love Story, me convainquit, au terme des deux chocs pétroliers d’aller, moi aussi, un jour, étudier aux États-Unis.
Ce fut, en 1988, délibérément, le Midwest et un Master of Science. L’Indiana, en dessous de Chicago. Le Middle of Nowhere : la vraie Amérique, celle des bus scolaires jaunes, des aciéries en ruine, mais aussi des champs de maïs à l’infini. Celle des longues routes, de l’herbe bleue du Kentucky, des stations-service improbables et celle, plus bas, de Cap Canaveral qui m’avait fait rêver le ١٦ juillet ١٩٦٩.
Je crois que je cherchais les racines de ma vraie famille, et puis aussi Simon & Garfunkel. J’avais bien aimé « America » de 1968. Je les ai trouvées, chaque jour, dans ce soleil enveloppant qui caresse les universités et les pelouses parfaites des universités au sein desquelles l’insouciance candide dégage le parfum de destin des fraternities. Je n’ai jamais rien regretté. Ceux qui ont étudié aux États-Unis savent les grands bâtiments rouges, les gazons impeccables, le drapeau qui claque le 4 juillet et cette bienveillante chaleur des mois d’été lorsque, fraîchement diplômé, on lance son chapeau d’étudiant au soleil, lors de la cérémonie en caps and gowns.
Ce jour-là, le cœur explose. J’avais aussi été bouleversé par un amour universitaire. Ma vie américaine fut faite de ces infimes moments intenses, mais figés. De ces rares instants qui fragilisent une vie sans la faire vaciller. Ils emportent un destin vulnérable, dans l’imminence et la nostalgie.
Ce fut aussi, lors de la préparation de mon doctorat, les recherches à Harvard dont j’humais la cire des bibliothèques pour retrouver le parfum du Paper Chase. Pour effleurer tout cela, il faut lire L’étudiant étranger de Philippe Labro. Ma grand-mère me l’avait offert. Ce fut ma clé d’entrée dans ce monde universitaire américain qui émeut les âmes de ses alumni.
Tout cela, c’était avant la vague néolibérale.
2. Le crachin vertical de New York
J’allais avoir vingt ans. Je n’avais pas compris que le visage de François Mitterrand, dévoilé ligne par ligne sur TF1, le 10 mai 1981, serait le dernier regard d’une Europe qui allait capituler après un court état de grâce.
J’avais envie que mon Amérique reste celle de mes vingt ans, avec désormais le cœur étouffé de constater qu’elle deviendrait celle de Donald Trump et que j’avais confondu l’émerveillement d’un jeune adulte avec les réalités sociales auxquelles elle conduirait.
Ce dimanche de novembre 2007, il pleuvait, devant Wall Street, comme un mauvais présage. Là-bas, la pluie est souvent verticale, comme si elle était domestiquée par les gratte-ciels.
Devant Wall Street, il y a la statue de George Washington (1732-1799). C’est là qu’il prêta serment comme premier président des États-Unis. La Bourse et la Présidence. Non pas face à face, mais côte à côte. Parce que Wall Street, c’est Manhattan. Et que Manhattan, c’est New York. Et que New York, ce sont les États-Unis. Et que Washington DC, ville quadrillée créée de toutes pièces par l’architecte français Pierre Charles L’Enfant (1754-1825), ne deviendrait la capitale des États-Unis qu’en 1800, soit deux siècles après la découverte de Manhattan.
Wall Street. On l’appelait le transept mais il damnerait le capitalisme. Le krach imminent se pressentait comme une divinité maléfique. Les Bourses de valeurs mobilières ressemblent aux temples, car on y négocie le futur. Personne n’est venu chasser les marchands. La déité, c’est parfois le Moloch.
Quelques mois plus tard, telles des pythies, les premiers manifestants qui créeraient, en 2011, le mouvement Occupy Wall Street, avaient dressé leurs pancartes en carton devant Trinity Church, presque face à Wall Street.
Parfois, je les ai enjambées.
Je me souviens de ces traders, les ongles rongés et le teint cireux d’angoisse, qui s’essayaient à passer des ordres sur le parquet de la Bourse, pourtant devenue électronique depuis longtemps. Le temps les avait balayés. Ils le savaient. J’ai sonné deux fois la cloche de Wall Street. Il n’en reste rien, comme de ces cours boursiers que le temps efface comme une vague d’écume.
C’est en 2008 que j’ai ressenti – trop tard – que le monde basculerait et que le décrochage boursier serait, comme la fin des accords monétaires d’après-guerre en 1971, une césure de crises enchevêtrées dans l’histoire économique.
3. Les krachs
Chaque crise boursière coïncide avec la popularisation d’un média de communication, accélérant la vitesse de circulation des données : le téléphone (crises de 1893 et de 1907), la radio (crise de 1929), la télévision et l’informatique (abattement boursier des années ١٩٧٠ et 1980) et l’Internet (crises de 2000 et de 2008). Il est d’ailleurs troublant de constater que l’atonie boursière des années 1972-1981 et le krach de 2000 ont tous les deux coïncidé avec l’avènement de développements technologiques majeurs, à savoir le microprocesseur et Internet.
La crise de 1893-1897, répliquée lors de la panique bancaire de 1907, a coïncidé avec la première bancarisation de l’économie. À cette époque, le secteur financier se développe afin de répondre aux besoins de la révolution industrielle et du démarrage de la production en masse des biens de consommation. Ce krach correspond surtout à la naissance des moyens de transport terrestre, à savoir le chemin de fer et ensuite l’automobile. Les matières et le travail deviennent mobiles. Le téléphone se popularise. Les sites de production industrielle se concentrent.
La dépression suivante, celle de 1929-1932, constitue l’écho d’une paix mondiale mal signée. Elle symbolise aussi la transition d’un environnement agricole à une économie industrielle. L’agriculteur quitte les champs pour travailler dans les usines. Le facteur de production travail s’ajuste à l’allocation manufacturière du capital. À la même époque, l’information commence à mieux circuler, grâce à la radio.
L’atonie boursière des années 1974-1981 a, quant à elle, été déclenchée par les dérives de la guerre du Vietnam, l’abandon du système monétaire de l’étalon-or et des deux chocs pétroliers (1973 et 1979). Cette décennie révèle également la transition d’une économie industrielle à une société tertiaire, c’est-à-dire fondée sur les services. Ne parlait-on pas naïvement à l’époque de la société des loisirs ? Cette économie du secteur tertiaire est synchronisée avec une mobilité croissante du capital et surtout de l’information, grâce aux progrès de l’informatique et de la télévision.
Avant la crise du coronavirus, le krach boursier de l’année 2008 fut lui le signe de l’avènement d’un monde fondé sur la mondialisation, c’est-à-dire une interdépendance économique sans solidarité ni coopération. C’est aussi le fruit de la mutation d’une économie de services vers les réseaux de la connaissance digitale.
4. La lave de la crise
L’économie ressemble à ces terres calmes sur lesquelles les saisons posent leur rythme. Rien ne souille les immuables cycles de la nature. Le temps se dérobe par fines couches qu’aucun sentiment d’alerte ne saurait abîmer. Mais, depuis le fonds des âges et aux entrailles de la terre, des forces titanesques se déchaînent furieusement. Les hommes et les éléments se battent dans une lutte fanatique et hargneuse.
Alors, parfois, telle une lame qui libère la boursouflure de ces énergies sulfureuses, la terre éclate de ses orages. Elle rejette des déferlantes de combats. De gigantesques torrents de lave se déversent, emplis de la colère de l’histoire de l’humanité, trop longtemps contenue. L’homme se bat contre lui-même.
Celui qui a travaillé essaie d’échapper à son successeur. Il a inventé la monnaie pour accumuler son travail, mais des forces renouvelées refusent cette oppression. Toute la rage des humains et de la monnaie enchaînés hurle dans des bouillonnements qui détruisent tout avant de modeler de nouveaux mondes arides. Tous les penseurs de l’économie sont là, tels de lugubres fantômes. Pris de panique, ils savent que le monde peut, à tout moment, basculer car les crises sont de brûlants naufrages.
Et puis ce krach de 2008. Chacun d’entre eux possède sa propre configuration, ses ruses et grimaces, et surtout des éléments de transmission et d’enchaînements différents. Il est impossible d’en distinguer les ruptures, les continuités et les interdépendances.
L’euro, à peine créé, fut au bord de son effacement. Et c’est l’Europe qui tomba, plus violemment que les États-Unis, comme après le krach de 1929 qui contamina le continent au travers du Creditanstalt viennois, déclaré en faillite en 1931. Que croyait-on en 2008? Qu’elle pourrait être indéfiniment le passager clandestin d’une croissance économique créée à son insu par ses partenaires économiques ? Que nos systèmes fiscaux et parafiscaux, fondés sur un effet d’optique et une conjoncture d’aubaine d’après-guerre, allaient nous permettre de traverser sans encombre les fureurs du néolibéralisme ?
Nous avions été hypnotisés, croyant naïvement pouvoir conserver la bienveillance mielleuse d’après-guerre, alors que nous étions immergés dans l’économie de marché. Comme une fusée éclairante, ce krach de 2008 fut trop subi et profond pour être un accident conjoncturel. C’était la fin du multilatéralisme, de la cohésion de l’Occident, le début du papy-boom, et l’entrée dans la véritable économie de marché dont l’Europe avait cru pouvoir faire l’économie.
L’économie serait désormais escaladée par la face Nord.
5. Le négatif du monde
Le krach de 2008, comme la crise pandémique du coronavirus, aura d’ailleurs, chez chacun d’entre nous, des conséquences non seulement économiques, mais aussi psychologiques. Car ce bouleversement financier a ramené à un traumatisme collectif, à un glissement de valeurs et à la prise de conscience de la fragilité des constructions humaines.
Tout krach ramène au péché financier originel, c’est-à-dire au risque systémique, qui représente le frôlement existentiel du néant. L’effondrement systémique est, pour tout économiste, le trou noir, le rien suivant l’implosion. C’est la pandémie financière, la semence maléfique. Il représente l’annihilation du système, voire la négation des perspectives. Le risque systémique est, pour cette raison, inassurable et non diversifiable.
Dès 2008, j’y avais d’ailleurs consacré un livre, dans le sillage de la chute de Lehman Brothers. Dans cet écrit, l’importance du phénomène m’avait étreint par son envergure. J’écrivais : « Cette crise est trop subite et profonde pour être un accident conjoncturel. Elle présente un aspect structurel, presque référentiel, dont il faut prendre la mesure. C’est une pénétration brutale dans les réalités de l’économie de marché. Alors, que préfigure le krach de l’année 2008 ? Est-il un signe annonciateur ou un événement non connexe ? Quels sont les nouveaux paradigmes ? La mutation vers une société de la connaissance et de l’intangible ? L’étalement planétaire des richesses suivant la mondialisation ? Des défis démographiques ? Alimentaires ? Écologiques ? »
Insidieusement, le futur s’était déplacé vers les océans Atlantique et Pacifique. Charles de Gaulle (1890-1970, président français de 1958 à 1969) avait rêvé d’une Europe qui s’étendrait de l’ouest vers l’est, de l’Atlantique à l’Oural. Nous aurions le contraire, en termes de géométrie planétaire : une économie de croissance qui est le négatif gaullien, s’étendant de l’est à l’ouest, c’est-à-dire de l’Oural à l’Atlantique, englobant la Chine, l’Inde, les économies asiatiques en croissance et bien sûr les États-Unis. Avec une naïveté coupable, nous avons été illusionnés par une mondialisation que nous croyions s’effectuer à notre avantage.
C’était exactement l’opposé des années ١٩٥٠ qui se passait. Nous avions confondu cette mondialisation avec les temps anciens des colonies, où les richesses étaient importées des pays lointains à notre bénéfice. Il est vrai que la première mondialisation, correspondant à la révolution industrielle et à la colonisation, avait été favorisée par l’émigration massive des populations européennes vers les colonies et le servage.
Mais la mondialisation contemporaine, c’est l’inverse : ce sont les pays lointains qui ont construit un formidable modèle d’épargne populaire dont nous sommes aujourd’hui les débiteurs. D’ailleurs, ce qui l’a embrasée, c’est l’adhésion de la Chine à l’Organisation mondiale du commerce en 2001. On parla alors d’hypermondialisation.
C’est cela que le krach de 2008 révélait, mais nous ne le savions pas.
6. Les lendemains qui déchantent
Nous sommes douze ans plus tard, dans une Europe à la démographie inversée et à la croissance économique haletante. Au vu de cette épidémie de coronavirus, elle devrait être de moins 8 à 10% en 2020 dans la zone euro, soit un pourcentage catastrophique conduisant à figer les inégalités sociales, à côté d’un capitalisme américain hégémonique. Les déficits budgétaires en seront pulvérisés. Il n’y a qu’une seule façon de sortir de cette crise, c’est d’inonder l’économie d’un déluge de monnaie et d’entrer dans une période profonde de déficit budgétaire. Ce sont seulement ces deux armes qui vont permettre d’éviter des ruptures dans la chaîne financière.
La dernière décennie européenne fut celle de l’illusion européenne, c’est-à-dire celle de la politique monétaire accommodante pour éviter la confrontation avec l’inévitable appauvrissement économique.
Cette période est révolue. L’Europe est confrontée à ses tristes réalités. La déflation en est le meilleur symbole : elle est caractéristique des communautés vieillissantes dont l’avenir sera appauvri. Après la déflation, ce sera peut-être l’inflation qui érodera les économies, gorgées de transferts sociaux et d’endettements publics impossibles à rembourser.
Passagers clandestins depuis quarante ans de la vague néolibérale, nous réalisons que ce capitalisme n’est pas compatible avec les engagements sociaux promis par nos États providence. Tout l’oppose aux modèles d’États sociaux européens : les modes de pensée (inductif ou déductif), le rôle de l’État, le rapport à la solidarité sociale et au temps, la fiscalité, la domination du capital sur un travail dont l’exigence de mobilité est croissante, les empreintes religieuses, etc.
Malgré ce que le postulat néolibéral s’évertue à affirmer, on ne gère pas un État comme une entreprise, dans la dictature du temps et sans conception du temps long. Cette dernière est en quête de monopole et obéit aux lois de rentabilité du marché qu’elle essaie d’influencer.
L’État, en revanche, est une formulation morale qui exprime le subtil équilibre entre la prospérité individuelle et la solidarité collective. Les missions de l’État portant sur des secteurs non marchands, comme l’éducation et la santé. C’est pour cette raison que la privatisation des biens communs est toujours périlleuse et que certaines entreprises, dans des pays hyperlibéraux, comme le Royaume-Uni, sont renationalisées.
7. La crise sanitaire mondiale
Le coronavirus n’est pas une crise, c’est une prise de conscience. Aucun système politique, économique, et donc aucune entreprise (privée ou publique), ne peut fonctionner dans l’interdépendance sans solidarité ni coopération. Nous le constatons parfaitement dans la logique de confinement: c’est ensemble et partout pour nous sauver collectivement. Cette interdépendance solidaire et coopérative est le secret pour repenser une mondialisation harmonieuse et respectueuse. Quel incroyable choc que cette crise sanitaire ! On croyait accessoires les malheurs lointains et les détresses d’autres méridiens. Tout était loin, dans cette frénésie narcissique qui anime le monde occidental depuis quarante ans. La mondialisation, ce n’était finalement qu’un relais du temps des colonies. Mais voilà, nous percutons notre avenir, qui était tout aseptisé. Il faudra sortir grandis, ensemble et en bienveillance, de cette crise. De nouvelles personnalités, libérées de leurs cloisonnements intérieurs, vont émerger. « L’action, ce sont les hommes au milieu des circonstances », disait Charles de Gaulle. Le véritable débat portera sur le dialogue entre l’État et le marché, car ces deux notions sont l’avers et le revers de la même pièce, ce qui est d’ailleurs confirmé par l’aide des pouvoirs publics au soutien de l’économie. Ce dialogue ne peut être ni conflictuel ni escamoté. Il s’agit de redéfinir rigoureusement ce qui ressortit, d’une part, à la sphère marchande et, d’autre part, aux services et biens publics dont le financement et les bénéfices sont naturellement mutualisés. Je suis d’ailleurs certain que cette crise révélera la tempérance et la longue construction des communautés européennes dans cette troisième voie entre capitalisme déchaîné et égalitarisme démobilisateur. En 1947 et 1948, Charles de Gaulle avait tracé cette voie: « Quelque chose de simple, de digne et de pratique, qui est l’association... la voie de la concorde et de la justice fructifiant dans la liberté. Ceux qui s’obstinent aux répétitions de scénarios et autres biais idéologiques seront écartés au profit des refondateurs de la véritable trame de pensée européenne: l’humanisme. »
8. Une conviction
Dans ce maelström de questions sociopolitiques et économiques qui éveillent l’attention, ce court essai rassemble quelques idées relatives aux défis socioéconomiques auxquels nos communautés font face.
Ma conviction est que l’État doit s’inscrire à nouveau dans une logique à la fois stratégique, régulatrice et protectrice, sans être paternaliste. Il s’impose de redéfinir les contours de l’Étatprovidentiel et de réaffirmer le choix social.
Certes, ces derniers, imaginés en 1946 et fondés sur une démographie et une productivité favorables, constituent une exception de modèle à l’aune du capitalisme moderne. C’est pourtant maintenant qu’il faut réhabiliter desÉtats stratèges dont la mission serait de mettre en œuvre unerégulation pour assurer une croissance soutenable et inclusive.
UnÉtatstratège, ce n’est pas unÉtatqui se borne à administrer, mais qui est plutôt le garant d’une vision d’excellence en termes d’équilibres sociaux, écologiques, économiques, etc. C’est unÉtatqui investit dans les secteurs publics. Il ne s’agit pas de mettre en œuvre desÉtats dirigistes, trop planificateurs ou arbitres, ou même des technostructures, mais plutôt de réhabiliter leur rôle dans un contexte capitaliste, sans subordination aux marchés. D’ailleurs, la crise du coronavirus est, à cet égard, révélatrice : ce sont lesÉtats, par des politiques de stimulation économique et d’endettement publics, ainsi que les banques centrales, au travers de la création monétaire, qui aident l’économie privée.
Mais que le lecteur ne se méprenne pas : il ne s’agit pas de refouler ou d’accabler aveuglement le néolibéralisme, mais plutôt de souligner sa singularité avec des États européens qui ont abandonné leur rôle de vigies stratégiques, se sont subordonnés aux fluences des marchés financiers et ont privilégié une redistribution sociale financée par l’endettement plutôt que l’investissement public et productif générateurs d’emplois. L’absence de financement des retraites et des soins de santé, dans le sillage de la logique de la répartition, relève aussi de la décision de privilégier le narcissisme financier immédiat au détriment du bien-être des futures générations, dans la logique d’immédiateté des marchés financiers.
La critique de la mondialisation n’est pas non plus l’objet de cet essai. Chaque phase de mondialisation a été accompagnée d’une amplification du progrès et des découvertes, de transferts et de partages de technologies et d’une circulation de connaissance.
En revanche, une mondialisation ne peut pas s’épanouir durablement au détriment des choix sociaux et d’une suffocation du travail, sauf à pénétrer dans un monde orwellien. On est donc très loin de la mondialisation heureuse consacrée dans un ouvrage d’Alain Minc (1949-) en 1999.
Après une contextualisation de la réflexion (chapitre II), l’essai résume la ligne du temps du capitalisme moderne et sa mutation libérale jusqu’à son aboutissement populiste (chapitres III à VI) et met en exergue le choc de modèle économique (chapitres VII et VIII). Les deux chapitres suivants sont consacrés à l’euro et à l’impérieuse nécessité d’en reformuler les principes idéologiques et budgétaires (chapitres IX et X). Le chapitre XI s’intéresse à la désolante déliquescence du sentiment européen, tandis que les chapitres XII et XIII plaident pour la réhabilitation d’États stratèges dans l’action décisive.
Le texte a été construit de manière modulaire afin que chaque chapitre puisse être abordé indépendamment des autres. Ce choix volontaire explique quelques répétitions.
L’intuition de cet essai, prudent et interrogatif, qui est le résultat d’observations et d’itérations intellectuelles personnelles, n’engage en aucune manière les institutions privées et publiques auxquelles je collabore. Il est le résultat d’une évolution personnelle et probablement plus mature de l’étude des contextes socioéconomiques. L’âge et l’érudition apportent lucidité, nuances et tempérance. Cette réflexion a aussi bénéficié, depuis de nombreuses années, d’interactions avec les sphères académiques, politiques, syndicales et professionnelles belges. Ces échanges ont affirmé mes convictions.