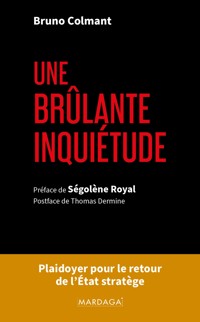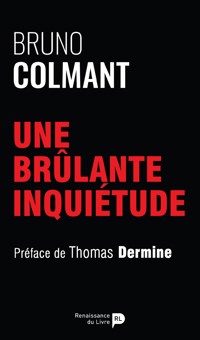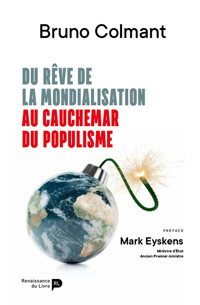
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Renaissance du livre
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
En moins de quarante ans, le capitalisme anglo-saxon s’est engouffré dans nos communautés européennes.Chaque jour, la mondialisation et la révolution de la d igitalisation amplifient la prédominance de cette sphère marchande. Aujourd’hui, les États européens sont écartelés entre des engagements sociaux impayables et des marchés qui leur échappent. Certains États-providence européens ont été financés par l’endettement public alors qu’ils ont désormais perdu leur souveraineté budgétaire et monétaire dans la zone euro.Des courants populistes rejettent les dirigeants qui n’ont pas protégé leur population vieillissante contre ces forces de marché. Ces populismes, relayés par les réseaux sociaux et radicalisés par des embrasements politiques, pourraient fissurer le modèle social-démocrate européen et conduire à des chocs sociaux et politiques d’une envergure désespérante.Cet essai replace ces évolutions dans la longue histoire du capitalisme et, plus spécifiquement, dans le sillage de la révolution néolibérale des années 1980 dont nous ressentons désormais le ressac social. Il constitue un avertissement avec un message clair : le sauvetage de la tempérance politique européenne doit impérativement passer par la réhabilitation d’États stratèges et par un projet européen stabilisé par de nouveaux équilibres sociaux et fiscaux. Il s’impose désormais de subordonner toute décision politique à l’intérêt général et au bien-être des futures générations dans un esprit de solidarité et dans le respect d’une concertation sociale et écologique.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Avenue du Château Jaco, 1 – 1410 Waterloo
www.renaissancedulivre.be
Renaissance du Livre
@editionsrl
Du rêve de la mondialisation au cauchemar du populisme
Mise en pages : Extra Bold
Corrections : Catherine Meeùs
isbn : 9782507056438
© Renaissance du livre, 2019
Tous droits réservés. Aucun élément de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans une banque de données ni publié sous quelque forme que ce soit, soit électronique, soit mécanique ou de toute autre manière, sans l’accord écrit et préalable de l’éditeur.
It’s not enough that we succeedWe still need others to fail.—
Roger Waters, Is this the life we really want?, 2017
Remerciements… Et un peu d’histoire personnelle
Cet essai est dédié à la mémoire de mes grands-parents maternels, Jean (1899-1973) et Esther (1911-2005) Spinhayer, qui m’ont transmis le singulier gène de l’alerte sociétale. Ils ont connu deux guerres et ils étaient, l’un et l’autre, des immigrés. Mon grand-père était le descendant d’exilés moraves. Ma grand-mère était américaine, descendante d’un Belge émigré aux États-Unis car en Flandre, au milieu du XIXe siècle, les paysans mouraient de faim. Ils ont eu très peur pendant les années 1930.
Je tiens à remercier Caroline Mathias, la plume qui a accompagné avec talent mes mots et ma pensée au fil des pages, ainsi qu’Hans Bevers, Joan Condijts, Amid Faljaoui et Pierre-Henri Thomas pour les échanges de vues qui ont accompagné la rédaction de cet essai.
J’associe à ces remerciement tous les acteurs issus des mondes politiques, syndicaux, académiques, médiatiques et professionnels qui ont façonné mon apprentissage de l’économie et m’accompagnent depuis plus de vingt-cinq ans dans ma passion de la prospective et l’écriture. Qu’ils trouvent ici l’expression de ma plus profonde gratitude.
Préface
L’auteur de ce remarquable livre excelle par sa rigueur de pensée, la profondeur de ses analyses, le cadrage historique de ses arguments et sa vision de l’avenir. Bruno Colmant est devenu l’éminent séismologue socio-politico-économique des secousses qui traversent notre monde tous azimuts. Mais il est beaucoup plus qu’un observateur engagé. Il tente dans de très nombreux écrits, exprimés par un orfèvre de la formulation, de décoder le dessous des événements qui déferlent sur nos sociétés pour le meilleur et pour le pire. Car Bruno Colmant est convaincu que l’événementiel est trompeur dans la mesure où il cache des courants fondamentaux de l’Histoire et des paradigmes implicites de l’évolution de l’humanité. Il n’hésite pas à tirer des conclusions qui franchissent la dichotomie entre le court terme et le long terme. Et il le fait avec l’autorité de l’académique, de l’économiste distingué, du professeur, du praticien de la vie économique, du conseiller écouté des plus hauts responsables politiques.
Les propositions de Bruno Colmant, dont d’aucunes ont été adoptées par les gouvernants, visent à transcender le caractère purement technique des solutions à apporter, l’auteur mettant l’accent sur la nécessité de transformer tous les changements, qui se précipitent, en véritable progrès humain. Bruno Colmant n’hésite pas à introduire une dimension éthique dans ses raisonnements car ce qu’on appelle « progrès humain » réfère au vaste chantier de la promotion des valeurs civilisatrices. L’Histoire de l’humanité est largement déterminée par les découvertes de la science et les innovations technologiques qui en découlent. Ce qui se passe et ce qui s’annonce dépassent toute science-fiction. Sous l’Ancien Régime, les changements étaient tellement lents que peu de gens les remarquaient. Aujourd’hui, les changements sont tellement intenses, profonds, disruptifs que peu de gens se rendent compte de leurs conséquences. Mais pas Bruno Colmant, auteur de livres visionnaire.
Démographie galopante, transmigration, problèmes écologiques d’une extrême gravité, digitalisation de la vie en commun, modification génétique, transhumanisme, vieillissement de la population, viabilité menacée de nos systèmes de sécurité sociale, grandes inégalités entre les habitants de la planète, dysfonctionnements de la démocratie ne constituent qu’un résumé incomplet des immenses défis auxquels l’humanité est confrontée.
Les problèmes à résoudre sont d’une extraordinaire complexité et requièrent en plus une prise de décision de plus en plus multilatérale. L’interdépendance est devenue globale. Pour la plupart des citoyens, le pouvoir politique manque totalement de transparence et devient abstrait. Il ressemble à un tableau non figuratif en porte-à-faux avec le souhait d’une démocratie engagée et coopérative, capable de gérer les divergences d’opinions dans une société tolérante. On décide, on décrète, on gouverne, on autorise et on interdit. La mondialisation, conséquence largement positive des progrès scientifiques et technologiques, génère toutefois une série de frustrations. Notre société, au sein de laquelle le peuple devient une population diversifiée, est soumise au règne d’ON, un pouvoir dépersonnalisant et opaque. Il s’agit d’une aliénation, que j’appelle « l’onitude », et qui affecte les électeurs auxquels s’applique l’expression « they have a vote but no voice ». Celui qui proclame que le monde est devenu notre village appartient généralement à l’élite sociétale, alors que le citoyen « normal » a tendance à se rebiffer en affirmant que c’est toujours son village qui constitue son monde. Un point de vue explicable et respectable mais qui, à cause des dérives nationalistes et isolationnistes, ne peut qu’aggraver de graves déceptions.
Cet ouvrage, comme d’ailleurs toute l’œuvre imposante de Bruno Colmant, contient toutefois un message qui échappe au dilemme entre pessimisme et optimisme. Le pessimisme, surtout intellectuel, est débilitant et paralysant et entrave la détermination à agir. L’optimisme, en revanche, face aux énormes défis qu’il faut affronter, n’est qu’un antidouleur fallacieux. En plus, un optimiste est souvent un pessimiste mal informé. Bruno Colmant appartient à une autre école de pensée et de volonté que j’appelle le « méliorisme », à savoir la conviction que les choses et les hommes sont améliorables, que les changements peuvent être transformés en véritable progrès humain et que l’avenir n’est pas un droit acquis mais qu’il faut le construire.
Prof. em. Mark Eyskens — Ministre d’État
I. Contexte de la réflexion
« L’humeur du monde a changé », comme aurait pu l’augurer l’académicien français Georges Duhamel, cité par Charles de Gaulle (1890-1970), entre les deux conflits mondiaux.
Dix ans après une crise économique majeure, cette humeur pourrait devenir maussade pour nos sociétés, dont le modèle social-démocrate tempéré est désormais à risque. Même si ma formation académique ne me donne pas de légitimité pour aborder la réflexion politique, j’ai l’intime intuition que nos communautés européennes se rapprochent de chocs importants menaçant de bouleverser nos structures sociales. Les évolutions socio-politiques contemporaines confinent à d’inquiétantes discontinuités. Cette prémonition est d’ailleurs partagée : la plupart des dirigeants européens l’ont exprimée.
François Mauriac (1885-1970) pensait que « un écrivain est un homme qui ne se résigne pas à la solitude ». L’écriture reflète l’urgence de témoigner. Offrir un texte à la critique est pourtant une démarche fragilisant son auteur. Un essai, c’est d’abord une offrande à la contradiction et une tentative hasardeuse, mais que j’espère féconde, de déchiffrage de l’avenir. La difficulté, dans l’écriture, est évidemment de trouver la bonne distance. J’espère l’avoir approchée. Sans tomber dans un pessimisme stérile, cet essai dévoile le regret que quelque chose s’est lentement abîmé dans nos pays européens, comme un silencieux sabordage.
Comme cet essai se veut être le transport d’une alerte, il reflète mon inquiétude d’une évolution entropique de nos sociétés qui pourraient s’échouer, sauf sursaut moral, au creux de régimes plus autoritaires après des désordres que la redéfinition d’une promesse de société solidaire n’aura pas permis d’éviter par manque de vision et de volonté politiques.
Dans cet essai, le lecteur ne trouvera ni une théorie, ni un travail scientifique ou académique, ni même un constat économique définitif, mais un faisceau d’intuitions. Il s’agit de poser côte à côte, sous différents angles, un ensemble de réflexions relatives à cette réalité. Le temps et le recul, notamment historique, manquent toujours à l’économiste qui se doit cependant d’observer une juste distance focale par rapport aux événements qui se bousculent dans son viseur. La prise de vue n’est toujours qu’imprécise, fuyante. Des zones floues et sombres subsistent.
Pour autant, s’éloignant des explications déterministes ou séquentielles, des corrélations par essence volatiles et temporaires ainsi que de faciles confusions entre les causes et les antécédents (post hoc ergo propter hoc) ou les conséquences, l’économiste pourra, au mieux, identifier des affinités électives ou des congruences entre des phénomènes complexes qui s’entrelacent et s’entrechoquent.
Je crois que nous avons trop vite cédé à l’idée que l’économie de marché entraînait l’atrophie des conflits sociaux, comme si la pseudo-démocratisation du capitalisme anglo-saxon avait dilué les classes sociales et les idéologies. C’était une imposture. Car il se passe quelque chose. On ne pourra pas éviter le dialogue avec les gilets jaunes et des mouvements comme Podemos, les Indignés de Stéphane Hessel, les Nuit debout et Occupy Wall Street aux abords de Trinity Church, devant Wall Street. La pluie et la résignation ont eu raison de ces mouvements mais le feu n’est pas mort et c’est sain pour nos démocraties, d’autant qu’une série de problèmes de nature financière qu’on voyait arriver dans le grand futur se sont rapprochés d’’une génération.
Mais attention : il ne serait pas possible, ni opportun, d’établir une causalité définitive, ou, pire, un déterminisme entre le capitalisme anglo-saxon, désormais transfiguré en néolibéralisme, et le populisme, d’autant que ce dernier, fédéré par des personnalités plutôt que par des systèmes, est protéiforme. La trame de l’essai est que le capitalisme est une source incontestable de prospérité et de liberté mais que sa mutation en néolibéralisme, non plus balisé par les États européens, est source de malaises sociaux.
Le populisme est certes, pour partie, l’expression d’une insécurité sociale et culturelle combinée au tarissement du déversement, théorisé par le démographe français Alfred Sauvy (1898-1990). Selon celui-ci, les progrès techniques, en entraînant une augmentation de la productivité, se déversent du haut de la pyramide sociale vers le bas. Cette notion est incidemment fort proche de la théorie du ruissellement – en anglais « trickle down theory » – qui postule que les revenus des individus les plus riches sont réinjectés dans l’économie, contribuant ainsi, directement ou indirectement, à l’activité économique générale et à l’emploi dans le reste de la société.
Pourtant, je n’ai pas voulu opposer le néolibéralisme aux formes imprécises du populisme car cela aurait conduit à confronter une idéologie à des expressions politiques. En effet, l’analyse des statistiques socio-économiques indique une amplification du populisme à la suite des événements terroristes et à l’accroissement des flux migratoires, qui se sont d’ailleurs taris en Europe. Sauf à croire que le populisme s’oppose à la nomadisation des hommes dans un contexte mondialisé, on ne peut se limiter à l’associer exclusivement à un rejet du néolibéralisme par des populations qui expriment un ressentiment face à tout un système. L’intuition est plutôt qu’il y a uniquement une certaine juxtaposition, et même une affinité élective, entre le néolibéralisme et le populisme, à tout le moins en Europe.
Je me limiterai donc, au fil de ces pages, au partage de mes intuitions, à la fois précaires et provisoires, sur l’état des configurations socio-politiques passées, actuelles et prochaines. Celles-ci se verront certainement chanceler au gré d’épisodes inattendus dont l’envergure, toujours sous-estimée, bouleversera inéluctablement les prospectives. D’une ampleur exceptionnelle, la crise, loin d’être terminée, devrait faire sentir l’amplitude de son cycle et la violence de ses effets endéans les très prochaines années.
L’essai s’articule en plusieurs chapitres. Après avoir contextualisé l’évolution socio-politique contemporaine, un chapitre évoque la trame historique de l’émergence du capitalisme anglo-saxon, particulièrement à compter du siècle passé. Le chapitre suivant propose une synthèse des attributs des capitalismes anglo-saxon et rhénan afin d’illustrer l’intuition que le populisme européen est peut-être lié à la confrontation de nos communautés avec un modèle anglo-saxon qui lui est, pour partie, antagoniste. L’essai s’intéresse ensuite à l’asphyxie progressive du modèle social-démocrate européen et à la nécessité de restaurer le culte de l’intérêt général. Enfin, le dernier chapitre esquisse des pistes de réflexion et de solution centrées sur un projet de société solidaire, dans l’intérêt général des générations futures.
Sans en minorer – au contraire ! – l’importance décisive, cet essai n’abordera pas les défis écologiques, climatiques et énergétiques. D’autres ouvrages en traitent mieux que celui d’un auteur dont ce n’est pas la spécialité académique. Le World Wide Fund for Nature (WWF) propose, à cet égard, comme indicateur, le calcul de notre empreinte écologique, c’est-à-dire la quantité de surface terrestre bio productive nécessaire à produire les biens et services que nous consommons et à absorber les déchets que nous produisons. Il s’agit de la surface totale de Terre requise pour produire les ressources que chacun utilise pour répondre à sa consommation d’énergie et ses besoins d’infrastructures. Un pays connaît un déficit écologique lorsque l’empreinte émise par sa population sur son territoire dépasse la biocapacité de ce territoire. Or, que constate-t-on ? Avec une empreinte écologique de 4,7 hectares par habitant en Europe, nous sommes en surrégime par rapport aux ressources de la planète : si tous les habitants de la Terre vivaient comme les Européens, il faudrait deux planètes supplémentaires pour pouvoir vivre tous ensemble. Par un calcul de prospérité par actualisation, il est donc simple de conclure qu’une économie qui diminue l’empreinte écologique de ses membres augmente le capital écologique des générations de demain. C’est un problème que l’économie capitaliste n’arrive pas à régler, cette externalité négative n’étant pas (encore) intégrée dans les prix de marché. Quand on s’intéresse actuellement aux états de discontinuités, de crises, de déséquilibres à venir, qu’ils relèvent de l’économie réelle ou financière, on s’aperçoit qu’il y a néanmoins une sorte de convergence de tous les paroxysmes vers l’année 2028.
L’économie ressemble à ces terres calmes sur lesquelles les saisons posent leur rythme. Rien ne souille les immuables cycles de la nature. Le temps se dérobe par fines couches qu’aucun sentiment d’attente ne saurait abîmer. Et pourtant, depuis le fond des âges et des entrailles de la Terre, des forces titanesques se déchaînent furieusement. Les hommes et les éléments se battent dans une lutte fanatique.
Alors, parfois, telle une fine lame qui libère ces boursouflures sulfureuses, la Terre éclate de ses orages. Elle rejette des déferlantes de combats. De gigantesques torrents de lave se déversent, emplis de la colère de l’Histoire de l’humanité, trop longtemps contenue. L’homme se bat contre lui-même. Celui qui a travaillé essaie d’échapper à son successeur. Il a inventé la monnaie pour accumuler son travail mais des forces renouvelées refusent cette oppression.
C’est la révolution ou la dévaluation.
Toute la rage des humains et de la monnaie enchaînés hurle dans des bouillonnements qui détruisent tout, avant de modeler de nouveaux mondes arides. Les penseurs de l’économie sont là, tels de lugubres fantômes unis par les mêmes inquiétudes. Ils savent que le monde peut, à tout moment, basculer.
L’année 2019 sera peut-être l’année des bouleversements socio-politiques après que nous ayons corrodé et éreinté, par l’emprunt d’un bien-être des futures générations et par pusillanimité politique, le modèle social-démocrate solidaire qui avait prévalu après le second conflit mondial.
Louis-Ferdinand Céline commence son Voyage au bout de la nuit par « Ça a débuté comme ça. Moi, j’avais jamais rien dit. Rien… »
Je n’ai pas voulu être Ferdinand Bardamu.
Bruno Colmant
Hiver 2018-2019
II. Une tempête populiste
Les rafales de crises économiques et sociales, dont la mutation est permanente, placent aujourd’hui notre continent devant des défis socio-économiques extrêmement importants. La croissance économique s’illustre par sa faiblesse, probablement liée au vieillissement de la population, tandis que les États conservent des systèmes sociaux dont la seule garantie est l’espoir d’une croissance future et de prélèvements fiscaux qui seront déçus.
1. Des gilets jaunes aux multiples teintes
J’ai commencé la rédaction de ce texte quelques mois avant les manifestations tentaculaires du mouvement des gilets jaunes dont je ne peux pas présager de l’aboutissement au moment de la publication de l’essai. Ce mouvement de colère de certaines classes populaires, dont les rages s’additionnent, déçues par la gauche et la droite et donc tentées par les extrémités politiques, ne m’a pas surpris. Depuis plusieurs années, je consacre de nombreux articles à l’imminence de chocs sociaux découlant de la perte de repères induite par la mondialisation et, encore plus, de l’austérité, plus perçue que réelle car la croissance économique est incontestable, donnée par les autorités européennes en réponse aux crises successives des subprimes en 2008 et des dettes souveraines en 2011.
Je distingue évidemment une expression de malaise social des phénomènes insurrectionnels qui sont constatés à Paris au moment d’écrire ces lignes et qui font penser au film American Nightmare (2013, La Purge, en français), qui décrit une société américaine dystopique caractérisée par un faible taux de chômage et de criminalité compensé par une période annuelle de douze heures consécutives au cours de laquelle toute activité criminelle est permise. Au cours de cette nuit, officiellement appelée « la Purge », chacun peut évacuer ses émotions négatives en réglant ses comptes, ou plus simplement en s’adonnant à la violence gratuite.
Sans comprendre les ferments de la sourde colère des oubliés de la mondialisation, nos gouvernants et syndicats (que les réactions populistes disqualifient complètement) restent d’ailleurs indécis devant ces mouvements non structurés et non dirigés qui reflètent d’abord, à mon intuition, un désespoir social, un abandon sociétal et la perte d’un projet collectif solidaire. Ce sont des mouvements antiparlementaires et opposés aux médias traditionnels, sans figure de proue, au contraire du poujadisme, du nom de l’homme politique Pierre Poujade (1920-2003).
Aujourd’hui, l’accès aux centres urbains et aux gisements de travail devient la césure, ou plutôt la fracture sociale, d’autant plus visible que la vitesse de la sphère marchande s’accélère. L’économie digitale et les exigences logistiques font pénétrer nos communautés dans un contexte de flux commerciaux plutôt que de stock d’actifs. Si la vitesse de ce flux dépasse la capacité de mobilité et d’adaptation du travail, certains veulent réduire la vitesse des échanges. Ce n’est donc pas une coïncidence que les premières manifestations des gilets jaunes aient consisté à ralentir les flux de véhicules autour de ronds-points ou sur le tracé des autoroutes.
Derrière ces slogans et barricades, se cache un profond effroi devant l’oubli des plus faibles par les élites depuis le basculement financier subi en 2008, l’insécurité économique, sociale et morale liée aux clivages sociaux et géographiques entre populations urbaines et rurales, et, enfin, l’impact effroyable des attentats et la peur entretenue de l’immigration et de ses conséquences démographiques résultant des bouleversements moyen-orientaux.
Cette peur de l’immigration plonge ses racines dans de nombreuses angoisses, dont celle du glissement du socle des valeurs mais aussi celle du partage du travail et donc du déclassement social face à ces populations nouvelles pourtant bien nécessaires pour contrer le vieillissement structurel de nos communautés. La détérioration des services publics (fermeture de gares ou de bureaux de poste notamment, dans des régions isolées et des villes oubliées) joue aussi un rôle décisif, tout comme la rupture des structures familiales et la nécessité de renouer avec des solidarités, même éphémères et circonstancielles, ce qui ne les disqualifie pas.
Ce mouvement des gilets jaunes est lui-même le produit d’un nouveau mode de communication au travers des réseaux sociaux qui ouvrent d’ailleurs la voie à des expressions politiques humiliantes, outrancières et indignes qui s’enracinent dans l’anxiété populaire. N’étant pas fédéré par des personnalités dirigeantes dont l’émergence serait incidemment la contradiction de sa spontanéité et de la pluralité de ses revendications (sauf à envisager la structuration d’un mouvement organisé insurrectionnel ou révolutionnaire), il permet d’agréger des revendications multiples et contradictoires, personnelles et collectives. Les pouvoirs publics se retrouvent impuissants devant ce type de mouvement : la répression serait immorale tandis que la promesse d’un futur meilleur relève de l’imposture.
Le mouvement des gilets jaunes est aussi une manifestation contre des inégalités salariales et le manque de dignité du travail manuel. C’est une crise du pouvoir d’achat et d’une prospérité mal partagée, et la Belgique en est l’éprouvette : issu de France, le mouvement s’est étendu en Wallonie, infiltrant la partie la plus pauvre et rurale du pays, tandis que la capitale, Bruxelles, et la Flandre, ayant mieux épousé le cycle économique, n’en ont pas été affectées.
Si certains qualifient ces élans d’expressions du libéralisme, il semble que cela soit pourtant de l’inverse dont il s’agit. Depuis la crise de 2008, les inégalités salariales se sont incontestablement accrues alors que le capital s’est amplifié grâce à la baisse des taux d’intérêt décidée par les banques centrales pour contrarier les tendances déflationnistes. Dans toutes les statistiques officielles, nationales, européennes ou mondiales, la part des revenus du capital augmente au détriment de la part des revenus du travail dans la richesse produite.
Le travail devient précaire et le pouvoir de négociation salariale des travailleurs est très limité dans une économie digitale et robotisée dans le secteur industriel et désormais dans l’économie des services. Même si le choc de 2008 a été, pour partie, surmonté, l’Europe reste menacée d’un chômage endémique et structurel pour les personnes moins qualifiées alors que la mobilité des capitaux met en concurrence les systèmes sociaux. Cette réalité est encore plus frappante aux États-Unis qu’en Europe : malgré un taux d’activité plus faible qu’auparavant, les États-Unis sont en situation de plein emploi sans augmentation du pouvoir d’achat salarial depuis des décennies.
Nombreux sont ceux qui considèrent le modèle de la stabilité économique et de l’emploi en expansion comme une référence. Ce modèle, caractérisé par des paramètres démographiques et socio-politiques invariants, ne rencontre pourtant plus les réalités de la jeunesse dans de nombreux pays. Déjà accablée par des taux de chômage effarants, celle-ci se voit confrontée à un phénomène inédit : la précarité persistante de l’emploi. Dans la plupart des pays européens, les segments d’emplois précaires ouverts à la jeunesse deviennent la norme. La durée de promotion d’un contrat précaire en emploi stable s’allonge, tandis que le taux de pauvreté des jeunes et de certains aînés est en lévitation. Si ce modèle de précarité de l’emploi et du multi emploi (induit par le fait que de nombreuses personnes doivent cumuler des emplois), qui conduit à ce que chacun devienne un indépendant employable selon un degré de liberté modulable, s’impose, sera-ce une victoire sociale, celle de la liberté individuelle, ou un échec sociétal, celui de la fin des réponses collectives ? La question est ouverte.
En Europe, il n’est pas non plus possible de distinguer le populisme du façonnement monétaire de l’euro, couplé à la déterritorialisation du travail. Les unions de devises sont très exigeantes car elles impliquent une mobilité des facteurs de production. Malheureusement, si une monnaie unique exige la mobilité du capital sans entraîner celle du travail, c’est tout le mécanisme économique qui se grippe. Faute d’utiliser la devise pour refléter la force d’une économie, ce sont les forces de travail qui doivent alors s’ajuster à la monnaie, s’adapter à la versatilité des poches d’emploi, voire migrer. Or, la mobilité des travailleurs est bien naturellement et légitimement limitée dans le temps et l’espace. Lorsque le poids de l’exigence monétaire devient insupportable à une population, la monnaie est alors contestée. Ajoutons qu’une devise, qui ne se défend jamais par la force publique, n’existe que par l’adhésion populaire. En basse conjoncture, les unions monétaires s’opposent aux revendications sociales. Là aussi, on constate que les gilets jaunes s’opposent, par leurs actions de blocage routier, à une mobilité du travail requise par le déplacement latéral des foyers de croissance, pour partie lié à la monnaie unique.
Une autre couleur à la palette du populisme est la probable prise de conscience de la finitude des biens publics et de l’État-providence, largement financé par l’endettement public, c’est-à-dire par l’espoir socio-étatique d’une ponction sur la prospérité future. L’économiste allemand Adolph Wagner (1835-1917), en énonçant sa loi éponyme, exposait que plus la société se civilise, plus l’État est dispendieux, c’est-à-dire que la part des dépenses publiques dans le produit intérieur brut augmente avec le revenu par habitant. Wagner décelait donc une corrélation entre le niveau de développement et l’étatisation de l’économie. Cette corrélation peut paraître contre-intuitive lorsqu’on adhère à l’idée que c’est l’économie de marché et non le collectivisme qui apporte le progrès. Wagner l’explique par un accroissement de la demande de biens publics plus rapide que le développement qui l’induit. Il enseigne également une autre leçon, à savoir que le rôle de la fonction publique est de consolider le pouvoir de la bureaucratie. L’État est ainsi bénéficiaire de la croissance. Il suppose aussi que l’accroissement du rôle de l’État renforce la paix sociale par la redistribution. Voici peut-être un constat que l’on peut tirer de la crise : au-delà des manifestations populistes, celle-ci entraîne une étatisation croissante accompagnée de son corollaire d’accélération des dépenses publiques, qui deviennent, théoriquement, les ciments sociaux qui assureront la cohésion sociale.
Certains associent l’émergence des mouvements populistes à la sécularisation de nos communautés. Selon cet argument, cette dernière entraînerait leur anomie, c’est-à-dire la désintégration de leurs valeurs sociales. À mon intuition, la puissance explicative de cet argument est faible, sans qu’elle soit disqualifiée pour autant qu’on s’intéresse à l’aspect culturel et communautariste, et non strictement religieux, de cette sécularisation. Au reste, certains mouvements populistes sont encouragés par des mouvements religieux. C’est le cas aux États-Unis et au Brésil. Mais plus que la sécularisation des communautés qu’on constate en Europe, il me semble que c’est plutôt le glissement d’un monde de centralisation catholique vers un contexte d’empreinte protestante qui est établi, à commencer par la mutation du capitalisme qui trouve ses racines dans des pays protestants (États-Unis et Royaume-Uni). J’avais développé cette thèse dans l’ouvrage Capitalisme européen : l’ombre de Jean Calvin (Collection de l’Académie royale de Belgique, 2013). L’argument de la lutte des classes me paraît avoir un pouvoir explicatif légèrement plus pertinent, encore que limité, que le constat de la sécularisation dans la lecture du populisme européen contemporain.
Quoiqu’il en soit, le populisme exprime la marginalisation, une désespérance et une misère sociale alimentant un sentiment de déresponsabilisation personnelle. Même la pédagogie sur les réalités économiques et les dépenses sociales de l’État devient inutile. Ces informations sont, au mieux, des abstractions. Le populisme traduit un sentiment, en partie justifié, de solitude et d’abandon. Il est aussi le reflet de la déliquescence d’un modèle social qui fonde et entretient pourtant la notion d’État-providence, qui amplifie ses effets redistributifs par l’éducation et les soins de santé.
De nombreux citoyens, écartés de la mondialisation par une sphère marchande oppressante et alimentant l’image de désirs matériellement inassouvissables, sont en perte de dignité humaine. Les réseaux sociaux enflent les pulsions narcissiques de personnes qui deviennent malheureusement les victimes d’une économie irradiante mais inaccessible.
Tout ceci est d’autant plus intolérable que des révélations de type « Panama Papers » et autres « LuxLeaks » illustrent l’existence, souvent tronquée et populiste, d’une infime couche de la population qui se jouerait des lois, jusqu’alors en toute impunité, pour assurer sa prospérité de manière occulte. Il faut évidemment rester très prudent devant ces scandales dont le décodage est d’abord émotionnel et passionnel plutôt que raisonné et instruit par des spécialistes. Il en découle l’image d’une sphère financière immorale, obscure, dévoyée et dissociée de la réalité de la vie laborieuse. Il ne faut incidemment pas sous-estimer l’exacerbation du sentiment d’impunité fiscale par l’opacité qui entoure ses protagonistes, qui explique qu’on tolère plus facilement les salaires phénoménaux de joueurs de football dont on peut apprécier les prestations physiques et même s’y associer lors d’événements populaires que le salaire d’un opérateur boursier qui, sa réalité et son humanité étant moins accessibles à l’imaginaire collectif, sera vilipendé.
2. Les concentrations politiques
Si la notion de populisme est ancienne et ramène à la psychologie des foules élaborée par Gustave Le Bon (1841-1931), effrayé par la Commune de Paris après la première guerre franco-allemande et les impulsions de masse associées aux mouvements ouvriers, on l’interprète désormais comme un antiélitisme compris comme un rejet de certaines configurations étatiques et marchandes. Gustave Le Bon examine, dans sa thèse séminale, la dilution de la rationalité individuelle dans les pulsions émotionnelles d’une foule.
Au reste, on peut intuitivement établir un parallèle entre les populismes du XIXe siècle, dérivés de la révolution industrielle manufacturière, et ceux du XXIe siècle, associés à la révolution technologique liée au déploiement d’Internet dans une expansion mondialisée des flux de commerce. Les premiers mouvements populistes furent d’ailleurs qualifiés tels quels dans la Russie tsariste de 1840 ainsi qu’aux États-Unis, lors des troubles agrariens de 1870.
La volatilité socio-économique enfle et devient insupportable aux yeux de populations européennes qui avaient trouvé l’apaisement dans un modèle social-démocrate. Aujourd’hui, l’inquiétude que le capitalisme anglo-saxon suscite en se couplant aux dynamiques de mondialisation et de digitalisation se fait le terreau fertile de tous les engouements populistes. Ce modèle économique apparaît consubstantiel à l’exaspération sociale qui conduit à le rejeter tout en nourrissant ses côtés obscurs.
Le capitalisme anglo-saxon s’emballe dans une course contre le temps facilitée par les marchés financiers qui entretiennent leur propre volatilité. La peur de l’avenir conduit à renoncer au présent et à alimenter une course éperdue vers des futurs qu’on voudrait paradoxalement conjurer. On mondialise pour conjurer la mondialisation, on spécule pour combattre la spéculation, on abandonne la pensée réfléchie pour conjurer des flux informationnels. En d’autres termes, le capitalisme mondialisé renforce son propre caractère volatil. Le monde suffoque dans un système économique qui accélère sa propre dynamique.
Si, dans les paragraphes précédents, je me suis essayé à esquisser et à circonscrire certaines causes et certains attributs des manifestations populistes spontanées, tels les gilets jaunes, il en va autrement des mouvements populistes structurés politiquement. Il s’agit souvent, dans ces cas de figure, d’une approche démagogique, et souvent emmenée par une forte personnalité, qui oppose le peuple aux élites et aux structures politiques accusées de le priver de ses droits. Les cas des États-Unis et de l’Italie sont, à cet égard, révélateurs.
Il est alors de nature politique plutôt qu’idéologique. Il considère que des élites corrompues s’opposent à la volonté d’une expression d’un peuple vertueux et adhérent « pur », victime de la mondialisation, ce qui conduit à la recherche d’homogénéités raciales, ethniques et religieuses notamment (ce qui explique peut-être l’expression croissante d’un antisémitisme au sein de certaines couches des gilets jaunes français). Le populisme est d’abord le résultat d’un abandon, par les dirigeants de nos pays, de la gestion de la chose publique, la res publica, au détriment de l’économie, qu’elle soit de nature anglo-saxonne ou autre. L’abandon du politique pour l’économique signifie donc, pour certains pays européens, la subordination de la gestion politique à une certaine modalité du capitalisme.
Au reste, le populisme ne reflète pas l’opposition de corps sociaux préalablement définis selon une géométrie horizontale, mais une expression verticale de rejet des ordres établis. L’exemple allemand est, à cet égard, très intéressant : il n’est en effet pas possible de superposer l’émergence de l’AfD (Alternative für Deutschland) à des origines géographiques ou idéologiques (la RFA ou République fédérale d’Allemagne et la République démocratique allemande ou RDA), ni même à des empreintes religieuses (catholiques ou réformées).
Je ne crois pas que le populisme se juxtapose parfaitement à la lutte des classes, au sens marxiste, puisqu’il ne correspond pas à une division étatique ou à l’opposition entre la bourgeoisie et le prolétariat. Il relève néanmoins d’une opposition du travail au capital dans le cadre mondialisé. Au reste, il ne s’inscrit pas dans une dualisation de la société, mais dans son atomisation sociale, entraînant une solitude (liée, entre autres, à la déstructuration des cellules familiales et à la perte de repères moraux) ainsi qu’une angoisse personnelle suscitant un manque d’empathie. Cette solitude conduit à décomposer les éléments de la solidarité traditionnelle. Si l’atomisation sociale s’accompagne d’une restratification sociale associée à la déliquescence lente de la classe moyenne, les réseaux sociaux déstratifient la transparence des modes de vie, entraînant l’exacerbation des désirs de consommation confrontés à leur impossibilité d’assouvissement financier.
Le populisme ne trouve pas toujours de relais politique. Il revêt d’ailleurs parfois les attributs de mouvements insurrectionnels établis sur des communautés fluentes qui entretiennent leur propre dynamique de contestations confuses, à l’instar des mouvements de masse des gilets jaunes français. Mais on aurait pu croire que le populisme, s’opposant à l’ordre établi, ressortirait plutôt à la gauche politique. Il n’en est pourtant rien. Certaines émergences politiques, comme la Ligue italienne, s’inspirent de la pensée de Mussolini tandis que des personnalités fortes de droite en incarnent d’autres (en Hongrie, en Autriche, etc.). C’est sans doute l’une des nombreuses illustrations de la difficulté pour la gauche traditionnelle d’exister politiquement après avoir vu son champ d’action politique confiné par les traités européens associés à l’euro. On peut même étendre le raisonnement à l’impossible déploiement d’un modèle politique de gauche dans une économie nappée d’un capitalisme anglo-saxon néolibéral. Cette situation est un lointain écho à l’injonction « Prolétaires de tous pays, unissez-vous ! » (« Proletarier aller Länder, vereinigt euch! ») concluant le Manifeste du Parti communiste publié en 1848 par Karl Marx (1818-1883) et Friedrich Engels (1820-1895). À la mondialisation du capital, Karl Marx avait opposé son souhait d’un rejet prolétaire universel.
C’est dans ce contexte que des émergences politiques trouvent des terreaux fertiles pour s’épanouir. Certaines sont déstructurées, comme l’illustrent les expressions des gilets jaunes. D’autres, plus structurées, personnifient l’apaisement d’un monde utopique tout en entretenant le danger et les menaces du monde présent. Elles alimentent la névrose de terreur du présent qu’elles travestissent en monde dystopique pour le conjurer. Elles agglomèrent les narcissismes vers l’emballement. Il faut observer les communications de Jean-Luc Mélenchon, de la Ligue italienne, de l’AfD, du Rassemblement national français, entre autres, pour comprendre que les nouvelles configurations politiques relayent la pulsion de mort du capitalisme. Gilles Dostaler (1946-2011) et Bernard Maris (1946-2015), décédé lors de l’attaque de Charlie Hebdo, associaient d’ailleurs le capitalisme à la pulsion de mort. Ce n’est pas un hasard s’ils mettent tous en joue la symbolique ultime du capitalisme, à savoir la monnaie.
Pour ces aventuriers politiques, le modèle économique est consubstantiel à l’exaspération sociale qui conduit à le rejeter tout en en exacerbant les côtés obscurs. Quel est le message de ces populistes qui inventent des exclusions et des lignes de démarcation ? Le passé lointain semble apaisant et pousse certains à cultiver un culte des généalogies disparues. Le présent semble incompréhensible tandis que le sentiment d’un avenir effrayant se dilate. Le spectre de guerres, d’ailleurs impossibles à conceptualiser, est entretenu tandis que des idées d’insurrections et de conflits civils invitent les aventuriers politiques à sortir du bois.
« La terre, elle, ne ment pas », susurrait Philippe Pétain en juin 1940. Ceux qui établissent une causalité entre le néolibéralisme et le populisme parlent d’ailleurs de néofascisme au titre de dérivé d’une économie de marché idéologisée. On retrouve, dans la trame populiste, une empreinte fasciste si on se réfère à la Doctrine politique et sociale du fascisme de Benito Mussolini, exprimée en 1933 : « Si le XIXe siècle était le siècle de l’individualisme, nous sommes libres de croire que ceci est le siècle “collectif”, et ainsi le siècle de l’État. » Le rejet du libéralisme entraîne une réaction populaire qui veut restaurer l’État sous des attributs d’autant plus autoritaires que la sphère marchande échappe aux citoyens et à l’État. Le populisme est alors une liquidation des structures sociales. C’est une ubérisation de la pensée et la création de groupes par des processus d’individuation.
Au reste, une chose me paraît frappante, à tout le moins depuis l’élection de Donald Trump (1946-) : le populisme américain, même s’il est une complexe chimie de néolibéralisme et de conservatisme, voire de bigoterie morale, est plutôt synonyme de progrès économique, là où son acception européenne l’assimile à une régression sociale. À cet égard, il est intéressant de noter qu’à la suite de la crise de 2008, les États-Unis de Trump ont tourné le dos aux réponses rooseveltiennes des années 1930 et au social-libéralisme de Tony Blair (1953-) et de Gerhard Schröder (1944-), respectivement Premier ministre du Royaume-Uni entre 1997 et 2007 et Chancelier allemand entre 1998 et 2005.
Le sentiment d’étouffement et d’encerclement par des forces économiques non structurées allume le désir d’un retour à une nation souveraine. Ainsi, le populisme, en rejetant l’élite mondialisante et l’économie mondialisée, se révèle parfois de nature souverainiste. À nouveau, on identifie ici clairement un lien à l’économie.
Au reste, il est essentiel de souligner que le populisme, lorsqu’il est organisé politiquement (cette précision est cruciale), est souvent associé à la notion de démocratie illibérale, ce qui est en soi un sujet à confusion. Certains l’évoquent pour illustrer le fait que des régimes autoritaires, tel le régime vénézuélien qui en constitue l’aboutissement eschatologique, accèdent au pouvoir par des moyens démocratiques. Le populisme est une expression d’intolérance par rapport à l’expression démocratique traditionnelle, perçue comme incapable de faire émerger une vision de la gestion de la société au motif de l’image déformée de l’égalitarisme associée à l’État de droit.
C’est incidemment pour cela que le populisme a besoin des structures démocratiques de l’État pour les nier ensuite : l’égalitarisme démocratique sert d’élément fédérateur pour légitimer des pouvoirs qui le combattent. La démocratie participative, invoquée comme substitut ou comme complément de la démocratie représentative, serait ainsi un foyer de populisme puisqu’il s’agirait de nier la structure de représentation démocratique au motif qu’elle serait élitiste.
L’idée est plutôt qu’une démocratie peut être dissociée du libéralisme et donc des principes de l’État de droit et du pluralisme. Les démocraties illibérales sont donc hostiles au libéralisme. Il s’agit d’un rejet du libéralisme au titre de doctrine de philosophie politique et morale fondée sur la liberté et la reconnaissance de l’individu. Consubstantiellement, il s’agit aussi d’un rejet du libéralisme économique associé au Siècle des Lumières, qui postule que les libertés économiques (libre-échange, liberté d’entreprendre, libre choix de consommation, de travail…) sont nécessaires au bon fonctionnement de l’économie et ne tolère de l’État qu’une ingérence la plus limitée possible. Si le populisme conduit à la démocratie illibérale économique, on peut à nouveau y lire le rejet du mode capitaliste anglo-saxon.
Un dernier élément peut être rapporté à cette intuition : la démocratie, sous son acception contemporaine, se fonde sur la classe moyenne. Or, si cette dernière a constitué le socle du contrat social d’après-guerre, elle s’étiole désormais sous les forces de marché et le démantèlement de l’État-providence. Ceci conduit à renouveler le constat selon lequel les mouvements populistes ne se fondent pas sur une stratification sociale, mais bien sur une impulsion populaire.
3. Les salaires et le vieillissement de la population
Les causes de la crise sont essentiellement endogènes : le renversement des courbes démographiques, le vieillissement de la population, la chute des gains de productivité, le déclassement des personnes moins bien formées au milieu d’une révolution technologique, etc. Le dernier rapport de l’Organisation internationale du travail (OIT) révèle que la croissance des salaires n’a jamais été aussi faible que depuis 2008 et que les différences salariales entre hommes et femmes restent, au niveau mondial, à un niveau inacceptable de 20 %.