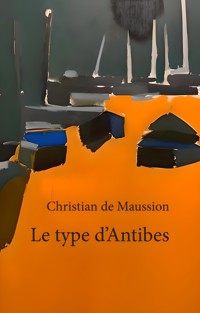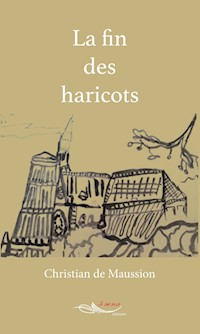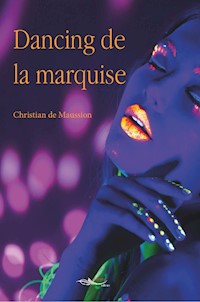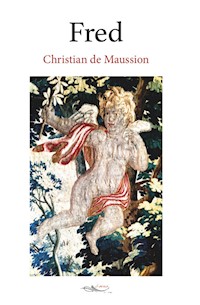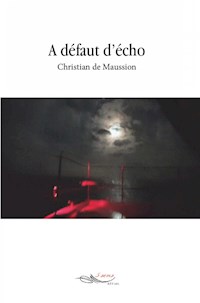
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: 5 sens éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Vous savez, nous sommes comme des compagnons de voyage, dans un compartiment de train. Sur un détail, nous engageons la conversation, puis nous nous confions l’un à l’autre comme si nous nous connaissions de toute éternité. Ce que je chuchote à votre oreille, c’est une prière partagée, le culte de la beauté.
À vrai dire, quand je prends le train, j’oublie sa destination. Je regarde par la fenêtre et je ne comprends rien. Je n’insiste pas. J’oriente alors mes yeux vers le compartiment. J’y découvre que ce n’est pas le travail qui fatigue mais l’ennui. Dans un train, en pleine journée, les trois quarts des passagers dorment à moitié.
Je descendrai votre bagage avec plaisir. J’ai l’habitude des sacs volumineux, des belles malles Vuitton de jadis dont j’ai la nostalgie. Au bar du terminus, on commandera quelque chose en attendant un vieux bus.
Je suis un piètre danseur. En revanche, je suis un bon vivant. Je souperai volontiers au restaurant du wagon. Votre apparition en robe de gala me fera forte impression. La soie sur vous m’ensorcèle. Je frôlerai d’une paume distraite votre jolie taille. C’est un art supérieur que de savoir faire une valise.
À PROPOS DE L'AUTEUR
La littérature l’avait aidé jusque-là, sorti d’embarras, de mille déconfitures. Il imaginait bien qu’elle ne lui serait d’aucun secours pour mourir. Il griffonnait des bouts d’alphabet. Il soignait la forme de crachat, fabriquait son venin sous la dictée d’une peur. Alors il avait su ce que signifiait, ce que révélait à vrai dire un style, une manière d’être seul.
Christian de Maussion publie son septième ouvrage, le cinquième chez 5 Sens Editions.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 115
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christian de Maussion
À défaut d’écho
Du même auteur
Dancing de la Marquise
5 Sens Editions, 2020
Fred
5 Sens Editions, 2019
L’Amitié de mes Genoux
5 Sens Editions, 2018
La Cicatrice du Brave
5 Sens Editions, 2017
Ainsi soit Staël
Editions du Bon Albert, 2013
C’est encore loin de Gaulle ?
Editions du Bon Albert, 2002
Cahier de L’Herne Simone Weil
Editions de L’Herne, 2014
Cahier de L’Herne Michel Serres
Editions de L’Herne, 2010
Blog A la diable
alladiable.blogspot.com, 2008-2020
À elle, la rouquine de Linkedin
« On a dit que la beauté est une promesse de bonheur. Inversement la possibilité du plaisir peut être un commencement de beauté. »
Marcel Proust (À la Recherche du Temps perdu, La Prisonnière, Bibliothèque de la Pléiade, tome III, page 647)
Bonjour Virginie,
Je suis touché, ému, percé par votre message qui est une flèche. Il est rare que deux visages communiquent, s’entretiennent pour de vrai. Or je vous reconnais aux premiers mots, sans vous identifier. Vous le pressentiez : la littérature est ma vie. Vous voudriez que je m’épargne les soucis de la laideur. Je vous comprends un peu. Mais je crois qu’il convient de la transfigurer, de faire d’une disgrâce un rayon de beauté. Écrire n’est jamais que fuir une sale gueule, essayer de se reconstituer une figure acceptable. Les phrases sont mon visage. Elles couvrent ma laideur. « Mes ours ratés » ne sont pas vraiment laids – sans doute, sont-ils ridicules –, mais je les veux beaux par mes mots. Je pense que ces gouttes de laideur rehaussent la beauté, lui donnent un charme, un strabisme entêtant. Au-delà de tout ça, j’aime la beauté brute, sauvage, sans ratures. J’aime l’épiphanie d’un visage, l’apparition miraculeuse d’une splendeur. Je viens d’achever le portrait d’un père. C’est un manuscrit qui s’appelle « Ted ». La beauté y est reine. Elle y courtise la bonté.
J’ai besoin de bien réfléchir à ce que vous écrivez. Ce que je sais, moi, à l’heure où tous mes amis, mes compagnons d’une même passion, sont morts, où ceux que j’aime, par liens du sang ou du coeur, se comptent à peine sur les doigts d’une main, ce que je sais c’est que les grands morts de la littérature me sont nécessaires pour vivre. J’ai besoin de Marcel Proust, de Gustave Flaubert, d’André Pieyre de Mandiargues, de Jacques Chardonne, de Julien Gracq, de Jean-Jacques Rousseau, de François-René de Chateaubriand. Tour à tour, ils s’invitent à ma table de lecture. Je les accueille avec joie. Ils me parlent si bien de ce que j’aime. La conversation avec ces grands artistes m’interdit d’être triste. Je les relis et je me sens bien : à demeure, chez moi.
Tant qu’ils viendront à nos dîners, tout ira bien. Hugo et Dostoïevski sont souvent de la partie. Je reçois aussi Bach et Chopin. Chez les jeunes, j’ai beaucoup de plaisir à écouter Bashung. Le jour où ils nous feront faux bond tous ceux-là, je mourrai sur le coup, faute d’oxygène.
Après les menues besognes matérielles qui m’ont accaparé ces dernières heures, je suis heureux de reprendre le fil de notre conversation. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Si je discrédite l’idée même d’histoire c’est que précisément je ne sais pas les raconter. D’un défaut, j’essaie de faire une vertu. Je biffe d’un trait l’histoire. Facile, direz-vous. Sans doute. Si je crois au travail, je crois encore plus à la vocation. Ma nature est de peaufiner la phrase, pas de bâtir un récit avec des personnages. Je ne sais pas le faire. Vous êtes peintre. Je me sens proche de la peinture. Une toile ne raconte rien. Elle fixe des vertiges, pour parler comme Rimbaud. À l’extrême limite, je pense pouvoir faire des portraits. « Ted » en est un. Au-delà, j’aborde une terre étrangère à mon désir. Je n’ai pas envie. La volonté – qui sent toujours mauvais – ne pourra rien m’imposer. Mon boulot est le travail des mots. On ne me fera pas boire un breuvage dont je n’ai pas la soif. Je n’écris pas à contre-penchant. J’écris si nécessaire.
Vous avez raison d’avoir le trac. Moi, je suis dans mes petits souliers avant d’ouvrir un grand livre.
Sartre, dans son magnifique et magistral livre inachevé sur Flaubert « L’Idiot de la Famille » (dix ans d’écriture, près de 3 000 pages), parle très bien de la Chantepie. C’est une Bovary, sujette à la mélancolie provinciale, qui se découvre dans Emma. La Chantepie est touchante de vérité. Flaubert lui répond en toute simplicité, d’égal à égal, sans jamais la dédaigner, bien au contraire, lui conseille des lectures fortes, de prendre l’air, de regarder les ciels, pour sortir de sa claustration morbide. C’est une correspondance bouleversante.
Quand j’avais vingt ans, une amie russe, fille d’une danseuse étoile de l’Opéra de Paris, m’a emmené au théâtre des Champs-Élysées voir danser Mikhaïl Barychnikov. J’ai été ébloui, marqué à vie.
La publicité autour de Sartre m’a longtemps agacé, éloigné du personnage. Je ne l’aimais pas, ne voulais pas le lire. J’avais lu « Les Mots », beau livre, point barre. Sur le tard, il y a trois ans, j’ai changé d’avis. Avec son Flaubert, j’ai découvert le vrai Sartre. C’est un grand écrivain, un authentique artiste.
J’ai essayé de lire Simone de Beauvoir. Je me suis arrêté en chemin. Une écriture sans faute, de première de la classe. Mais justement trop scolaire, trop académique, presque conventionnelle.
Vous me donnez mauvaise conscience. J’ai abandonné la gym cette année et je m’en ressens. Je me sens lourd, maladroit, sans souplesse. Il faut que je m’inscrive à un cours de stretching. J’aime bien courir mais la pollution de l’air me rebute. Je ne me rendors pas. Je suis bien éveillé, Virginie.
Votre Flauflau, c’est « l’oncle Cruchard », c’est comme cela que Gustave signe parfois ses lettres à sa nièce Caroline, la fille de sa soeur. Et Cruchard, c’est un personnage imaginaire, le révérend-père Cruchard dont le fou furieux de Croisset a inventé l’existence et a d’ailleurs rédigé une brève biographie. Parler de Flaubert me donne envie de m’y replonger. Mais je ne peux pas. Car je relis – Dieu sait que je n’aime pas cette formule convenue de l’ignorant qui relit sans jamais avoir lu –, mais je lis une deuxième fois, quatre ans après la lecture inaugurale, les sept livres de Proust qui constituent La Recherche. C’est une aventure de six mois, un bonheur incomparable, le sentiment d’une vraie plénitude. Je m’y sens tellement bien. J’ai le projet très ambitieux d’écrire une histoire d’Albertine, Albertine Simonet, de relater la fuite de la prisonnière de Marcel jusqu’à sa chute de cheval mortelle. Tout cela est à écrire. Cela dit, je retiens le Pilates.
Lire Proust par petits bouts, c’est bien, mais le lire in extenso, sans s’arrêter en besogne, c’est une expérience de vie, quelque chose qui vous cogne, vous change intérieurement. Il faut avoir du temps, beaucoup de temps. C’est un peu le sujet du livre, si tant est qu’il y ait un sujet. J’en suis sorti transfiguré. Je n’ai qu’un mot pour désigner Marcel Proust : admirable.
En réalité, j’aime bien Albertine, son caractère effronté. Elle est brune, ce qui me plaît. Proust laisse beaucoup de trous dans son livre grandiose. Rassurez-vous : je ne me prends pas pour Proust. Je sais rester à ma place. Simplement, je suis amoureux d’Albertine. Écrire un livre, c’est vivre avec elle. Et Proust n’en dit pas assez. Mais tout cela est embryonnaire. J’ai tort d’en parler. J’écris autre chose qui me tient à coeur. Mais par intermittence. Le projet Albertine viendra plus tard, à son heure. Je prends des notes, mais je n’écris pas.
Vous savez, nous sommes comme des compagnons de voyage, dans un compartiment de train. Sur un détail, nous engageons la conversation, puis nous nous confions l’un à l’autre comme si nous nous connaissions de toute éternité. Ce que je chuchote à votre oreille, c’est une prière partagée, le culte de la beauté.
À vrai dire, quand je prends le train, j’oublie sa destination. Je regarde par la fenêtre et je ne comprends rien. Je n’insiste pas. J’oriente alors mes yeux vers le compartiment. J’y découvre que ce n’est pas le travail qui fatigue mais l’ennui. Dans un train, en pleine journée, les trois quarts des passagers dorment à moitié.
Je descendrai votre bagage avec plaisir. J’ai l’habitude des sacs volumineux, des belles malles Vuitton de jadis dont j’ai la nostalgie. Au bar du terminus, on commandera quelque chose en attendant un vieux bus.
Je suis un piètre danseur. En revanche, je suis un bon vivant. Je souperai volontiers au restaurant du wagon. Votre apparition en robe de gala me fera forte impression. La soie sur vous m’ensorcèle. Je frôlerai d’une paume distraite votre jolie taille. C’est un art supérieur que de savoir faire une valise.
Pour « Ted », Madame Cinq Sens n’a pas dit son dernier mot. J’admire trop la danse pour y rentrer. Mais avec vous, c’est différent. Je m’appliquerai.
Moi, c’était en Normandie, entouré d’une grande plaine et d’une forêt hirsute. Mon père, c’était « Ted ». Je lis Proust aujourd’hui, cinquante ans après, dans le même livre que lui. Il se dépiaute un peu. Je ne peux pas le lâcher. Mes souvenirs sont mitigés. J’en parle dans « L’amitié de mes genoux » (bout de poème de Saint John-Perse), paru chez Madame Cinq Sens.
Oui. C’est un très vieux Pléiade. C’est mon missel. Je le lis comme un curé lit son bréviaire. Non, j’ai eu une enfance très heureuse avec des parents adorés. Mais la campagne, l’hiver, c’est une solitude difficile, rude à l’adolescence.
Croisset était à moins d’une heure de la maison. Je suis nationaliste dans mes goûts littéraires. Chauvin même, quand je m’exalte sur Flaubert.
Mille ans ont passé. Je crois que c’est trop tard, car je suis amoureux de vous, Virginie. Vous êtes Albertine. Je vous ai reconnue à la première ligne. J’ai songé à vous cette nuit, et les autres nuits. J’aime votre robe de soie de l’Orient-Express. Je suis marié avec Karen, élégante comme vous. J’ai un fils de tente-trois ans, Arpad, une petite-fille d’un an, Chiara. Et vous depuis toujours. Cela fait les quatre doigts de la main. Il m’en manque un. Comme Django Reinhardt. J’ai envie de vous voir, Virginie. Au mois de mai, c’est loin – encore mille ans –, je serai derrière un petit bureau à ne pas signer des exemplaires de mon livre (« L’amitié de mes genoux ») à des lecteurs absents. Votre apparition me transporterait de joie. C’est à la mairie du cinquième arrondissement de Paris du 15 au 22 mai et ça s’appelle Festival Quartier du Livre. Je vous embrasse sur une joue.
Nous sommes faits l’un pour l’autre. J’ai hésité longtemps avant de choisir la joue. J’ai d’abord penché pour la tempe. Plus beau, plus délicat, plus discret. Puis j’y ai vu une proximité avec un pistolet et j’ai reculé. Vous avez eu l’audace du baiser sur la tempe. J’y vois un signe. J’aime voir vos photographies car elles confirment que nous sommes proches. Votre beauté brune, c’est bien celle d’Albertine au caractère effronté, un peu cabochard. Je vous trouve très belle, raffinée et sauvage à la fois. Je vous adore. Mes genoux vous attendent, Virginie. Ils attendront mille ans s’il le faut. À votre signal, j’accourrai, tremblant, craignant de vous décevoir mais heureux.
La littérature m’éloigne de la réalité. Je le sais, toujours su. Pourtant, les rêves sont ma vie. Avec vous, je ne les discerne plus de la réalité. Nos affinités électives sont un bien précieux. Il ne faut pas les renier. Notre séduction mutuelle demeure un don du ciel. Je continuerai à écrire, vous peut-être à me lire et moi à vous lire car j’aime votre écriture. Nous resterons des confidents, échangeant nos passions. Les mots seront nos traits d’union.
Je n’ai pas vu le film dont vous me parlez. J’en suis resté au cinéma des années 60/70. J’adore Antonioni. Dans ses premiers films, il y a Lucia Bosè, que je tiens pour la plus belle fille du monde. J’en parle dans « La cicatrice du brave ». J’aime « Identification d’une femme ». J’aime tous ses films. Godard est un grand coloriste aussi. « Pierrot le Fou » est un chef-d’œuvre, « Le Mépris » une féerie.
J’ai un fils. Vous vous souvenez, les doigts de la main ? Je reviens de chez lui où nous avons déjeuné. Ma petite-fille est adorable. J’ai beaucoup joué avec elle. J’aime bien aussi l’ambiance Sautet. C’est un cinéaste sous-évalué. En réalité, c’est un grand réalisateur. J’aime bien son film avec Emmanuelle Béart et Serrault. En revanche, je ne suis pas un fanatique de Truffaut. Mais j’adore « La Peau Douce » avec cette actrice géniale, italienne volcanique, dont je ne retiens jamais le nom, et qui tue son mari au fusil de chasse, à bout portant, dans ce restaurant de jadis, Le Val d’Isère, à l’angle de la rue de Berri et des Champs-Élysées. Lelouch, je l’ai aperçu à Deauville quand j’avais quinze-seize ans et que je faisais les tournois de plage de tennis. Je suis assez insensible à son univers.
J’ai entendu le verdict : j’en ai pris pour mille ans et quelques. Je vous aimerai tout seul, Virginie. Votre tempe, celle de droite, je la baise doucement. J’ai une sensation sur les lèvres. Je ne suis plus là.
J’ai envie de vous voir, de vous tenir dans mes bras, Virginie, d’enfouir mon visage dans vos cheveux.
Vous m’avez ensorcelé. Je ne peux pas lire une ligne sans penser à vous. « Partout où il n’y a rien, lisez que je vous aime. » Diderot. Je cite de mémoire sa lettre à Sophie. Vous êtes ma Virginie, cachée dans le noir. Je ne vous vois pas.
Votre lumière, si belle, si délicate, est un couteau dans ma plaie, éternelle, en pleine tête. Je vous regarde à l’intérieur de moi et cela me fait du bien. Merci Virginie. Je sens vos lèvres sur ma blessure.
Je vous suivrai au bout du monde, au bout du temps. Je suis votre épaule, vous êtes ma maîtresse adorée.
Nous sommes d’un sang qui dévore nos deux corps. J’ose vous regarder. Vos yeux de braise sont une joie solaire sur cette terre. J’aime m’égarer dans votre regard. Aimons-nous joliment.