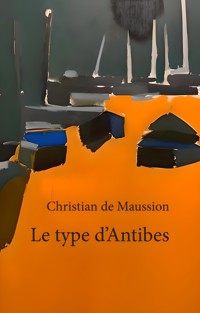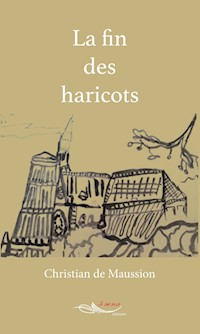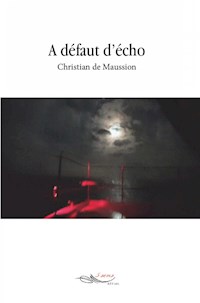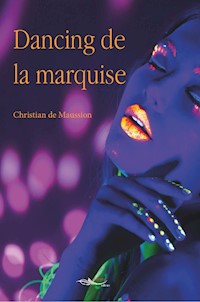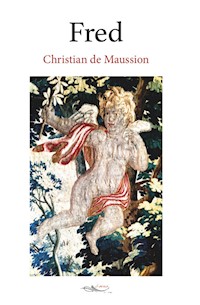Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: 5 sens éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
La leçon de Michel Serres ? Il n’y en a pas. Pas de leçon. Ni de morale, ni de conseil, ni de consigne. Non, juste une chose ; un chuchotement, l’éventement d’un secret. On ne se délivre du mal qu’en se donnant un mal de chien : inventer. Serres n’aimait pas l’Histoire. Il aimait les histoires, les racontars de bonne femme. Quand je regarde aux alentours l’immédiat environnement, je sais que le joyeux penseur occitan n’a pas d’équivalent, que son rayonnement intellectuel s’est introduit dans mon champ de conscience comme une chance, une espérance, un privilège de l’existence. Michel se plaisait à décerner à Georges Rémi, alias Hergé, le label olympique de « seul génie qu’il ait jamais croisé dans sa vie ». Moi, c’est à Michel que j’attribue le prix d’excellence, le trophée de l’intelligence la plus radieuse, parmi les hommes qui figurent au répertoire de ma mémoire. D’une génération à l’autre, les hommes s’éblouissent mutuellement, fertilisent leurs œuvres à coup d’admiration fortuite. Jankélévitch. Le chemin était tracé, la salle Cavaillès le lieu d’une liberté. Mais un jour, au lieu du frêle intellectuel vêtu d’un costume anthracite, de mon banc d’étudiant mendiant, je voyais un corps d’athlète en chandail torsadé, j’entendais les voyelles chantantes d’une langue méridionale. Alors, j’ai noté la joyeuse parole d’un homme d’extérieur, ami des choses de la géographie, qui mêle science dure et littérature à ses propres aventures.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Jadis chef d’entreprise, l’auteur a entrepris des chefs d’œuvre (De Gaulle, Staël).
Christian de Maussion a publié des textes dans Le Monde, Le Figaro, La Croix, Libération, Le Quotidien de Paris, Les Echos, L’Idiot International, Les Cahiers de l’Herne. Il a participé à l’aventure emblématique de Matulu. Il rédige des chroniques pour Service Littéraire. Les fées de Serres est le neuvième ouvrage qu’il publie, le septième édité par 5 Sens Editions.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 103
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christian de Maussion
Les fées de Serres
Du même auteur
Tita Missa Est
5 Sens Editions, 2021
À défaut d’écho
5 Sens Editions, 2020
Dancing de la marquise
5 Sens Editions, 2020
Fred
5 Sens Editions, 2019
L’Amitié de mes Genoux
5 Sens Editions, 2018
La Cicatrice du Brave
5 Sens Editions, 2017
Ainsi soit Staël
Editions du Bon Albert, 2013
C’est encore loin de Gaulle ?
Editions du Bon Albert, 2002
Cahier de L’Herne Simone Weil
Editions de L’Herne 2014
Cahier de L’Herne Michel Serres
Editions de L’Herne, 2010
Blog À la diable, 2008-2021
À Hélène
« L’Esprit c’est un corps parfait. »
Louis-Ferdinand Céline
Pourquoi les hommes meurent-ils à quatre-vingt-huit ans ? Fred, Ghislain, Michel.
À deux décennies du terme, peut-être à moins, je mesure la douceur d’être en vie, de sentir une pâle lumière de novembre glisser sur ma peau.
Il y a dix-huit mois, la radio m’apprenait la mort de Michel, me révélait une réalité à laquelle je répugnais à songer. À la télévision, je voyais certes un vieillard, un corps courbé, un visage rougi d’ecchymoses, mais un gaillard tout autant, une tête restée jusqu’au bout si bien faite.
Quand je regarde aux alentours l’immédiat environnement, je sais que le joyeux penseur occitan n’a pas d’équivalent, que son rayonnement intellectuel s’est introduit dans mon champ de conscience comme une chance, une espérance, un privilège de l’existence.
Michel se plaisait à décerner à Georges Rémi, alias Hergé, le label olympique de « seul génie qu’il ait jamais croisé dans sa vie ». Moi, c’est à Michel que j’attribue le prix d’excellence, le trophée de l’intelligence la plus radieuse, parmi les hommes qui figurent au répertoire de ma mémoire.
D’une génération à l’autre, les hommes s’éblouissent mutuellement, fertilisent leurs œuvres à coups d’admiration fortuite.
L’éditrice du penseur, après sa mort, publie des photographies de son terroir. Je vois un jeune homme de dix-sept ans qui arpente un trottoir carrelé, mains dans les poches et pantalon pattes d’éléphant, une dégaine délurée de petite frappe, de voyou provincial à l’affût d’un mauvais coup. L’impression première est une désillusion. Je me suis fourvoyé. Je suis même assez terrifié. Je dévisage une sorte de chenapan. Le philosophe occitan était-il un charlatan ? Je m’égare dans mes ressentiments, ou plutôt dans mes sentiments contrariés. J’ai vénéré un type assez ordinaire, un homme ambitieux qui n’a pas froid aux yeux. À voir et revoir ce portrait d’immédiat après-guerre, je me demande si je n’ai pas manqué de sagacité, si je n’ai pas été floué, trompé sur la denrée.
L’histoire avec Serres a commencé par un faux pas, une erreur d’aiguillage. Salle Cavaillès, je me destine un pupitre. Disciple occasionnel de Vladimir Jankélévitch, je m’encanaille en philosophie, au voisinage d’une voix de gouaille et d’innocence, joyeuse et saccadée, effusive et démonstrative. Mon école buissonnière est domiciliée à la Sorbonne. J’ai fait le mur des universités préfabriquées, Nanterre, Dauphine, où les savoirs utilitaires leurrent des esprits ancillaires. Je m’aère avec Plotin, me détache des baratins. L’intitulé du cours exerce un charme sur ma liberté : Le doigt sur la bouche.
D’emblée, je saisis la musicalité du beau français, le patriotisme esthétique de Jankélévitch. Le gaullien que je suis s’entiche du je-ne-sais-quoi du maître bergsonien. J’aime que la raison s’applique au flou d’une sensation. Je me lave des mots sales d’une lourdingue sociologie. Je me dévêts de mes oripeaux économiques, je me déshabille d’un dédaigneux babil à deux balles, je me dépouille de mes rudiments de management. Loin du sabir obligatoire, je respire l’air qui sied à ma nature.
Jankélévitch, je l’ai choisi plutôt que Conche, Marcel Conche, dont le nom figurait à toutes les lignes du cursus de philosophie épinglé aux murs de la faculté. Jankélévitch m’avait séduit jusqu’en Normandie, jusqu’à ma maison de Silly en Gouffern. Les ondes d’alors captaient le sifflement d’une voix heurtée, les merveilleuses digressions d’un discours sans tiédeur. J’étais conquis par une formule ramassée qui touchait dans le mille, parlait à ma quotidienneté : « On ne gagne du temps que pour pouvoir en perdre. » Aux idiots des familles, la radio d’alors donnait des mots de pareil désordre, diffusait de subtils paradoxes au milieu des périls.
J’ai donc fui Nanterre-la-Folie, ses balafres soixante-huitardes, sa mythologie criarde, ses perroquets marxistes, Baudrillard et ses simulacres. J’ai décapoté ma deux-chevaux kierkegaardienne, l’ai désenclavé du parking de grande surface, l’ai garé rue des Écoles. Le philosophe du quai aux fleurs restituait une jeunesse, une ardeur, une finesse revigorante aux humanités délaissées.
Là, j’étais préservé d’une science déjà très envahissante, à l’écart de toute technologie toxique. Jankélévitch philosophait à mains nues. À l’écouter, à noter des bribes de ses brillantissimes exposés, à observer la virtuosité de phrasé de ses apartés, je me persuadais à mesure de ma légitimité d’évadé. Je me sentais bien avec Plotin. Je m’enhardissais au point d’interroger le bienfaisant enseignant sur la valeur heuristique de l’analogie. J’en avais ma claque des longues chaînes de raisons, d’inductions et de déductions. L’inventive analogie m’éveillait à la rêverie.
Le chemin était tracé, la salle Cavaillès le lieu d’une liberté. Mais un jour, le système s’est enrayé, le mécanisme d’horlogerie s’est détraqué. Au lieu du frêle intellectuel vêtu d’un costume anthracite, de mon banc d’étudiant mendiant, je voyais un corps d’athlète en chandail torsadé, j’entendais les voyelles chantantes d’une langue méridionale. Ses longs cheveux déjà blanchis, autour d’un large crâne dégarni, évoquaient la figure burinée de Léo Ferré. Serres était l’allégorie d’une autre philosophie, d’une deuxième pensée enracinée dans la terre, balafrée par les mers. J’étais resté à la même place, ne m’étais pas instruit des diktats de bureaucrates. Serres s’était substitué à Jankélévitch.
Durant dix ans, je n’ai pas bougé d’un pouce, j’ai oublié Jankélévitch, j’ai noté la joyeuse parole d’un homme d’extérieur, ami des choses de la géographie, qui mêle science dure et littérature à ses propres aventures.
Avec lui, je ne m’expatrie pas de la géométrie. Je demeure au plus près des développements de la technologie, je m’installe aux premières loges, coudoie la beauté littéraire, voisine avec la splendeur des grands textes. Je reste, vissé au pupitre. Je suis ficelé. La séduction opère comme une sidération, ôte à la raison ses naturelles préventions. Serres a le feu vert pour m’instruire.
Du côté des anciens locaux de l’Otan, à l’université de Dauphine où bivouaque une certaine gauche américaine, déjà prête au renversement du pouvoir giscardien, le nom de Serres revient dans la bouche d’Attali, le petit Mozart de l’éclectisme intellectuel, et de Stourdzé, son prestataire ébouriffé en récits littéraires.
Stourdzé, c’était un penseur qui cheminait sans filet, le premier de cordée, pionnier du virtuel, un sociologue résolument iconoclaste qui savait décrypter les palimpsestes et sentir les humeurs du temps qui vient.
Je me souviens d’Yves Stourdzé, jeune et fringant chargé de cours, puis dix ans plus tard, rattrapé de son vivant par ce mal banal qui tue sans faiblir, dans l’appartement de son père. Il parlait les yeux dans les yeux de l’avenir, de grands projets, des « ruines du futur » comme travaux pratiques. Le lecteur de ce livre énigmatique ne doit pas égarer son regard sur le titre de superproduction hollywoodienne. Il lui faut lire, ouvrir l’œil et annoter ces pages inspirées.
Au milieu des années soixante-dix, Stourdzé écrivit son chef-d’œuvre, un poème à la Lucrèce, précis comme une vision du monde numérique, multiple comme un métissage de sciences et de cultures. Ce texte assez stupéfiant tient le choc, et toujours la distance. Il faut rendre grâce à son éditeur Hubert Tonka d’avoir imprimé ces pages en leur temps. Ce livre nous revient aujourd’hui, inchangé, insaisi, pimpant de modernité, comme un boomerang d’intelligence en pleine figure.
Stourdzé travaillait pour les générations du silicium et du prochain millenium. Parmi les lecteurs rares, Simon Nora qualifia l’effronté, le chercheur téméraire « d’Einstein des sciences sociales ».
« Sentons-nous ceci : que tout objet déjà se convertit en signes et que ceux-ci se réduisent à des miettes électroniques ; ce sont les bits, 01… à l’infini. »
Cet opuscule décrit le transit du régime du simulacre au règne de la simulation.
Cet « électronique de la passion » annonce Internet mieux que la somme indigeste de tous les pseudo-gurus de la Silicon Valley. Le livre d’Yves Stourdzé a périmé d’avance le discours creux des pontifes de la révolution informatique. Il a vu juste et loin, compris l’essentiel le premier : l’électronique appartient au temps des métamorphoses ovidiennes, se structure au vent de l’éventuel, introduit au caprice du virtuel, s’émeut du moindre clic.
Stourdzé rêva tout haut d’Internet : « Une précipitation sans pôles, des questions sans réponses, ou des réponses à mille questions. Le processus d’avalement : du questionnement et du récit même, sans question, ni discours. Troie s’effondre, sans narration… Saisissement et captation qu’indiquent désormais le terme générique de données et le processus global de saisie. »
Yves Stourdzé nous invite au festin d’une civilisation tout numérique, à côté des reliefs abandonnés des temps industriels énergétiques. Il scrute la nuée insensée, « a-syntaxique », des petites énergies, des données qui s’abattent en rafale sur le village planétaire, sur la cité mondialisée comme « tornade et marée de signes noirs ».
Il nous a confié ce murmure d’avant-garde, laissé ce témoignage dense et lumineux, précurseur, quasi-maudit, ce « De natura rerum » de l’âge du silicium. C’est un classique de bibliothèques universitaires, un texte sans lifting dont la peau éclatante n’a pas vieilli d’une ride. Mieux : son genre de beauté, incompris, insaisi à sa naissance, touche désormais en plein cœur le temps de ses contemporains.
Or Stourdzé, dont j’écoutais bouche bée les brillants exposés déstructurés, avait confié aux étudiants une liste d’ouvrages selon son cœur, à lire sans attendre. Figuraient sur la feuille ronéotée les auteurs et livres suivants :
Pierre Legendre (« Jouir du pouvoir »), Pierre Clastres (« La société contre l’État »), Karl Wittvogel (« Le despotisme oriental »), Georges Bataille (« La part maudite »), Pierre Klossowski (« La monnaie vivante »), Jean Baudrillard (« L’échange symbolique et la mort »), René Girard (« La violence et le sacré »), Jacques Derrida (« De la grammatologie »), Gilles Deleuze (« L’anti-Œdipe »), Michel Serres (« Esthétiques sur Carpaccio »).
Vittore Carpaccio raccommodait les trous béants qui séparaient Dauphine de la Sorbonne. J’allais au musée de Caen, à l’église San Giorgio degli Schiavoni, au musée Correr à Venise. À voix haute, je déclamais les mots d’une lutte à mort, fratricide, du bien et du mal, doubles identiques, je récitais les phrases érudites qui révélaient un spectacle, derrière lequel gisait le monde tel quel.
Bref, j’entrais chez Serres par la porte Carpaccio, le petit bouquin funéraire des éditions Hermann.
On se construit à coups de mains tendues et de paroles données. J’ai serré celle de Serres. Je me suis nourri de sa pensée libre. À vingt ans et des poussières, l’avenir se projette dans le regard de ses maîtres. On se confectionne des bouts de vérité. Avec des visages de fortune, on rafistole les blessures de jeunesse. J’ai poussé la porte, j’ai passé la tête. Michel Serres éblouissait une poignée d’étudiants derrière trois rangées de pupitres écaillés. J’ignorais alors que le savoir était une joie. J’appris que la philosophie était un pacte avec l’aurore. J’envisageais enfin l’exercice de la raison comme un terrain de jeu sans tricherie, une activité sans vilenie. Je me suis installé aux premières loges. J’ai vu du pays. J’ai erré dans les parages de la science, des belles lettres et des arts. En quelque sorte, Serres multipliait les pains de la connaissance. Cet ami de longue compagnie œuvrait hors des sentiers de guerre. Il nous enseignait la paix et l’art d’inventer. Addicted. Nous étions adonnés, dans nos savoirs dépareillés, au dit de Serres. Au point de le mimer, d’entendre sa voix sous les voyelles d’un vent voyou.
Serres s’intéresse à l’état naissant des choses. À l’embryologie plus qu’à l’ontologie. À la jeunesse plus qu’à l’histoire. Jouvences sur Jules Verne. La naissance de la physique dans le texte de Lucrèce. Genèse. Détachement. Les origines de la géométrie. Nouvelles du monde. Hominescence, L’Incandescent, Rameaux. Ces titres d’ouvrages sont des pierres blanches, des invariants rieurs dans sa zigzagante randonnée du donné et ses luxueux embrouillaminis. Michel Serres aime l’imbroglio primitif des formes neuves. Le philosophe célèbre toutes les Sophie du monde. Toutes les belles noiseuses s’appellent Aphrodite. Elles jaillissent des eaux et des pinceaux. Deleuze et Serres, « amis de vieillesse », ont échangé leurs fins concepts comme des passes croisées de rugby : noise et devenir.
Serres court le monde. Il s’instruit. Il éprouve son corps. Il durcit ses textes. Il écrit sous la dictée de ses premières cordées. Il sait qu’un faux mouvement, qu’un seul froissement trop sonore suffit à escamoter le monde. La nature se sauve. Il ne faut pas réveiller les démons. Question de vie.