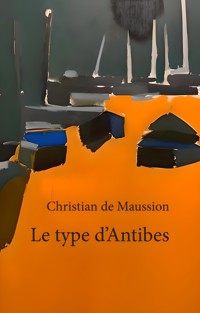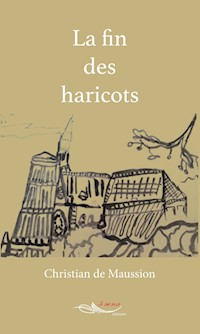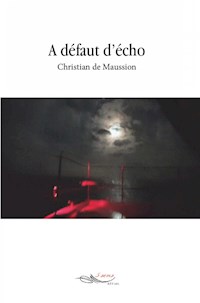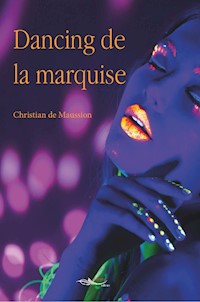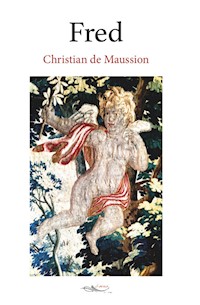
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: 5 sens éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Fred est une abréviation qui retentit comme une détonation. Fred est le portrait d’un ange gardien, le visage morcelé d’un destin. Avec Fred, l’eau n’est pas tiède. On est dans une mer de mots nécessaires. Ressentir interdit de mentir. J’écris à demeure, au milieu de gens qui meurent. J’éprouve une joie à regarder derrière moi, à dessiner une sorte de roi, un artiste sans oeuvre. Sans doute le plus grand, le plus secret, le plus sauvage des faiseurs de beauté.
J’ai écrit
Fred presque d’une traite, dans un bonheur presque irréel. J’ai rédigé sous sa dictée, exprimé presque sereinement, ses abîmes et ses vertiges. J’ai fait le portrait d’un artiste, non pas méconnu, mais introuvable, d’un artiste insituable, sans autre vocation que l’émerveillement, la contemplation des splendeurs du monde.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Jadis chef d’entreprise,
Christian de Maussion a entrepris des chefs-d’œuvre (De Gaulle, Staël). Il a fait paraître des textes dans
Le Monde, Le Figaro, La Croix, Libération, Le Quotidien de Paris, Les Echos, L’Idiot International, L’Autre Journal, Les Cahiers de l’Herne (Serres, Weil). Il a participé à l’aventure emblématique de la gazette littéraire
Matulu. Le blog
A la diable consigne ses vilaines pensées. L’auteur aime lire, écrire, bref ne rien faire.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 124
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Du même auteur
Dancing de la Marquise (à paraître)
L’Amitié de mes Genoux
5 Sens Editions, 2018
La Cicatrice du Brave
5 Sens Editions, 2017
Ainsi soit Staël
Editions du Bon Albert, 2013
C’est encore loin de Gaulle ?
Editions du Bon Albert, 2002
Cahier de L’Herne Simone Weil
Editions de L’Herne, 2014
Cahier de L’Herne Michel Serres
Editions de L’Herne, 2010
Blog A la diable
alladiable.blogspot.com 2008-2019
Christian de Maussion
Fred
à Constance, petite fille, entre nous et les lignes
« Je dois m’occuper d’être heureux »
(Albert Camus/Diego, L’État de Siège, Théâtre Récit Nouvelles, Bibliothèque de la Pléiade, page 196)
« Plus fort, plus aigu, plus raffiné, toujours plus absolu »
(Nicolas de Staël, citation de Marie du Bouchet, Altamira, Nicolas de Staël Lumières du Nord/Lumières du Sud, page 131)
« Il aimait trop les bourrasques pour dilapider un capital de fulgurance. »
(Christian de Maussion, L’Amitié de mes Genoux, 5 Sens Editions, page 26)
Il y a des hauts et des bas. Les cols sont fermés comme des bouilles renfrognées. La neige a enseveli les derniers coloris. Le cliquetis des bennes ponctue les étendues souveraines. J’ai passé Les Demoiselles Coiffées, quitté Gap, serpenté, cheminé sur l’asphalte entaillé, derrière une coalition de dos ronds, derrière une dénégation de camions de route Napoléon.
Pas de bêtes féroces au Val d’Allos. À Pra Loup, je gare mes quatre roues avec un zèle ustensilaire. Les mélèzes sont des banderilles grises sur les flancs des massifs. D’abondance, un sang blanc coule vers la Durance.
Notre cellule de moine est d’un merdique patrimoine. Réfectoire braillard de mauvais verres à boire. L’intime intériorité patine dans une gargote sans âme. J’ouvre une parenthèse, au milieu des mélèzes. Du vaste ratage, je sauve l’instant suave. Je bivouaque au soleil téméraire du Clos du Serre. Je songe à Lagarce, grand gars des lettres françaises, renégat de race : « C’était un peu mélancolique comme toutes les fêtes réussies » (Journal, tome 1, page 280, Les Solitaires Intempestifs, 2007). Il a suffi d’une éclaircie. Fred. C’est le petit nom du livre à faire. Fred for ever. Fred for Rêveur. C’est décidé.
C’est un nom que prononce ma mère. C’est lui qui m’aide sur la terre, Fred. Une voyelle et trois consonnes. Les quatrième, cinquième et sixième lettres de l’alphabet, un tir groupé de signes qui composent une sonorité brève, une impérieuse détonation. J’identifie l’onomatopée. Je sais sa qualité d’autorité. Dans ma langue intérieure, Fred se dit Pap. Je le considère comme un seigneur des steppes. Je me fie, me confie, n’obéis qu’à sa loi. Sa figure éclaire la nature. Moi je suis d’ici. J’apprivoise une géographie. Quand il me sourit, je reconnais un pays. Fred est calé dans un fauteuil jaune. Il lit. J’ai les genoux qui cognent sur le carrelage. J’ai l’âge de mon premier visage.
La page est blanche. Elle est riche de tous les virtuels possibles. L’infini ne joint pas les deux bouts. Rien n’est joué. Rien n’est écrit. Rien n’a de sens d’avance.
Il est téméraire de s’aventurer, en première ligne, en premières phrases, sur une terre littéraire, sur un champ de chair. Il est téméraire de briser la ronde coutumière des jachères. Tracer les premières lettres, se saisir de l’alphabet éparpillé, composer des mots qui fassent écho, dessiner des fragments de signifié, s’affranchir d’un impérieux désir : écrire comme on libère un cri.
Le lieutenant-colonel sait quoi faire, décider sans collégialité, dans l’immédiateté. Le lieutenant-colonel a des ailes. La terreur ne lui fait pas peur. C’est un chef de ferveur : il est à l’œuvre. La poésie d’Ezra Pound lui indique la direction du pays : « Si légère est l’urgence. »
Le lieutenant-colonel se livre à l’ignoble forcené du mal, arrache la caissière des griffes du furieux animal. Acte anti-économique, par excellence. Acte christique.
Le lieutenant-colonel est seul, infiniment seul, premier et dernier de cordée. Avant d’expirer, il prie sa patrie. Il écrit avec son sang le chef-d’œuvre d’une vie, le récit fondateur de notre temps. C’est un livre de résistance, le traité d’une grandeur, l’Évangile gaullien d’un admirable gendarme.
La rébellion du lieutenant-colonel n’est rien d’autre que de servir une nation, d’honorer sa mission. Elle a le style des beautés les plus pures, des fulgurants chants d’amour, insoucieux des périls de bravoure.
À Palerme, rien n’alarme sauf une lumière du matin. Je griffonne les menues pages d’un carnet. Je jette sur le papier les fragments désaccordés d’une vie émerveillée. La saisie littéraire d’une sensation est une manœuvre éphémère. C’est un exercice de vérité. Il fait du songe le contraire du mensonge.
Les insoucieux Siciliens considèrent le travail comme une occupazione, sans autre espèce d’émotion. J’aime un large dédain du quotidien.
Via Principe di Belmonte, on observe les ciselures des ombres sur les murs, on paresse à la terrasse du Spinnato. La pasticceria est saturée d’exquisités sucrées. Je commande, non je quémande, un cioccalata calda in tazza.
À toutes les heures d’un malicieux désœuvrement, deux élégants vieillards s’attablent, rigolards et charmants, baskets écarlates. Soudain une jeune fille grimpe au cou du grand-père à chignon gris. L’embrassade démonstrative, vivace, est l’art sicilien des quiétudes apéritives.
C’est un soleil de trois heures qui chauffe le contour des cheveux. Boire d’un trait, c’est comme écrire d’un jet : c’est bon.
Après la collation du matin, j’apprécie le chiffonné du Corriere della Sera. Je m’assieds à lire des histoires. À côté du buste de Wagner, dans le hall marbré du grand hôtel des Palmes, délicieusement décati. Un jour, j’écrirai les sottes cérémonies du travail. Cela s’appellera « La clownerie des lundis ».
C’est un roman. Un roman qui ment sur son identité. Un roman qui casse l’ambiance du moment, l’heureuse connivence d’une narration qui avance dans le bon sens. Un roman qui ment sur sa promesse de boniment. Bref, c’est un roman dont l’écriture colle à la littérature, dont la fantaisie s’observe dans le souci des ciselures, le ressenti d’une taille exacte, le splendide malaise d’une phrase de langue française. C’est un roman dont le sujet seul est la vérité d’ornement. Déjà L’Amitié de mes Genoux était le récit, la définition même d’une solitude. Or un style n’est jamais qu’une manière d’être seul. Dans un livre paginé, dans un texte ouvragé, il n’y a que ça de vrai.
La communication est à la communion ce que l’information est à la connaissance. C’est sans doute la même chose : communier et naître ensemble, s’offrir et savoir.
Montaigne, dans sa langue, est quasi illisible. J’ai refermé le bouquin d’une main robuste comme on poignarde un rêve. J’entasse des Pléiade qu’aujourd’hui je laisse en rade. Je lirai Les Essais dans un patois rénové.
La virée orientale de Flaubert s’éternise dans des lettres inégales. J’ai besoin d’espacer leur lecture, de me divertir au petit bonheur. Ici et là, j’ai grignoté des mots de Gracq comme des cerises sur l’arbre. Je dévore un vieil entretien sur Jules Verne. En bon élève, j’ai griffonné deux adjectifs sur un bout de papier : « maléficiée », « entretoisé ».
Le magique géographe définit les Balkans comme « une région maléficiée ». La malice n’est jamais loin du maléfice. Gracq cite ainsi Giraudoux à l’enterrement de je ne sais plus qui : « Allons-nous-en, il n’est pas venu. »
Je ne l’ai jamais entendu prononcer un mot d’une autre langue que la sienne. Il m’enseigna le front du refus. Je vois ce geste d’anachorète, l’entaille discrète d’une pensée muette : l’arrondi du pouce, une légère griffure d’ongle sur la chair d’une lèvre.
Comme le président Mao, il s’isolait au « petit coin », verrouillait les lieux, s’enfermait dans les toilettes à lire sans qu’on l’embête. Papa aimait les albums d’Oumpah-Pah. Il disposait d’un wigwam où partager ses états d’âme. Il lisait tout, mais sans hâte, comme un gosse au grenier cède à ses entêtements. Il se retranchait pour rire un peu seul. Il se cachait dans l’enfance pour mourir déjà d’avance. Il se barricadait, masquait une gêne, derrière une porte claire en chêne orangé. Il s’abreuvait d’une liqueur de jouvence. Le cagibi était un havre de pudeur.
On tournait la clenche. On maugréait. Papa s’esclaffait sans qu’on le voie, seigneur et roi parmi les fées. Il quittait l’horizon, se terrait pour gouverner la maison. Il adorait le temps moins long de sa petite prison. L’incarcéré exerçait une radieuse souveraineté. Il inventait un bonheur à demeure. Il était gaullien, d’une délicate brutalité, exemplaire dans l’art de rompre un lien. Il tuait sans jamais blesser, net, propre, hors labeur. Il était libre, souriait d’une bonté triste, bourrue pour l’homme des rues.
Papa prononçait le nom d’Yvonne Printemps. Il le lâchait en chemin, le destinait au néant. Il se taisait sur tout, même sur l’amour fou. Il était capable de tout, même de ne pas valoir un clou. Il regardait le monde comme si c’était la dernière fois. Il inspectait les bois, toisait un désarroi, dévisageait nos joies.
« Les femmes préfèrent être belles, plutôt qu’intelligentes, parce que chez les hommes, il y a plus d’idiots que d’aveugles. »
La petite bonne de cuisine est affublée d’un mot de dame du macadam. C’est une souillon qui n’a pas le sou. Le chef de culture l’engrosse comme une circonstance de la nature. Ginette est lutinée comme une soubrette. Rien ne l’étonne, pas même un abdomen. Il enfle. Mais la tête ignore le corps de Ginette. On n’évente pas les secrets d’un mal de ventre. Faire l’amour la fait mère. Jean, le paysan, ne se ronge pas les sangs. Ginette a débarrassé le plancher depuis belle lurette.
Dans sa bergère de velours jaune, il feuilletait le journal local. Il stationnait, page des mots croisés. La liasse de papier était alors pliée en quatre sur son genou de tergal anthracite. Il noircissait les carreaux. Arbre, deux lettres. Saint normand, deux lettres. If et Lo balisaient l’exercice de routine. Son soulier crissait sur le parquet strié, couleur de miel. Il réfléchissait. Ses lunettes glissaient du milieu du crâne aux yeux. Il relançait la machine, imprimait une vitesse de croisière. Il était prompt à dessiner les lettres capitales. Il achevait le jeu d’enfant en deux temps trois mouvements. Pareil galop d’essai préludait à sa journée. Il abandonnait le journal tire-bouchonné, regardait le soufflet de la cheminée, jetait un œil sur les ciels incertains, se levait d’un bond, quittait le salon.
Je ne sais plus où il est. Il dispose de trois bureaux. Il recherche la compagnie des mots, le spectacle des gravures et des photographies, la fantaisie d’un bienveillant désœuvrement. Il travaille au petit bonheur. Il est attentif à la somptuosité du loisir, au méticuleux respect de l’oisiveté. Je l’ai perdu de vue.
Il avait quatre prisons. Il s’était confectionné quatre geôles. J’ignorais les règles de transit de l’une à l’autre. Il était secret, sauvage, aérien comme un dieu sans message.
Vert bouteille. Elle rutilait dans ses chromes. La Mercedes de l’oncle Hubert glissait en majesté sur l’asphalte clair. L’industriel jouissait d’une beauté irréelle. Il avait soixante-trois ans – « l’âge de Sartre » me confiait-il –, ressemblait à Gary Cooper. Il avait baptisé sa maison de bord de mer, Villa Alamo, à cause du film de John Wayne. Dans les restaurants, on lui réclamait des autographes, une brève signature, à montrer plus tard aux enfants.
Ce grand vieil homme m’impressionna, m’éblouit toujours, au point de demeurer, gravé dans la mémoire, un modèle à respecter. Il gara sa limousine à l’Alma. Nous étions cinq à nous extraire de l’habitacle : tante Jacqueline alias « la baronne du coton », mes parents embringués dans la fête et moi, aussi de la partie. L’oncle Hubert aimait à naviguer, à regarder la mer. Ses yeux bleus fendaient l’obscurité d’une peau burinée, entaillée des plis du travail accompli. Il jouissait d’une criante légitimité plastique. Une sensuelle nature l’avait doté d’une beauté absolue, d’une figure de seigneur, d’une preste silhouette d’esthète, d’un rayonnement solaire de gentleman farmer. Il y avait de la bonté passive, de l’attention précise dans sa manière d’aller, de jeter ses mots à la volée, d’échanger un regard, une émotion dans la conversation. Nous avions longé le fleuve jusqu’au Petit Palais où la foule ondoyait par le vent et l’émotion du moment.
La veille, nous n’avions pas manqué le raout des fidèles. Sur le canapé où se serraient de jeunes hommes choyés des fées, j’entendais des phrases obligatoires, plombées de certitude, qui contrariaient mes désirs.
« De Gaulle est un dangereux homme. Il a gouverné avec les communistes. Il n’aime pas le capitalisme. L’argent lui fait horreur. C’est un homme de gauche. »
J’abhorrais d’instinct ces suppôts d’un libéralisme hautain. J’étais sonné par ce discours de haine à l’endroit du chef que j’aimais. Charles de Gaulle était un maître d’école, un professeur d’histoire. Il m’enseignait la langue de Flaubert. J’aimais le comédien qui monologuait en alexandrins, causait du pays comme d’un sujet racinien.
À la Concorde, nous nous sommes mêlés aux cortèges, banderoles et mots d’ordre braillards. À la campagne, d’où nous venions, on appelait ça « la cohue ». On n’en menait pas large. On a monté les Champs-Élysées avec sérieux, application, comme une dernière étape de Tour de France, en peloton.
Le soir, à la télévision, j’ai vu Robert Poujade, mon préféré à cause de son talent oratoire, coincé entre Malraux et Debré, tous deux enfiévrés, éméchés, à moitié déjantés. À les observer, je m’en voulais d’un manque de ferveur. Je rougissais de mon assiduité d’élève trop sage. Pas grave. J’étais la bleusaille d’arrière-garde. De Gaulle était remonté sur son cheval.
Vent boudeur. Bourru s’il dure. La Provence me glace. Je me sauve. Je me fourre dans une peinture entre quatre murs.
Anne et Gustave se tiennent la main, honorent un père, un peintre byzantin qui sacralise la couleur.
Le musée d’Aix nous cale dans l’axe exact du luxe. Une lumière irradie la paupière.
Soixante-et-onze toiles. On chemine comme dans un album d’homme, un livre d’images saintes, pleines de pages peintes. Le soleil est sa dernière demeure. Il va mourir, se risque à sourire en grand coloriste.
Staël flanque des flaques d’éblouissement, fige un vertige d’ensoleillement, peint sa loi, une toile qu’il aime, plusieurs fois. Rien ne ment dans le dénuement. Les nus sont des nuages. Raconte rien, la peinture. Seulement la couleur, un rouge, peut-être une lumière qui bouge.
La cérémonie d’Aix est un sacre, le couronnement du peintre en sa maison vermillon. Les toiles cognent dans l’œil, tapent une nuque, commotionnent une trogne d’homme. C’est le bouquet final, d’une petite fille, d’un fils, sans artifice, les signes d’une piété au père émeutier, roi fulgurant, général de beauté.
Jeanne est une damnation, l’apparition d’une passion, le soubresaut du coquelicot, le début d’un nuage, le nu encore bleu, merveilleusement venimeux. Le destin est une main d’homme qui se donne d’instinct. Il est un âge où la vérité est une dernière solitude, une sorte d’assuétude à l’authentique manière.