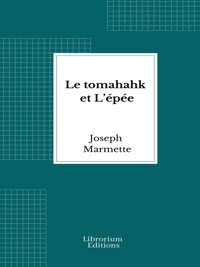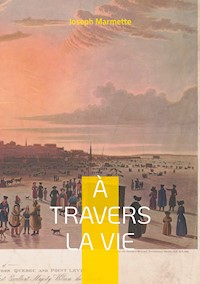
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
RÉSUMÉ : "À travers la Vie" de Joseph Marmette est une plongée introspective dans les souvenirs d'un Québécois au XIXe siècle, alors qu'il navigue entre le Séminaire de Québec et le Regiopolis College de Kingston en Ontario. Ce récit autobiographique offre un regard intime et authentique sur la jeunesse d'un homme en quête de savoir et de sens, dans un contexte historique riche et complexe. Les mémoires de Marmette révèlent les défis et les triomphes d'une éducation religieuse et intellectuelle, tout en peignant un tableau vivant de la société canadienne-française de son époque. À travers ses expériences, l'auteur nous invite à explorer les valeurs, les croyances et les aspirations qui ont façonné son identité et sa vision du monde. Ce livre est non seulement un témoignage personnel, mais aussi une fenêtre ouverte sur les dynamiques culturelles et éducatives du Canada du XIXe siècle, offrant aux lecteurs une occasion rare de s'immerger dans une époque révolue mais toujours significative. L'AUTEUR : Joseph Marmette, né en 1844 à Montréal, est un écrivain et historien québécois reconnu pour ses contributions à la littérature canadienne-française du XIXe siècle. Diplômé du Séminaire de Québec, il s'est d'abord fait connaître par ses romans historiques qui explorent les événements marquants de l'histoire du Canada. Marmette s'est distingué par son style narratif riche et sa capacité à rendre vivants les personnages historiques. En plus de son oeuvre littéraire, il a joué un rôle important dans la promotion de la culture et de l'identité canadienne-française. Ses écrits, profondément ancrés dans le contexte social et politique de son temps, reflètent sa passion pour l'histoire et son engagement envers la préservation du patrimoine culturel de son pays. Bien que moins connu aujourd'hui, Marmette reste une figure clé dans l'étude de la littérature et de l'histoire du Québec, offrant aux chercheurs et aux lecteurs un aperçu précieux des défis et des aspirations de son époque.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 153
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
Première partie : Au collège
Chapitre I : Souvenirs du jeune âge
Chapitre II : En vacances
Chapitre III : La vie au collège
Chapitre IV : Premières amours
Deuxième partie : Dans le monde
Chapitre I : La mansarde du palais
Chapitre II : Larmes d’amoureux, baptême de poète
Chapitre III : Une vocation
L’employé
Fragments du journal d’Alexandrine
Première partie
Au collège
I
Souvenirs du jeune âge
Parmi les deux cents élèves qui, en 1860, étaient internes au collège de S***, se trouvait un camarade dont la vie m’a paru assez intéressante pour en faire le sujet d’une étude de mœurs contemporaines.
Lucien Rambaud, qui faisait cette année-là sa quatrième, était, je dois l’avouer, un assez médiocre élève.
Cette classe, dans laquelle on commence à s’imprégner la cervelle des rudiments de la langue d’Homère, est sans conteste la plus ingrate, la plus ennuyeuse de tout le cours d’études classiques. Comme la majeure partie du travail y consiste dans un effort constant de la mémoire, cette année-là est extrêmement redoutée du liseur et des paresseux. Aussi notre ami Rambaud, qui préférait de beaucoup lire et rêver que passer des heures en tête-à-tête avec les maussades verbes contractés, ou déterrer le sens des racines grecques sous un fatras de mots quelquefois apparemment contradictoires, passa-t-il en silence la plus grande partie de ses récréations. Il avait, du reste, pris l’immuable détermination de ne travailler que tout juste assez pour ne pas doubler sa classe.
– Tu ne saurais croire comme j’aime lire, me disait-il un jour où son professeur, habituellement impitoyable envers lui, avait sans doute oublié de le mettre en retenue. Or, comme je lis et à l’étude et en récréation, au lieu d’y apprendre bêtement la leçon qui m’a valu mon pensum, ce n’est pas moi qui suis le volé, c’est le professeur.
Lucien avait seize ans. Il était petit, frêle ; il avait les yeux noirs, vifs, le front haut, le teint pâle. Autant par suite du repos forcé où le tenait son maître, que par indifférence pour les amusements du collège, il jouait peu. Quand il lui arrivait de prendre part aux exercices violents auxquels les autres enfants se livraient avec tant d’ardeur, c’était par caprice passager, tout d’un coup, pour une demi-heure ; puis, il allait tranquillement reprendre le fil de ses rêveries.
Né à Saint-Omer, bourg situé sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, quelques lieues en aval de Québec, il appartenait à l’une des bonnes familles du pays. Son père était avocat ; par sa mère, il tenait des Beaupré, qui, depuis et même avant la cession du Canada, y ont joué un rôle considérable dans le commerce, au barreau et dans la politique. De sa mère, il tenait beaucoup d’imagination et une extrême sensibilité, ce qui fait les poètes ; de son père, de la volonté et de l’énergie, trop souvent affaiblies pourtant par le tempérament nerveux, mélancolique et timide qu’il devait à sa mère.
Quand il ne lisait pas à l’étude, il rêvait, et, comme nous étions voisins et même intimes, il me faisait part de ses rêveries...
Lucien avait pour sa mère une affection très vive ; il était l’aîné, elle l’avait gâté plus que ses autres enfants. Dans ses ressouvenirs, il la revoyait souvent : maladive, pâle, blonde, elle lui apparaissait dans son attitude favorite du soir, douillettement enfouie dans un grand fauteuil et lisant, tandis que là-haut, dans le salon, M. Rambaud jouait de la flûte.
Parmi les morceaux que son père affectionnait, il y avait un certain boléro qui avait beaucoup frappé Lucien.
« Un très curieux air, me disait mon compagnon qui était quelque peu musicien et avait une fort jolie voix de ténor. Figure-toi un air de danse très vif, écrit en mineur. Le ton plaintif de ce mode musical avec le rythme alerte du boléro forment le plus étrange contraste. Cet air me frappa tellement, la première fois que je l’entendis, que je me rappelle encore ce que je lisais ce soir-là ; il y a sept ans de cela et j’en avais neuf. C’est une étude historique de Henri Berthoud, dans le Musée des Familles, intitulée La Madone de Torquato Tasso. Les personnages qui s’agitent dans cette nouvelle imprégnée de tristesse, comme le sont du reste tous les écrits du sympathique Berthoud, sont le Tasse, l’illustre poète, le grand peintre flamand Rubens, et le philosophe Michel de Montaigne. Chaque fois que je me rappelle ce boléro, je me revois à côté de ma mère, regardant à la lumière d’une bougie, dont la lueur brille douce entre nous deux, une gravure qui représente le cadavre du Tasse porté au capitole sur un char triomphal. Il passe, traîné par quatre chevaux richement caparaçonnés, revêtu de la toge romaine, le front ceint de laurier, le poète immortel, tout roidi par la mort, l’amant infortuné d’Eléonore, sa barbe noire se découpant en pointe sur le ciel clair de Rome ; il dort enfin d’un sommeil éternel et dont les fiévreux transports d’une passion malheureuse ne doivent plus le réveiller. Hier encore, pauvre, emprisonné, fou, maintenant mort, on le mène au capitole en triomphateur. Quelle ironie du sort que ces honneurs tardifs au cadavre du sublime auteur de la Jérusalem délivrée !... Je revois cette gravure et j’entends le boléro qui jette dans la maison, d’ailleurs silencieuse, ses notes à la fois sautillantes et tristes. »
En dépit de ces impressions mélancoliques, autant dues à ses lectures, considérables pour un adolescent, qu’à son organisation de poète, Lucien n’était pas sans avoir des réminiscences plus gaies et plus communément de son âge.
Alors, dans son imagination si vive revenaient en foule les souvenirs joyeux de ses plaisirs d’enfance, et, suivant la saison, il se remémorait les différents jeux qui avaient marqué ses premières années.
Souvent, l’automne, peu de temps après la rentrée, pendant l’heure et demie d’étude qui précède le souper, quand il n’avait rien à lire qui l’intéressât, le front perdu dans la main, il pensait :
– Voici le temps de la cueillette des prunes, Autrefois, quand, à quatre heures, je sortais de l’école, mon père me disait : – « Lucien, le temps est venu de cueillir les prunes, allons ! » Balançant au bout de mon bras un fort panier d’osier, je partais derrière lui, faisant de grandes enjambées pour le suivre. Et nous allions dans le verger, tandis que sous nos pas criaient les feuilles jaunes que le vent d’automne avait arrachées des arbres.
« – Tiens, commençons par les plus mûres », me disait mon père en s’approchant d’un prunier couvert de beaux fruits bleus. Et, moi dessous, il donnait, de son bras vigoureux, une forte secousse à l’arbre. Il me tombait sur tout le corps une abondante pluie de prunes ; ce qui me faisait rire aux éclats et mon père aussi. Alors, tout en croquant les plus appétissantes, j’en jetais à pleines mains dans le panier. Quand notre arbre était épuisé, nous passions à un autre, et la joyeuse averse de recommencer, et nous de rire, lui de plaisir à la vue de son fils, autre lui-même, croissant en âge, et de son verger qui, planté par ses mains, produisait une belle moisson de fruits. Une fois le panier rempli et devenu trop lourd pour mes bras, mon père s’en emparait et le portait à la maison, tandis que mes pas s’efforçaient de s’emboîter dans les siens et que j’attrapais au vol, gourmand insatiable, les plus beaux fruits de la cueillette, le dessus du panier. »
Quand les premiers froids de l’hiver venaient faire geler les eaux de la rivière du Sud, auprès de laquelle M. Rambaud avait sa résidence, Lucien exhumait ses patins de la vieille armoire en chêne, et après en avoir bien lié les courroies à ses pieds, il s’élançait avec un long cri de joie sur la glace polie comme un miroir.
C’était surtout les jours de congé que lui et ses camarades d’école s’en donnaient à cœur joie. Du matin jusqu’au soir, tous ces infatigables petits pieds, couraient, glissaient, tournaient en capricieux zigzags. C’était à qui ferait les plus hardies voltiges. Ou bien on allait à toute vitesse, les uns poursuivant les autres qui s’efforçaient de leur échapper par mainte ruse, par des écarts imprévus.
Quelquefois, quand la rivière était tout arrêtée et qu’il n’était pas tombé encore assez de neige pour empêcher le patin de glisser sur la glace, on remontait un mille ou deux en amont, s’arrêtant de ci et de là pour examiner les curieux caprices de la gelée, selon les remous, les courants ou les rapides.
Dans les endroits où la glace était le plus mince, souvent on faisait halte, on se couchait à plat ventre, pour mieux voir, à travers le transparent cristal, s’agiter les petits poissons ; l’on s’émerveillait que ces pauvres bêtes pussent vivre dans cette eau si froide et ne pas étouffer sous la couche de glace qui pesait sur les eaux.
Et puis, l’on se remettait en marche en échangeant ces singulières réflexions ; et, à droite, à gauche, défilaient les champs dénudés et saupoudrés d’une légère couche de neige, pendant que, sur les bords, les saules dénudés laissaient pendre leurs branches noires, sur lesquelles on voyait parfois se balancer un nid depuis deux mois abandonné.
Tout au fond s’élevaient les montagnes, dépouillées de leur manteau de verdure et maintenant d’un bleu rougeâtre avec des taches blanches sur les plateaux défrichés.
Le silence de la campagne déserte n’était troublé que par les aboiements lointains d’un chien qui jappait à la lune, dont le disque pâle commençait à monter dans le ciel assombri par le jour fuyant. On s’en revenait alors, l’estomac sonnant l’heure du retour et du souper.
Lorsqu’une épaisse couche de neige avait rendu impraticable l’exercice du patin, venaient les plaisirs de la glissade.
Le jeudi, surtout, les enfants du village qui possédaient un traîneau se dirigeaient tous vers la grande côte du moulin, et, là, toute la journée, le soir même, il fallait voir comme ils allaient, glissant avec une rapidité d’éclair sur la pente raide de la côte et gravissant la rude montée durant des heures, infatigables gaillards, couverts de neige, les joues rougies par le mouvement et l’air vif, sans se lasser jamais.
Ou bien encore, on creusait des cavernes dans les bancs de neige ; on élevait des forteresses et alors il y avait bataille pour les prendre et les défendre.
Et les yeux pochés, les nez déformés que plusieurs combattants rapportaient le soir à la maison, témoignaient qu’il y avait eu rude jeu de guerre.
Enfin, le soleil finissait par avoir raison de l’hiver. La rivière du Sud, gonflée par les torrents de neige fondue qui s’échappaient des montagne, soulevait, broyait son fardeau de glace avec de rauques grondements de joie et le jetait dans le grand fleuve, où ces débris épars finissaient par s’émietter et se fondre au soleil en descendant à la mer.
C’est alors, avant que les jours chauds fussent revenus que le père Pigeon, le tourneur, avait de la besogne ! Il ne suffisait pas à fournir de toupies toute la marmaille de Saint-Omer. Quoiqu’il se fût mis à l’ouvrage bien avant Pâques, sa provision s’épuisait dès les premiers jours.
« – Une toupie, monsieur Pigeon ? demandait un retardataire qui n’avait pu se procurer plus tôt les trois sous que coûtait l’objet de sa convoitise. »
– Eh ! petit, il n’y en a plus.
« – Ah ! faisait le gamin en se passant sous le nez la manche de sa blouse ; et demain qui est jeudi !... »
Il y avait tant de regret douloureux dans cette exclamation, que le père Pigeon se laissait attendrir, et défaisant de son tour un pied de couchette qu’il était en train de tourner pour quelque jeune gars qui devait se marier après les semailles, il ajustait au tour un bon morceau de cœur de merisier en disant au gamin :
– Petit, reviens demain, tu l’auras, ta toupie.
– Vrai ! s’écriait l’enfant qui sortait radieux, tandis que le bon vieux homme mettant la lourde roue de son tour en mouvement, grommelait à part soi :
– Après tout, il n’est pas si pressé que ça avec sa couchette, le petit Louison Minville !...
Et dans son petit œil, aux paupières toutes ridées dans les coins, se reflétait un sourire égrillard, tandis que les copeaux se tordaient sous le tranchant de sa gouge qui mordait dans le bois.
Le jeudi matin, sur les neuf heures, les bambins des environs, tous amis de Lucien, se réunissaient auprès de la maison de M. Rambaud.
Sur un plateau d’où la neige avait disparu plus tôt qu’ailleurs et que le soleil avait déjà séché, on traçait un grand cercle avec le clou d’une toupie et le jeu commençait.
Le moins impatient de la bande se résignait à mettre au blanc, dans le cercle, sa toupie que chacun des joueurs visait à tour de rôle. Les toupies qui ne touchaient pas la sienne, il les étouffait dans le rond ou les attrapait au vol en les lançant en l’air avec sa corde et les plaçait prisonnières à côté de la sienne, jusqu’à ce qu’un autre joueur la fît sortir du cercle et lui rendît la liberté.
Comme l’on riait de bon cœur lorsqu’un joueur adroit faisait sauter un éclat de quelque toupie !
Il y avait surtout le grand Thomas Fournier avec sa grosse toupie de gaïac, chaque fois qu’il frappait en ahanant, il y avait plaie ou trou dans le tas. Aussi restait-il longtemps dans le cercle quand une fois on l’y avait pris ! Tous se liguaient contre lui ; et, l’une après l’autre, les plus habiles joueurs allaient cueillir les toupies qui environnaient la sienne.
– Attends un peu, Thomas, lui disait-on, tu vas tout nous payer à la fois !
Et lui riait de sa bonne et large face rouge épanouie !
Ça n’a l’air de rien ces jeux de l’enfance, tant ça tient à peu de chose ; et pourtant comme les heures s’enfuient rapides à ces simples amusements, et quelle santé tous ces enfants aspirent à pleins poumons, dans une pareille journée d’exercice, sous le bienfaisant soleil du bon Dieu !
Les bourgeons des peupliers et des trembles faisaient éclater leur enveloppe duveteuse ; les feuilles perçaient et se développaient ; les branches se couvraient de verdure et les arbres fruitiers de fleurs blanches ; les oiseaux, revenus des régions du midi, construisaient avec des cris de joie, sous ces ombrages odorants, des nids nouveaux pour abriter leurs amours nouvelles ; les champs ensemencés peu à peu se couvraient d’herbe fine, et sur la campagne ensoleillée se promenait le souffle fécondant de la nature en travail.
C’est alors que se réchauffaient les eaux de la rivière et que le poisson se remettait à mordre.
Près du pont rouge, tout à côté de la maison de M. Rambaud, Lucien donnait ses premiers coups de ligne. Alors que la rivière était encore gonflée par la crue des eaux du printemps, le goujon et la carpe abondaient dans le grand remous formé par le premier pilier, à l’entrée du pont.
À tour de bras, comme les enfants, Lucien lançait sa ligne qui sifflait avant de s’enfoncer dans l’eau ; et, les jambes écartées, serrant sa perche, la tête penchée, il attendait.
– Toc, toc, la ligne se raidissait avec deux petits coups secs.
– Ça c’est un « gardon », pensait Lucien.
– Toc, toc, répétait le goujon, que Lucien lançait à tour de bras sur la berge.
Le pauvre poisson tressautait convulsivement, laissant sur les cailloux quelques-unes de ses écailles argentées ; le petit pêcheur l’embrochait sans pitié sur une branchette coupée ad hoc, mettait un nouveau ver sur l’hameçon et rejetait sa ligne à l’eau. Quant le fil s’agitait avec une tension douce et régulière :
– C’est une carpe qui suce mon appât ! se disait Lucien.
Il laissait faire. Lorsqu’il sentait la traction devenir plus pesante, il donnait un bon coup, et tout son être tressaillait d’aise à la vue d’une grosse carpe rougeâtre qu’il sortait bruyamment de l’eau et qu’il envoyait tomber loin derrière lui, pour ne pas la manquer.
Du haut du pont, son bonnet bleu sur la tête, le brûle-gueule aux lèvres, le père Normand, le gardien, appuyé sur le garde-fou, souriait, tout en chauffant ses vieux membres au bon soleil de juin.
Mais les vraies parties de pêche se faisaient l’été, durant les vacances.
Alors, on partait trois ou quatre, la ligne sur l’épaule, et l’on remontait la rivière, courant les fossés, cherchant les bons trous, les endroits connus pour être poissonneux.
Lucien se rappelait bien le jour et l’endroit où il avait manqué son premier achigan.
C’était dans la grande fosse, vis-à-vis le champ de Joseph Nichol, dont la maison blanchie à la chaux se dressait en face, de l’autre côté de la rivière, avec son toit rouge et ses contrevents verts.
On était en août et le soleil dardait tous ses feux sur les champs jaunis. Assis sur une grosse pierre, au bord de l’eau, sous un orme gigantesque dont l’ombre se projetait jusqu’au milieu de la rivière, Lucien attendait patiemment, sa perche appuyée sur le genou gauche, que quelque poisson voulût bien mordre ; ce qui, ce jour-là, se faisait attendre. Lassé de regarder la ligne qui s’enfonçait immobile dans l’eau, profonde à cet endroit, il examinait avec curiosité tout un tableau qui se reflétait sur la surface calme de la rivière.
De l’autre côté, sur la rive opposée, une femme et deux hommes, en retard dans la fenaison, chargeaient de foin une charrette. Comme ils se trouvaient sur le point culminant de la rive, et tout près du bord, les travailleurs, la voiture et le cheval étaient réfléchis dans l’eau. Seulement, les gens et l’animal s’y mouvaient la tête en bas, près d’un gros nuage blanc qui, du fond du ciel, se mirait aussi dans l’eau couleur d’acier bruni. À droite, une clôture dévalait sur la grève, suivant la pente abrupte de la berge, et, sur un pieu dont la base trempait dans l’eau, une corneille lissait ses plumes en poussant de temps à autre un rauque croassement ; vers la gauche, une vache, la tête passée par-dessus la clôture du champ voisin, ruminait lentement et de ses grands yeux paisibles observait les travailleurs.