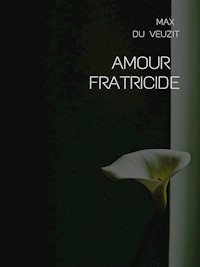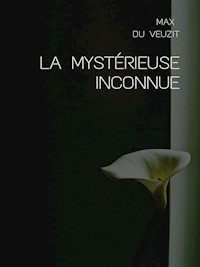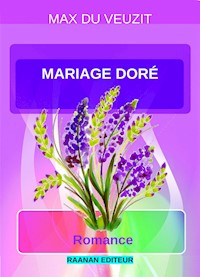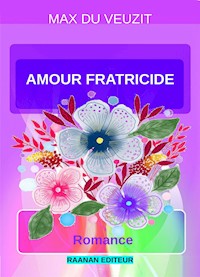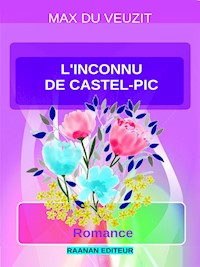1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Pour se soustraire aux assiduités de son beau-père, Arlette Dalimours quitte sa province pour vivre seule à Paris. Devant toucher l'héritage d'une tante très riche le jour de son mariage - c'est là une clause du testament de son originale parente - Arlette contracte une union "blanche" avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle, moyennant une pension qu'elle lui versera.Arlette devient donc Mme Lussan, mais son mari "pour rire" meurt subitement une année après sans que les époux aient pu se revoir.Quand, plus tard, Arlette fera la connaissance d'un jeune homme, Pierre, qui l'aime et qu'elle aime, elle n'osera pas lui avouer la supercherie de son mariage avec M. Lussan. Et ce Pierre - elle l'apprendra bientôt - n'est autre que le neveu... de son premier mari. Sera-t-il son second époux ? Mais il est des supercheries qui coûtent cher à leurs auteurs...|Librairie Jules Tallandier|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
SOMMAIRE
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
MAX DU VEUZIT
ARLETTE ET SON OMBRE
1946
Raanan Éditeur
Livre 1033 | édition 1
Arlette et son ombre
I
Francine Montel s’était levée au coup de timbre avertisseur pour aller recevoir le visiteur qui s’annonçait.
Dans la pénombre du vestibule, une forme féminine apparut que la maîtresse de logis identifia tout de suite :
– Oh ! Arlette ! Quelle bonne surprise !... Bonjour, ma chérie !
– Bonjour, ma grande ! répondit d’une voix douce la nouvelle venue. Je ne te dérange pas ?
– Penses-tu !... Entre donc bien vite.
La jeune femme avait saisi aux épaules Arlette Dalimours, son amie d’enfance, et elle la regardait avec une affectueuse stupeur.
– Ah ! par exemple ! Si je m’attendais à te voir !...
De nouveau, elles s’embrassèrent avec chaleur, heureuses de se retrouver ensemble après tant de mois de séparation.
Leurs effusions terminées, Francine entraîna l’arrivante vers la salle à manger-salon – on dit salle de séjour aujourd’hui – où elle travaillait auprès de ses deux enfants. Et, dès le seuil, elle commença joyeusement les présentations :
– Voici mes deux bébés... Il y a longtemps que tu ne les as vus... Mon petit Philippe que tu connais bien et ma petite Claudine qui a grandi ?...
– Oui, elle a grandi !... Ils sont magnifiques, tous les deux !
La visiteuse avait maternellement attiré contre elle les deux babys et les examinait affectueusement.
Un nuage passa sur son front pâle.
– Une mère doit être heureuse d’avoir d’aussi beaux bébés...
Elle s’arrêta, soupira, puis, reprit comme en songe :
– Le vrai bonheur pour une femme : vivre pour ses petits !... Ah ! je t’envie, Francine ! ajouta-t-elle avec plus de vivacité. Tu ne te doutes pas combien tu es riche de les posséder...
– Avec un bon mari surtout !
– Oui... Avec leur père, évidemment ! Ce brave André !... Comment va-t-il, à propos ?
– Mais très bien, fit l’autre en riant.
– Pourquoi ris-tu ? s’étonna Arlette.
Un peu rouge, elle ajouta :
– J’ai dit quelque chose d’extraordinaire ?
– Au contraire... C’est ton « à propos » au sujet d’André qui me fait rire... Comme si tu avais pu oublier mon mari.
– Non ! Bien sûr, je ne l’oublie pas ! Mais peut-être ai-je pensé involontairement qu’un homme n’est pas absolument nécessaire au bonheur d’une femme.
Francine regarda sa compagne avec étonnement.
Qu’est-ce qui lui prenait, à cette petite Arlette, d’énoncer de pareilles réflexions ?
L’arrivante avait vu sa surprise et deviné ce qu’elle pensait. Elle éclata de rire :
– Fais pas attention, ma grande ! Je suis un peu ahurie de me trouver chez toi... dans ce Paris si remuant, si mouvementé... la tête est perdue et les idées viennent en foule qu’on n’a pas le temps d’approfondir... surtout lorsque, comme moi, on n’a pas l’habitude de voir tant de gens et tant de choses...
L’autre ne répondit pas. Le ton de son amie sonnait faux. Et pourquoi parlait-elle tant... si fiévreusement ?
La jeune mère s’était placée devant Arlette et par-dessus les têtes de ses deux enfants, elle examinait affectueusement la jeune fille.
Sa langue et ses lèvres traduisaient au fur et à mesure les conclusions de son inspection :
– Un peu de pâleur... la mine tirée... Et que signifie ce regard ?... De la tristesse ?... Alors quoi ! Cela ne va pas chez toi ?... Mais non, je divague ! Puisque te voici en promenade dans la capitale, c’est que tout est bien. Et s’il y a dans ces grands yeux-là un semblant de mélancolie, c’est parce que, depuis quelques jours, mademoiselle Arlette abuse, à Paris, de son temps et de sa jeunesse !... Trop de plaisirs ! parbleu ! Tu es fatiguée, voilà tout !
La jeune fille eut un sourire un peu triste.
– Hélas ! fit-elle doucement. En fait de distractions... Drôles de plaisirs, plutôt !
Son air abattu inquiéta sa compagne. Elle avait soudain conscience que quelque événement grave justifiait la visite d’Arlette.
– Voyons ! qu’est-ce qui ne va pas ?... demanda-t-elle avec autorité. Mais d’abord, remets Philippe sur ses pieds et assieds-toi... Raconte, maintenant.
Arlette avait exécuté l’ordre en silence. Puis, embarrassée pour débuter, cherchant ses mots, elle dit gauchement :
– Je vais te surprendre, ma grande... Je suis à Paris depuis douze jours...
– Douze jours ! Par exemple ! Et c’est seulement aujourd’hui que tu viens me voir ?
Francine paraissait outrée ; mais doucement, Arlette lui saisit la main.
– Ne te fâche pas... Il m’a été impossible de venir plus tôt... J’ai eu de terribles soucis, vois-tu...
– Des soucis ? Mais pourquoi ?... Comment cela ?
Comme l’autre haussait les épaules avec accablement, Francine la pressa de questions.
– Voyons !... Voyons !... Je ne comprends pas ! Explique-toi. Tu m’intrigues !... Mais d’abord, clarifions !... Ta mère ?
– Ma mère est naturellement à Battenville.
– Et M. Lebredel ?
– Mon beau-père s’occupe toujours de sa pharmacie... Il crée de plus en plus de nouveaux produits pour le soulagement des malades et la prospérité de sa maison... Je suis ici...
Elle s’arrêta et, devant le regard un peu dur de son amie, elle protesta doucement :
– Ne me fais pas ces yeux-là, chérie... Je suis à Paris pour y travailler... Tu vois comme c’est simple et naturel.
– Trop simple, trop naturel, pour que je comprenne du premier coup !
– Comment le dire mieux ? J’ai trouvé un emploi... Je vais gagner ma vie... Il me faut désormais ne compter que sur moi... sur moi toute seule.
– Qu’est-ce que tu me racontes là ?... Est-ce que je saisis bien : tu n’es plus auprès de tes parents ? Tu es seule à Paris ?
– Oui ! Ça te paraît extraordinaire ?
– Absolument renversant !
Et sans doute pour donner plus de poids à son affirmation, Francine attira un siège à son tour et s’y laissa choir, face à son amie.
Saisie par l’énormité du fait qu’Arlette venait de lui révéler, la jeune mère laissa échapper encore, comme une lamentation :
– Tu as quitté ta mère !... Tu l’as quittée !...
– Oui !... confirma l’autre avec lassitude. Et ce n’est pas sans déchirement, crois-le bien !
Francine, un peu abasourdie, regarda son amie comme si elle la voyait pour la première fois. Après un court silence où toutes les suppositions trottèrent dans son cerveau, la jeune femme demanda :
– Allons, explique... Tout cela, ce n’est qu’une crise, un mauvais passage ?
– Non, j’ai quitté ma mère pour toujours.
La gravité du ton, les syllabes prononcées lentement, comme détachées, ne laissaient aucun doute sur le caractère irrévocable de la décision prise. Cette fois, le silence se fit lourd, pénible... Si lourd et si pénible qu’il s’imposait en se prolongeant...
En présence de ces deux femmes dont l’une, âgée de vingt-deux ans, échappait en ce moment à la destinée qui lui était imposée, dont l’autre, de taille un peu plus grande et de traits plus marqués, portait avec la maturité de ses vingt-huit ans celle de sa double maternité, on n’eût pu manquer de remarquer le contraste de leurs personnalités. Cette dernière avait l’expression reposée et quiète de la physionomie d’une maman heureuse, alors que, sur le visage de la jeune fille, un masque de gravité s’imprimait, révélateur de profonds soucis.
Effarée de la nouvelle imprévue, Francine essayait de se l’expliquer elle-même :
– Je sais bien que Mme Lebredel n’était pas une maman très affectueuse... Du moins, pas autant que ta nature aimante aurait pu le souhaiter...
Mais Arlette secoua lentement la tête :
– Ce n’est pas à cause de ma mère que j’ai quitté Battenville...
– Alors, je ne comprends pas.
Et, subitement, s’emportant :
– Explique-toi, voyons !... Tu es là devant moi, comme une énigme, tandis que je fais toutes les suppositions, faute d’être renseignée suffisamment ! Tu me laisses sur des charbons ardents alors que je redoute tout à ton sujet !
Comme l’autre esquissait un geste de protestation, la jeune mère spécifia :
– Oh ! J’ai pleine confiance en toi, c’est entendu ! Mais éclaire-moi vite, de grâce !
Comme à regret, hésitant et baissant la voix, l’autre avoua péniblement son cruel secret :
– C’est à cause de mon beau-père...
– Hein !... De ton beau-père ?...
– Oui !
– Maurice Lebredel te faisait la vie dure ?... Un garçon si paisible, si doux en apparence !...
– Trop paisible en apparence !... Trop doux aussi !
Et, timidement :
– Faut-il que je te rappelle qu’il ne m’a jamais considérée comme sa fille ?... Quand il a épousé ma mère, j’avais douze ans ; j’étais déjà une grande fille alors que lui n’avait encore que trente ans... Avec tout ce que cet âge comporte pour un homme !...
– Il n’ignorait pas ton existence... Ta mère disait qu’il serait pour toi un vrai père.
Arlette eut un geste de vague dénégation.
– Ma mère ? Elle était heureuse de se remarier avec un jeune mari qu’elle adorait !... Pense donc : un mari de huit ans plus jeune qu’elle ! Elle ne pouvait pas, vraiment songer à autre chose... C’était là tellement de l’inattendu qu’elle en était émerveillée...
– Une simple coquetterie prolongée, de sa part.
– Je ne le crois pas, fit Arlette avec un soupir de regret. J’envisage plutôt une sorte de revanche... Une compensation qui s’offrait à elle, car il faut songer à ce qu’a pu être son existence auprès de mon pauvre papa. Un homme de science !
– C’était un brave homme.
– Ah ! certes ! Et ce n’était pas précisément sa faute si ma mère ne s’épanouissait pas auprès de lui... Quand l’homme est pris par un idéal... un travail cérébral... il oublie un peu ceux qui l’entourent... ses proches ne lui apparaissent guère que comme des accidents un peu insignifiants...
– M. Dalimours était la crème des hommes ! protesta Francine chaleureusement.
Un pâle sourire erra sur les lèvres de la jeune fille.
– J’aimais beaucoup mon père et je suis heureuse que tu gardes de lui cet excellent souvenir... Mais mon père était aussi un savant... Et un savant, vois-tu, Francine, ça ne rend jamais une femme très heureuse ! Ça s’occupe de recherches, de science... ça met le nez dans de gros bouquins... Mais pour le reste !
L’autre parut saisie.
– Mon Dieu... Peut-être, en effet ! Je n’avais jamais pensé à cela...
– Oui, hélas ! soupira la nouvelle venue... Mon père, sans s’en rendre compte, finissait par oublier ma mère... Il ne remarquait même plus à son foyer la présence d’une femme jeune, jolie, car ma mère était jolie... pas du tout comme moi !... S’inquiétait-il seulement des menus faits qui étaient sa vie à elle ?...
Francine observa pensivement :
– Je vois ça... L’homme est souvent l’artisan de son malheur... Plus qu’il ne le croit, j’en suis sûre !
– C’est très juste ! Mais, pour en revenir au remariage de ma pauvre maman, je crois qu’au fond, ma chère grande, comme j’appelais celle-ci... ma chère grande n’a pas trouvé auprès de mon père tout le bonheur auquel elle avait droit. Aussi, quand Maurice est entré dans sa vie, comment aurait-elle pu résister à ses amabilités ? Il concentrait sur elle toutes ses attentions. Il lui faisait une cour discrète, mêlant le respect à l’amour... Ajoutant ainsi le charme et la distinction à des agréments de moindre qualité, mais non moins sensibles.
– Évidemment !... Ce pharmacien si vivant, si gai, à la conversation agréable, était en quelque sorte la coqueluche de tous les gens de Battenville... On comprend que ta mère ait été séduite !
– Tu te rends compte !... Elle ne pouvait pas songer beaucoup à moi.
– Surtout qu’elle était encore jeune... Elle ne portait pas l’âge qu’elle avait en réalité... Elle semblait, auprès de toi, plutôt comme une sœur aînée.
– Justement, ma présence à la maison même contribuait à l’égarer là-dessus. Le fait que je paraissais être la cadette l’aidait à oublier les huit années qu’elle avait de plus que Maurice... Malheureusement, du même coup, elle n’avait pas pensé que j’allais grandir et devenir une jeune fille à mon tour...
Elle s’arrêta et, en hésitant, ajouta :
– Remarque que je n’accuse pas ma mère de ne point m’avoir aimée, loin de là ! Mais, auprès de son jeune mari qu’elle adore, imagine combien la présence d’une jeune fille en âge de se marier apparaît gênante !
– En effet ! constata Francine, étonnée de n’avoir pas elle-même fait déjà cette remarque, Je me souviens que la venue de ton petit frère fut pour elle un triomphe.
– Oui, quand Marcel est né, ce fut un immense bonheur à la maison. Ce petit être plaçait maman au rang des jeunes mères ! Elle m’en a oubliée, moi et mes quatorze ans !... À vrai dire, avant cette date, je ne comptais pas beaucoup... Depuis, je n’ai plus compté du tout !
Elle avait prononcé ces derniers mots avec un sourire un peu triste, et Francine d’approuver :
– Évidemment, la sœur aînée s’est trouvée confinée dans le grade de bonne d’enfant.
– Bah !... J’accomplissais de bon cœur tous les petits travaux, les besognes élémentaires... les menues corvées familiales... Ça ne me déplaisait pas. Ma mère et Marcel étaient tout pour moi... Je ne crois pas avoir jamais...
Elle s’arrêta, puis, après quelques instants de réflexion qui lui permirent de sonder la mémoire de son cœur, elle expliqua :
– J’aimais mon frère, j’aimais ma chère grande !... J’ai peut-être pleuré quelquefois dans mon lit de jeune fille, comme toute enfant privée de tendresse, de baisers et de toutes ces douces expansions qui sont nécessaires au début de la vie... Mais, la crise passée, il ne restait en moi aucune arrière-pensée. Et, tiens, Francine, cette expression de ma chère grande, spontanément venue à mes lèvres pour désigner ma mère, ne te prouve-t-elle pas que je voyais en elle une grande sœur adorée plutôt qu’une maman ? N’as-tu pas remarqué toi-même que j’étais la première à lui épargner des corvées, à contribuer à la faire belle... Car je l’admirais naïvement, sincèrement, presque avec dévotion !... Ah ! vois-tu, tout cela demeure pour moi le bon passé !
– C’est pourquoi je m’explique mal que tu aies pu la quitter.
– Ah ! oui. Voilà...
Il y eut un nouveau silence.
Des larmes brillèrent dans les yeux d’Arlette sous certains souvenirs accablants. Et, pour expliquer discrètement la cause dominante de son exil volontaire, elle chercha ses mots lentement, un peu gênée :
– J’ai eu seize ans... Puis dix-huit ans... La vingtaine est venue... Le petit frère continuait à créer autour de ma mère le symbole de la jeune maman... Mais moi, l’aînée ? La grande fille ? Fatalement, je jouais un rôle inverse ; je menaçais de détruire l’ambiance. Ma seule présence ne suffisait-elle pas à rappeler l’âge réel de maman ?... Et je crois bien que cela devait être atroce, pour une femme aussi jeune... pour une grande enfant comme ma petite maman l’a toujours été... pour cette chère poupée, charmante, adorable et qui est toute grâce, tout sourire !
– Je vois cela, en effet ; mais je le réalise mal en mon esprit, fit Francine qui réfléchissait. Il est vrai que ma condition est tellement différente de la tienne que toute appréciation de ma part s’en trouve faussée par avance.
Mais, Arlette, quelque regret que tu aies pu éprouver de cet état de fait, je ne vois pas là motif suffisant pour aboutir à cette rupture qui m’inquiète tant.
– Patience, j’y arrive ! répéta la jeune fille, qui éprouvait peut-être quelque gêne à entrer dans les détails. Mais, comprends déjà la situation... Si ma mère avait été seule à s’apercevoir que je grandissais et que j’étais devenue une jeune fille bonne à marier... que les hommes regardaient déjà... Tiens ! je me souviens, en cet instant, de la tentative qu’elle fit, l’an dernier, pour me faire épouser un ancien ami de mon père.
– M. Dupernois ?
– Oui, lui !... Il avait quarante-huit ans et il était plus vieux que ma mère. Je n’aurais plus habité Battenville... auprès d’elle... Tu comprends ?
Francine sursauta :
– C’était pour ça ?
– Hélas !... Involontairement... Sans s’en rendre compte... car ma petite maman m’aime bien aussi, tu sais !
– Naturellement, une mère !
– Oui, enfin... Quoique ce ne soit pas toujours une raison !... J’ai pensé que, peut-être, j’avais eu tort de négliger l’occasion qui s’offrait à moi ; je n’aurais pas dû refuser ce parti. À distance, je vois combien ce mariage arrangeait les choses ! D’abord, je quittais la maison au bras d’un mari aisé, ce qui était un avantage pour moi ; ensuite, ma mère entrait en possession de la rente laissée par tante Euphrasie... Enfin, j’aurais évité d’autres inconvénients plus graves dont la menace devait bientôt apparaître... Je t’ai écrit à ce moment-là ; t’en souviens-tu ?
– Très bien... Mais j’ai été indignée qu’une pareille pensée de mariage pour toi puisse venir à Mme Lebredel. Mon mari, lui-même, était révolté. Tu ne peux pas t’imaginer toutes les réflexions qu’il faisait contre ta mère ! Il n’admettait pas cette contradiction : elle, qui avait épousé un jeune mari, osait te proposer, à toi plus jeune, un quinquagénaire ! Un homme mûr !
– Cet homme m’épousait... tout est là ! Je me mariais et cela seul comptait...
– Mais pourquoi ?
– N’oublie pas les clauses du testament de ma tante.
– Ah ! j’ignore !... Quelles sont-elles, au juste, ces fameuses clauses ?
– Elles paraissent singulières, à première vue... pour qui, surtout, ne connaît pas le caractère léger de ma chère grande. Or, je suis sûre que tante Euphrasie n’a cherché que le bonheur de tous... Elle craignait que ma mère ne souhaitât un jour mon entrée au couvent : une grande fille, ça vieillit ; une religieuse, on l’ignore, on l’oublie. Alors, pour m’éviter cette perspective qu’elle considérait comme un malheur irréparable, – une idée à elle, n’est-ce pas ? – elle estimait que le rôle de la femme est avant tout d’être mère, donc épouse... elle me laissa toute sa fortune – une dizaine de milliers de francs de rente – sous deux conditions...
– Par exemple ?
– Premièrement, je ne dois entrer en possession du capital que le jour où je me marierai... Et, deuxièmement, ma mère touchera les revenus sa vie durant... Tu comprends, l’intérêt de ma mère est que je me marie... même si des petits-enfants doivent la transformer en grand-mère...
– Ta tante a été prévoyante.
– Évidemment...
Elle soupira profondément.
– Oui... quoique... Une chose est sûre, reprit-elle d’un air navré, c’est que je n’aimais pas ce M. Dupernois et que je ne pouvais concevoir ma vie rivée à celle de cet homme qui avait l’âge d’être mon père.
– Parbleu !
– Pourtant, je m’en aperçois maintenant, c’était une solution !... Il avait une jolie situation dont ma mère m’avait souligné tous les avantages... Je n’aurais pas dû dédaigner ces considérations.
Francine se mit à rire :
– Il faut croire que ce mariage n’entrait pas, heureusement, dans le cadre de ta destinée.
La jeune fille eut un léger hochement de tête. Puis, fermant les yeux sur une vision intérieure assez pénible, elle soupira :
– Et cependant, il faut le reconnaître, elle n’était pas brillante, ma destinée !... Les jours qui se sont écoulés, depuis que j’ai refusé ce vieux mari, n’ont pas été parmi les plus heureux de mon existence...
– Quelle situation !... Le conflit classique de l’amour passionnel et de l’amour maternel. Cela me donne le vertige, toutes ces complications, à moi dont la vie est si simple et si droite. Comme tu as dû en souffrir, ma petite enfant !...
Dans un élan affectueux, Francine attira vers elle la tête de son amie et la maintint quelques instants sur son épaule, puis elle lui donna un baiser.
Après quoi, elle l’invita à poursuivre son récit :
– Que te dire encore, fit Arlette tristement. Le mécontentement de ma mère ?... Ses inévitables bouderies qui étaient un blâme permanent ?... Tu devines !... À la longue, tout aurait probablement fini par s’arranger si les moindres faits n’apportaient parfois des incidences imprévisibles... Quelqu’un fut assez satisfait de mon refus, contrairement à ce qu’on pourrait croire : Maurice Lebredel, en triturant ses produits, découvrit de nouveaux horizons... et il s’efforça vite de les explorer !
Une stupeur passa dans le regard de la jeune femme.
– Non !... Est-ce possible ?... Maurice Lebredel !
– Hé oui !... Il avait suffi qu’un homme me recherchât en mariage !... Il s’attacha subitement à mes pas !... Un jour, il eut certaines paroles...
Elle s’arrêta, extrêmement gênée, pour continuer :
– Et alors ? insista Francine, dont les grands yeux loyaux étaient remplis d’indignation.
– Alors, vois-tu, reprit Arlette courageusement. J’étais tellement confiante... et bête ! Je n’ai pas compris !... Je n’ai pas cherché davantage à comprendre. J’ai eu tort encore, probablement...
– Qu’est-ce que tu as fait ? s’inquiéta la jeune mère.
– Sottement, avoua Arlette, je me suis mise à rire... comme s’il s’agissait d’un trait d’esprit ou d’un madrigal !... J’ai cru à un simple compliment... Un compliment d’homme qui n’était pas mon père mais qui, en fin de compte, se trouvait être le mari de ma mère, mon second père !
Francine avait froncé le sourcil, cherchant à reconstituer la scène.
– Évidemment, il a pu croire que tu riais par coquetterie ?... Il en faut si peu pour affoler un homme !
– Que veux-tu, mon amie ! reconnut Arlette. Jamais il ne m’était venu à l’idée que cet époux aimé à la folie par ma chère grande, pouvait seulement être effleuré d’une mauvaise pensée s’appliquant à moi... à moi son enfant !
– Et... tu es sûre ?... Tu te frappes peut-être, tout de même ?... L’imagination brode si vite sur des mots... Surtout que tu avoues n’avoir pas compris sur le coup.
Mais Arlette hocha la tête lentement, dans une grave dénégation.
– Non... Il est des choses... Si tu savais !... À la fin, j’étais comme folle, vois-tu...
– Quelle misère !
– À tel point que je me suis demandé, en pensant à maman qui pouvait tout apprendre, si ma disparition n’était pas préférable... Non... Ne me regarde pas avec ces yeux-là ! Je te le jure, j’ai songé à mourir... Et puis, j’avais vingt ans. Et, lorsque la santé est robuste, les pensées de mort pour échapper aux peines de la vie ne durent pas longtemps ; l’instinct de la conservation demeure intact. Le grand départ ? C’est bon lorsqu’on n’a plus du tout d’espoir... Moi, j’aimais ma mère, j’aimais mon petit frère et, sans doute, j’aimais aussi la vie ! Tout cela fait que je me suis calmée et que j’ai pu raisonner... J’ai fini par espérer que les choses s’arrangeraient d’elles-mêmes... Je me disais que mon beau-père avait dû subir quelques minutes d’aberration... Si j’en juge par ce qu’on entend raconter partout, les hommes sont de drôles d’êtres au fond ! Ils sont égrillards par nature, semble-t-il... Bref ! Tu vois le raisonnement qui me disposait à l’indulgence.
– C’était mieux que de penser au suicide...
– Oh ! ce n’était guère plus sage, car je finissais par me leurrer...
– Ce n’était pas fini ?
– Hélas !... Ce fut la lutte continuelle... Tous les jours... Et je me taisais pour épargner de la peine à maman...
– Qui, naturellement, ne se rendait compte de rien ? s’indigna Francine.
Arlette secoua la tête.
– Heureusement ! fit-elle... Cependant, maman me rabrouait pour toutes sortes de raisons... Elle me reprochait d’être coquette. Trop bien coiffée... Trop soigneuse avec mes petits cols blancs que je lavais et repassais chaque jour... Et, pour essayer de la satisfaire, je tirais mes cheveux, je les plaquais sur le crâne ; j’évitais toute recherche de coquetterie dans mes vêtements ; j’acceptais de porter le chapeau qui me seyait le moins ; je devenais enfin une vraie Cendrillon, sans charme et sans sourire...
– Pauvre gosse !
– Et cependant, continua Arlette avec accablement, ma mère, je l’adorais !... Mais quel mal ses critiques et ses réprimandes injustes ont-elles pu me faire ! Je les supportais pourtant, en pensant que son bonheur et sa tranquillité valaient bien les quelques mortifications essuyées... Pourquoi a-t-il fallu ?... Ah !
Elle s’arrêta, cachant son visage subitement empourpré dans ses mains, à l’évocation atroce d’une scène qu’elle n’avait pas voulu subir une seconde fois.
En silence, Francine l’examinait.
Avec cette pudeur instinctive des femmes, elle eut l’intuition de ce qui avait dû se passer. Sa main affectueuse vint se poser sur l’épaule de la jeune fille dans un geste de réconfort.
– Mon tout petit, murmura-t-elle avec compassion.
– Ah ! ma petite Francine ! Quels souvenirs ! Un jour, la coupe déborda !... Mon beau-père fut odieux... Il me mit hors de moi !... Je ne me reconnaissais pas ! Il me semble que si, à ce moment, une arme quelconque m’était tombée sous la main, je n’aurais pas hésité un instant à en faire usage. Songe donc... Oui, je m’énerve à ce souvenir. Mais comprends, Francine, pourquoi j’ai tenu à partir... Ma décision était la seule qui fût logique et nécessaire... La seule possible... Fuir ! Fuir au plus vite !... Fuir très loin !
Francine était aussi émue que son amie était en proie à l’exaltation. Comme des larmes mouillaient ses yeux, elle les tamponna avec une pochette tirée de la ceinture de son corsage, puis elle se moucha longuement.
– Ma petite Arlette, dit-elle, avec une conviction profonde. Quel malheur pour toi, une pareille histoire !
– Tu t’expliques maintenant pourquoi je suis ici ?
– Je ne pouvais pas deviner, c’était inconcevable !... Mais partir... venir à Paris seule... sans situation, sans argent... Ce n’est pas moins extraordinaire...
Arlette haussa les épaules avec indifférence.
– Si j’arrive à gagner ma vie, tout s’arrangera. J’ai toujours aimé la couture... Même petite, j’étais sans cesse fourrée avec les couturières qui venaient faire des journées à la maison ! Après la mort de mon pauvre papa, devant la situation financière assez embrouillée qu’il nous laissait, maman m’avait mise en apprentissage chez Mme Lobligeois... J’étais ravie de cette bonne idée, sans soupçonner que j’aurais besoin de gagner ma vie plus tard...
Francine approuva :
– Pour une fois, ta mère avait vu juste. En vérité, la couture est un métier...
– Oui, mais le plus difficile, en quittant Battenville, n’était pas de faire une robe... ça, je sais !... C’est moi qui faisais toutes les toilettes de maman... C’était de partir... Où aller ? Et comment vivre ?
– Quelqu’un t’aura aidée à quitter le pays ?
– Non ; la bonne m’offrait d’aller à Rouen, chez une de ses tantes qui y dirige un atelier... J’ai trouvé que c’était trop près de ma famille... maman, mon beau-père ?... Ne m’aurait-on pas relancée ?... Alors, j’ai eu l’idée d’écrire à Mme Lobligeois. Je l’ai priée de me chercher un emploi, car elle habite Paris depuis qu’elle a hérité le fonds de mercerie tenu autrefois par sa sœur... Oh ! ce fut vite fait !... Je lui avais dit que rester au pays était une affaire de vie ou de mort pour moi... Je n’ai pas donné d’explication... Il y a des choses que l’on ne peut raconter qu’à son amie... et encore !
– Comment !... et encore ?
– Dame ! fit Arlette en riant. As-tu été assez soupçonneuse, méchante !
– C’est que, justement, je t’aime bien, Arlette, et je te veux sans reproche.
– J’ai bien compris, va... Ne t’excuse pas !... Mais je reviens à Mme Lobligeois... La bonne dame a dû comprendre que quelque chose de sérieux m’obligeait à partir ; elle a eu tôt fait de me découvrir du travail dans un atelier de Paris.
– Alors, tu es placée ?
– Oui, heureusement.
– Dans une bonne maison ?
– Je pense que oui.
– Pourquoi ne m’as-tu pas écrit ? Est-ce ainsi qu’on agit avec ceux qui vous aiment ?
– Je ne pouvais pas te raconter par lettre ce que je viens de te dire. J’avais peur que tu doutes et que tu me grondes, comme tu paraissais vouloir le faire au début de mes explications. Il me fallait tout t’avouer de vive voix... et encore !... en l’absence de ton mari.
– Pourquoi ça, en l’absence d’André ?
– Parce qu’il va être furieux contre moi.
– Mais, pas du tout, il va très bien comprendre ta situation.
– Hélas ! Il va la trouver surtout irrégulière !
– Tu te trompes ; il va être révolté en apprenant comment s’est conduit M. Lebredel à ton égard et je ne suis pas sûre qu’il ne se décide à une intervention énergique auprès de ce vilain monsieur, de ce...
Mais Arlette, d’un geste expressif de la main, l’arrêta :
– C’est un homme, mon amie !... Semblable à beaucoup d’autres... Je n’ai plus guère d’illusions, malgré mon inexpérience... Dans les petites villes, la gazette scandaleuse colporte, de bouche en bouche, les potins et les ragots. On en sait long ! Il n’est pas un homme sur le compte duquel il ne coure quelque petite histoire scabreuse... réelle ou créée sur des apparences de réalité !
– On invente tant de choses !
– Mais il y en a de vraies !
– Peut-être !... Enfin bref, te voici à Paris !
– Oui, ma grande, et pour longtemps !... Tu vois, mon premier moment de liberté est pour toi.
D’un mouvement spontané, elle se pencha vers la jeune mère et l’embrassa :
– Ma bonne amie ! Je n’ai plus que toi... Avec ton mari, vous allez être ma seule famille... Une famille de prédilection, de sagesse et d’habitudes...
– De cœur surtout, répondit Francine en lui rendant ses caresses. L’amitié vaut mieux souvent que les liens légaux ou que ceux du sang !
– C’est vrai !... Toi et moi, nous avons grandi ensemble.
– Qu’est-ce que tu racontes ? J’ai six ans de plus que toi !
– La belle affaire !... Malgré ses vingt ans de plus que moi, ma mère était en vérité la cadette... C’était moi certainement la plus vieille !
– L’horreur !
Des larmes montèrent aux yeux de la jeune fille.
– Non !... C’était du bonheur ! J’adorais ma chère grande et rien ne m’était plus doux que de la câliner... de me dévouer pour elle.
Elle s’arrêta, un sanglot lui montait à la gorge, car toute son enfance revenait à sa pensée.
– Et maintenant, fit-elle en un cri de désespoir, je suis toute seule... toute seule et je ne la verrai plus !
Son cœur, longtemps contracté, laissait enfin percer sa peine et elle hoquetait, dans l’impossibilité d’arrêter cette crise de larmes trop longtemps retenue.
– Pardonne-moi... C’est tellement bête de venir pleurer chez toi... Mais il fallait que ça crève !... J’étouffais de chagrin d’avoir remué tout ça !
– Ma petite Arlette !... Mon enfant chérie... Ne parlons plus... Il faut oublier.
Maternellement, Francine attirait la frêle tête contre sa poitrine et, en la réconfortante sensibilité des femmes, elle mêlait ses larmes à celles de l’affligée...
Très graves, inquiets de ces effusions qu’ils ne comprenaient pas, les deux bébés avaient cessé leurs jeux et tendaient leurs petits cous vers le groupe des deux amies, pleurant dans les bras l’une de l’autre.
Ce fut Arlette qui, la première, aperçut leurs moues adorables dans la crispation d’angéliques visages.
– Oh ! Francine ! Sommes-nous sottes ! Voilà Philippe et Claudine qui ont aussi des larmes dans les yeux... Chers petits anges !... Oh ! mes chéris, voilà qu’ils pleurent !
Déjà, les deux femmes avaient saisi les bambins et les couvraient de caresses, en riant malgré elles de ce petit intermède.
Elles affirmaient même bruyamment en essuyant leurs joues humides :
– Riez vite, mes chéris... Nous nous amusons, vous voyez !... Faut pas pleurer ! C’était pour rire !... Oh ! les amours ! Ah ! bon. Voilà qu’ils rient, maintenant !
Cet incident était venu interrompre heureusement le long récit qu’Arlette avait entrepris courageusement de faire à son amie.
Celle-ci en profita pour conduire la jeune fille dans sa chambre.
– Viens, mon petit ; passe-toi de l’eau sur le visage, puis, repose-toi. Pour l’instant, tu as assez remué tous ces mauvais souvenirs. Pendant que tu t’allongeras un peu sur ce divan, je vais faire manger mes deux gosses et les coucher, car voici l’heure de préparer le repas du soir...
– Oh ! alors, je vais te quitter.
– Pas du tout ! Tu vas dîner avec nous.
– J’aimerais mieux pas... Ton mari me fait un peu peur, vois-tu.
– Quelle idée !
– Il serait mieux, certainement, que tu lui parles d’avance... Je crains tellement qu’il soit choqué par mon départ de Battenville.
– Par exemple ! Quelle conception te fais-tu de mon brave André ?... Il sait comprendre, va !... D’ailleurs, je te dis de te reposer un peu... Je vais lui parler la première. Mais je tiens aussi, et non moins fermement, à ce que tu ne nous quittes pas ce soir... Après des confidences aussi poignantes, tu as besoin de te retrouver en famille, avec nous... Donc, reste ici, je le veux !
– Ma bonne Francine !... comme tu te montres affectueuse pour l’exilée... Viens ! Il faut que je t’embrasse encore.
Spontanément, elle lui sauta au cou.
– Allons, allons ! Ne nous attendrissons plus... Je vais t’en donner, moi, des larmes !... Repose-toi, t’ai-je dit !
Et, en riant, la jeune femme s’éclipsa, en refermant soigneusement derrière elle la porte de la chambre.
II
Francine avait tenu sa promesse. Elle avait mis André, son mari, au courant des détails de la vie d’Arlette.
L’homme, positif et droit, loyal en toutes circonstances, avait éprouvé cette sainte colère que soulèvent les laideurs humaines dans les âmes d’élite. Et il avait fallu tout le poids de l’engagement pris par sa femme avec la jeune fille, pour qu’il reconquît une maîtrise suffisante, capable de l’empêcher de clamer son indignation et son dégoût pour Lebredel. Certes, il se contiendrait, puisque Francine s’y était engagée, mais cela lui coûtait beaucoup.
Lorsque Arlette vint pour se mettre à table, Montel, le corps droit et le regard clair, l’accueillit, les deux mains tendues, par ces simples mots :
– Je suis heureux, Arlette, de pouvoir vous offrir une famille honnête dans ce grand Paris où vous devez vous sentir un peu perdue. Vous êtes ici chez vous...
La jeune fille ne put se défendre d’une douce émotion, une humidité voila son beau regard pendant qu’il se levait sur André.
Elle sentait que ces mots venaient du cœur, autant que de la raison de celui qui les prononçait, en accord avec sa femme.
L’attitude d’André signifiait : « La loyauté vous accueille parce que vous êtes loyale... » et le ton de ses paroles complétait : « Une famille vous admet parmi ses membres, parce que vous êtes honnête... »
C’est donc avec une gratitude émue qu’elle serra les mains qui se tendaient vers elle.
Et chacune des trois personnes réunies à cette minute-là, apporta toute sa sincérité, dans cette sorte de signature d’un pacte moral entre braves gens.
Après ces premières effusions, ils se mirent à table. Pour commencer, la conversation aborda mille sujets ; puis, comme, au fond, chacun pensait à la même chose, on ne tarda pas à entamer celui qui concernait Arlette.
André, qui observait celle-ci depuis quelques minutes, remarqua tout à coup :
– Vous n’avez guère bonne mine actuellement, petite fille. Depuis quand êtes-vous à Paris ?
– Exactement depuis douze jours.
– Et vous travaillez ?
– Ma foi, je suis restée trois jours seulement avant d’occuper un emploi... Le temps de trouver un gîte, d’aller voir mon ancienne patronne, de faire la connaissance de la nouvelle et de traiter avec elle.
– Tout cela, seule et sans appui ? insista-t-il.
– Oui, toute seule, s’excusa-t-elle. Il fallait bien que je me débrouille.
– Vous auriez pu venir nous voir plus tôt.
Arlette rougit à ce reproche.
– Non, André... Je tenais à ne venir ici que lorsque tout serait fini... Je souhaitais vous mettre en présence du fait accompli, car il est des responsabilités que l’on doit prendre seule, sans en faire subir le partage à ses amis...
Il sentit la justesse de sa décision, mais son ton demeura fraternellement grondeur.
– Vous aviez surtout peur, enfant terrible, que je ne cherche auparavant à arranger les choses avec votre mère.
– C’est vrai, avoua la jeune fille timidement. Vous n’auriez certainement pas permis que je m’éloigne de cette façon.
– Sûrement ! En partant ainsi, vous vous êtes donné tous les torts.
– Mais la tranquillité de ma mère... son bonheur plutôt a été sauvegardé.
– Oui, bien que...
Il haussa les épaules et, un peu ironique :
– Je ne comprends pas très bien qu’elle soit restée si jeune, votre maman, poursuivit-il... Elle oublie par trop qu’elle possède une grande fille envers qui elle a des devoirs... Enfin, passons... Où êtes-vous placée, Arlette ?
– Dans un atelier... rue du Louvre. Je gagne d’assez bonnes journées.
– Vraiment !... Et combien, si je ne suis pas indiscret ?
– Vingt-deux francs par jour.
André poussa un léger sifflement.
– Pfft... D’assez bonnes journées !
Son ton railleur avait fait sourire Arlette.
– Dame !... Par rapport à ce qu’on gagne à Battenville, c’est bien payé.
– Oui, mais par rapport à ce qu’on dépense à Paris ?... On voit bien que vous ne connaissez pas les difficultés de l’existence dans les grandes villes !
– Oh ! Je ne dépense guère... Une femme seule s’en tire toujours... Ce qui est lourd à supporter, c’est le loyer, il me semble. J’ai loué une chambre meublée.
– Où cela ?
– Rue des Petits-Champs... Sous les toits... Pas loin du lieu de mon travail... Ça manque un peu d’espace et de confort...
Francine sourit.
– Ne parlons pas des absents, fit-elle gaiement. Le principal, c’est que tu saches où rentrer coucher le soir.
– C’est tout de même chez moi ! De ma fenêtre, je jouis d’un panorama splendide au-dessus des maisons de Paris.
– Vous avez plus d’air qu’aux étages inférieurs, en tout cas ! remarqua André qui, jusqu’ici, semblait approuver les dispositions prises par la jeune fille.
– Pourtant, aussitôt que je le pourrai, je louerai une chambre vide et je l’arrangerai à mon goût ; cela vaudra mieux qu’un meublé !
– Tu as raison, car tu seras alors vraiment chez toi, observa encore Francine. C’est qu’on s’attache à ce qui est à soi !
– Et surtout, on l’installe à sa fantaisie.
André railla :
– Mademoiselle a déjà des goûts de propriétaire.
– Oh ! pas du tout ! protesta la jeune fille. Je ne demande qu’un petit coin tranquille... qui ne soit pas le vulgaire logement d’hôtel...
– Eh bien ! on tâchera de vous aider à le réaliser, ce petit coin familier... Francine est merveilleuse sur cette question. Fiez-vous à elle !... Mais avant de faire des projets pour demain, si nous parlions un peu d’hier, ajouta-t-il avec l’autorité d’un homme droit qui n’aime pas à louvoyer.
Arlette le regarda, une interrogation dans ses grands yeux d’enfant.
– Hier ?
– Oui, petite fille. Certes, je suis heureux de vous voir parmi nous ; mais si j’avais eu le choix des circonstances qui vous y ont amenée, j’aurais évité tous ces chagrins par où vous avez dû passer.
– Je n’en doute pas !... Francine et vous, André, vous êtes si bons pour moi.
– Attendez donc que nous vous ayons prouvé notre bonté autrement qu’en paroles, avant de faire notre éloge... Pour le moment, parlez-moi de votre départ... Comment avez-vous pu le réaliser ?
– De façon très simple, André. J’ai rassemblé ce qui m’appartenait : petits vêtements et modestes bijoux. Il s’agissait d’en assurer le transport. Je me suis confectionné un de ces grands sacs « fourre-tout », vastes et pratiques ; puis, pour éviter de froisser ma lingerie, de l’exposer à des détériorations, j’ai pris – à contrecœur, vous le soupçonnez bien ! – une valise appartenant à maman.
– Et tu es partie comme ça, sans un mot ? s’inquiéta Francine qui s’agitait sur sa chaise à l’idée de ce départ clandestin.
– Penses-tu... J’ai écrit !... Une longue lettre pleine d’excuses et de tendresse... Pour ma mère... Rien que pour elle, naturellement.
Des larmes, à nouveau, lui montaient aux yeux, car elle ne pouvait évoquer le souvenir de cette mère tant aimée sans se mettre à pleurer.
– Maman, ajouta-t-elle, ne s’est doutée de rien quand je l’ai embrassée si fort... au moment où elle partait se promener, comme chaque jour, avec mon frère... C’est à son retour, seulement, qu’elle aura compris...
Arlette s’arrêta à nouveau, car l’émotion coupait sa voix et l’empêchait de continuer. Après un silence que personne ne troubla, elle reprit :
– Elle me disait : « Tu me décoiffes... regarde, il faut que je me remette de la poudre !... Quelle insupportable gamine tu fais ! Qu’est-ce qui te prend, aujourd’hui, de m’embrasser si fort ?... » Jamais elle ne m’avait paru aussi adorablement enfant... Elle n’avait pas compris que c’était un adieu que je lui donnais... un dernier souvenir que je voulais emporter... ma chère grande !... Son dernier baiser !...
Cette fois, oubliant ceux qui l’entouraient, la jeune fille s’était mise à pleurer.
André la regardait, ému. Il savait combien Arlette aimait sa mère ; mais c’était seulement à cette minute-là qu’il se rendait compte jusqu’à quel point l’enfant pouvait avoir élevé son adoration filiale.
– Pauvre petite ! fit-il, profondément apitoyé... Ces mères éternellement jeunes ne savent pas comprendre dans leur égoïsme intégral.
Mais la jeune fille, d’un geste suppliant, l’arrêta :
– Non, André, ne dites rien. Ne m’accablez pas !... Je sais bien que ma petite maman si jolie était terriblement jeune ; mais c’était ma mère... toute mon enfance... toute ma tendresse... Que voulez-vous, j’ai été élevée dans l’isolement, toujours seule avec elle... Toute mon affection s’était exclusivement concentrée sur elle...
– Et l’on dit que le sentiment appelle le sentiment ! observa l’homme ironiquement, en s’efforçant de couper court à l’émotion qui étreignait chacun.
– Pourquoi pas ?... Je l’ai toujours pensé, moi.
Elle s’était accoudée sur la table, le visage caché dans les mains.
Francine vint l’entourer de ses bras.
– Ma petite Arlette, ne pleure pas... Tu ne fais que ça depuis tantôt... À quoi bon remuer tous ces souvenirs, d’ailleurs...
Par-dessus la nappe, André tendait la main vers l’affligée pour la réconforter d’une amicale étreinte.
À ce moment, la jeune fille relevait la tête, les paupières closes sous le poids de douloureuses pensées...
Son front traversa la zone de lumière rabattue par l’abat-jour de la lampe électrique. Une auréole de clarté vint illuminer son visage pâle qu’une désespérance infinie burinait.
Ce fut rapide, mais il parut à André que la douce tête était nimbée de soleil... comme les saintes, dans les églises... vision céleste qui faisait penser aux anges ou aux martyrs.
Il en eut la gorge serrée et, sous l’influence du trouble qui l’étreignait une sorte de sanglot vint mourir sur ses lèvres.