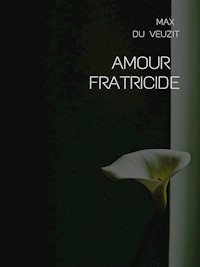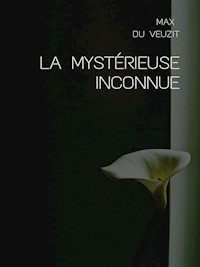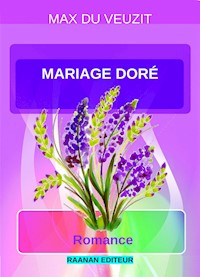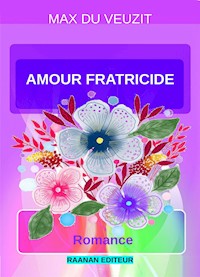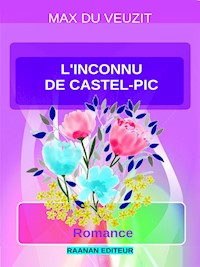1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Claude Frémonde, orpheline et milliardaire, ne souhaite plus être entourée de prétendants qui se révèlent tous être des « coureurs de dot ». Orgueilleuse et autoritaire, elle décide de contacter un simulacre de mariage, en achetant un mari qui acceptera de vivre comme elle le désire....|Librairie Jules Tallandier|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
SOMMAIRE
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
Notes
MAX DU VEUZIT
UN MARI DE PREMIER CHOIX
1934
Raanan Éditeur
Livre 1030 | édition 1
Un mari de premier choix
I
– Toc, toc !
Sans lever les yeux de dessus son tricot, Marie Jousserand, dame de compagnie en cette riche demeure, jeta de sa voix nette un Entrez retentissant.
Une jeune femme de chambre pénétra dans la pièce.
– C’est moi, mademoiselle, fit-elle, un peu intimidée.
– Ah ! te voilà, Céline ! Eh bien, es-tu contente d’être ici ? La place n’est pas trop fatigante, elle est bien rétribuée. Si tu sais être sérieuse et dévouée, te voilà tranquille sur le sort des tiens.
– Oh ! oui ! Et je fais des projets ; on dit que Mlle Frémonde est très bonne.
– Elle est exquise pour qui sait la comprendre.
– Et c’est pourquoi j’ai osé venir vous trouver, mademoiselle. Vous avez été très généreuse pour mes parents et grâce à vous je suis entrée ici. Je voudrais que vous n’ayez jamais à regretter ce que vous avez fait pour moi.
La dame regarda la jeune fille.
– Pourquoi serais-je mécontente de toi, Céline ? fit-elle avec bienveillance.
– Involontairement, je puis commettre des bévues ; je n’ai jamais travaillé chez les autres avant ce jour et j’ignore bien des choses.
– C’est juste ! tu es neuve dans tes fonctions de femme de chambre.
Elle désigna un tabouret à la jeune fille.
– Tiens, assois-toi là, petite. Nous avons tout le temps voulu pour causer, Mademoiselle ne rentrera pas avant une bonne heure.
Quand la soubrette eut pris place, à ses pieds, sur le siège bas qu’elle venait de lui désigner, la tricoteuse demanda en souriant :
– Dis-moi ce qui t’embarrasse ?
– Voilà ! fit la jeune fille, gravement, Mlle Frémonde commande très vite. On sent qu’il faut comprendre à moitié mot...
– Eh bien ! tu devineras ce qu’elle désire avant qu’elle ouvre la bouche. Le principal est de ne jamais répondre à ses observations.
– Ne jamais répondre ?
– Jamais !
– Même si Mademoiselle fait une remarque imméritée ?... Il y a des cas...
– Surtout quand elle a tort.
– Par exemple ! s’exclama la femme de chambre avec étonnement.
– Cela est indispensable et ne souffre aucune exception. Quand Mademoiselle n’a pas raison, elle s’en rend parfaitement compte, car elle est d’une intelligence remarquable ! Mais c’est justement dans ces moments-là qu’il faut dire comme elle, céder, ou se taire.
– Eh bien, en voilà une mentalité ! Elle ne sera pas heureuse dans la vie, la petite patronne, si elle ne supporte aucune contradiction.
La jeune fille hochait la tête avec un air de réprobation qui en disait long sur ses réflexions.
– Il faut se rendre compte de ce qu’est Mlle Frémonde, reprit la vieille dame avec fermeté. Son père était l’un des hommes les plus riches de France et il adorait sa fille. À onze ans, la fillette avait un budget personnel de mille francs par mois pour ses menus plaisirs. À quinze ans, la même somme lui était versée chaque semaine et l’adolescente trouvait que c’était maigre pour satisfaire tous ses caprices ou répandre ses libéralités. Car Mlle Frémonde est généreuse autant que prodigue. L’argent file entre ses doigts sans qu’elle veuille se rendre compte de la façon dont il s’en va.
Céline ouvrait maintenant de grands yeux étonnés.
– Tant d’argent ! fit-elle, éberluée. On ne peut pas s’imaginer ça : une femme qui dépense sans jamais compter !
Mlle Jousserand sourit.
– Pour qui connaît Claude Frémonde, cet éparpillement d’argent est secondaire. Elle est prodigieusement riche, il est tout naturel qu’elle sème ses revenus aux quatre vents. Ce qui l’est moins, c’est la façon dont cette fortune a réagi sur son caractère.
– Mademoiselle est originale, je parie ?
La tricoteuse hocha la tête.
– Elle est surtout indépendante et volontaire. Il ne lui vient pas à l’idée qu’il y ait pour elle des choses permises ou défendues. Son bon plaisir est la loi. Si elle ne fait pas de mal, c’est qu’elle n’en éprouve pas le besoin. Elle est foncièrement droite. Mais je suis sûre que si jamais elle était tentée d’accomplir quelque acte stupide, aucun conseil, ni aucune volonté humaine ne l’en détourneraient.
– C’est inconcevable !
– Ce qui a manqué à cette enfant, c’est une mère... Elle avait perdu la sienne alors qu’elle n’avait pas encore atteint ses onze ans et, depuis, aucune autorité n’a pesé sur sa juvénile volonté. Son père n’a pas permis à qui que ce soit de la contrarier ! Quand, après la mort de sa femme, il m’a appelée auprès d’elle pour être sa gouvernante, il m’a dit qu’il ne voulait pas que son enfant fût contrainte ou attristée. Par tous les moyens possibles, je devais la rendre heureuse et satisfaire tous ses désirs... Une larme d’elle et je perdrais ma place ! En revanche, tous ses sourires me vaudraient des gratifications...
La vieille dame s’arrêta pour soupirer.
– J’ai accepté ce programme, reprit-elle. La place était bien rétribuée et j’avais ma mère à qui mon gros salaire permettait bien des douceurs... J’espérais aussi pouvoir faire du bien à ce petit être qu’on flagornait si lamentablement.
– Et ça a marché ?
– Oui, je ne l’ai jamais contrariée, ce qui ne m’a pas empêchée de m’attacher à elle et de ne plus vouloir la quitter.
– Ce qu’elle a dû vous en faire voir !
– Non, pas trop : le fond était bon.
– Mais quand elle commettait quelque bêtise, comment faisiez-vous ? insista Céline.
– Eh bien ! je le lui faisais remarquer avec douceur, et son bon sens la rangeait souvent de mon avis.
– Tout de même, elle n’est pas mariée ! Ça prouve que son caractère...
Mais la gouvernante interrompit vivement la femme de chambre :
– Son caractère n’a jamais été discuté par personne. Si notre jeune patronne n’est pas mariée, c’est qu’elle n’a accepté aucun des prétendants qui ont essayé de l’attendrir !
Céline eut un sourire ambigu.
– C’est bien la première fois que j’entends dire qu’une femme ne veut pas se marier ! remarqua-t-elle, incrédule.
– Et pourquoi en aurait-elle le désir ? riposta Marie Jousserand avec feu. Depuis quatre ans que son père est mort, nous sommes allées d’un bout du monde à l’autre, côtoyant tous les milieux et toutes les races. C’est ça qui enlève quelques illusions ! Avec la fortune qu’elle possède, Mlle Claude a traîné à sa suite tous les soupirants possibles.
– Tant que ça ?
– Elle n’avait qu’à ouvrir les yeux pour voir autour d’elle vingt épouseurs guettant ses moindres gestes.
– Et aucun ne lui a plu ?
La gouvernante eut un geste vague.
– Pauvre gosse, dont on ne pèse que les gros sous ! fit-elle avec tristesse. Comment pourrait-elle croire à l’amour véritable ? Toutes ses amies riches, mariées avant elle, sont malheureuses. Il semble qu’un mari loyal n’existe pas pour une orpheline douée de fortune.
Célina approuva, toute songeuse :
– C’est difficile aussi pour un homme de ne pas se laisser griser par tant d’argent !
– Évidemment, les hommes sont excusables. Les femmes ont le même vertige devant les bijoux et les toilettes ! Aussi, ma petite Claude, qui est intelligente et juge sainement les choses, n’est pas du tout pressée de se mettre la corde au cou.
La jeune fille eut une moue significative.
– Elle restera vieille fille ! fit-elle d’un ton qui semblait prophétiser une catastrophe.
– Ce n’est pas toujours désagréable, remarqua doucement la vieille demoiselle. Je me trouve très heureuse, moi ! Et tant que Mlle Frémonde me sentira à ses côtés, elle a bien raison de rester libre et indépendante : c’est son meilleur temps !
– Évidemment, fit pensivement la soubrette. Quand une femme peut se payer tout ce qu’elle désire, un mari n’est pas précisément nécessaire.
À ce moment, il y eut des bruits de portes brusquement ouvertes dans l’appartement spacieux que Mlle Frémonde occupait avec sa suite, avenue du Bois-de-Boulogne.
La dame de compagnie fit signe à Céline de s’en aller.
– Voici Mademoiselle ; file vite à ton travail. Il est inutile qu’on te trouve inoccupée.
La servante avait à peine disparu que la porte du salon s’ouvrit et qu’une grande jeune fille, engoncée dans un ample manteau de zibeline, apparut.
– Comme il fait chaud ici quand on arrive du dehors !
Elle jetait son chapeau, ses gants, sur un fauteuil.
– Vous avez eu froid, au Bois ? interrogea Marie Jousserand.
– Non, pas trop ! J’ai fait une bonne promenade. Il y avait du givre aux arbres et le vent faisait rougir les nez ; mais combien la marche semble bonne par un temps pareil ! Vous avez eu tort, Jousserand, de ne pas m’accompagner.
– Je deviens frileuse en vieillissant, fit celle-ci d’un ton d’excuse. J’ai préféré travailler pour vos petits protégés ; vous voyez... ça avance !
Elle désignait son tricot, que Claude prit et examina.
– Ma brave Jousserand, vous nous gagnez le ciel avec vos aiguilles. Heureusement, vous êtes plus courageuse que moi. Je n’aime pas beaucoup la couture et les travaux manuels.
– Bah ! Quand vous aurez mon âge...
– Oui, je pratiquerai beaucoup moins le patinage et la marche, c’est certain, remarqua-t-elle avec bonne humeur. Quant à tricoter au coin du feu ? Hum ! Il faudra réellement que je change !
Elle se mit à rire à cette perspective.
Puis, sans transition :
– Rien de neuf, au courrier ?
– Rien !
– On est venu de chez Alice ?
– Votre robe est là-haut.
– J’attendais aussi un envoi de livres.
– Ils sont ici, également.
– Parfait. Vous avez téléphoné au Casino de Paris ?
– Oui. Vous avez l’avant-scène désirée.
– C’est très bien, nous serons à merveille pour voir Maurice Chevalier faire sa rentrée, après tant d’années d’absence. Il ne doit pas être très jeune, le beau Maurice !
Marie Jousserand sourit :
– Réellement, Claude, l’âge de Maurice Chevalier vous inquiète ?
– Cela m’est parfaitement égal, répondit la jeune fille avec conviction.
Puis, poussant un soupir :
– Mais ça ou autre chose. Quand on ne sait pas comment tuer le temps !
Et croisant les bras, debout devant la dame de compagnie :
– Ah ! Jousserand, comme le temps semble long quand on n’a pas de but et qu’on ne sait quoi faire !
– Voyageons.
– Les sports d’hiver ou la Riviera ! Merci bien, c’est toujours pareil.
– Allons ailleurs.
– Voyager ne me tente pas. Non, réellement, c’est encore à Paris qu’on est le mieux l’hiver. Paris ! mon beau Paris !
– Pourquoi vous y ennuyer, alors ?
– Ah ! oui, pourquoi ? fit-elle en retirant lentement son manteau.
Et, songeuse, les yeux dans le vague :
– Sait-on jamais pourquoi une jeune fille de vingt-trois ans, riche, libre et saine, s’embête parfois à mourir ?
– Voyons, Claude, que signifient ces pensées tristes depuis quelque temps ? Avez-vous un ennui, un chagrin ?
– Oh ! non, fit la jeune fille en haussant les épaules. Je n’ai aucun motif à exprimer. Seulement, voilà : j’ai l’impression de gâcher ma vie et de perdre follement mon temps... Quoi que je fasse : plaisir, travail ou promenade, il y a du vide en moi, avec la sensation du néant, de l’inutilité des choses... Ce n’est pas du tout amusant une impression comme celle-là.
Il faut réagir, mon petit... Peut-être qu’en pensant davantage encore aux humbles, aux déshérités, vous sentiriez-vous utile... Il faut si peu de chose pour être satisfaite de soi-même !
– Vous prêchez une convertie, Jousserand ! Vous savez bien que je donne beaucoup aux œuvres de charité...
– Si vous visitiez vous-même vos protégés ?
La jeune fille réprima un bâillement.
– J’ai essayé : je n’arrive pas à m’intéresser à leurs petits soucis. Quand les pauvres gens commencent à se plaindre, je n’ai qu’une idée : les couvrir d’argent pour qu’ils ne souffrent plus, et vite, filer très loin d’eux pour ne plus entendre leurs lamentations ou voir leur médiocrité. C’est effrayant, mais je crois que je n’ai plus de cœur.
– Ce serait dommage, ma brave Claude, fit en souriant la dame de compagnie, car, jusqu’ici, je n’y ai jamais fait appel sans qu’il se soit montré extrêmement compatissant.
– Oui, donner, donner toujours ! Je ne sais faire que cela ! Ce doit être pourtant bon de recevoir quelquefois.
Elle s’arrêta, songeuse, et poussa un soupir. Puis, tout à coup, secouant les épaules comme pour écarter un fardeau :
– Mais laissons cela, fit-elle. Combien voudraient être à ma place ! Et j’ose me plaindre d’être trop obstinément heureuse ! Ouf ! je retourne à mes livres, ce sont encore les meilleurs amis !
– Vous lisez trop, ça fait travailler votre imagination.
– Mais avec mes bouquins, pas de déception : les héros sont magnifiques, les princes Charmants sont tous loyaux et courageux. Quant aux jeunes filles, elles ont toujours du bonheur à revendre. Voyez-vous, Jousserand, c’est encore à travers un livre que la vie m’apparaît vraiment belle. Sur ce, au revoir, ma vieille amie ; je vous retrouverai, tout à l’heure, au dîner.
II
– Allons, Jousserand, réveillez-vous ! J’ai des choses très importantes à vous dire, ce matin !
La vieille demoiselle entrouvrit ses yeux clignotant sous la lumière crue du jour matinal.
– Quelle heure est-il donc, Claude, que vous soyez levée avant moi ?
– Il est huit heures, ma vieille amie.
– Ah bien ! huit heures !
Et, subitement, se dressant sur son lit :
– Mon Dieu ! quelle catastrophe y a-t-il pour que vous soyez sortie de votre lit d’aussi bon matin ?
– Aucune catastrophe, mais du bonheur, de l’espoir ! Ah ! ma bonne Jousserand, comme j’avais hâte de vous voir... de vous raconter ! Je ne m’ennuie plus ! J’ai un but ! La vie est belle !
– Qu’est-ce que vous me racontez là ?
– La vérité, Jousserand ! C’est passionnant, je vais vivre un roman.
– Hein ?
– Oui, je vais être l’héroïne d’une magnifique aventure ; je suis folle de bonheur.
La jeune fille arpentait nerveusement la chambre confortable de sa dame de compagnie, à grands pas impatients, avides de s’évader des limites trop étroites de cette pièce close. Les bras s’agitaient, ponctuant ses paroles. Tout son être bouillonnait sous une pensée intime qui, visiblement, la bouleversait.
Mlle Jousserand n’était pas évidemment au même diapason que sa délicieuse compagne, dont les formes harmonieuses apparaissaient sculpturales, sous le satin du pyjama.
Après avoir bâillé et s’être étirée béatement, elle dit, la voix pâteuse et sans aucun enthousiasme :
– Eh bien, Claude, quelle est cette si merveilleuse nouvelle que vous ne pouviez attendre pour me la communiquer ?
– Je vais me marier, Jousserand ! J’ai décidé de prendre un mari !
– Aïe ! fit la vieille fille. Je savais bien qu’une idée si impulsivement débordante ne pouvait tenir que du cauchemar.
– Comment, du cauchemar ! Ah ! çà, Jousserand, réveillez-vous ! Je vous dis que je me marie et que je vais vivre un vrai roman ; ce n’est pas une vision de vos rêves, je pense !
Mais Marie Jousserand ne voulait rien entendre.
– Je dormais si bien, Claude ! Et c’est pour me raconter une aussi stupide histoire que vous me tirez des bras de Morphée ?
– Par exemple ! s’écria la jeune fille avec impatience. Ne me comprenez-vous pas, chère vieille chose, comme dit mon ami Bonny ? À qui donc voulez-vous que je parle de mes espoirs et de mes projets, si ce n’est à vous, que mon père a placée auprès de moi justement pour me soutenir et m’encourager dans tous les actes graves de ma vie ?
Puis, tapant du pied d’un petit air rageur, elle remarqua sans aménité :
– Vraiment, je me demande à quoi vous êtes bonne si, aujourd’hui, vous ne pouvez m’entendre sans railler !
La dame de compagnie ne broncha pas sous ce déluge de reproches.
À demi tournée vers la tête de son lit, elle secouait douillettement son oreiller et le remontait sur le traversin.
Puis, y calant bien son buste, elle encouragea tranquillement Claude :
– Allez-y, mon petit. Je suis tout yeux et tout oreilles pour entendre votre rocambolesque histoire.
– Oh ! Jousserand ! Vous me feriez bondir avec vos adjectifs subversifs, si je ne savais combien, au fond, vous m’êtes dévouée ! Je vous dis que j’ai décidé de me marier !
– J’entends bien. Et je me demande quel est le malheureux mortel contre qui vous prenez cette décision ?
Claude eut un geste d’insouciance.
– Le mari importe peu...
– Hein ! Je croyais que c’était le point palpitant dans un projet de mariage.
Une moue dédaigneuse crispa les lèvres orgueilleuses de Claude.
– Un mari ! Ça se trouve comme de l’herbe entre les pavés. Vous savez bien, Jousserand, que je n’ai qu’à choisir.
– Justement. Jusqu’ici, aucun n’a trouvé grâce devant vous.
– Parce que tous affirmaient m’aimer, alors qu’ils n’en voulaient qu’à l’héritage de mon père.
– Et vous en avez trouvé un qu’on ne puisse suspecter de courir au même but ?
– Pas du tout ! Ce serait chercher une rose dans un buisson de chardons. J’ai eu trop de désillusions pour croire encore au désintéressement d’un prétendant.
– Allons, constata tranquillement la vieille fille, vous déraisonnez moins que votre entrée en matière ne le faisait craindre tout d’abord.
– Écoutez-moi, avant de vous réjouir ! protesta Claude avec un sourire mystérieux.
Et, sans illusion sur le sort que la vieille fille allait faire à ses déclarations, elle ajouta, malicieusement :
– Préparez vos cris d’orfraie, ma brave Jousserand : je n’épouse pas un petit monsieur qui parle d’amour pour mieux me rouler. Non ! Au contraire, j’épouse un mari que j’achète et sur les sentiments duquel je ne garde aucune illusion.
– Un mari qu’elle achète !
Marie Jousserand s’était dressée pour mieux dévisager sa compagne.
– Parfaitement, un mari qui soit ceci ou cela, qui fasse telle ou telle chose à ma convenance, non pas parce qu’il m’aime ou dise m’aimer, mais tout simplement parce que je le paie pour être ceci ou pour faire cela.
– Un mari qu’elle paie pour qu’il fasse ce qu’elle veut. Ô ma pauvre tête ! Ça existe, cela ?
– Je pense, fit Claude avec le plus grand sérieux, que si ça n’existe pas encore d’une manière générale, il suffira de le créer pour que ça devienne rapidement une généralité.
– Et c’est vous qui songez sérieusement à créer un précédent en une telle matière ?
– Voilà ! Oui, c’est moi ! acquiesça la jeune fille avec une belle désinvolture.
Et, s’asseyant sur le bord du lit, les jambes croisées et les mains aux genoux, elle expliqua très posément :
– Vous savez que depuis quelques mois je me plais à lire les auteurs étrangers en leur propre langue. C’est ainsi que je me suis jetée en affamée sur les livres espagnols. Et hier soir, notamment, j’ai lu un de ces ouvrages...
– Que vient faire ici la littérature espagnole ?
– Presque rien ; mais c’est en lisant ce roman pondu par le cerveau d’un Cervantès moderne, que l’idée d’acheter un mari m’est venue. J’en ai rêvé toute la nuit.
– Ce brave sujet de la république ibérique aurait bien pu s’abstenir de vous troubler la cervelle.
– Mais vous ne comprenez donc pas, Jousserand, que c’est une idée de génie que la lecture de ce livre m’a suggérée ! J’achète un mari, c’est-à-dire que je le choisis selon tel ou tel modèle que j’ai en tête. Je le paie pour que...
– Oui, oui, vous l’avez déjà dit. La difficulté sera de dénicher l’oiseau rare qui acceptera de faire vos quatre volontés.
Mais cela ne devait pas embarrasser la jeune fille.
– En y mettant le prix, affirma-t-elle avec une évidente sincérité, ce ne doit pas être impossible.
La dame de compagnie leva les bras au ciel. Et presque avec colère :
– J’espère, s’écria-t-elle, que la Providence vous sèmera tant d’embûches sur la route que vous ne rencontrerez jamais un homme assez vil pour accepter un tel marché.
Les remarques de la vieille fille commençaient à échauffer Claude, qui protesta avec vivacité :
– Vous pensez qu’un garçon qui vous dit : « Je l’aime » et pense : « J’empoche » est beaucoup plus propre que celui qui consent loyalement à remplir les termes d’un marché ?
Allez donc répondre à un tel argument !
La dame de compagnie se mit à considérer avec effarement l’orpheline, dont le visage grave et l’air décidé disaient la profonde conviction.
– Ma pauvre petite Claude, fit-elle en hochant la tête, je ne sais par quelles raisons combattre cette nouvelle excentricité qui vous passe par le cerveau. Vous devriez vous dire que le mariage est une chose trop sérieuse pour qu’on y mise sa vie sur une folle idée de roman.
– Le mariage est une bien triste chose, en l’état actuel de nos mœurs, remarqua amèrement la jeune fille.
– Mais c’est également le meilleur état pour la femme sérieuse.
– C’est pourquoi je songe sérieusement à me marier ; j’ai vingt-trois ans...
– Et les épouseurs ne manquent pas ! Parmi eux, il en est de bonne famille qui offrent de sérieuses qualités.
Claude se leva avec impatience.
– Les qualités de ces prétendants ressemblent à celles des différentes marques de sardines : moins elles sont fameuses, plus on les vante en larges placards de publicité. Merci des fiancés à l’huile rance, sous des noms pompeux. J’ai trouvé un moyen qui m’agrée et que je crois bon. Si je ne trouve pas le merle blanc par ma nouvelle façon de le chercher, il sera toujours temps de renoncer.
La vieille fille leva les yeux au ciel avec découragement.
– Que vous dire encore, ma pauvre enfant ? fit-elle, vraiment navrée, devant l’impuissance de ses conseils.
– Rien que des félicitations, ma vieille amie. Réjouissez-vous plutôt : je vais me marier avec un mari choisi par moi, donc à mon goût !
Mais l’autre n’était pas du tout convaincue.
– Réjouissons-nous, puisque la joie est à l’ordre du jour, répliqua-t-elle lugubrement.
Elle avait piteuse mine.
– Et alors, continua-t-elle à mi-voix, c’est par la voie des journaux... par une annonce que vous comptez... acheter ce mari ?
Claude éclata de rire et son rire frais et jeune dénotait une volonté éloignée de toute indécision.
– Oh ! Jousserand, que vous m’amusez ! Me voyez-vous porter une telle annonce à un journal et attendre le résultat à la poste restante ?
– Vous préférez répandre votre désir parmi vos prétendants ?
– Que vous avez donc une pauvre imagination ! remarqua gaiement la jeune fille.
Elle se leva et, debout devant la haute glace, à trois faces qui renvoyait indéfiniment son image, elle s’étira voluptueusement.
– Je vous quitte, ma petite Jousserand, pour aller de ce pas à « Select’Agence », qui est bien la plus sérieuse agence matrimoniale que nous ayons en France.
La vieille dame avait sursauté :
– Une agence ! Claude, c’est impossible ! Ma petite fille, ne vous embarquez pas dans une telle aventure !...
Mais le rire gamin de la jeune fille n’avait aucun égard pour les transes de la dame de compagnie.
– Soyez tranquille, amie Jousserand, je vous tiendrai au courant, puisque, si sincèrement, vous vous réjouissez avec moi.
Et mutine, avec un baiser envoyé du bout des doigts à la vieille fille affolée, la jeune millionnaire disparut.
III
« Select’Agence », à proximité de laquelle Claude Frémonde se fit conduire, était située dans une des rares rues calmes du quartier de l’Opéra.
Universellement connue depuis plusieurs dizaines d’années, cette agence matrimoniale avait une réputation sans égale pour amorcer, honnêtement et dans les formes légales, de nombreuses unions.
On citait la haute conscience de son directeur, sa probité qui faisait de lui un collaborateur précieux dans la réalisation des projets matrimoniaux qu’on lui confiait. Enfin, on affirmait que, grâce à un service complet de renseignements, la bonne foi des clients n’était jamais surprise et que les mariages négociés par les soins de « Select’ Agence » étaient généralement des unions bien assorties.
Depuis 1920, c’est-à-dire depuis une douzaine d’années, cette agence matrimoniale avait pris une extension considérable.
La médiocre qualité des mariages d’après guerre, la mauvaise foi des conjoints s’efforçant mutuellement de se duper, les grosses désillusions des moins de trente ans qui s’apercevaient de n’avoir pas été plus malins que leurs aînés ; le prix de la vie, qui, dans son ascension vertigineuse, changeait les ailes de l’amour en un perpétuel cauchemar de dépenses, des notes à acquitter et de reproches cuisants ; bref, l’horreur que chacun commençait à éprouver pour un fil à la patte de plus en plus décevant et lourd à porter, tout avait permis à « Select’ Agence » de se développer considérablement et de prendre une place importante et presque indispensable dans cette société moderne, égoïste, jouisseuse et, malgré tout, bon enfant.
Avec « Select’ Agence », il n’y avait pas de surprise.
On connaissait exactement l’âge de sa fiancée, l’état de son estomac et le casier judiciaire de sa famille. Les jeunes filles n’ignoraient plus le gain réel de leurs prétendants, leurs habitudes dépensières et apéritives, ainsi que leurs manières de rompre avec les femmes.
Et ce mutuel savoir permettait à chacun de se marier selon son goût ou son tempérament, sans crainte d’être déçu.
On savait où l’on allait, et, si le mariage se trouvait dénué d’un peu de poésie, du moins offrait-il toutes les garanties de sincérité et de confiance. Et cela d’autant plus qu’un examen attentif, par un docteur incorruptible attaché à « Select’ Agence », était imposé à tous les candidats au mariage et équivalait au certificat prénuptial réclamé en vain, à la Chambre, par le corps médical.
Tant de bonne réputation avait séduit Claude, et c’est sans aucune arrière-pensée, après avoir quitté sa voiture pour ne pas attirer sur sa démarche l’attention de son chauffeur, qu’elle gagna à pied les salons de « Select’ Agence », où la jeune fille demanda à parler au directeur lui-même.
Il y eut bien un peu de flottement avant qu’elle obtînt d’être mise en présence de cet important personnage qui ne recevait que sur rendez-vous et seulement dans les cas tout particulièrement intéressants.
Mais Claude Frémonde avait des arguments auxquels les gens résistaient rarement. Et surtout, elle était belle fille, portait une fourrure de prix et usait d’un petit ton de commandement auquel il semblait difficile de s’opposer.
Quand elle eut glissé un billet bleu dans la main du garçon de bureau, qui devint tout de suite obséquieux, elle fut certaine d’être introduite.
M. Michot était un homme d’une cinquantaine d’années, d’une élégance discrète et indiscutable et qui, par sa position même l’obligeant aux meilleures fréquentations, était un véritable homme du monde.
Avec lui, on était loin des directeurs d’agences matrimoniales d’autrefois.
Après avoir fait attendre la visiteuse, comme il convient, une douzaine de minutes, il la reçut avec la plus grande courtoisie.
Son œil, habitué à jauger les hommes et les femmes fréquentant son établissement, s’aperçut tout de suite de l’importance de la jeune visiteuse. Il comprit qu’il ne s’agissait pas d’une cliente ordinaire.
La jeune fille était trop jolie et trop élégante pour être réellement en quête d’un mari introuvable. La petite tête altière, aux lèvres dédaigneuses, malgré le sourire plein de franchise, devait avoir plutôt l’habitude de repousser les prétendants que le désir d’en saisir un coûte que coûte.
Et M. Michot mit, dans son ton, toute son affabilité pour rassurer la jeune inconnue et lui donner confiance.
Claude d’ailleurs éprouva, tout de suite, une grande confiance en l’homme qu’elle venait voir.
– J’ai insisté pour être reçue par vous, monsieur, car ce qui m’amène est tout à fait personnel et j’ai besoin de votre entière discrétion.
– Elle est acquise à tous les visiteurs, quels qu’ils soient, madame. Quand vous connaîtrez mieux « Select’ Agence », ses salons et son personnel, vous verrez que vous pouvez parler ici en toute confiance.
La voix de l’homme était calme, grave, reposante, et Claude en subit véritablement le charme apaisant.
– Je n’en désire pas moins n’avoir affaire qu’à vous, insista-t-elle avec son plus gracieux sourire.
Elle avait cru qu’à « Select’ Agence », elle n’aurait qu’à dicter ses conditions et à ouvrir largement sa bourse ; mais, dès le début, elle sentait que pour obtenir la collaboration efficace de l’important directeur, il convenait de faire cas de son autorité et de ses conseils.
– Je suis à votre disposition, madame, affirma-t-il. Si vous voulez bien m’exposer en détail vos désirs et vos prétentions, je m’efforcerai de vous donner complète satisfaction.
La jeune fille avait la tête si pleine de son sujet qu’elle n’éprouva aucune difficulté à soumettre ses désirs au directeur de « Select’ Agence ».
Elle voulait un mari qui fût ceci ou cela... Le physique lui importait peu, pourvu qu’il fût assez grand de taille et assez agréable de visage.
Mais, ce à quoi elle tenait par-dessus tout, c’était : l’éducation.
Elle voulait un mari qui fût de bonne compagnie, instruit, aimable, empressé et homme du monde d’une irréprochabilité morale et matérielle absolue.
Enfin, elle limitait à l’avance leurs rapports : son mari et elle devraient vivre en bons camarades, user vis-à-vis l’un de l’autre de la plus grande courtoisie, être, moralement unis par les mêmes goûts, les mêmes intérêts et une mutuelle confiance. Elle comptait sur son compagnon pour la défendre au besoin et la traiter en toute circonstance comme une amie très chère ; mais là s’arrêteraient leurs relations. Claude ne voulait pas subir l’emprise de l’homme... du moins tant qu’elle ne connaîtrait pas à fond son mari et ne serait pas absolument certaine d’en faire définitivement le compagnon de toute sa vie. Elle avait la prétention de demeurer maîtresse de son corps et de n’être point importunée par la galanterie ou les désirs d’un mari énamouré... Plus tard, peut-être ? Mais, de ce plus tard, elle tenait essentiellement à rester seule libre de décider.
Jusqu’ici, M. Michot avait écouté, en approuvant silencieusement de la tête, les divers désirs exprimés par sa jolie cliente : tous lui paraissaient réalisables.
À ces dernières prétentions, cependant, il fronça le sourcil.
– Je préfère vous dire tout de suite, mademoiselle, que cette dernière condition me paraît difficile à réaliser. Quel homme sensé, loyal et honorable, comme vous le désirez, accepterait cette clause ? De deux choses l’une : ou premièrement, il n’éprouvera pour vous que de l’indifférence et cherchera son plaisir en dehors de vous... et c’est vous, alors, qui vous plaindrez de sa froideur. Ou, secondement, il s’attachera à vous et désirera nouer des liens plus intimes avec vous.
Claude eut, instinctivement, une moue de dégoût qui fit sourire M. Michot.
– Mettez-vous durant quelques secondes, mademoiselle, à la place de ce mari possible. Évidemment, vous êtes assez jolie pour flatter la vanité d’un homme même difficile ; mais s’il ne doit pas tirer personnellement... disons un profit... de votre beauté, quel avantage comportera pour lui une telle union ?
– Ici, monsieur, permettez-moi de faire intervenir la question argent...
– Je vous écoute, mademoiselle.
– Je suis riche... très riche ! Or je ne désire pas que mon mari le soit...
M. Michot eut un sourire approbateur :
– Ceci est, en effet, un dédommagement sérieux !
– D’autant plus que l’homme que je choisirai sera assuré d’une vie large et agréable : les voyages, les distractions nombreuses, les grands hôtels, les costumes confortables, les autos de luxe. Bref, tout ce qui peut ouater et embellir l’existence.
– Je m’explique mieux vos exigences, mademoiselle.
Claude sourit, et très fière de pouvoir énoncer des chiffres, elle continua :
– Enfin, pour les besoins personnels de ce monsieur, je pense qu’en lui allouant une somme de douze mille francs par mois il trouvera dans cette union quelques sérieuses compensations au désagrément qu’un galant homme peut éprouver à n’être que le mari en titre de sa femme.
M. Michot ne répondit pas. Les chiffres de la jeune fille l’impressionnaient. Malgré tout, cependant, il réfléchissait aux singulières propositions de sa cliente, et, pesant le contre et le pour, il s’efforçait en homme de juger ce que répondrait un autre homme à un tel marché.
– Il est possible de vous satisfaire, mademoiselle, fit-il enfin, à la condition que vous le vouliez personnellement.
– Comment cela ?
– En acceptant de fermer les yeux, plus tard, sur les discrètes escapades que sera amené à faire votre compagnon.
Une rougeur empourpra le visage de Claude. Et tout de suite, intransigeante comme le sont généralement les femmes quand elles ne bénéficient pas des infidélités de l’homme :
– Mais je ne veux pas que mon mari soit un coureur, ni qu’il se permette la moindre escapade ! Je tiens essentiellement à avoir un compagnon de tout repos, qui ne s’occupe que de moi et ne fréquente aucune autre femme.
M. Michot hochait la tête et, amusé au fond des prétentions de Claude, il s’efforçait en apparence de l’approuver entièrement :
– Oui, oui, je vois... je vois !
En réalité, sa grande expérience de la vie lui disait de ne pas s’effrayer de cette exigence féminine. Depuis toujours, les femmes ont réclamé la fidélité complète de leurs compagnons...
Aimé ou non, époux réel ou époux fictif, le mari qu’épouserait cette belle jeune fille serait exactement du même bois que tous les autres épouseurs, surtout avec de pareilles conditions à la clef...
« Le principal, se dit-il, est de lui dénicher un mari bien élevé et correct. Avec un galant homme, les choses s’arrangent toujours admirablement ! »
Et, contemplant la jeune tête orgueilleuse qui posait ses anormales conditions avec tant de décision, un sourire indulgent flotta sur les lèvres du grave directeur et il la rassura avec son habituelle autorité :
– Je crois pouvoir vous affirmer que je trouverai le mari que vous désirez. Dans quelques jours, je vous ferai connaître mes premiers résultats. En attendant, pour faciliter mes recherches et vous assurer un fiancé selon vos goûts, voulez-vous remplir une de nos fiches ?
Il tendit à la jeune fille un imprimé semé de nombreux blancs. C’était un véritable questionnaire que Claude examina avec surprise et hostilité.
– Comment ! il me faut fournir tous ces renseignements ? protesta-t-elle.
– L’homme susceptible de vous convenir peut désirer aussi quelques détails sur la femme qu’on lui propose.
– Évidemment, mais...
– Remarquez, insista M. Michot, que plus nous choisirons un homme de caractère élevé, plus il sera lui-même difficile. Avant qu’il s’engage, il faudra lui exposer la situation et répondre à toutes ses questions.
– C’est juste, reconnut la visiteuse. Mais, dans tout cela, que faites-vous de la discrétion que je réclame ?
– Cette fiche est confidentielle, mademoiselle. Une partie seulement en est relevée et soumise aux prétendants éventuels. Certains points, tels votre nom, votre adresse et ce qu’il y a de particulier dans votre signalement, ne sont jamais communiqués. Au surplus, si vous désirez ne pas vous faire connaître, même à nous, il vous suffira de mettre un chiffre ou des initiales en place de votre état civil. Pour la régularité de nos écritures et comme garantie, vous en serez quitte pour verser à notre caisse une provision couvrant à l’avance les frais de recherches.
« Nos clients sont absolument libres de découvrir ou non leur personnalité. Une seule chose est exigée d’eux, et cela sous peine de radiation, c’est l’exactitude des renseignements qu’ils nous fournissent. À eux de ne pas répondre si la question les embarrasse, mais à nous de prendre nos précautions contre toute erreur volontaire. Quand celle-ci est prouvée, nous cessons immédiatement de nous occuper de ces mauvais clients et l’avance d’argent qu’ils nous ont versée est acquise à la maison, pour compenser le tort qu’ils auraient pu nous causer.
– Et vous avez raison, après tout, répondit Claude, rassurée par un pareil programme, sinon chacun s’efforcerait de se faire passer pour un merle blanc.
Claude prit une plume et, bravement, elle remplit les blancs du long questionnaire.
Cependant, quand elle arriva aux indications à fournir sur les qualités physiques du fiancé qu’elle souhaitait rencontrer, elle resta le porte-plume en suspens.
– Quelque chose vous embarrasse ? interrogea M. Michot, qui ne la perdait pas de vue.
– Oui, avoua-t-elle. Je ne préfère pas une silhouette masculine à une autre. J’ai eu, à mes pieds, tous les prétendants possibles et aucun ne m’a convenu véritablement. Instinctivement, je souhaite que mon mari soit plus grand que moi et qu’il ait un visage sympathique. Mais la forme de ce visage, la couleur des yeux ou des cheveux m’importent peu... pourvu qu’il ait les qualités morales que je lui souhaite et qu’il soit un véritable cavalier servant.
– On essaiera de vous satisfaire, répéta M. Michot, qui voyait poindre avec satisfaction un beau bénéfice pour son agence.
Mais, comme si la télépathie lui faisait deviner la pensée de son interlocuteur, Claude cessa d’écrire et releva la tête.
– Je voudrais aussi vous dire, monsieur, expliqua-t-elle d’une voix suave, mais nette, que ma fortune ne concernera mon mari en aucune manière ; toutes les dispositions seront prises à ce sujet par mon notaire. En dehors des honoraires que je vous verserai, vous n’aurez rien à attendre de celui que je choisirai ; de même que je romprais immédiatement une union qui ne répondrait pas à mes desiderata. En revanche, comme il est juste que chacun soit récompensé selon ses mérites, j’estime que si vous êtes l’artisan de mon bonheur, je vous devrai un beau remerciement. Et la forme de celui-ci serait celle d’un billet de mille francs qu’on vous verserait tous les mois !
– Tous les mois ! fit le directeur en tressaillant, malgré son habituelle maîtrise.
– Oui, tant que durera ce mariage... et jusqu’à la fin de mon existence, s’il n’est pas rompu.
M. Michot admira en son for intérieur les précautions prises contre lui en cette affaire. Mais, comme ces précautions elles-mêmes lui étaient favorables, il ne put que féliciter la jeune femme qui se révélait si habile en pareille matière. D’un seul coup, Claude lui était apparue une femme supérieure avec laquelle il fallait compter et qu’il était utile de ne pas chercher à rouler.
Quand ils se séparèrent, ils se serrèrent fortement la main : chacun d’eux était content de l’autre.
Le directeur de « Select’ Agence » se sentait rempli de zèle pour sa généreuse cliente, et Claude voyait avec satisfaction que la réalisation de son extravagant projet était possible.
« Vivat pour l’auteur espagnol qui m’a mis en tête un si joli roman ! s’écria-t-elle gaiement lorsqu’elle eut repris place en son auto. À nous deux, messieurs les épouseurs ! Pour une fois, c’est une femme qui parlera la première et posera ses conditions ! Il y a assez longtemps que les jeunes filles sont forcées de choisir leurs maris dans le lot restreint des hommes qui les remarquent ; si bien que certaines d’entre elles en sont réduites à prendre le premier qui se présente, de crainte de rater l’occasion ! »
Et, sans se rendre compte qu’elle affichait, en parlant ainsi, des sentiments singulièrement subversifs pour la tranquillité de son futur mari, elle se mit à chantonner joyeusement, pendant que sa voiture la ramenait chez elle.
IV
Le repas tirait à sa fin et, dans ce dîner d’hommes, la plus franche gaieté régnait.
L’amphitryon, Simon Wass, le banquier si connu, avait d’ailleurs, comme de coutume, fait bien les choses.
Quoique marié et père de trois beaux enfants, Simon Wass avait pris l’habitude de réunir tous les mois, en un dîner où l’élément masculin était seul représenté, un certain nombre de ses amis ou connaissances qu’il s’efforçait de varier chaque fois, avec le désir intime d’entretenir ses relations, d’en nouer de nouvelles ou d’amorcer quelques naissantes affaires.
Ce soir-là, les mets fins avaient succédé aux entrées délicates, et les vins généreux aux apéritifs de marque.
À cette minute où les cigares commençaient à laisser poindre leurs bouts rouges, des liqueurs de toutes couleurs irisaient les verres et les flacons. Et les convives, une béatitude aux lèvres, une animation aux yeux, l’estomac satisfait et le palais flatté, se laissaient aller aux propos un peu gras ou aux demi-confidences, selon leur tempérament.
Avec le maître de maison qui l’entretenait amicalement, M. Michot, un des heureux convives de cette réunion, laissait percer à la fois, et sa satisfaction et le souci de ses affaires :
– « Select’ Agence » recrute des clients dans tous les milieux, affirmait-il. Quand j’ai commencé à prendre de l’extension, il y a quelque douze ans, c’est-à-dire vers 1920, je n’avais alors qu’une clientèle d’employés et de petits rentiers qui, faute de relations, ne pouvaient arriver à trouver le compagnon ou la compagne de leur choix.
« Aujourd’hui, il n’en est plus de même. Le jeune homme moderne, en général, a plus de besoins que ses aînés. Il veut que sa femme réponde à certaines de ses exigences, qu’elle ait telles aptitudes, telle fortune, telle éducation. Et quand il est convaincu que celles qu’on lui présente sont comme il en souhaite une, alors seulement, il laisse poindre le sentiment et choisit parmi plusieurs concurrentes celle qui lui plaît le mieux.
– Il est évident, reconnut Simon Wass, que nos pères se mariaient avant tout par amour.
– À moins que ce ne fût tout simplement pour le chiffre d’une grosse dot, remarqua un voisin.
– L’une et l’autre de ces façons étaient également mauvaises, reprit le directeur de « Select’ Agence ». Dans le premier cas, l’homme sincère épousait, les yeux aveuglés par l’amour, une femme qui souvent était indigne de lui ; dans le second, il sacrifiait toutes les possibilités de bonheur en mariage à la seule satisfaction de posséder un joli magot. Dans les deux cas, il faisait son propre malheur et celui de la femme qui se confiait à lui. Avec la conception moderne du mariage, nos jeunes gens étudient les caractères, les goûts, ils soupèsent les valeurs, les qualités ; c’est beaucoup moins aléatoire. Je vous assure que, personnellement, j’estime que, depuis deux ou trois ans, mettons depuis 1930, le niveau du mariage tend à remonter.