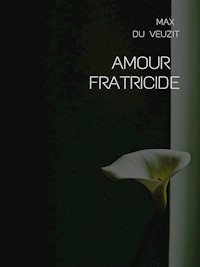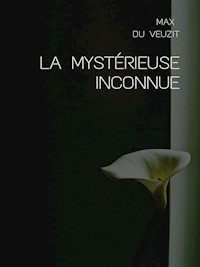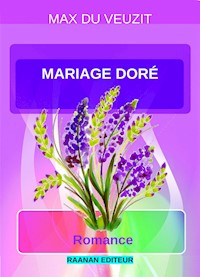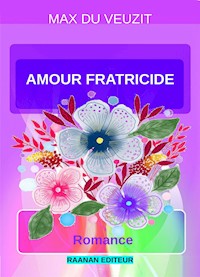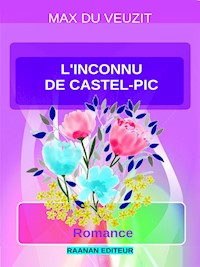0,85 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Je n’ai pas toujours été la vieille femme aux cheveux blancs et aux joues parcheminées que je suis aujourd’hui.
Autrefois – il y a de ça cinquante ans – j’étais une fillette de dix-sept ans aux lèvres rouges et aux yeux noirs.
Était-je jolie ?... On me le disait souvent, et je le croyais facilement, sans l’avouer pourtant, car ma mère ne me permettait pas d’écouter les nombreux galants qui papillonnaient autour de moi.
Elle veillait sur moi comme un dragon gardant son trésor ; et, d’ailleurs, j’en étais un pour elle, puisque, n’ayant que moi d’enfant, toutes ses ambitions se trouvaient concentrées sur mon jeune front.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Max du Veuzit
La Jeannette
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782383837817
Prologue
À la terrasse d’un restaurant champêtre situé à la sortie d’Auffay – bourg de la Seine-Maritime traversé par la grande route de Dieppe à Rouen – un groupe de cinq jeunes gens finissait de déjeuner.
Quatre d’entre eux étaient des étudiants venus dans leur famille pour y passer les vacances de Pâques : le cinquième, Victor Leblanche, était fils d’un gros industriel de la contrée.
Ce dernier n’était pas le moins gai de tous, à en juger par les éclats de rire dont il accueillait les saillies de ses compagnons.
La bande joyeuse était dans cet état de demi-ivresse, alors qu’il reste encore assez de raison pour comprendre ce que l’on fait et pas assez, pourtant, pour s’empêcher de faire et dire des bêtises.
– Je vous le dis en vérité, s’écria Victor Leblanche en brandissant un flacon de cognac à moitié vide : il y en a, dans cette bouteille, beaucoup plus qu’il n’en restera tantôt.
– Quand tu auras fini de débiter des sottises, répondit un des jeunes gens.
– Des sottises ! Où donc en vois-tu dans mes paroles ?... Toi-même, ne vas-tu pas m’aider à soulager de son contenu ce grossier récipient, dont les flancs rebondis sont pleins d’un délicieux breuvage appelé « fine Champagne » !
– Bravo ! Continue, tu deviens savant dans tes phrases !
– Non. Je ne continuerai pas, répondit nonchalamment le jeune homme en remuant son café. Causons sérieusement plutôt.
– Camarades, vous avez entendu votre ami ? Il se vante de pouvoir parler sérieusement.
Un sourire circula sur les lèvres de chacun.
– Vous me raillez, Paul Lamé ? Eh bien ! écoutez : qu’allons nous faire ce soir ?... Est-ce sérieux, cela ?
– Hélas, oui ! Ça commence à être assommant, les soirées à la campagne.
– Ne trouverons-nous rien d’aussi inédit que nos occupations des soirs précédents ? Voyons, Louis, en ta qualité de poète, n’auras-tu pas une idée géniale pour nous tirer d’embarras ?
– Je cherche en vain, répondit l’interpellé ; nous avons épuisé tous les plaisirs délectables : lundi, nous fîmes le plus délicieux concert qu’on puisse rêver – avec des chaudrons et des vieilles casseroles ; cette nuit, nous attachâmes des chats aux sonnettes des paisibles bourgeois endormis. Que faire à présent, après d’aussi belles choses ?
– Nous pourrions accrocher des chiens à la place des chats.
– Merci bien ! Autant pêcher des grenouilles au clair de la lune, que de recommencer quelque chose déjà fait !
Ils se turent un moment, chacun cherchant, à part soi, une inspiration qui ne venait pas.
– Messieurs ! Voyez donc, s’écria tout à coup, avec emphase, un des jeunes gens. Quel est cet être encapuchonné qui s’avance là-bas, suant, soufflant, étant rendu ?
– La « Jeannette », dit l’un.
– De son vrai nom : Suzanne Dorbat, veuve Latour, rectifia Victor Leblanche.
– Tiens ! Et d’où lui vient ce surnom de la « Jeannette » ?
– Ignorance complète ! Mon père, depuis cinquante ans, le lui a toujours entendu donner.
– Parfait ! dit sentencieusement Paul Lamé. Réclamons-lui des explications, en vertu de cette loi que nul n’a le droit de porter un nom qui ne lui appartient pas.
– Quel code et quel article ? demanda finement celui que ses amis avaient surnommé « Louis le poète ».
Paul Lamé haussa les épaules.
– Il suffit, mon cher, que j’aie édicté cette clause pour qu’elle fasse loi aujourd’hui. Par conséquent, formons la chaîne.
– Ça y est ! s’écria en chœur la bande joyeuse en se levant vivement.
– Pas de sottises ! dit gravement Victor Leblanche en essayant de les retenir, Madame Latour est une excellente personne, qui a beaucoup de piété ; je la connais depuis mon enfance, mes parents l’estiment et je serais désolé que nous lui manquions d’égards.
– Nous prenons bonne note de ta protestation ; mais, en attendant, ne fais pas bande à part.
Le jeune homme suivit ses amis.
À ce moment, celle dont il était question n’était séparée du groupe que de quelques mètres. En un instant, les cinq jeunes gens, se tenant par la main, l’eurent entourée.
– Au nom de tous les étudiants en vacances, dont nous sommes les représentants, nous vous sommons de vous arrêter, Madame Jeannette.
– Polissons ! dit la vieille dame sans se fâcher, tout en essayant de franchir le cercle de ses poursuivants.
– Prenez garde ! reprit Paul Lamé avec un sérieux affecté. N’aggravez pas votre cas en essayant de résister, ou votre rançon sera plus forte !
– Laissez-moi aller, enfants ; je vous servirai, quand vous voudrez venir chez moi, une excellente collation.
– Il nous faut mieux que ça !
– Un biberon de lait avant de vous coucher ? continua avec une railleuse indulgence la petite vieille.
– Horreur ! s’écrièrent-ils en chœur.
– Que vous faut-il donc, jeunes fous ?
Un des étudiants en rupture de cours répondit, en élevant la voix pour donner à ses paroles le ton d’une proclamation :
– Nous demandons à la citoyenne ici présente, pourquoi, elle, Suzanne Dorbat, veuve Latour, est appelée généralement la « Jeannette » ? Elle est prévenue que si elle refuse de répondre, une escorte d’honneur lui sera faite jusqu’à son logis par cinq des nôtres, c’est-à-dire par nous tous.
La vieille dame regarda à terre. Un nuage de tristesse avait passé sur son visage à la question du jeune homme.
« Louis le poète » s’en aperçut, et comme ami des muses, il se montra sensible. Quittant la main de ses compagnons, il fit place à la prisonnière.
– Passez, madame Latour ; nous venons de vous faire de la peine sans le vouloir.
– Non, mes amis ; les événements que votre question a fait passer devant mes yeux sont toujours présents à mon cœur. En y faisant allusion, vous ne pouviez m’attrister. Seulement, ce que vous me demandez est toute une histoire et je ne puis vous la raconter, là, au beau milieu du chemin. Venez ce soir, chez moi, passer la soirée, et je vous promets de ne pas vous ennuyer.
– Bravo ! un petit ban en l’honneur de notre future hôtesse !
La bande joyeuse se mit à taper des mains avec ardeur, et la petite vieille reprit sa marche lente, un sourire mélancolique aux lèvres.
Le soir venu, nos amis se dirigèrent allègrement vers Saint-Denis. Tout en marchant, pour égayer la route, ils jouaient les airs les plus discordants sur un « mirliton » dont chacun d’eux s’était muni.
Après une demi-heure de marche, ils arrivèrent devant une assez grande maison, qu’entourait un vaste jardin. À travers les volets mal clos, un peu de lumière filtrait.
– C’est ici, dit Victor Leblanche : on nous attend.
Ils pénétrèrent dans l’enclos et se rangèrent autour du seuil en continuant d’exécuter, sur leurs instruments criards, un air populaire de l’époque.
Les aboiements d’un chien de garde s’y étant mêlés, ce fut, pendant quelques minutes, le plus infernal charivari que ce coin paisible eût entendu depuis longtemps.
Bientôt, à leur vacarme, la porte s’ouvrit, et la propriétaire du logis apparut dans l’entrebâillement.
– Jeunes insensés, qui, le sourire aux lèvres, venez entendre l’histoire dramatique de toute une existence de pleurs ! À quoi bon vous arrêtez ici ? Reprenez le chemin d’Auffay, la tristesse n’est pas faite pour vous.
En un clin d’œil, les mirlitons eurent disparu dans les poches de nos amis.
– Chose promise, chose due, Madame Latour ! Vous nous avez annoncé une histoire et un café ; vous devez nous les servir.
Elle s’effaça pour les laisser entrer.
Après les avoir installés autour d’une large table sur laquelle six tasses remplies d’excellent café, furent bientôt posées – elle commença, d’une voix que l’âge rendait tremblante, l’histoire suivante :
I
Le récit de la vieille hôtesse
Je n’ai pas toujours été la vieille femme aux cheveux blancs et aux joues parcheminées que je suis aujourd’hui.
Autrefois – il y a de ça cinquante ans – j’étais une fillette de dix-sept ans aux lèvres rouges et aux yeux noirs.
Était-je jolie ?... On me le disait souvent, et je le croyais facilement, sans l’avouer pourtant, car ma mère ne me permettait pas d’écouter les nombreux galants qui papillonnaient autour de moi.
Elle veillait sur moi comme un dragon gardant son trésor ; et, d’ailleurs, j’en étais un pour elle, puisque, n’ayant que moi d’enfant, toutes ses ambitions se trouvaient concentrées sur mon jeune front.
Ma mère était une de ces femmes – nombreuses dans les campagnes – qui, ayant peiné de longues années pour amasser, sou par sou, une petite aisance, connaissent la valeur de l’argent ; et si, dans sa vie de labeur, elle avait été âpre au gain, elle resta, par la suite, économe et avaricieuse même.
Néanmoins, par orgueil, pour faire de moi une « demoiselle » et pour rendre jalouses quelques anciennes compagnes qui avaient moins bien réussi qu’elle-même, ma mère m’avait envoyée trois ans en pension.
Pendant ce temps, elle hérita d’un vieil oncle, qui lui laissait, en mourant, tout son avoir, et quand je revins à la maison, j’y trouvai tout bouleversé.
Les modestes meubles de bois blanc et de chêne, qui, jusque-là, avaient orné la cuisine et les chambres, avaient disparu et étaient remplacés par d’autres en acajou ; des cuivres étincelants détrônaient les modestes marmites de fonte, et les cristaux, derrière les vitres du buffet, avaient succédé aux verres grossiers de jadis.
Je fus enchantée des changements apportés. On le serait à moins quand on a dix-sept ans !
Cependant, au bout de quelques jours de vie intime avec ma mère, beaucoup de mes illusions s’en étaient allées.
Je m’étais figurée que, puisque nous étions riches – relativement à notre position d’antan – ma mère serait moins raide dans les rapports journaliers et qu’elle perdrait un peu de sa parcimonie.
Il n’en était rien, hélas !
Toute la journée, je l’entendais crier après l’une ou l’autre des deux servantes qu’elle occupait, et souvent le motif de ses plaintes reposait sur une allumette ratée, une bougie trop usée, ou une salade dans laquelle elles avaient ménagé les feuilles vertes.
Pour ma part, je n’avais pas à me plaindre ; ma mère ne me refusait rien, si ce n’est une piécette blanche dans ma poche ou un moment de liberté : – elle comptait ceux-ci encore plus minutieusement que les grains de sel de la soupe ! – J’étais toujours mise avec coquetterie, et son ambition était satisfaite quand, sur notre passage, le dimanche, en allant aux offices, elle entendait dire :
– Hein ! Est-elle « chouette », la petite Dorbat ! Ce qu’elle en a de beaux atours !
À ce moment, je me demandais pourquoi ma mère, qui se privait de tout, – depuis plus de dix ans, elle portait la même robe, – était si généreuse pour moi.
Je le compris par la suite ; elle espérait qu’un beau mariage couronnerait son œuvre, tout en la débarrassant du mal que lui causait l’excessive surveillance dont elle m’entourait. Je n’étais pourtant pas bien difficile à garder.
D’un caractère un peu renfermé, je faisais tranquillement l’ouvrage qu’on m’assignait comme tâche, et, quand j’avais fini, sans bruit, je gagnais ma chambre pour me plonger dans la lecture de quelque livre de prix.
Un dimanche matin, nous allions à la messe et marchions précipitamment, car nous étions en retard.
Tout en allongeant le pas aux côtés de ma mère, j’enfilais mes gants et j’en perdis un, sans m’en apercevoir de suite.
Je ne l’aurais probablement pas retrouvé, et cela m’aurait valu, plus probablement encore, une verte semonce, si un jeune homme, qui, lui aussi, se rendait à l’office, ne l’eût trouvé.
Jugeant peut-être, à la dimension de l’objet, qu’il ne pouvait appartenir qu’à une jeune personne, et que, parmi les jeunes filles du pays, il n’y avait que « mademoiselle Dorbat » qui portât des gants de peau, il se mit à ma recherche.
Nous arrivions près de l’église lorsqu’il nous rejoignit.
J’avais déjà constaté, avec terreur, la perte de mon gant, et je n’osais pas en parler à ma mère, quand une voix me fit détourner :
– Mademoiselle, me disait un inconnu, je viens de trouver ce gant sur le chemin, ne serait-il pas à vous ?
– Oui, monsieur, m’écriai-je avec un soupir de soulagement, pendant que mes yeux se levaient sur lui, tout brillants de gratitude.
– Comment ! s’écria ma mère, tu perds ton gant et tu ne t’en aperçois pas ! Conçoit-on pareille négligence ! Je suis sûre qu’il y a déjà longtemps que tu ne l’as plus, et tu n’en prenais pas souci... Où l’avez-vous trouvé ? ajouta-t-elle, en s’adressant au complaisant monsieur qui m’examinait avec intérêt.
– À quelques pas d’ici, répondit-il avec un imperceptible sourire aux coins des lèvres.
Je lui adressai un nouveau regard de remerciement en même temps que d’admiration, car il y avait bien un quart d’heure que l’objet du délit avait disparu, et ses enjambées avaient dû lui être joliment grandes pour pouvoir les traiter de « quelques pas ».
À mon regard de merci, il répondit par un autre d’admiration, – quoique je fusse jeune, je ne m’y trompai pas. Je rougis comme un coquelicot et rejoignis ma mère qui, déjà, murmurait contre le temps que nous venions de perdre.
Mon attention, durant l’office, fut un peu diminuée par le souvenir de mon ami inconnu, comme déjà je l’appelais.
Après avoir suivi la première partie de la messe sur les prières des vêpres et pris à l’évangile l’« avent » pour le « carême » je fus heureuse d’en voir arriver la fin.
En sortant, je revis, près du bénitier, celui qui m’avait causé tant de distraction.
Il plongea ses doigts dans l’eau bénite et me les tendit ; nouveaux regards, nouvelle rougeur de ma part, et, cette fois-ci, en plus, un petit « toc » dans ma poitrine.
Quand nous fûmes dans la rue, ma mère, naturellement, revint sur l’incident, et me fit subir une mercuriale en règle.
Je la supportai avec une muette soumission, et cela d’autant plus que je savais qu’en ne m’excusant pas, j’avais des chances qu’elle fût écourtée.
En effet, une demi-heure après, ma mère n’en parlait plus. Ensuite, malgré mon désir de savoir qui était mon inconnu de la matinée, je n’osais pas l’interroger.
Je préférais m’adresser à Zélie, une de nos servantes, et, dès que l’occasion s’offrit à moi de la questionner, je la saisis aux cheveux – pas la servante, non... l’occasion !
– Dis donc, Zélie, connais-tu dans le pays un jeune homme très aimable et très gentil ?
– C’est un peu vague comme renseignements. Tous les jeunes gens d’ici sont très aimables et très gentils.
J’ouvris des yeux étonnés : la plupart des garçons que je rencontrais me paraissaient vilains, avec leur mise de paysans et leurs visages bronzés par le soleil ; mais comme Zélie avait vingt-cinq ans, elle devait mieux savoir que moi, et je lui fis un portrait détaillé de mon inconnu.
– Un jeune homme pas très grand, qui a des yeux noirs, des mains très blanches et très petites ; il a l’air très doux.
– Il est brun ?
– Oui.
– Avec une petite moustache plus claire ?
– Oui.
– Ça pourrait bien être le fils à monsieur Ménard.
– Le fils de l’ancien instituteur qui m’a appris à lire ?
– Je crois que oui.
– Ah ! j’ignorais que son fils habitât encore le pays... et que fait-il ici ?
– Son père est mort il y a deux ans et lui a pris une petite ferme qu’il a montée et agencée avec toutes sortes de choses, comme dans les livres. On dit même qu’il eût fait bien mieux de travailler la terre à la façon de tout le monde : les innovations ruinent généralement leurs partisans.
Je laissai Zélie retourner à la maison, et, m’étant assise sous une tonnelle de chèvrefeuille, je me mis à réfléchir à ce qu’elle venait de me dire.
À ce moment, ma mère passa près de là, et m’aperçut.
– Toujours à ne rien faire, Suzanne ; même le dimanche, on ne doit pas être inoccupée !... Accompagne Zélie qui va faire une commission au château.
Je ne me le fis pas dire deux fois, et mettant rapidement un chapeau, je suivis la fille.
Tout en marchant, je lui parlai de mon aventure du matin. Depuis quelques heures, je ne pensais qu’à ça.
Soudain, au détour d’un chemin, je revis celui qui en avait été le héros.
Zélie éclata de rire.
– Eh bien, Suzanne ; le voilà, monsieur Ménard !
– Oui, fis-je à mi-voix. Ne crie donc pas si haut ! S’il entendait !...
Mais la servante, une fois partie, était difficile à arrêter.
– Bonjour, monsieur Jean, lui cria-t-elle, que faites-vous donc si près de la Roseraie ? (La Roseraie était le nom de notre maison.) Nous y avons une gentille colombe, continua-t-elle en me désignant de l’œil ! Malheureusement, dame Dorbat la tient cachée par crainte des audacieux.
Ma mère n’avait pas besoin d’être là pour me tenir cachée. Dès les premiers mots de Zélie, je m’étais dissimulée derrière elle. Ce que voyant, elle reprit avec une audace incroyable.
– Bon, voilà que Suzanne a peur de vous, à présent, et quand vous n’êtes pas là, elle ne cesse de parler de vous !
Je pris mon courage à deux mains et, me montrant enfin, je protestai contre ces paroles :
– Il ne faut pas la croire, monsieur, Zélie aime à taquiner les gens.
– Au contraire, mademoiselle, répondit Jean Ménard avec un long regard à mon adresse, je serais trop heureux si vraiment vous daigniez vous occuper de moi.
Je baissai les yeux, à nouveau intimidée.
– Nous allons au château, monsieur Jean ; nous accompagnerez-vous ? demanda Zélie.
– Volontiers, dit celui-ci.
Je m’arrêtai.
– Non, Zélie ; maman serait en colère si elle savait que nous étions en compagnie.
– Bah ! elle ne le saura pas ; ce n’est pas moi qui irai le lui dire. Venez-vous, monsieur Jean ?
Une ombre avait passé sur le visage de Jean Ménard.
– Non, répondit-il. Il suffit que mademoiselle Dorbat ait manifesté le désir que je ne l’accompagne point pour que je prenne ce désir comme un ordre.
– Merci, lui dis-je doucement ; cela vaut mieux ainsi.