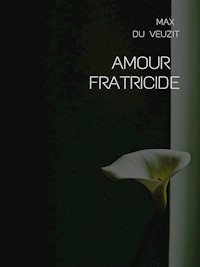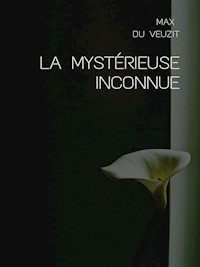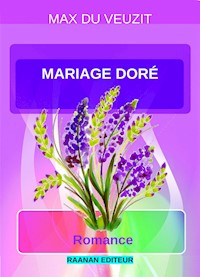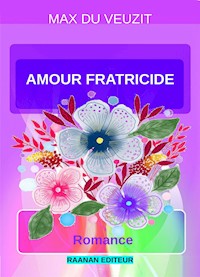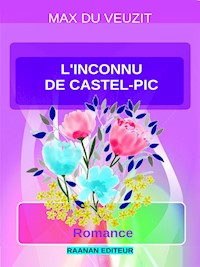
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
"Un précepteur auprès de moi, à Castel-Pic, ce manoir isolé de Dylvanie où nous vivons en sauvages, quel bouleversement !" A dix-huit ans, on rêve d'une autre compagnie que celle d'une grand-mère autoritaire. Le cœur battant, Diane de Kermoc attend l'inconnu. Il arrive. Il la regarde avec dédain. Elle ne songe plus qu'à lui... Qui est-il, cet étrange et trop séduisant précepteur? Malgré ses grands airs, il semble se cacher. Est-ce un terroriste, un proscrit? Le pays traverse une période troublée... Diane est trop curieuse. On l'éloigne. On l'envoie à Paris où son innocente beauté fait des ravages. Un jour, dans un salon, elle aperçoit avec stupeur une miniature encadrée de saphirs qui représente... son précepteur ! Décidée à percer le mystère, la jeune fille retourne à Castel-Pic Celui qu'elle aime a fui, emportant son secret. Pour Diane, une fiévreuse attente commence...|Librairie Jules Tallandier|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
SOMMAIRE
L’inconnu de Castel-Pic
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
MAX DU VEUZIT
L'INCONNU DE CASTEL-PIC
1939
Raanan Éditeur
Livre 1031 | édition 1
L’inconnu de Castel-Pic
I
Castel-Pic est le nom de la maison que nous habitons, grand-mère et moi, avec nos deux serviteurs Sabin et Fauste.
C’est un vieux manoir, lézardé et sombre, qui se dresse tout en haut d’un amas de rochers escarpés dominant les vallées environnantes.
Il n’y a guère de verdure à Castel-Pic : quelques grands pins ont poussé dans les creux des rocs et dressent leurs cimes orgueilleuses, de-ci de-là, sans symétrie ; les bruyères ont grimpé à l’assaut des roches nues et se sont emparées des moindres anfractuosités ; les genêts, les romarins, les ronces semblent avoir élu domicile sur la pierre même, de telle sorte que leurs couleurs sombres se confondent avec la teinte foncée du granit de nos assises ; enfin, le lierre a envahi nos murailles et il revêt en entier la façade nord du château et la tour carrée dont il est flanqué à gauche.
Ces pins, ces bruyères, ces ronces, ce lierre c’est toute la flore de Castel-Pic, et Sabin, qui tient chez nous le rôle multiple de commissionnaire, garçon de peine, frotteur, concierge, muletier, jardinier, a vainement essayé d’y planter des arbres fruitiers. Il y a trop de neige l’hiver, de soleil l’été, de vent toute l’année.
Tel qu’il est, pourtant, sauvage et nu, inaccessible aux véhicules de tous genres, loin de toute habitation, de tout bruit, de tout mouvement, seul enfin, sur son aiguille de pierre, tel qu’il est, j’adore Castel Pic.
Je suis fière de ses hautes murailles, de sa teinte sombre que le temps patine chaque jour davantage, de ses flancs arides, infranchissables à l’homme, de son sentier rocailleux qu’on ne peut gravir qu’à pied ou à dos d’âne, de sa position unique dominant tout ce qui l’entoure et portant le regard, par-delà les vallées et les coteaux, jusqu’aux confins de l’horizon.
Oui, j’adore Castel-Pic !
――
Castel-Pic est situé en pleine brousse dylvanienne, à cent cinquante milles de Khéta, capitale de la Dylvanie.
La Dylvanie est un très petit État de l’Europe septentrionale qui se dresse au sud de la chaîne de montagnes des Lazes.
Limitée à l’ouest par la mer Grise, à l’est par le fleuve Knour, la Dylvanie est admirablement située dans une contrée riche et fertile, où son peuple de laboureurs peut se développer tranquillement, bien à l’abri des catastrophes et des guerres qui ont dévasté ses voisins.
Ce pays, où j’ai vu le jour, comme dit je ne sais quelle chanson française, serait le plus beau de la terre et le plus doux à habiter si, depuis une vingtaine d’années, un vent de folie ne paraissait souffler sur les Dylvaniens qui ne rêvent plus que plaies, bosses et révolutions.
La Dylvanie était encore, au début du siècle, un délicieux royaume qu’un bon vieux roi, Jacques VII, dirigeait paisiblement depuis trente-cinq ans. Tout à coup, sans que l’on sache bien exactement ce que le souverain avait fait pour perdre l’estime de son peuple, celui-ci décréta, un beau matin, qu’il en avait assez d’être représenté par un vieillard caduc et impotent, qui n’assistait plus aux fêtes qu’en voiture fermée, son grand âge lui faisant craindre les courants d’air et l’empêchant de parader à la tête de notre milice nationale (cinq cents hommes en tout ! notre armée, quoi !).
Un pareil mécontentement chez un peuple aussi tranquille, jusque-là, que le nôtre, obligea Jacques VII à abdiquer en faveur de je ne sais quel petit neveu, le prince Paul, un délicieux gamin de douze ans.
Il fallut, naturellement, nommer un régent pour gouverner la Dylvanie durant la minorité de Paul V, si bien qu’au bout de quelques mois notre peuple se déclara, un beau matin, plus malheureux encore que du temps du vieux roi.
Il paraît que le régent dilapidait les finances publiques !
Je crois, tout simplement, que sa situation privilégiée portait envie à ses anciens collègues, les ministres moins chanceux que lui, et que des meneurs, grassement payés, aidèrent le peuple à manifester son déplaisir.
Bref, il y eut encore un changement de gouvernement. La Régence se mua en dictature !
Mais il semble que notre pays n’était pas mûr pour obéir à un dictateur. Le peuple se cabra une nouvelle fois.
Ce fut très grave ! Le mécontentement populaire se traduisit par des échauffourées et des combats dans les rues de Kétha. Le choc fut effroyable !... On compta au moins soixante morts et près de deux cents blessés. Jamais la Dylvanie, depuis l’antique passage des Huns sur son territoire, n’avait vu pareillement couler le sang de ses enfants !
À Paul V et à son régent malfaisant succéda un gouvernement provisoire. Nous connûmes alors des luttes intestines bien pénibles jusqu’au jour où la République fut proclamée et que tous les princes d’Yber, de Tovin et d’Ani furent conduits à la frontière sous menace d’être fusillés s’ils se permettaient jamais de remettre les pieds en Dylvanie.
Depuis lors, nous sommes en république...
II
Grand-mère a toujours habité notre vieux château. Elle y est née, y a grandi, s’y est mariée. Puis, mère de deux enfants, elle y a connu les joies de la famille et la douleur des deuils. C’est là que son mari, mon grand-père, mourut encore jeune, et c’est là que ses deux enfants, dont ma mère, après avoir vécu loin d’elle leur courte destinée, vinrent reposer pour l’éternité.
J’avais trois ans quand elle me recueillit.
J’étais orpheline.
Mon père, un brillant officier de marine, avait péri dans un naufrage. Le chagrin de cette mort avait tué lentement ma mère.
Ma grand-mère était la seule parente qui me restât ; elle devint vite la seule personne que je connusse et dont ma mémoire ait gardé intacte l’empreinte indélébile.
Aussi loin que ma pensée remonte dans le passé de ma prime jeunesse, c’est toujours grand-mère que je revois. Sa grande silhouette aux formes imposantes, son visage un peu froid aux lignes énergiques, mais aux yeux si bons, semblent s’être toujours penchés vers moi.
Mon aïeule représente un tout formidable dans ma vie. C’est elle qui m’a enseigné la lecture et la prière, qui m’a expliqué les principes sacrés de la religion, qui a surveillé elle-même mon instruction et mon éducation.
À son contact, j’ai appris à aimer les héros de notre histoire, leurs actes valeureux, leurs sentiments sublimes ; j’ai connu nos gloires nationales et leurs impérissables chefs-d’œuvre ; j’ai exalté le courage et la beauté, l’art sous toutes ses formes, la bonté dans ses infinis détails. J’ai aussi méprisé les timides et les méchants, abhorré les lâches et les parjures, maudit les traîtres et leurs ténébreux exploits.
――
– L’esprit n’a pas de sexe, dit souvent grand-mère qui regrette que je ne sois pas un garçon. Je veux faire de ma petite-fille un être loyal et brave qui pensera et agira courageusement, sans faux préjugés comme sans hypocrisie, tel qu’elle aurait pensé et agi si, au lieu d’être une femme, elle avait été un garçon.
Et le résultat de cette éducation virile est assez bizarre, car, si la pensée est saine, l’esprit fort, le jugement solide, le caractère ferme, j’ai, en revanche, toutes les faiblesses et toutes les mièvreries de la femme, physiquement parlant. Je suis plutôt délicate de santé et n’ai pas même, malheureusement, la haute stature de grand-mère.
Mon portrait ?...
Ni brune, ni blonde ; ni grosse, ni maigre ; ni grande, ni petite ; ni belle, ni laide ; il me semble que je suis la négation en personne. Et quand je me regarde dans une glace, je pousse de gros soupirs en songeant à tout ce que j’aurais pu être... et que je ne suis pas !
――
Ne croyez pas que notre peuple, ayant obtenu un gouvernement républicain entièrement nommé par lui, soit satisfait de ses élus ! Ce serait mal connaître les Dylvaniens modernes. Le calme et la tranquillité qui règnent partout paraissent les décevoir. Ils protestent contre le budget qui s’équilibre mal et se disent abreuvés d’impôts.
Il paraît aussi que l’actuel président de la République dylvanienne n’est pas assez démocrate.
Reproche grave et qui paraît justifié !
Ce grand personnage aime les honneurs, les réceptions brillantes et les parades militaires. Enfin, il parle trop ! Ce ne sont que discours et harangues... « Beaucoup de bruit pour rien », disent les vieux Dylvaniens qui évoquent avec attendrissement l’époque du bon roi Jacques VII où tout allait patriarcalement, pour le mieux, dans le plus paisible des royaumes de ce monde.
Certains, même, rêvent de rappeler Paul V...
Mais ceci est une histoire trop dangereuse pour que j’ose en parler ici...
On n’aime pas les conspirateurs dans notre pays et tout ce qui se dit royaliste est tout de suite suspect...
Le mot d’ordre est d’être républicain dans l’âme... envers et contre tous !
――
Nous vivons en vrais sauvages à Castel-Pic. D’abord parce que nous sommes loin de toute habitation et que les abords de notre château ne se prêtent guère aux visites et aux réceptions, ensuite, parce que grand-mère, après les deuils successifs qui ont assombri son existence, s’est repliée sur elle-même, farouchement, et a laissé s’éteindre, peu à peu, toutes les relations amicales de son passé.
Elle en veut d’ailleurs à la République d’avoir chassé de Dylvanie les princes d’Yber, et elle ne lui pardonne pas sa noblesse d’arrivistes « qui, dit-elle, se disputent bassement le pouvoir comme des chiens à la curée ».
Pour elle, tout homme qui n’a pas de vieux parchemins est un parvenu, quelles que soient sa situation de fortune et la façon dont celle-ci lui a été acquise.
Il faut entendre grand-mère prononcer ce mot de parvenu ! Il y a, dans son ton, du mépris, du dégoût, des choses honteuses qu’elle n’énumère pas, mais que l’oreille devine, car s’éveillent en vous, à votre insu, des idées de bassesses, de vols, de crimes...
Avec cette façon de juger les choses, on comprendra aisément que peu de gens aient trouvé grâce devant mon aïeule.
La plupart des châteaux de la région où nous aurions pu fréquenter sont habités par d’anciens financiers ou fonctionnaires.
Il y a un filateur qui a fait fortune dans l’industrie de la soie, un autre eut pour père un modeste tisserand, le domaine de Vak-Ru a été acheté par le fils d’un raffineur, celui de Kermacos par un fabricant d’automobiles, les Roc-Black appartiennent à un général en retraite et les Hormaux à un ancien ministre.
Tous parvenus, quoi ! pour employer l’épithète de grand-mère.
Nous ne fréquentons donc personne et, en dehors des fournisseurs habituels qui gravissent, le moins souvent qu’ils peuvent, notre abrupt sentier, nul ne songe à tirer la chaîne de la grosse cloche dominant l’entrée de Castel-Pic.
Deux fois par an, cependant, à Noël et à la « Saint-Jean », notre maison est en rumeur et la vaste salle résonne de grosses voix, de pas lourds et de vaisselles heurtées.
Ce sont les fermiers de grand-mère qui viennent lui apporter le prix de leur fermage. Et, selon l’habitude depuis longtemps établie chez nous, ils ne partent pas sans s’être copieusement repus et abreuvés.
――
Si personne ne monte à Castel-Pic, nous ne descendons guère plus souvent dans la vallée.
Tous les dimanches matin, nous allons entendre la messe dans une petite chapelle située juste au bas de notre éminence.
La messe se dit à huit heures et, à cause des difficultés du chemin, nous nous mettons en route vers sept heures.
Cette descente, comme le retour d’ailleurs, est pour moi le plus heureux moment de la semaine.
J’ai dit que, le sentier étant très escarpé, aucun véhicule ne pouvait s’y engager. C’est donc à dos d’âne que nous descendons et gravissons la pente.
Grand-mère s’installe entre des coussins, dans une sorte de fauteuil d’osier assujetti, comme le serait une selle ordinaire, par des courroies sur le dos de Nora, le vieil âne, et moi je prends place sur Fakir le turbulent, de la même façon, sinon avec la même commodité, que je monterais un pur-sang anglais.
Sabin nous conduit. Il va à pied et dirige l’âne que monte grand-mère.
Autrefois, il me fallait suivre le groupe, ma bonne aïeule ayant toujours peur que je ne commisse quelques imprudences.
Depuis mes seize ans, c’est-à-dire depuis quinze mois, on me permet de filer en avant.
Oh ! la délicieuse chevauchée ! Fakir semble partager ma joie de courir librement et nous filons, moi le montant et lui me portant à l’allure vertigineuse d’un petit trot irrégulier. Les cailloux roulent sur le chemin, mon voile vole derrière moi, les sabots de Fakir résonnent sur les pierres, je l’excite de la voix : nous faisons ainsi du huit kilomètres à l’heure, environ !
Et voilà mon grand plaisir de la semaine ! La messe finit à neuf heures. Nous remontons à Castel-Pic. En voici pour huit jours.
――
La maison est beaucoup trop grande pour deux femmes seules qui ne sortent pas et ne reçoivent jamais personne. Aussi n’habitons-nous qu’une partie des appartements.
La Tour Carrée que j’ai dit plus haut entièrement tapissée de lierre, est complètement délaissée depuis longtemps.
J’y ai pénétré une seule fois.
C’était un jour que grand-mère allait chercher des papiers de famille qu’elle croyait y trouver et je l’accompagnais.
La tour est encore meublée : des lits sans literie, des fauteuils recouverts de housses poussiéreuses, des pendules de cuivre ou d’albâtre, arrêtées depuis des années, des bahuts sans vaisselle, mais remplis de toutes sortes d’ustensiles, depuis des harnais de chevaux jusqu’à de lourdes pièces d’argenterie, des armoires bondées de linge et d’effets démodés, des tableaux sans cadres et des cadres sans tableaux.
Bref, tout un passé de meubles qui ont eu une vie, une histoire, enseveli derrière des murs épais et des volets clos.
L’habitation principale est moins délaissée. La plupart des pièces ont encore une destination : la grande salle n’est habitée que deux fois par an, au passage des fermiers : mais la petite nous voit chaque jour, aux repas. Le salon d’honneur ne reçoit ma visite qu’à l’heure du piano, mais nous prenons le thé, régulièrement, tous les soirs, dans le petit salon. Puis, il y a des pièces transformées en lingerie, laiterie, fruiterie, salle de couture. Autrefois, j’avais une nursery, maintenant, j’ai un atelier où crayons et pinceaux marchent de compagnie !
Comme on le voit, nous nous « étalons » sans peur d’occuper trop de place pour nos menus travaux.
Grand-mère dit que cela donne plus de mal à Fauste, mais, en revanche, que nous sentons moins notre esseulement et notre captivité.
Notre servante a connu Castel-Pic lorsque grand-père vivait encore et que la vieille maison était pleine d’activité et de rumeur. Aussi, parce que l’excellente femme ne connaît plus les jours de presse et de bouleversement, trouve-t-elle qu’à présent elle n’est plus utile à rien au château.
Brave Fauste ! C’est elle qui est tour à tour notre cuisinière et notre femme de chambre. Elle surveille la basse-cour, l’office et la lingerie. Elle est sans cesse en mouvement, jamais inoccupée. À elle seule, elle évite à grand-mère deux domestiques supplémentaires, et elle dit encore qu’elle n’est utile à rien !
――
Ma chambre est séparée de celle de grand-mère par un vaste cabinet qui sert à pendre les effets.
Ce cabinet était autrefois ma chambre. Un petit lit blanc, un bureau, deux chaises trouvaient facilement à s’y loger. Mais, comme j’ai la manie d’explorer les greniers de Castel-Pic et d’y faire, chaque fois, de nouvelles découvertes que je rapporte triomphalement chez moi, ma chambre devint rapidement trop petite.
Le nombre de chaises dépaillées que j’ai trouvées dans ces greniers et que j’en ai retiré religieusement, parce qu’elles avaient un dossier sculpté ou une forme bizarre, est invraisemblable ! Elles avaient fini par s’aligner, serrées les unes contre les autres, à tel point que, pour gagner mon lit, il me fallait quelquefois les franchir en montant dessus !
Et, pour rien au monde, je n’aurais voulu les reporter là où je les avais trouvées. Je les soignais comme des meubles précieux, cachant leurs sièges percés sous des coussins, recollant leur bois piqué de vers, au grand amusement de ma grand-mère, qui m’appelait « mademoiselle l’antiquaire ».
Mais, comme je ne me contentais pas de rapporter seulement des chaises lors de mes excursions dans les combles abandonnés, et qu’un guéridon, un rouet, un grand fauteuil de bois surmonté d’un dais de soie rouge, une harpe dont je raccommodai les cordes, une chaise longue, un coffre à linge, et que sais-je encore ? me charmèrent à leur tour, il devint absolument nécessaire de nous transporter ailleurs, moi et mes reliques !
C’est ainsi que devint mienne la plus grande chambre de Castel-Pic, celle qui est au-dessus du salon d’honneur et qui, avant moi n’avait jamais abrité que des hôtes de marque.
Je ne m’attarderai pas à la dépeindre ; on devine, par ce qui précède, de quels objets hétéroclites elle est meublée.
Je dirai seulement qu’elle me paraît délicieuse ainsi, que je reste des heures entières à réjouir mes yeux de son ameublement bizarre, que j’y dors de pleines nuits et que jamais, avant de l’habiter, je n’avais fait autant de jolis rêves.
――
Je passe mes journées d’une façon un peu uniforme, on s’en doute.
La musique, la peinture, la lecture surtout, occupent la majeure partie de mes loisirs.
Le reste du temps, quand je ne mange ni ne dors, je me plonge dans une de ces longues rêveries que grand-mère n’aime pas, mais qui m’attirent d’autant plus qu’elles emportent ma pensée vers des régions mystérieuses, des êtres inconnus, des sensations nouvelles. Pour trancher un peu la monotonie de mes journées, toujours semblables, j’ai voulu réunir en collection des fleurs, des papillons, des pierres...
Mais je me suis vite lassée de ces dernières occupations. Mon herbier est resté inachevé et mes papillons, piqués sur des cartons, me donnent des remords. Comment ai-je eu le courage de faire souffrir ces gracieuses bestioles qui apparaissaient à Guy de Maupassant, les derniers mois de son existence tourmentée, comme la personnification de ses idées inspiratrices qui s’enfuyaient et qu’il ne pouvait ressaisir ?
Un jour, j’ai demandé à grand-mère la permission d’échanger des cartes postales avec des collectionneurs amateurs, par l’intermédiaire du journal de modes que nous recevons chaque mois.
Elle a refusé.
Elle ne veut pour moi aucune promiscuité... même épistolaire !
Une autre fois, j’ai voulu qu’elle m’autorisât à descendre dans la vallée, avec Sabin, quand il va aux provisions.
Nouveau refus de sa part. Elle n’admet pas que les maîtres aient l’air de contrôler les prix d’achat des objets rapportés par leurs serviteurs.
C’est qu’elle est très Régence, grand-mère, et rien ne lui semble moins distingué que les questions d’argent !
J’aurais désiré visiter les pauvres dans leurs chaumières et leur apporter un peu de bien-être ou de consolation, selon leurs besoins.
Ma grand-mère a encore hoché négativement la tête.
– Les gens du peuple ne respectent rien... Leurs plaintes et leurs remerciements iraient peut-être vers toi, mais tes oreilles de jeune fille entendraient des choses qu’elles doivent ignorer.
– Mais si ces pauvres gens ont besoin de secours, grand-mère ?
– Je fais le nécessaire, dans la mesure de nos moyens, pour soulager leurs peines. Chaque mois, je remets une certaine somme à l’abbé Drieux, je sais qu’il la distribue intégralement.
– Les gens ne nous en ont aucune reconnaissance.
– Je ne la cherche pas... Je n’ignore pas, d’ailleurs, le proverbe :
« Bien qu’on fait à un vilain
Retombe en crachat dans la main »
Et comme j’insistais encore en parlant des malades, mon aïeule me refusa catégoriquement.
– Non ! Ma petite-fille n’ira jamais s’asseoir au chevet d’une femme en couches, panser des plaies intimes, emmailloter des nouveau-nés ou changer le linge des infirmes. Je trouve cela inconvenant et ne puis me faire à cette idée-là !
Depuis, je n’en ai plus reparlé, et je passe mes journées, toute seule, entre les murs de Castel-Pic qui ne s’ouvre pour moi que deux heures, le dimanche.
――
Il paraît que de nouvelles secousses politiques menacent notre pays.
Les journaux ne parlent que de scandales ! Nos élus toucheraient des pots-de-vin fantastiques sur toutes les commandes de l’État !
On dit aussi que tous nos ministres sont compromis dans un krach financier qui atteint les épargnants !
Si ces faits sont exacts, ce serait un grand malheur pour notre pays ! La Dylvanie serait déconsidérée à jamais, car, dans aucune contrée, nul n’a pu enregistrer de pareilles mœurs !
――
Le facteur a apporté, ce matin, une lettre recommandée à grand-mère.
Cela a été pour nous tout un événement !
Jamais le facteur ne monte la sente de Castel-Pic. Nous sommes trop éloignés des habitations et ce détour allongerait terriblement sa tournée.
C’est Sabin qui, descendant chaque jour dans la vallée avec Nora, prend le courrier au bureau de poste de Sal-Côme, bourg le plus proche d’ici, bien que situé pourtant à cinq bons kilomètres.
Quand la grosse cloche d’entrée a tinté, ce matin, j’ai sursauté de surprise. Cela arrive si rarement !
Sans donner le temps à Fauste ou à Sabin d’accourir, je suis allée moi-même ouvrir.
– Une lettre pressée... même qu’elle est recommandée... pour Mme de Noyvic ! m’a dit aussitôt la facteur.
Il était tout en nage, le brave homme !
– Il est rudement à pic, vot’ chemin ! C’est point un p’tit voyage, sûrement, mais, vu qu’y avait pressé sur l’adresse, j’ai préféré vous la monter moi-même !
– Et je vous remercie, monsieur ! fis-je aimablement en l’introduisant dans Castel-Pic.
Grand-mère n’a pas été moins surprise que moi de voir le facteur.
Elle a pris la lettre du bout des doigts avec une certaine méfiance, comme on accueille une chose qui n’est ni désirée, ni attendue, et dont on redoute plutôt du mal.
Mais, à peine avait-elle vu l’écriture de la suscription, que, la reconnaissant sans doute, son visage s’est tout de suite détendu.
– Conduis ce brave homme à l’office et dis à Fauste de le restaurer convenablement, m’a-t-elle recommandé.
Et, pendant que j’exécutais ses ordres, elle est rentrée chez elle avec la mystérieuse lettre.
Quand j’ai revu grand-mère, à table, à l’heure du déjeuner, elle m’a paru tout agitée et comme sous le coup encore d’une violente émotion.
Elle a à peine touché aux mets qu’on lui présentait. Ses mouvements étaient fébriles, ses lèvres remuaient, comme si elle parlait en elle-même à un personnage présent à son esprit. Ses pommettes brillantes et rouges accusaient mieux encore sa fièvre intérieure.
Elle me paraissait si bouleversée que je n’ai pu me retenir de l’interroger, malgré l’habituelle discrétion qu’elle m’a toujours imposée.
– Auriez-vous reçu de mauvaises nouvelles, grand-mère ?
J’ai vu que ma question ne lui plaisait pas.
– Du tout. Qu’est-ce qui vous fait supposer cela, mademoiselle ?
Oh ! le ton de ce « mademoiselle » ! J’ai rougi jusqu’aux oreilles, de l’air de blâme dont elle avait prononcé.
Et c’est gênée, en bafouillant, que j’ai cherché à excuser mon indiscrétion.
– Vous ne mangez pas, grand-mère, et vous paraissez tout émue... J’ai craint que cette lettre... cette lettre extraordinaire, ne fût la cause de... de...
Elle m’interrompit :