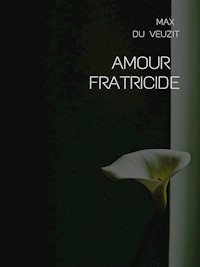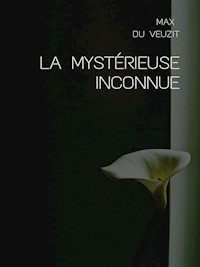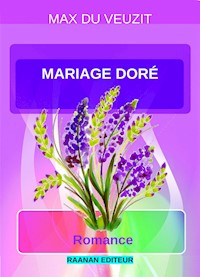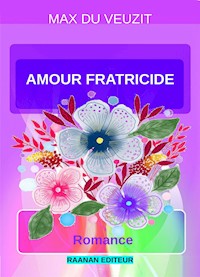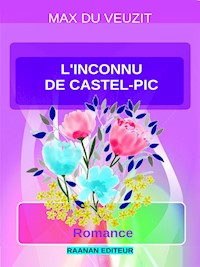1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Lorsque Simone Montagnac découvre qu’elle est mariée à son insu à un anglais Walter Anderson, elle décide de partir immédiatement pour Londres afin d’obtenir l’annulation....|Librairie Jules Tallandier|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
SOMMAIRE
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
Notes
MAX DU VEUZIT
MON MARI
Paris, Tallandier, 1925
Raanan Éditeur
Livre 1040 | édition 1
Mon mari
I
Ce jour-là, Anne-Marie, la femme de chambre de Mme Nordin, pénétra chez moi, une lettre à la main.
Cette fille se montrait peu affable pour moi. Depuis deux mois que j’étais au château, elle me poursuivait d’une sorte d’antipathie sournoise que je n’avais pu vaincre encore, malgré tous mes bons procédés à son égard.
J’ai pensé, depuis, que l’envie devait être le motif de cette animosité injustifiée qu’elle me marquait. Je mangeais à la table des maîtres, je tenais compagnie à Mme Nordin ; celle-ci me mettait au courant de toutes ses affaires ; enfin, et surtout, j’avais un appartement à part, à l’étage réservé aux invités. Anne-Marie ne pouvait pas me pardonner d’être traitée au château d’une façon différente de celle dont on usait normalement avec les domestiques.
– Pas gros, votre courrier. Mais, pour une fois, il compte, fit la femme de chambre en me désignant de loin la lettre qu’elle tenait.
Retournant la missive entre ses doigts, elle se mit à rire d’une façon incisive et mordante.
Et, lisant tout haut la suscription :
– « Madame Walter Anderson, née Simone Montagnac, lectrice de Madame Nordin, au château des Fresnes, par Clavigny (Eure)... » C’est bien pour vous, il n’y a pas d’erreur ! Alors ! vous êtes mariée ? Compliments, mademoiselle Simone Montagnac, comme vous vous faites appeler ici ; quand on a déjà un passé de femme mariée et qu’on le cache, c’est qu’il renferme des choses peu propres... Foi d’Anne-Marie, j’aime mieux afficher ouvertement le galant qui m’épousera aux prochaines feuilles que d’envoyer mon mari aux oubliettes comme vous paraissez le faire !
Ahurie, je toisai la fille dont le rire insolent m’insultait plus que les paroles.
– Quelle est cette histoire ? dis-je sans comprendre, mais pourtant mise sur la défensive par son ton narquois. Donnez-moi cette lettre si elle m’est adressée, et occupez-vous de ce qui vous regarde.
Mais elle, si heureuse de ce qu’elle croyait être un motif d’insolence, n’était pas pressée d’en finir.
Elle ne me tendit pas encore la lettre subversive.
– Mariée ! reprenait-elle. Et ça se fait passer ici pour une demoiselle sortant de pension et n’ayant jamais vu le loup ! Pour un mot plus haut que l’autre, ça rougit comme une innocente ! C’est à mourir de rire !... Madame Walter Anderson ! En voilà du nouveau... et du vrai ! Pas moyen de nier, la lettre porte l’en-tête officiel de Me Dargile, notaire à Évreux. Il doit bien savoir de quoi il retourne, Me Dargile !
Elle eut un nouvel éclat de rire et me jeta la lettre plutôt qu’elle ne me la tendit.
– Voilà votre courrier, madame Walter Anderson Bien des choses pour moi à votre mari, quand vous lui écrirez !
Elle pirouetta sur ses talons et je perçus son rire insultant encore après qu’elle eut refermé la porte.
La surprise, l’émotion de cette apostrophe inattendue, me clouait au sol. Il en résultait que c’est à peine si j’osais toucher à la singulière missive, cause première de cette curieuse scène.
Cependant, je pris l’enveloppe, et, tout de suite, comme l’avait fait la femme de chambre, je me mis à l’examiner.
D’abord, l’en-tête imprimé attira mon regard :
Me Dargile, notaire à Évreux (Eure).
Cette simple ligne retirait, en effet, à la lettre, toute apparence de plaisanterie.
Me Dargile existait bien. Il était le notaire de ma maîtresse, Mme Nordin, et je croyais me rappeler qu’il avait été aussi, autrefois, celui de ma pauvre maman, trop vite enlevée à mon affection. Néanmoins, depuis de longues années, je ne me souvenais pas qu’il eût eu à s’occuper de moi, un homme d’affaires, M. Bertheim, ayant été nommé mon tuteur à la mort de ma mère.
De l’en-tête de l’enveloppe mes yeux passèrent à la suscription. Et, de celle-ci, la première ligne seule me surprenait étrangement : Madame Walter Anderson, née Simone Montagnac.
Voyons, voyons ! Quelle était cette mauvaise plaisanterie ?
Anne-Marie pouvait s’y arrêter, mais moi, je savais bien que je n’étais pas mariée, et que, pour tout nom, je portais celui que m’avait légué mes parents. Simone Montagnac j’étais née, et Simone Montagnac j’étais restée jusqu’à ce jour.
Seule, une erreur avait pu associer mon nom à celui d’un Walter Anderson.
L’erreur de quelque clerc, parbleu !
Il était probable que celui-ci avait eu à écrire, le même jour, à Mme Walter Anderson et à moi. Par suite d’une amusante méprise, il avait accolé nos deux noms. Et, de cette simple étourderie, Anne-Marie avait tiré, tout de suite, une ridicule et rocambolesque histoire.
En raisonnant ainsi, je continuais à retourner l’enveloppe dans tous les sens, sans oser l’ouvrir.
Une question, en effet, se posait à ma loyauté : le contenu de cette lettre était-il bien pour moi, ou, l’erreur continuant, le clerc inattentif n’y avait-il pas joint un document intéressant la dame Anderson dont il m’affublait si peu cérémonieusement la qualité ?
Après bien des hésitations, je me convainquis que j’avais le droit, et même le devoir, d’ouvrir cette lettre.
Si son contenu m’avait été bien destiné, l’erreur n’aurait porté que sur l’enveloppe. Si, au contraire, il intéressait une autre personne, il me serait facile d’excuser mon erreur involontaire par le doute qu’avait fait naître en moi la singulière suscription.
Donc, je décachetai la lettre.
Un papier mi-imprimé, mi-manuscrit m’apparut, telle une circulaire dont les blancs auraient été remplis à la main.
Et ce ne fut pas sans une croissante stupéfaction que je pris connaissance du libellé :
« Madame Simone-Louise Montagnac, épouse Walter Anderson,
née à Paris,
le 27 novembre 1912,
est priée de bien vouloir passer à l’étude
le plus tôt possible,
pour affaire la concernant. »
« Signé : Dargile,
Notaire à Évreux. »
Deux fois je relus cet avis, me répétant :
– Mon nom, mes prénoms, mon état civil de jeune fille, quoi !
Mais comment ce nom de Walter Anderson pouvait-il être accouplé au mien ?
Je ne connaissais pas cet homme. Mieux que cela, je pouvais affirmer n’avoir jamais entendu ni lu son nom, jusqu’à ce jour.
– Oh ! mais il faut tout de suite dissiper ce quiproquo. Je vais écrire à Me Dargile ! Je ne dois pas permettre à une erreur aussi grossière de subsister plus longtemps.
Déjà je m’avançais vers mon petit bureau pour y griffonner ma protestation, quand une pensée subite traversa mon cerveau.
– Avec ou sans Walter Anderson, Me Dargile a besoin de me voir... de voir Simone-Louise Montagnac...
Au lieu d’écrire, ne valait-il pas mieux me rendre à son invitation ? Plus vite que par un échange de lettres, l’erreur serait reconnue et réparée. En même temps, je serais fixée sur l’affaire me concernant le plus tôt possible.
Ce projet ne me paraissait souffrir aucun empêchement, je résolus de le mettre à exécution le jour même.
Je descendis donc rejoindre Mme Nordin pour la prier de m’accorder la liberté de la journée.
À la porte de son appartement, je croisai Anne-Marie qui en sortait.
Cette fille paraissait égayée, et son œil moqueur s’attarda sur moi.
Je compris qu’elle venait de faire un rapport à sa maîtresse sur mon singulier courrier du matin.
Et, soudain, la chose me parut amusante.
Mariée ! Elle croyait que j’étais mariée !
J’obtins facilement de Mme Nordin la permission de m’absenter.
Cette excellente dame paraissait d’ailleurs outrée de la mystification dont j’étais l’objet.
– Une jeune fille que les religieuses m’ont recommandée ! qu’elles ont élevée ! Ce notaire de malheur mériterait tous les anathèmes !
II
Il était à peine deux heures de l’après-midi quand je pénétrai dans l’étude de Me Dargile.
C’était une pièce longue et triste, tapissée de cartons poudreux avec, de-ci de-là, quelques pupitres noirs couverts de paperasses.
Devant les regards curieux et effrontés des clercs fixés sur moi, je me sentis un peu intimidée.
Une voix sympathique, heureusement, m’interpella de l’autre bout de la pièce.
– Que désirez-vous, madame ? questionna poliment un homme d’un certain âge qui occupait un pupitre à part, derrière un grillage.
– Puis-je voir Me Dargile ? répondis-je en m’avançant vers lui ?
– Il est très occupé en ce moment, madame, et je crains fort qu’il ne puisse vous recevoir que sur rendez-vous.
– Il m’a convoquée, cependant, à son étude. « Le plus tôt possible », a-t-il dit.
– Alors, c’est différent. Voulez-vous me rappeler votre nom, Madame ?
L’insistance de cet homme à me nommer madame m’agaçait véritablement, bien que sachant qu’il ne me donnait ce titre que par politesse et dans l’ignorance de mon identité.
Mais j’avais encore dans l’oreille la voix d’Anne-Marie me nommant sur tous les tons :
« Madame Walter Anderson ! »
J’appuyai donc sur le qualificatif de mademoiselle en donnant mon patronyme.
– Simone Montagnac ? répéta-t-il, comme s’il cherchait à se souvenir.
En même temps, il consultait du regard une liste placée à sa portée.
Il me parut que ses recherches demeuraient vaines, et j’en éprouvai un peu de déception, tant je craignais à cause de l’erreur du nom – avoir fait un voyage inutile.
– Je ne vois pas pour quelle affaire, l’entendis-je murmurer.
Et plus haut, il demanda :
– Y a-t-il longtemps que cette convocation vous est parvenue ?
– Ce matin même, monsieur.
– Tiens ! fit-il, étonné.
Puis, se levant :
– Veuillez-vous asseoir, mademoiselle ; je vais voir si Me Dargile est à son bureau.
Je restai songeuse pendant qu’il disparaissait pour revenir quelques secondes après.
– Si vous voulez entrer, madame, Me Dargile vous attend.
Pourquoi me sembla-t-il lire dans ses yeux une sorte de curiosité qui n’y était pas auparavant ? Pourquoi remarquai-je ce nom de madame qu’il recommençait à me donner ?
J’en éprouvai une sorte de malaise qui tenait de l’appréhension.
Que pouvais-je craindre, cependant ?
Je dois avoir dit déjà que je ne connaissais pas du tout Me Dargile. Sa vue ne me rappela aucun souvenir.
C’était bien la première fois que je me trouvais en sa présence.
C’était un homme d’une soixantaine d’années, à l’apparence très grave, très posée, mais aussi très sympathique.
D’un geste courtois, il me fit asseoir et, en homme d’affaires dont les instants sont précieux, il entama tout de suite l’objet de sa convocation.
– Je vous ai priée de passer à mon étude, sans retard, afin de régler définitivement, si possible, toutes les questions pendantes qui vous concernent dans l’inventaire de M. Bertheim.
– L’inventaire de M. Bertheim ? interrogeai-je.
– Oui, de Bertheim, qui fut un homme d’affaires en cette localité pendant trente-quatre ans. Il était votre tuteur, je crois ?
– En effet.
– Eh bien ! Bertheim est mort il y a quelques mois, vous devez le savoir.
– Je l’ignorais.
– Depuis, j’ai été chargé, avec Me Lecourt, avoué en cette ville, de faire l’inventaire et de régler toutes les affaires pendantes. J’ajoute, madame, que cela ne vous engage en rien, quant à l’avenir, vis-à-vis de moi. Vous pourrez toujours prendre tel autre homme d’affaires qui vous plaira. Si même vous désirez cette fois ne pas vous en occuper vous-même, vous n’avez qu’à me désigner tel mandataire à votre choix.
Le ton de Me Dargile était extrêmement courtois et naturel. Cependant, à ces paroles, il me sembla qu’il ne tenait guère à m’avoir pour cliente...
Un sourire un peu triste passa sur mes lèvres.
– Je n’ai aucune fortune... ni aucun parent. Je n’attends rien que de mon travail ; je n’ai donc pas besoin de m’embarrasser d’un mandataire. Mes affaires ne doivent pas être très compliquées. Si le décès de M. Bertheim me concerne de quelque manière, je vous serais obligée de bien vouloir m’éclairer, puis de vous en occuper pour moi.
– Mon Dieu ! oui, cela vous concerne ; non pas tant à cause des comptes de tutelle à vous rendre, puisque le mariage vous a émancipée de plein droit, et que votre récente majorité n’apporte avec elle que quelques formalités sans importance..., et seulement, parce que M. Walter Anderson semble avoir négligé de régler cette question depuis quatre ans, mais encore, et surtout, parce que le décès de Bertheim vous prive d’un conseil à opposer au solicitor de Londres...
Je crus devoir interrompre Me Dargile
– Je ne comprends pas du tout.
Poliment, il m’expliqua en appuyant sur les mots :
– Je veux dire que votre intérêt vous oblige à ne pas rester désarmée devant votre mari.
– Mon mari ! Mais je n’ai pas de mari, monsieur !
– M. Walter Anderson ?
– Je ne le connais pas ! Vous vous trompez, ce n’est pas moi !
– Cependant...
– Non, non, vous confondez.
Je souriais, cette fois, amusée de voir que la méprise continuait.
Le notaire, en revanche, me regardait avec une véritable surprise.
– Vous n’êtes pas madame Simone Montagnac, épouse Walter Anderson ?
– Je suis mademoiselle Simone Montagnac, et c’est tout... Je ne suis pas mariée, et, pour la première fois, aujourd’hui, j’ai entendu parler de ce Walter Anderson.
Les yeux de Me Dargile m’enveloppèrent de stupéfaction. Et sa voix parut devenir sévère :
– Voyons, voyons, mon enfant... Qu’est-ce que c’est que cette plaisanterie ? Il y a quatre ans que...
– Mais ce n’est pas une plaisanterie, je vous l’affirme, je ne suis pas mariée !... C’est une erreur de nom... d’état civil. Quatre ans ! J’ai quitté le couvent où j’ai été élevée, il y a quelques mois à peine. Les religieuses pourront vous affirmer que j’ai toujours vécu auprès d’elles depuis mon enfance.
Je me tus, ne sachant plus quelle autre dénégation fournir, et subitement gênée de l’effarement que je lisais sur le visage du notaire.
Ses yeux mi-clos semblaient me convaincre de mensonge. Mes explications devaient lui paraître extravagantes, car, sur ses lèvres, un sourire d’incrédule ironie s’épanouissait.
– Mon Dieu ! repris-je, vous ne me croyez pas ?
– J’ai tenu, hier, votre acte de mariage entre mes mains, fit-il posément, pour toute réponse.
– Hier !... Mon acte de mariage !...
Et, irrévérencieusement, je me mis à rire.
Non, vraiment, c’était trop drôle !
L’insistance de cet homme à me vouloir mariée finissait par être comique. D’abord j’avais été navrée de l’aventure. On n’aime guère, en général, être prise pour une autre... Mais, à présent, je ne voyais plus que le côté amusant de la question : un notaire, un grave notaire pouvait s’embarquer sur un pareil bateau !
Mais pendant que mon rire intempestif troublait le silence de la pièce, Me Dargile, imperturbable, avait sonné son secrétaire.
– Apportez-moi le dossier de Mme Walter Anderson, ordonna-t-il.
– Bien, monsieur.
Deux minutes plus tard, le notaire avait entre les mains de quoi pouvoir m’éclairer.
– Vous paraissez très affirmative, me dit-il. De mon côté, je ne le suis pas moins. Recherchons ensemble ce que cela veut dire.
– Je vous affirme que c’est une erreur...
Il m’interrompit :
– Soit ! admettons l’erreur un instant, et, pour la découvrir, remontons à quelques années en arrière. Je vous demande seulement de me répondre en toute sincérité, bien que je ne sois pas un juge d’instruction ! Mais l’affaire est trop grave pour être traitée à la légère... Je souhaite, vu votre jeune âge et vu mon expérience, être pour vous un paternel ami, vous guidant sur la bonne voie.
– Je vous remercie, fis-je avec émotion, ma gaieté factice subitement envolée devant la gravité de mon interlocuteur. Interrogez-moi, je vous répondrai avec précision.
Il ajusta son lorgnon, remua quelques feuillets, puis commença, mon dossier en main :
– Vos nom et prénoms sont-ils bien ceux portés sur la feuille de convocation que vous avez reçue ce matin ?
– Oui, tout est exact, sauf le nom de Walter Andersen.
– Bien ! bien ! N’allons pas si vite. Vous êtes orpheline de père et de mère ?
– Oui, monsieur ! Mon père est mort quelques semaines avant ma naissance. Je perdis ma mère il y n seulement une dizaine d’années.
– C’est bien cela... J’ai ici les actes de naissance de vos parents ; je possède également le vôtre... J’ai trouvé ces papiers chez Bertheim. Cet homme n’était pas très scrupuleux dans les affaires qu’il entreprenait ; mais je dois reconnaître qu’il avait un ordre admirable, et que les dossiers sont complets.
– Nos recherches n’en seront que plus faciles.
– Espérons-le... En plus de ces deux actes d’état civil, voici un relevé des principaux frais payés pour vous, autrefois, au couvent ; ces comptes s’arrêtent il y a quatre ans.
– C’est curieux, car il n’y a que trois mois que j’ai quitté les religieuses.
– Nous examinerons cela à part... Voici encore une fiche concernant un nommé Charles de Florent...
– Mon parrain ! interrompis-je.
– Votre parrain, parfaitement. Ce Charles de Florent est mort en 19...
– Il y a cinq ans.
– Oui, c’était au mois de février. Or, cette même année, je relève parmi les notes acquittées de vos frais d’éducation une feuille à part qui concerne une somme de cinq mille francs destinée à payer un voyage en Angleterre. Vous êtes donc allée dans ce pays en 19..., c’est-à-dire il y a quatre ans et demi.
– En effet, mon tuteur exigea ce voyage destiné à me perfectionner dans la langue anglaise.
– Vous y êtes allée seule ?
– Non, une religieuse m’y a accompagnée.
– Ah ! On vous y a accompagnée ?
– Oui... mais, pourquoi ?
– Voilà, voilà ! nous y arrivons ! Vous rappelez-vous vers quelle époque eut lieu ce voyage ?
– Pendant les grandes vacances, c’est-à-dire du 20 juillet au 15 septembre environ.
– Vous en êtes sûre ?
– Oh ! certainement !
– Eh bien ! s’écria-t-il victorieusement, c’est le 23 juillet, cette année-là, que vous y avez épousé M. Walter Anderson, comme en font foi les deux papiers que voici : l’acte de transcription de votre mariage sur les registres de l’état civil français – cet acte est enregistré et parfaitement authentique – et cet autre : une copie d’un acte officiel passé devant Me Curnett, attorney à Londres. Par cette copie, je vois qu’une somme de dix mille livres sterling vous est reconnue comme dot.
– C’est impossible, ce n’est pas moi ! répétai-je machinalement, sans être troublée par l’énormité de la somme qu’il m’attribuait.
– Voyez vous-même, fit-il en me tendant les deux feuillets. Tout est régulier et en ordre. Si vous lisez l’anglais, il vous sera facile de voir que c’est bien de vous qu’il s’agit.
En proie à la plus complète stupéfaction, j’essayai de déchiffrer l’affreux grimoire qu’il me conviait à parcourir.
J’étais trop émue pour le lire avec profit. À quoi bon, d’ailleurs ? À chaque ligne revenait mon nom accolé à celui de Walter Anderson, et cela seul me sautait aux yeux.
Mon Dieu ! Mon Dieu ! Qu’est-ce que cela voulait dire ? J’étais mariée, moi ! moi qui n’avais jamais parlé à un homme sur un ton même seulement amical ! Moi, dont le cœur, dont l’âme étaient aussi neufs que ceux d’un enfant !
Cela tenait de la folie !
Une détresse m’envahit tout à coup, et les larmes me montèrent aux yeux. J’avais l’impression d’être seule et sans force, en présence d’un grand danger.
– Je vois, dis-je en reposant les papiers sur le bureau du notaire. Je vois que je suis soi-disant mariée, que mon nom est sans cesse accompagné de celui d’un autre ; c’est légal, puisque vous l’affirmez. Pourtant, je vous le jure, monsieur, je ne comprends pas, je ne sais pas ce que cela veut dire ; ce n’est pas moi, ce ne peut pas être de moi qu’il est question !
La vue de mes larmes parut émouvoir Me Dargile. Sa main s’étendit vers moi.
– Calmez-vous, mon enfant. S’il y a une erreur, nous la ferons reconnaître. Ce M. Walter Anderson doit savoir de quoi il s’agit, si, vous, vous ne savez rien ; nous l’interrogerons.
– Mais cet homme dont on me fait porter le nom, qui est-ce ? Un Anglais ? Est-ce seulement un honnête homme ?
Il esquissa un geste d’ignorance.
– On le désigne seulement, ici, sous la profession d’homme de lettres. Ce qualificatif est un peu vague en l’occurrence. Cependant, la dot qu’il vous a constituée, lors du mariage, me semble indiquer une assez belle situation de fortune ; enfin, la pension de trente mille francs qu’il vous sert depuis deux ans...
– Quelle pension ? interrompis-je. Je n’ai jamais touché d’argent !
– Ah ! cela est autre chose ! D’après les papiers que je possède et les chiffres de Bertheim, je vois que, depuis deux ans, votre mari vous sert une rente annuelle de trente mille francs.
– Je n’ai jamais touché un centime, ce qui prouve bien qu’il s’agit d’une autre personne.
Il eut, à nouveau, un geste évasif.
– Ce qui est certain, reprit-il, c’est que Bertheim a donné quittance au solicitor de Londres, par deux fois, de cette somme de trente mille francs. Votre tuteur, vous le voyez, était au courant de votre mariage. Il connaissait l’existence de Walter Anderson et savait les liens qui vous unissaient à lui.
– C’est à y perdre la tête ! fis-je en m’étreignant le front. Comment vous convaincre, monsieur ? Tenez, vous dites que je me suis mariée le 23 juillet 19...
– Parfaitement.
– Eh bien ! au mois d’octobre de cette même année, je suis allée passer l’examen du brevet supérieur à Rouen. Avant de poursuivre, interrogez les religieuses ; elles vous confirmeront qu’elles m’ont élevée, que je ne les ai quittées qu’à ma majorité et que je n’ai pu me marier à l’époque dont vous parlez.
– Les religieuses ne pourront affirmer que ce qu’elles savent. Or, pendant votre voyage à Londres, vous avez pu...
– Me marier ! protestai-je avec indignation.
– Peut-être l’avez-vous fait sans vous rendre compte des conséquences... par gaminerie... par étourderie... Que sais-je ? On a pu abuser de votre bonne foi I
– Une femme a pu prendre mon nom et s’en servir. Cela aussi est possible. Pourquoi ne l’envisagez-vous pas ?
– Parce qu’une chose est certaine et assez troublante, c’est que vous étiez à Londres, vous le reconnaissez vous-même, à l’époque où vous êtes supposée avoir contracté mariage avec Walter Anderson.
– En effet, fis-je, accablée. Cette coïncidence est épouvantable.
– Un deuxième point est encore acquis, c’est que ce M. Walter Anderson est bien convaincu que vous êtes sa femme, puisqu’il n’hésite pas à vous faire une pension. Il y a quelques jours, j’ai reçu une lettre de son solicitor, lettre adressée à Bertheim, naturellement, mais que j’ai ouverte en raison de mon mandat. Cette lettre contenait un chèque de quinze mille francs, représentant le solde des six mois courants de pension. En même temps, cet homme d’affaires réclamait de vos nouvelles.
– C’est pour moi incompréhensible.
– Et comment croire qu’il y a erreur de personne, puisque c’est votre tuteur qui servait d’intermédiaire entre vous et votre mari ?
– Bertheim saurait expliquer cela, lui !
– Oui, il pourrait nous éclairer davantage. Sa mort est fort regrettable pour vous, car ses renseignements eussent pu vous rappeler quelque chose, puisque vous paraissez tout ignorer.
Je restai songeuse quelques minutes.
Je me rendais compte que Me Dargile, malgré sa bonhomie, n’était pas convaincu de ma bonne foi.
Je cherchai en moi-même quelle preuve lui donner de ma sincérité, mais aucune ne se présentait à mon esprit.
Pourtant, je lui dis :
– Ce mariage m’émancipait, n’est-ce pas ?
– Assurément.
– Comment, alors, expliquer que je sois restée au couvent pour ne le quitter qu’à ma majorité ?
– Un motif que j’ignore a pu vous dicter cette conduite.
– Quel motif ?
– Je n’ai pas à le rechercher, je m’en tiens aux faits acquis.
– Soit, passons... Vous dites que Bertheim a laissé ses écritures en ordre. Or, mariée depuis quatre ans, cette pension ne m’aurait été faite que depuis deux ans ; pourquoi ?
– J’ignore.
– Mai si, par deux fois, Bertheim a reçu une somme de trente mille francs, soit en tout soixante mille francs, il a dû laisser quelque trace de l’emploi de cet argent. L’ai-je reçu ? Lui ai-je donné quittance ?
– Ah ! voilà ! J’ai cherché...
– Eh bien !
– Il n’en est fait mention nulle part.
– Donc, il est mon débiteur pour soixante mille francs.
– C’est-à-dire que, comme tuteur et homme d’affaires, il doit vous rendre compte de l’emploi de cette somme.
– Parfait ! Mais vous ne trouvez rien dans ce sens ?
– Rien.
– En revanche, il a subvenu, depuis quatre ans, aux frais de mon éducation et de mon entretien.
– Depuis cette date, il n’est plus fait mention sur ses livres d’aucune indication de ce genre.
– Depuis cette date, c’est-à-dire depuis l’époque du supposé mariage, mon tuteur gardait donc en sa possession les sommes destinées à Mme Walter Anderson, et, en revanche, il ne tenait plus compte des dépenses occasionnées par l’éducation de Simone Montagnac. Comment conciliez-vous cela, monsieur ?
Le visage du notaire était subitement devenu soucieux.
– En effet, voilà deux irrégularités flagrantes, approuva-t-il.
– Eh bien, monsieur, m’écriai-je victorieusement, renseignez-vous auprès des religieuses, elles vous diront avoir toujours été payées régulièrement.
– Je vais poursuivre cette affaire, déclara Me Dargile avec une énergie soudaine. S’il est prouvé que Bertheim : 1° payait votre internat sans en mentionner le débit ; 2° qu’il conservait par devers lui des sommes importantes qui auraient dû vous parvenir ; 3° que, tenu au courant de votre mariage, il n’a pas liquidé ces comptes de tutelle, cela expliquera bien des choses... sans les éclaircir, d’ailleurs !
– Oh ! monsieur, que je souhaite que vous fassiez ces preuves-là, le plus tôt possible.
– Elles ne serviront qu’à nous documenter un peu plus.
– Elles vous convaincront de ma bonne foi.
Il sourit, et, paternellement :
– Je commençais à n’en plus douter, mon enfant.
– Vrai ! Vous êtes convaincu que je ne suis pas mariée ?
Il se mit à rire et fit de la main un geste de protestation :
– Pardon, pardon ! Pour être mariée, vous l’êtes bien ! Cela est indiscutable. Mais il est probable que votre naïveté, votre inexpérience furent exploitées. Comment ? Par qui ? Dans quelles conditions ? Je l’ignore. Vous avez un mari, mais vous ne le connaissez pas ; et, mieux que cela, jusqu’à ce jour, vous avez vécu sans profiter d’aucun des avantages que vous conférait ce mariage : fortune, liberté, indépendance, etc.
– Et maintenant, que dois-je faire ? Que me conseillez-vous ?
Longuement, il réfléchit.
– Donnez-moi quarante-huit heures avant de vous répondre. Je veux réunir quelques preuves à l’appui de vos dires ; il me faut consulter Me Lecourt qui s’occupe également de la liquidation Bertheim. Revenez dans trois jours, à cette même heure, mon enfant, j’aurai certainement du nouveau à vous faire connaître.
– Que Dieu vous entende, monsieur ! J’ai hâte que ce mariage soit annulé.
Il se mit à rire.
– Vous allez bien vite en besogne. Avant même de songer à cela, essayons d’abord de savoir comment il u été conclu.
Il s’était levé et me reconduisait à la porte.
– Allons, vivez tranquillement d’ici notre prochaine rencontre. Ne vous tourmentez pas : cette affaire est peut-être beaucoup plus simple que vous l’imaginez. Dans tous les cas, au point de vue matériel, votre situation est plus belle que vous le supposez.
Une forte poignée de main termina ces paroles encourageantes du tabellion, et je me trouvai dans la rue, tout étourdie de ce que je venais d’apprendre et d’entrevoir.
Mariée ! J’étais mariée vraiment, et je ne connaissais même pas mon mari !…
III
Je rentrai le soir même au château de Fresnes où je dus faire à Mme Nordin le récit détaillé de ce que j’avais appris à l’étude de Me Dargile.
Cette dame était une excellente personne. Cependant, très puritaine, elle ne se montra pas pour moi, en cette circonstance, aussi indulgente qu’elle l’était habituellement.
Peut-être aussi Anne-Marie m’avait-elle desservie, auprès d’elle, en mon absence ? Je ne sais. Mais, à mesure que je poursuivais impartialement mon récit, Mme Nordin poussait des exclamations offusquées.
– Voici une bien vilaine affaire, mademoiselle ! et je regrette fort que vous y soyez mêlée. L’homme dont vous portez le nom est peut-être un libertin dont vous avez suivi les pernicieux conseils durant votre séjour à Londres...
Je l’interrompis avec indignation :
– Je puis vous affirmer, madame, que je n’ai jamais rencontré cet homme !
– Vous le dites, mon enfant, et mon amitié pour vous ne demande qu’à vous croire ; mais comment pourrai-je convaincre mes amis que les choses se sont passées ainsi ? Déjà, la domesticité est en émoi par suite de votre aventure ; demain, tout le village la connaîtra, et sans que les gens attendent le dénouement, je serai la risée de tous, car chacun me condamnera de vous avoir introduite chez moi.
– Bref, madame, vous me condamnez ?
Je me levai, très pâle :
– Écoutez, ma chère enfant, je voudrais vous conserver auprès de moi, et je ne sais comment arrêter cette publicité désagréable qui va vous être faite... comprenez bien...
– J’ai compris, madame. Et puisqu’il faut une victime à la malignité publique, il est tout naturel que vous ne vouliez pas me couvrir de votre protection. Demain matin, je quitterai votre maison, madame, et soyez persuadée que nulle, plus que moi-même, ne regrettera pour vous les ennuis que ma présence sous votre toit peut vous causer.
– Oh ! ne vous fâchez pas... comprenez bien...
Mais, froidement, je m’étais inclinée devant elle.
– Madame, je vous salue.
Ma patience était à bout, et je n’aurais pu en entendre davantage.
Dès le lendemain, à mon réveil, je fis ma malle. Mon désir de m’éloigner de cette maison devenue pour moi inhospitalière était si grand que, pour gagner du temps, je ne descendis pas, comme d’habitude, prendre avec Mme Nordin le petit déjeuner du matin.
Cette dame ne me vit donc que vers les onze heures, quelques instants seulement avant que je montasse en voiture pour gagner la gare.
Elle fut affable, regrettant peut-être, ou, tout au moins, cherchant à se faire pardonner son attitude de la veille.
Avant de me quitter, elle me tendit, dans une enveloppe fermée, la modeste somme qu’elle me devait pour le mois écoulé, et qui représentait pour moi, en cet instant, à peu près tout ce que je possédais.
Dans le train, seulement, j’ouvris cette enveloppe, et je m’aperçus qu’au lieu des mille francs qui m’étaient dus, Mme Nordin en avait mis le double.
Un court billet y était joint :
« Permettez-moi, ma chère enfant, de vous offrir ce petit supplément et acceptez-le comme venant d’une vieille amie qui a su apprécier votre dévouement. »
« Je vous souhaite bonne chance, ma petite, et faites-moi le plaisir de me donner quelquefois de vos nouvelles. »
« N’oubliez pas, non plus, de vous adresser à moi si le sort, par malheur, vous était contraire ; je répondrai tout de suite à votre appel. »
« Croyez-moi bien sincèrement votre amie, »
« Berthe Nordin. »
Cette lettre et la pensée qui l’avait dictée me touchèrent vivement.
J’allais donc, par la suite, pouvoir me souvenir de Mme Nordin sans cette lourde amertume que je ressentais depuis quelques heures.
Cette dame m’avait sacrifiée à la peur d’un commérage, mais son acte discret me prouvait qu’elle avait su apprécier mon caractère et qu’elle n’oubliait pas les heures agréables que nous avions passées en commun.
Ma fierté blessée s’était évanouie subitement, et, pour la première fois, depuis la veille, je sentis des larmes de détente me monter aux yeux.
C’est à Évreux que je me rendis.
Je n’avais encore pris aucune décision sur ce que j’allais faire.
Mon modeste pécule ne me permettait pas de rester longtemps sans travailler, mais la pensée de ce mari anglais qui me tombait du ciel dominait toutes mes autres préoccupations.
Avant de chercher une autre situation, je voulais avoir revu Me Dargile et savoir s’il avait appris quelque chose me concernant.
Plus haut que mon bien-être matériel, je plaçais mon honneur de jeune fille qui me paraissait atteint épouvantablement par ce mariage inconnu.
Avant toute chose, mon devoir devait consister à faire effacer de mon état civil ce nom de Walter Anderson qui était accolé au mien.
Et, pour rester plus libre de mes actions, je descendis à l’hôtel, au lieu d’aller chercher auprès des religieuses qui m’avaient élevée l’asile respectable qu’elles ne m’auraient pas refusé.
IV
Les deux jours qui me séparaient encore du rendez-vous fixé par Me Dargile me parurent mortellement longs. Ils s’écoulèrent tout de même, et, à l’heure convenue, bouillante d’impatience, je pénétrai, pour la seconde fois, dans le cabinet du tabellion.
– Hélas ! fit-il en m’apercevant, je n’ai guère avancé dans mes recherches. Je n’ai rien de nouveau à vous communiquer.
– Rien ? dis-je, navrée.
– Rien ! D’abord, dans les papiers de Bertheim, je n’ai trouvé absolument aucune note ou fiche se rapportant, de près ou de loin, à votre affaire.
– C’est étrange, tout de même !
– Probablement que votre mariage était une chose si naturelle qu’il n’avait rien à mentionner à ce sujet.
Je hochai la tête, mal convaincue.
Il continua :
– Ensuite, je suis allé chez les sœurs de la Miséricorde. Elles m’ont confirmé ce que vous m’aviez dit déjà concernant votre voyage à Londres, qui fut imposé par votre tuteur.
– Vous voyez...
– J’ai tout particulièrement questionné la religieuse qui vous accompagna durant ce voyage...
– Et alors ?
– Elle affirme ne pas vous avoir quittée...
– Ah !
Cependant, elle se souvient que vous avez manifesté le désir d’aller assister aux offices de Bavarian Chapel, située dans Regent Street.
– En effet.
– Ne pouvant, ou ne voulant vous y accompagner, elle vous y laissa aller seule deux ou trois fois.
– Eh bien ?
– C’est là, justement, que fut célébré votre mariage avec Walter Anderson.
– Ah !... Ça, c’est le comble !
Mais, soudain, un flot de sang me monta au visage.
Un détail oublié me revenait après quatre ans et demi.
– Qu’est-ce qu’il y a ? fit le notaire, qui s’était aperçu de mon trouble.
– Un souvenir, dis-je... une coïncidence, peut-être...
– Expliquez-vous ?...
– Un jour que j’étais en prière, un couple de mariés passa devant moi. La jeune femme portait une somptueuse toilette. Elle était blonde, jolie, plutôt petite, alors que lui était très grand, très mince... Je les reconnaîtrais tous les deux, si je les revoyais... Et parce qu’elle me paraissait toute rieuse et lui très grave, je me mis à prier pour eux. Ils me semblaient mal accouplés et j’avais la curieuse impression qu’ils ne pourraient être heureux ensemble.