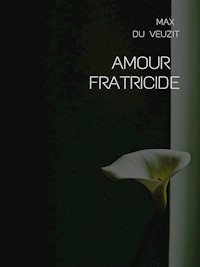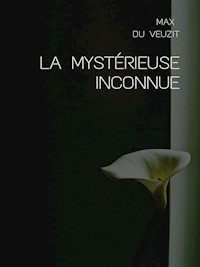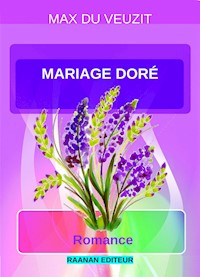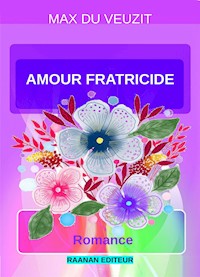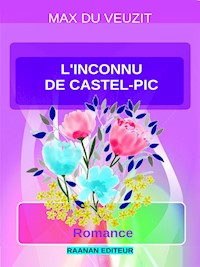1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Invité en Sologne, Lord Harry Blackfield, victime d’une chute de cheval s’éprend follement de Nicole, la fille du garde-chasse qui l’a soigné. Il l’épouse... Primesautière et rieuse la nouvelle lady ne se soucie guère des conventions. Son mari le lui reproche bientôt avec dureté : “Vous ne devez plus vous conduire comme la fille d’un garde-chasse !” lui lance-t-il un jour au comble de la fureur. D’autres scènes suivront, même après la naissance d’un fils qu’on ne laisse pas élever à Nicole. Lasse de supporter humiliation sur humiliation, submergée par l’amertume elle s’enfuit un soir... Et nul ne parvient à retrouver sa trace....|Librairie Jules Tallandier|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
SOMMAIRE
Première partie
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
Deuxième partie
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Troisième partie
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
Quatrième partie
I
II
III
IV
V
Notes
MAX DU VEUZIT
SA MAMAN DE PAPIER
Paris, 1934
Raanan Éditeur
Livre 1047 | édition 1
Sa maman de papier
Première partie
I
– Bonjour, Delphie, ma bonne Delphie ! Comme je suis contente de te voir !
Debout au seuil de la maison d’où elle guettait l’arrivée de ses maîtres, la vieille servante joignit les mains dans un geste de surprise émerveillée :
– Mam’zelle Nicole ! C’est-y Dieu possible que vous reveniez enfin ? Vous v’là ! C’est-y ben vous ?
– Mais oui, Delphie ! me voici ! Je t’assure que c’est bien moi, et bien vivante !...
Vivante, certes, elle l’était, la fraîche jeune fille qui venait de sauter lestement de la voiture arrêtée devant la porte ! Maintenant, elle s’avançait vive et légère vers Delphie et, la prenant dans ses bras, elle embrassait joyeusement les vieilles joues ridées comme des pommes sèches.
– Oui, ma bonne Delphie, je reviens pour toujours vivre à la maison. Finis le pensionnat, les braves religieuses et les camarades de classe ! Vivent papa et la liberté ! Vivent ma vieille Delphie et tous les hôtes du Ragon, y compris les chiens, les poules et les canards !
Une profonde révérence ponctua la fin de ce joyeux vivat.
Un sourire épanoui élargissait le visage de la vieille.
– Ah ! mam’zelle Nicole, toujours la même ! C’est ben vrai que vous êtes restée la chère mignonne d’autrefois... toujours gaie, toujours cajoleuse et me faisant faire toutes vos volontés !... Vous étiez ma toute petite !... Mais quand même, continuait-elle tout attendrie, vous n’êtes plus une enfant ! C’est une vraie jeune fille... bien belle et bien grande que vous v’là devenue !
– Bien sûr que je suis une vraie jeune fille ! s’écria Nicole en riant. Je viens d’avoir dix-huit ans, ne l’oubliez pas, Delphie... ! Une vraie jeune fille, c’est certain... Quant à être belle et grande, ajouta-t-elle avec une petite moue comique, ça, c’est une autre histoire !
– Oh ! si on peut dire ! murmura la vieille femme presque indignée. Moi qui n’ai jamais rien vu d’aussi mignon !
Il faut reconnaître que le dernier terme convenait, en effet, beaucoup mieux à Nicole que ceux de grande et belle. Elle était, en vérité, mignonne à souhait avec une figure régulière et douce, d’un charme indiscutable. Elle possédait de beaux yeux clairs et une chevelure châtaine presque dorée ; mais elle était plutôt petite et son expression avait quelque chose de très enfantin encore.
Si elle n’avait pas proclamé aussi fièrement ses dix-huit ans, on aurait pu ne lui en donner que quinze. Son corps, cependant, était bien proportionné, et tous ses gestes, souples et vifs, étaient harmonieux.
Elle répéta :
– Oh ! Delphie ! comme je suis contente !
Et, avant de franchir le seuil de la maison, elle se retourna vers un homme encore jeune, au visage énergique, à la peau bronzée, qui venait de descendre de la voiture et qui s’occupait à rassembler les bagages.
– Viens vite, mon papa chéri ! Laisse tous ces colis et viens me faire les honneurs de chez toi.
Elle parlait d’un ton impérieux et câlin d’enfant gâtée.
L’homme releva la tête et sourit, les yeux soudain illuminés par la grâce printanière de la petite.
– De chez nous, mon Nicou, rectifia-t-il avec tendresse.
Il entoura de son bras les épaules fragiles et c’est ainsi que tous deux entrèrent dans la grande salle du rez-de-chaussée.
– Tu vois, petite fille... rien n’est changé. Ta chambre est prête : la maison t’attend, elle aussi !
Après la belle clarté de ce matin ensoleillé, la grande salle paraissait plutôt sombre, et ce qu’on percevait avant toute chose, en entrant, c’était cette odeur particulière aux vieilles maisons de campagne où l’on conserve, très proches, les fruits du verger et où l’on fait, la majeure partie de l’année, de grands feux de bois dans un âtre séculaire.
Ce matin-là, un bon arôme de pêches mûres dominait et Nicole retrouvait, dans ce parfum aux relents de fumée, l’atmosphère accueillante de la maison qui la charmait à chacune de ses arrivées pour les vacances.
C’était bon, cela : ce plaisir de revoir les meubles familiers, si simples, en chêne noir ; le naïf bouquet de fleurs cueillies par Delphie, et jusqu’à cette impression bizarre de trouver chaque pièce de la maison plus petite qu’elle n’était restée dans son souvenir... Cela provenait, sans doute, de ses yeux habitués aux grandes salles d’étude et aux immenses dortoirs du pensionnat... une comparaison qu’involontairement sa rétine enregistrait.
Ordinairement, Nicole attachait peu d’importance aux choses familières ; elle ne venait au Ragon que pour quelques jours, ou quelques semaines, le temps des vacances. Cette fois-ci, la jeune fille examinait les aîtres avec plus d’attention ; ils prenaient pour elle un nouvel aspect... parce que la maison n’était plus un cadre passager, mais parce qu’elle allait vraiment y vivre... parce que le logis allait devenir son domaine.
Déjà, elle jetait sur les choses un coup d’œil réformateur et organisateur... Les deux mois qu’elle venait de passer en Allemagne, pour s’y perfectionner un peu dans la langue qu’elle avait apprise au pensionnat, lui avaient ouvert de nombreux aperçus sur l’utilité de certains arrangements et la commodité précieuse de quelques aménagements nouveaux.
Sa tête, à ce sujet, était farcie de projets ; mais, pour le moment, elle était toute à la joie du retour... S’il y avait des modifications à apporter dans la vieille demeure, on verrait plus tard.
Ce jour-là, elle se contentait d’être heureuse pleinement... Si heureuse, surtout, de retrouver son père !
Elle lui jeta câlinement les bras autour du cou ; et l’obligeant à se pencher un peu pour pouvoir l’embrasser, elle murmura dans un baiser, à son oreille :
– On ne va plus se quitter, mon petit papa ? As-tu pensé à ce prodige ? Je ne viens plus en vacances, cette année ! Je viens pour rester toujours auprès de toi ! C’est ça qui va être chic !
Elle se blottissait contre la solide épaule paternelle, heureuse de cette affection profonde et de cette confiance réciproque qui les unissaient tous deux et qui satisfaisaient entièrement tous les besoins de tendresse de son jeune cœur.
– Oh ! oui, mon Nicou, ta présence auprès de moi va m’être douce ! Il y a longtemps que je désire ce moment, je t’assure.
– Alors, pourquoi m’as-tu laissée, si longtemps, loin de toi ? Tu aurais dû me reprendre aussitôt après que j’avais passé mon brevet.
– Il ne le fallait pas, mon petit. Je l’ai compris et te l’ai expliqué, à ce moment-là. Notre pavillon du Ragon est un endroit charmant... quand on aime la solitude et la forêt ! Mais, enfin, il est perdu en plein bois, isolé de tout, et il faut avouer qu’il n’offre aucune ressource pour l’éducation d’une jeune fille... J’ai fait le sacrifice de me séparer de toi deux ans de plus... je peux te le dire maintenant que c’est fini...
– Oh ! père chéri ! Je l’ai bien compris... cependant...
– Il le fallait, Nicou... je voulais que tu te perfectionnes dans les arts d’agrément et, aussi, que tu vives dans un milieu gai, avec des compagnes de ton âge. À présent, tu as des amies avec qui tu correspondras et que tu inviteras ici... Je ne veux pas que tu te trouves isolée ni que tu t’ennuies auprès de ton vieux papa...
– Chut ! s’écria Nicole en mettant sa petite main sur la bouche de son père. Chut ! mon papa. Ne dis pas de vilaines choses, je ne peux, nulle part, être plus heureuse qu’auprès de toi...
Lucien Grammont sourit avec un peu de mélancolie.
« Cette enfant était sincère, aujourd’hui ; mais il savait bien qu’un jour elle désirerait autre chose... un autre amour, une autre présence...
Est-ce que cette autre tendresse serait aussi le bonheur ?
« Ah ! lui, il l’aimait tellement ! Il avait concentré sur cette unique enfant toute l’affection qu’il avait eue pour la jeune femme trop tôt ravie à son amour... pour la mère de Nicole que celle-ci avait à peine connue...
« Pour l’enfant, il avait voulu être à la fois, le père et la mère ; il avait désiré lui donner la forte protection de son cœur d’homme avec toutes les douces caresses que l’absente aurait prodiguées... Il ne fallait pas, n’est-ce pas ? que la petite fille souffrît du vide laissé, au foyer, par la mort de la maman ?... »
L’homme embrassa Nicole et conclut :
– Nous allons être aussi heureux l’un que l’autre, de ne plus nous quitter... Allons, mon petit Nicou, viens renouveler connaissance avec ta chambre et faire les ablutions nécessaires après ton long voyage... Ensuite, nous déjeunerons !
Dans sa chambre, la jeune fille trouva des roses sur la table près du lit et sur la cheminée. C’était son père lui-même qui les avait cueillies et disposées dans les vases qu’elle aimait.
Nicole sourit, un peu émue de cette attention presque féminine qu’on ne se serait pas attendu à trouver chez un être aussi énergique que l’était Lucien Grammont, premier piqueur du duc de la Muette, dont la volonté un peu rude dominait tous ses sous-ordres.
Grammont, en effet, par métier plutôt que par tempérament, était obligé de déployer une ferme autorité avec tout le personnel de chasse et de garde du puissant châtelain, il avait la haute main sur tout ce qui avait trait à la chasse, et son activité inlassable ne devait laisser rien passer qui pût nuire à la bonne tenue des équipages, pas plus qu’à la surveillance des terres et des bois dont il fallait observer le gibier.
De bonne famille, sorte de gentilhomme-fermier, Grammont avait autrefois connu des jours prospères et vécu librement sur une propriété léguée par ses parents et dont il gérait lui-même les terres.
La guerre, en le ruinant complètement, l’avait contraint à se placer chez les autres pour subvenir à son existence et aux frais d’éducation de sa petite Nicole.
Il devait sa situation actuelle à l’un de ses anciens compagnons d’armes, camarade des mauvais jours, le duc de la Muette, propriétaire d’un immense domaine, magnifiquement organisé pour les grandes chasses, et qui lui avait offert de remplir chez lui les fonctions de garde général et de premier piqueur.
Le duc était maître de l’un des derniers beaux équipages de France et se montrait aussi fier de son titre de lieutenant de louveterie que ses ancêtres l’avaient été de celui de grand veneur, porté par plusieurs d’entre eux, sous l’ancienne monarchie.
On chassait à courre sur les terres de la Muette, plusieurs fois l’an. Cela nécessitait une des plus belles meutes de ce temps et tout un personnel de gardes, de valets, de limiers et de valets de chiens, ainsi que des éleveurs et des rabatteurs, car le duc de la Muette, très moderne, ne dédaignait pas la chasse à tir et les élevages de son domaine étaient soigneusement agencés.
Gens et bêtes étaient donc sous la surveillance du père de Nicole. C’était une situation qui convenait à merveille à celui-ci. Il y jouissait d’une certaine liberté, en même temps qu’il pouvait employer son besoin d’agir, son esprit d’initiative et ses qualités d’énergie un peu rude.
On le savait juste, parfaitement probe, et aussi dur pour lui-même que pour les autres ; aussi, était-il aimé autant que respecté de ses subordonnés.
De bons appointements et le logement dans ce joli pavillon du Ragon, bâti au XVIIIe siècle, en pleine forêt, à une heure à pied du château, lui assuraient une complète indépendance.
Somme toute, Grammont était content de son sort et, le bien-être assuré pour Nicole, il ne désirait rien au-delà de l’amicale confiance que lui réservait le duc.
Parfois, il se plaisait à dire de lui-même qu’il n’était, en réalité, qu’un simple garde-chasse ; mais il faisait cette constatation sans aucune amertume et avec bonne humeur. Il avait toujours aimé la terre et les bois et ne se sentait ni gêné dans ses goûts, ni humilié devant son maître, qui, avec une simplicité de grand seigneur, le traitait en camarade comme lorsque tous deux étaient frères d’armes, dans la tranchée, et menacés des mêmes périls.
Mais ce que Grammont avait apprécié surtout dans les avantages pécuniaires de sa situation, c’était la possibilité de faire donner à sa chère Nicole une éducation digne de leur rang d’autrefois, digne surtout de la femme exquise et raffinée qu’avait été la mère de sa fillette. Il avait donc envoyé celle-ci dans un des meilleurs pensionnats des environs de Paris.
C’était un milieu de bon ton, mais assez peu ouvert à la vie moderne. La proximité de la capitale ne lui avait enlevé en rien un caractère provincial et légèrement désuet. Nicole en sortait, à dix-huit ans, suffisamment instruite, parlant l’allemand, sachant broder et coudre ; elle peignait à ravir, chantait et jouait du piano avec habileté, mais ne connaissait rien du monde et des réalités de l’existence.
Son père, d’ailleurs, la trouvait charmante ainsi. À toute la science des conventions mondaines que la petite ignorait avec tant d’insouciance, il préférait cette ingénuité, ce charme et cette aisance naturelle qu’elle apportait en toute chose.
Assis en face d’elle, à la table du déjeuner, il la contemplait avec satisfaction.
Sur la nappe éblouissante de blancheur, les assiettes de faïence fleurie, le pain frais et les fruits savoureux voisinaient avec le pichet de vin nouveau.
Au milieu de ce décor campagnard, vêtue d’une robe légère de mousseline à pois roses, Nicole avait l’air d’une petite princesse de légende, venue d’un pays lointain pour illuminer de jeunesse le pavillon silencieux sous les pins noirs.
Cependant, comme elle racontait avec gaieté une aventure qui lui était arrivée durant son voyage en Allemagne, son sourire et son entrain parurent l’harmoniser davantage encore avec ce milieu campagnard mais de bon ton.
Lucien Grammont perçut cette faculté d’adaptation chez sa fillette, et en fut ravi. Il traduisit son plaisir en ces mots :
– C’est drôle, mon petit Nicou, ce que j’éprouve à te voir là, en face de moi. Il me semble que tu y étais hier... avant-hier... toujours... Tu es si bien à cette place que je ne peux plus me rappeler comment était cette table quand tu n’y étais pas assise... Ton sourire, ton babil... je ne peux plus me figurer que j’aie pu vivre sans mon cher petit pinson !
– Tant mieux, papa ! s’écria l’enfant joyeusement. Comme ça, tu ne penseras plus jamais à me séparer de toi. Je suis contente, moi aussi d’être ici, je t’assure ! Tu vas voir comme je vais nous organiser une délicieuse vie à deux. Je veux que ton bonheur, comme ton repos, soit d’être auprès de ta Nicou.
L’homme sourit, si soudainement ému qu’une humidité eut du mal à ne point ternir son regard.
Derrière les volets à demi fermés, le soleil d’août fanait les passeroses. On entendait le joyeux bourdonnement des abeilles dans la grande lumière... Au Ragon, tout était paisible, joyeux, depuis que Nicole était assise, là, en face de l’homme...
Et Lucien Grammont souriait, n’envisageant rien d’autre que la continuation de ce tranquille bonheur.
II
L’une après l’autre, chaque fenêtre fut ouverte...
Les volets claquaient contre le mur, le minois tout rose de Nicole apparaissait un instant dans l’embrasure, puis c’était le tour d’une autre fenêtre de s’ouvrir à la clarté et à l’air vif. Au bout d’un moment, le pavillon tout entier aspirait la brise matinale par toutes ses ouvertures bâillant sur la forêt.
L’heure était encore fraîche, et Nicole profitait de ce moment où la chaleur n’était pas encore accablante pour faire la grande revue de son nouveau fief.
Évidemment, elle connaissait bien son cher pavillon du Ragon où chaque coin évoquait pour elle les meilleures heures de son enfance. Tout en souhaitant le rendre plus confortable par un aménagement intérieur plus approprié aux exigences nouvelles de la vie moderne, elle n’aurait voulu, pour rien au monde, modifier l’harmonie simple et gracieuse de la façade du XVIIIe siècle, avec ses trois grandes portes-fenêtres au rez-de-chaussée et ses lucarnes rondes éclairant les chambres du premier étage.
Le Ragon était un ancien rendez-vous de chasse comme les vieilles forêts de Sologne en cachent encore sous leurs frondaisons. C’était petit, simple et élégant.
Une seule pièce avait d’assez grandes proportions. C’était l’ancienne salle de réunion des chasseurs. Grammont y avait établi une sorte de bureau, chargé de papiers plus ou moins en ordre et où se dressaient encore la table sur laquelle il mangeait tous les jours et son vieux fauteuil, posé près du feu en hiver, près de la porte en été, où il fumait sa pipe rêveusement tous les soirs.
Cette pièce et la chambre monacale où il entrait juste pour dormir étaient les seuls endroits de la maison qu’il habitât.
Le reste du pavillon restait clos, sauf la cuisine de Delphie et la chambrette de celle-ci sous les combles.
Avec Nicole, la vie et la jeunesse étaient entrées au Ragon. Tout s’ouvrait et riait au soleil du matin, ou à la brume impalpable et légère, annonciatrice d’une splendide journée.
Dès le lendemain de son arrivée, la jeune fille avait fait son inspection, examiné les ressources cachées dans les greniers, ou le contenu précieux oublié dans les grandes armoires.
Maintenant, assise sur le parquet de sa chambre, au milieu de monceaux de mousseline blanche, la fillette combinait et taillait.
Cela dura plusieurs jours...
Au bout d’une semaine, elle alla chercher son père et le prenant par la main, elle l’entraîna jusqu’au seuil de sa petite chambre : tout y était transformé.
Le bois de lit démodé avait disparu. Un divan formé du sommier et du matelas l’avait remplacé. Les vieux rideaux de mousseline empesée, rajeunis et recoupés, voilaient les deux fenêtres rondes, tandis qu’un ancien bonheur-du-jour, un peu déverni mais d’une jolie forme, et une petite commode galbée achevaient de donner du style à cette chambrette toute simple.
– Bravo, ma Nicou ! Tu es une vraie fée !
– Et tu me permets d’aménager un peu la grande salle ?
– J’en serai enchanté, mon petit... C’est toute ma jeunesse, du temps où ta maman vivait, que tu feras renaître...
Si bien encouragée, la jeune fille s’attaqua au reste de la maison.
Tout fut bouleversé.
Par politique – et surtout parce que la cuisine était très bien en tant que cuisine – Nicole s’abstint de toucher au domaine de Delphie.
Elle fit, au contraire, beaucoup de gentils compliments à la vieille femme et obtint ainsi son aide pour ses déménagements.
Il fut convenu que le père et la fille mangeraient dans une petite pièce plus proche de l’office que la grande salle.
– De cette façon, Delphie, vous aurez moins de chemin à faire pour porter les plats...
Et la bonne vieille, toute contente, aidait de son mieux la jeune maîtresse de maison à poursuivre ses arrangements. Elle lavait et repassait, sans se plaindre, les vieilles toiles de Jouy à personnages, avec lesquelles Nicole allait donner un joli cachet à la nouvelle salle à manger.
– Oh ! not’ demoiselle ! C’est point croyable de faire tout ça si propre et si coquet, avec de vieux chiffons...
Mais le chef-d’œuvre de la jeune fille, ce fut le studio !
Ainsi s’appela, désormais, la grande salle transformée et rajeunie de la plus moderne façon possible.
Un grand divan, dans un coin couvert de cretonne fleurie ; quelques étagères pour poser les livres contre les murs ; une autre vieille cretonne, décorée d’oiseaux rouges et bleus pour faire de gais rideaux aux portes-fenêtres ; partout, sur le divan, sur les fauteuils, des coussins de couleurs vives ; partout, de grands vases de terre vernie remplis de fleurs...
Naturellement, tout cela n’avait pas été fait en un jour.
Les semaines avaient passé, les mois aussi !
Lucien Grammont, heureux de voir sa fille s’intéresser si fort à l’embellissement de la maison, l’aidait autant qu’il le pouvait. Il lui avait même fait la surprise de faire installer la T.S.F., ce qui, dans ce coin perdu de forêt, était une distraction précieuse.
Le père avait eu, un moment, la crainte de voir Nicole s’ennuyer au Ragon.
Absent la plus grande partie de la journée, très pris par ses tournées d’inspection sur tous les points de l’immense domaine où étaient disséminés les maisons des gardes et les enclos d’élevage, il avait redouté la solitude pour la jeune fille.
Mais Nicole déployait une telle activité, que le temps ne devait guère lui peser ; chaque fois que l’homme rentrait à la maison, il entendait sa fille rire ou chanter et Grammont s’était vite rassuré.
Véritablement, Nicole était heureuse. Pour le moment, cette vie active et libre suffisait à tous ses désirs...
――
Octobre était venu, la forêt avait revêtu son manteau d’or somptueux et la pourpre des châtaigniers se mêlait au jaune vif des platanes, à l’ocre sombre des chênes majestueux.
Pour la première fois, Nicole voyait les bois dans toute leur splendeur et elle se plut à accompagner son père dans ses tournées. Ils faisaient ainsi de longues promenades dans cet admirable décor d’automne.
Puis, quelques bourrasques vinrent secouer les futaies, et ce fut sur le sol un tapis merveilleux, toute la gamme des coloris aussi bien sous les pieds que sur les cimes.
Les premières bises arrivèrent, précédant les grandes chasses. Nicole attendait ce moment avec une impatiente curiosité...
Son âme, émerveillée, palpitait d’émoi au récit que lui faisait son père des pompes fastueuses d’une grande chasse à courre... Et l’enfant se demanda si elle n’avait pas apporté tant d’ardeur à l’embellissement de son logis, tout simplement parce qu’elle savait que le duc et ses invités venaient, parfois, s’y reposer...
Sans s’en rendre compte, Nicole avait peut-être tout au fond d’elle-même la nostalgie d’une autre vie... d’une vie plus riche... celle que son père et ses ascendants avaient connue autrefois…
III
Un matin, Nicole frissonna en ouvrant sa fenêtre : le froid était venu brusquement.
Les vastes étangs mélancoliques s’ourlaient de glace ; le sol durci résonnait sous les pas ; une nuit avait suffi pour faire envoler les dernières feuilles pendues encore aux arbres.
– Bientôt le duc de la Muette m’annoncera son arrivée, dit Grammont à sa fille. Les gardes m’ont signalé des traces toutes fraîches de sangliers et j’ai télégraphié au duc cette bonne nouvelle.
– Oh ! s’écria Nicole, ravie. Comme cela va m’intéresser, une chasse à courre !
– C’est surtout du travail que cela va nous donner, à tous les deux. Pendant deux ou trois jours, tu ne me verras guère ; il me faudra veiller à tout... La première chasse demande toujours un peu plus d’attention.
– Mais, moi ?
– Toi aussi tu auras des préparatifs. N’oublie pas que tu es, maintenant, la maîtresse de maison au Ragon.
– Et tu penses que la chasse sera menée par ici ?
– Sans doute... D’habitude, sauf imprévu, elle se termine du côté des Quatre-Chemins, vers l’Étang du Nord... Ce n’est pas loin d’ici et il est de tradition que les chasseurs viennent se reposer et se réchauffer au Ragon.
– Oh ! père ! Ce sera bien intimidant, tout ce monde que je ne connais pas !
– Allons, mon Nicou, ne fais pas la petite sauvage ! Le duc de la Muette sera très content de te voir, il me demande toujours de tes nouvelles... Tu le connais, celui-là ; tu sais combien il est chic avec nous... Je suis persuadé que tu seras enchantée de le recevoir.
– Oh ! oui, lui !... Mais les autres ?
– Bah ! les autres seront aussi très gentils... Pourquoi t’intimideraient-ils ? Il fera froid, ils seront contents de trouver un bon feu dans une maison si joliment arrangée par ma petite fée... Ma Nicou leur offrira un bon grog à la cannelle dont Delphie a le secret. Ce breuvage chaud achèvera de les mettre de bonne humeur. Tu verras comme tu seras ravie toi-même qu’ils soient venus au Ragon.
– Oh ! père, que tu es bon ! s’écria Nicole. Tu trouves toujours ce qu’il faut dire pour me rassurer et m’encourager.
L’homme mit un baiser ému sur le front de son enfant.
– Je désire tant, ma petite fille, te faciliter la tâche... Ta pauvre maman, malheureusement, n’est plus à tes côtés pour te guider, il faut bien que j’essaye de la remplacer.
– Mon papa chéri, fit doucement Nicole pour toute réponse.
Et tendrement la jeune fille noua ses bras autour du cou de son père et lui rendit ses caresses.
À dater de ce jour, Nicole n’eut plus qu’une pensée en tête : préparer le Ragon à recevoir les invités du duc de la Muette.
Elle voulait qu’au pavillon tout fût net et resplendissant ; la maison accueillante, parée de fleurs et offrant le plus de confort possible. Elle habitua Delphie à servir correctement et prestement une tasse de thé ou un rafraîchissement. Elle-même se voulut capable d’improviser, au pied levé, en ce coin perdu, n’importe quelle collation.
La vieille servante, sans cesse alertée par la jeune fille, bougonna bien un peu, au début :
– À mon âge, on va son petit train-train comme à l’ordinaire et tout se trouve fait tout de même sans qu’il y ait besoin de tant de répétitions !
Mais ses grosses mains malhabiles s’habituaient, à son insu, à manier adroitement les napperons de dentelle, les fines porcelaines et les légers cristaux ; si bien qu’au bout d’une semaine, Nicole, satisfaite, embrassa la vieille femme sur les deux joues en lui décernant le titre de première camériste de Sologne :
– Tu es épatante, ma bonne Delphie ! Nos visiteuses en seront émerveillées, le jour venu. Ton service sera si irréprochable qu’elles n’auront plus qu’une idée : te ravir à moi pour t’attacher à leur maison.
– Oh ! mam’zelle Nicou, voulez-vous bien vous taire ! Qu’est-ce que je ferais, à mon âge, loin de vous et de votre père ? Ça fait une vingtaine d’années que je n’ai pas quitté celui-ci... Il ferait beau voir que je vous abandonne, vous que j’ai élevée, pour aller chez des étrangers ! En voilà-t’y des idées à raconter !
– Te fâche pas, ma bonne. Je sais bien que, toi, tu ne me quitteras pas parce que je ne saurais me passer de toi ; mais je suis heureuse de pouvoir être fière de toi ; ça me fera plaisir que chacun t’admire et souhaite posséder une perle de ton espèce.
La vieille femme, flattée et attendrie, ne protesta plus. Au fond, elle était elle-même ravie de « faire voir à chacun qu’elle en connaissait autant, pour le service, que tous les laquais chamarrés de la ville et toutes les soubrettes en tabliers blancs de la terre » !
Bientôt, un télégramme du duc de la Muette au garde chef vint prévenir celui-ci de tout préparer pour la première grande chasse.
– Le duc sera demain au château, dit Grammont à sa fille. Je ne serai guère à la maison pendant quelques jours, ne t’en alarme pas.
– Est-ce que je pourrai t’accompagner, mon petit papa ? demanda Nicole.
– Non ! bien sûr ! Il ne s’agit plus de promenade, ces jours-ci, petite enfant ; il me faut préparer une belle chasse... sans aucune anicroche ! Toi-même, n’oublie rien.
– Oh ! moi ! Tout est prêt.
Mais Nicou, avec un battement de cœur d’anxiété, songea tout à coup que le plus difficile restait à faire : savoir dominer la timidité qui allait infailliblement la prendre devant tout ce monde !
IV
La chasse battait son plein ; la forêt résonnait des appels de trompe et du son des cors.
De grand matin, Nicole avait accompagné son père au château et elle avait assisté au départ de l’équipage : le duc de la Muette et ses invités en habit rouge et argent, la meute menée par les valets affairés et Grammont si jeune et si chic dans son beau costume de piqueur.
Nicole n’avait pas vu un tel spectacle depuis sa petite enfance. Au moment des grandes chasses, chaque année, en effet, elle était au pensionnat. Elle fut vraiment heureuse, cette fois, d’avoir été présente en cette occasion.
Quand l’équipage se fut éloigné, la jeune fille rentra en hâte au pavillon. Il y avait bien une heure de marche du château de la Muette au Ragon et, comme nul ne pouvait prévoir combien de temps durerait la chasse, il ne fallait pas qu’elle se mît en retard pour recevoir le châtelain et ses hôtes.
Au pavillon, tout était prêt pour leur faire bon accueil : un grand feu flambait dans l’immense cheminée et les fleurs étaient répandues partout, du chrysanthème pourpré aux dernières feuilles dorées de l’automne.
Le pâle soleil de novembre avait dépassé au ciel son point culminant... la journée avançait... Nicole et Delphie attendaient.
La chasse s’était certainement rapprochée... Elles avaient entendu sonner « la vue » depuis un long moment... puis, plus rien maintenant. Mais soudain, avant d’avoir perçu de nouveau les trompes, un grand mouvement se fit autour du pavillon. On eût dit une troupe piétinant le sol durci... Elles distinguèrent des pas de chevaux, des bruits de voix qui se rapprochaient.
Curieuses, penchées vers la fenêtre de la cuisine, les deux femmes essayaient d’apercevoir quelque chose.
Mais ce fut derrière elles, dans le studio, que la porte s’ouvrit. Et Nicole vit entrer son père avec le duc de la Muette.
Tous deux paraissaient fort affairés... Et voici que derrière eux, à la place des invités attendus, ce furent quatre des plus vigoureux valets qui pénétrèrent dans la salle. Ils portaient sur un brancard improvisé fait de branches d’arbres et de sangles, un grand jeune homme blond, aux yeux clos et aux traits contractés par la souffrance.
Une angoisse serra le cœur sensible de Nicole. Elle pâlit et courut vers son père :
– Qu’y a-t-il ? demanda-t-elle d’une voix étouffée.
– Un accident.
– Il est mort ?
– Non, répondit Lucien Grammont. Calme-toi, mon petit Nicou. Un cousin de M. de la Muette, lord Blackenfield, a fait une chute de cheval... Ce n’est peut-être pas grave du tout !... Écoute, va trouver Delphie et dis-lui qu’elle prépare tout de suite une coupe de son fameux grog, ce sera excellent pour le blessé.
Ayant trouvé ce moyen d’éloigner sa fille et de lui donner en même temps un rôle utile, ce qui était la meilleure manière d’apaiser son émotion, Grammont revint s’occuper du blessé.
On l’avait étendu sur le divan ; bien calé par les coussins, il semblait moins souffrir que pendant le transport sur ce brancard rudimentaire.
Le duc de la Muette s’était approché de lui et lui avait pris le poignet.
– Le pouls est bon, dit-il.
Le blessé ouvrit les yeux et les promena, un peu vagues, sur les personnes et les choses qui l’entouraient. Comme il les refermait, le châtelain s’informa :
– Eh bien ! Harry, comment vous sentez-vous ?
– Oh ! bien... merci... je pense... très bien... répondit le jeune homme avec un fort accent anglais.
– Très bien, c’est peut-être beaucoup dire, reprit le duc en souriant. Vous avez eu un fameux choc...
– Oui... je suis choqué... considérablement ! J’ai perdu ma propre science... je crois ?
– Votre propre science ?... Ah ! oui !... perdu conscience, voulez-vous dire ?
– Yes.
– Oui, mais pas longtemps... Vous êtes vraiment énergique et résistant, mon cousin... un type épatant !
– No, pas épatant ! Je suis un solide garçon, protesta Harry très modeste.
Il voulut bouger.
– Aïe ! gémit-il. Je crois seulement je suis un peu cassé...
– Vous souffrez beaucoup.
– Yes, la jambe... Là, c’est cassé... et le côté..., aï ! très malade aussi !
Grammont achevait de caler avec des coussins la jambe douloureuse quand un serviteur que le duc de la Muette avait envoyé au château, aussitôt après l’accident, revint rendre compte de sa mission :
– J’ai téléphoné à la ville, au chirurgien, monsieur. Il va venir.
– Est-ce à lui que tu as parlé ?
– Oui, monsieur, à lui-même.
– Et il va venir tout de suite ?
– Il a dit qu’il prenait son auto et qu’il serait ici dans un quart d’heure... avec l’infirmière.
– Parfait ! fit le duc de la Muette, qui s’inquiétait du sort de son ami.
Il s’était éloigné du divan où Harry reposait et il expliquait au garde :
– Mon bon Grammont, je crains que mon cousin ne soit pas transportable... Dans ce cas, vous devriez le garder ici quelques jours et cela va vous donner bien du mal... Si, si, ne protestez pas !... En tout cas, j’ai fait demander une infirmière qui s’occupera entièrement de tous les soins à donner au blessé.
À ce moment, la porte s’ouvrit et Nicole entra, un bol de grog fumant dans les mains. Elle s’arrêta au pied du divan et, silencieusement, regarda le jeune homme allongé, hésitant à le déranger.
Mais comme s’il avait deviné une présence féminine à ses côtés, lord Blackenfield ouvrit les yeux.
Il aperçut, à travers la vapeur légère qui s’élevait du liquide brûlant, le frais visage, rose d’émotion, entre les boucles brunes ; puis, il distingua le buste frêle et gracieux, moulé dans un pull-over de neigeuse laine angora... Et il oublia de parler français !
– Oh ! lovely ! s’écria-t-il. Very lovely, indeed !
Nicole comprenait un peu l’anglais. Elle rougit comme un coquelicot... Cependant, elle n’aurait pu dire si c’était son geste hospitalier que le jeune lord trouvait tellement aimable ou si, tout simplement, ce n’était pas sa petite personne elle-même.
V
Harry se réveilla au petit jour.
La lumière indécise d’un matin de novembre glacé entrait par les portes-fenêtres dont on n’avait pas tiré les volets.
Le blessé avait dormi d’un sommeil profond, grâce à la piqûre de morphine avec laquelle l’infirmière, la veille au soir, avait calmé sa douleur, très vive après le premier pansement.
Il se réveillait donc la tête lourde, à la fois engourdi et fiévreux, et ne sachant plus du tout comment il se trouvait dans cette grande pièce aux rideaux de cretonne fleurie, dont l’aspect confortable et rustique n’éveillait en lui aucun souvenir.
Dehors, le vent soufflait presque en tempête avec ce bruit particulier qu’il fait dans les forêts, à travers les grands arbres, et qui rappelle le chant des orgues.
« Une maison inconnue... dans une forêt ! Hello !... vous ne rêvez pas, vieux camarade ? » se demanda-t-il à lui-même.
Puis, après une longue minute d’observation :
« No, je ne rêve pas... Je n’ai pas encore bu le cocktail... Et je pense qu’il y a sortilège : je suis dans le pays de Merlin, livré aux enchanteurs... En vérité, il n’y a pas autre chose à croire... »
Il voulut se soulever, mais une douleur aiguë dans les côtes le fit retomber, épuisé, sur l’oreiller.
« Aïe ! tout à fait ça ! Prisonnier dans le lit !... Maléfice ! envoûtement ! Oh ! mais je n’aime pas cette chose ! »
Et il chercha à se retourner pour fuir la courbature que sa position couchée sur le dos semblait augmenter.
Mais à ce second mouvement, la mémoire lui revint subitement.
« Aïe ! je sais : pris par la patte... et les côtes en capilotade ! C’est cassé... voilà... C’est gai ! »
Non, ce n’était pas gai du tout, et Harry laissa percer sa mauvaise humeur par un grognement qui exprimait clairement sa rage de se sentir immobilisé au fond des bois, dans un coin perdu de Sologne.
« Pas bouger et trop penser, ça vaut les brouillards de Londres... Très mauvais, très mauvais ! Cher vieux camarade, vous allez fréquenter le spleen et celui-ci n’est pas un bon compagnon. »
Maintenant, le jeune homme se rappelait nettement les circonstances qui le retenaient dans cette chambre.
La veille au soir, le docteur était venu...
Après avoir palpé dans tous les sens le côté douloureux et la jambe déjà enflée, l’homme de science avait diagnostiqué :
– Trois côtes cassées et fracture du péroné... peut-être même fêlure du tibia... Rien de grave... Si, si ! avait-il ajouté devant la protestation du patient qui désignait sa jambe en grimaçant de douleur... rien de grave ! En fin de compte, la consolidation se fera sans aucun fléchissement ni aucun raccourcissement de la jambe.
Harry se souvenait que ce diagnostic lui avait été agréable.
En somme, c’était le principal : il n’avait aucune lésion sérieuse.
Malheureusement, le chirurgien avait parlé de repos obligatoire.
– Trois semaines de patience, un mois peut-être. À cette condition, il n’y paraîtrait plus.
Le beau et solide garçon qu’était Harry aurait trouvé absolument insupportable l’idée de rester boiteux ou même d’être gêné dans ses mouvements pour le reste de sa vie.
Ce matin-là, il se répétait donc, comme une parole de bon augure :
« Aucun raccourcissement. Bon ! All right !... Mais un mois ici, ça n’est pas gai, l’immobilité, la solitude ; très frigorifique, cette chose ! »
À ce moment, la porte de sa chambre s’ouvrit doucement.
Harry, sans bouger le torse, tourna la tête vers l’arrivante et, bien décidé à ne pas permettre à son caractère de s’assombrir, il observa gaiement :
– Oh ! Yes !... C’est le pays des fées qui continue... Et voilà la... comment on l’appelle ?... Oh ! oui !... La fée Carabosse... All right !
Il rit tout haut et prononça avec son fort accent anglais :
– Bonjour !
Delphie, qui entrait, toute courbée, un gros fagot dans les bras, avait, en effet, quelque ressemblance avec la fée Carabosse, mais elle venait ranimer le feu et non jeter un mauvais sort.
Elle posa son bois dans la haute cheminée et s’approcha du blessé.
– Bien le bonjour, monsieur le duc... Monsieur le duc a bien dormi ?
Tout ce qui avait un titre, pour Delphie, était « monsieur le duc ».
Lord Blakenfield, ne comprenant pas exactement qu’il s’agissait de lui, hocha la tête avec un bon sourire à l’adresse de la fée Carabosse :
– Très généreuse, la vieille fée, il donnait du titre à moi et me prenait pour mon cousin !
Le feu flambait clair dans l’âtre ancien quand Delphie s’en alla. Et, lui succédant presque aussitôt, l’infirmière, tout en blanc, commença après elle, avec une aisance professionnelle, à vaquer aux soins du blessé.
C’était une femme un peu forte, sans beauté et sans grâce ; sa parole était brève, son sourire plutôt rare.
Lord Harry, qui, des yeux, suivait tous ses gestes, ne put que se répéter à lui-même :
« Trois semaines comme ça, ce sera gai !... Oh ! yes... ce sera gai ! »
Et il se renfermait lui-même dans un silence d’enfant boudeur.
Tout de même, son dépit ne l’empêchait pas de penser :
« N’y avait-il pas autre chose, dans cette maison, que cette austère et blanche Mlle Thomas ? que cette bonne vieille fée Carabosse ?... D’autres habitants ? »