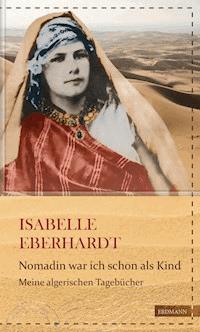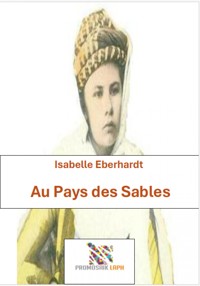
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Isabelle Eberhardt (1877-1904) était une exploratrice et écrivaine suisse d'origine russe. Sa vie était brève, mais intense, celle d'une femme voyageuse qui, vers 1900, entreprit un voyage au Maghreb déguisée en homme et se convertit à l'islam. En 1897, Isabelle s'installe avec sa mère à Bona, en Algérie, où son frère Augustine s'est enrôlé dans la Légion étrangère. Avec son frère Isabelle, il se convertit à la religion islamique. Après la mort de sa mère, elle retourna à Genève pour repartir ensuite pour l'Afrique du Nord en 1899. A seulement 22 ans, à partir de Tunis, Isabelle explore le Sahara, le Souf algérien et le Sahel tunisien. Le Maghreb devint sa patrie d'adoption. Elle aimait la communication et au cours de ses voyages, elle parlait avec le peuple et avec des personnes de tous les horizons. Elle fréquentait des prostituées, des vagabonds, des érudits, des cheikhs, des légionnaires, des bédouins, des galériens, des marabouts. Elle épousa ensuite un Français naturalisé musulman. Dans ce récit de voyage, intitulé Au Pays des Sables, Isabelle nous parle d'un voyage des sens qu'elle décrit de manière précise et pleine d'éléments poétiques. Elle parle de détails et décrit la vie quotidienne du peuple avec une grande empathie. Sa narration est réaliste et en même temps imprégnée d'une dimension onirique.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Droits d'auteur : Isabelle Eberhardti
Cover : Samir Tahadjrit
Une publication de ProMosaik LAPH
Impression : EPUBLI
Prinzessinnenstraße 20
10969 Berlin
Tous droits réservés.
Isabelle Eberhardt à 18 ans (en matelot). Source : Au pays des sables », s.d. et ni identification d’auteur.
Isabelle Eberhardt-Si Mahmoud. Source : Isabelle Eberhardt, Trimardeur, s.d. et ni identification d’auteur pour la photo.
Doctorat
Genève, avril 189…
Aujourd’hui, la soirée était tiède et de longs nuages blancs flottaient au-dessus des dentelures encore neigeuses du Jura. Il y avait pourtant dans l’air une grande langueur, une paix d’attente, avant la grande poussée de vie de mai.
Je sais bien qu’en passant les heures indéfiniment prolongées assise à ma fenêtre, à contempler, à travers le paysage familier de cette banlieue mélancolique, ma propre tristesse, je perds les fruits du labeur acharné, presque sincère de tout le semestre d’hiver… Mais l’ennui du présent et sa monotonie m’accablent et, comme toujours, je me plonge dans la vie contemplative.
… Tandis que je réfléchissais à toutes les inutilités morales s’accumulant de plus en plus autour de moi, on frappa.
C’était une jeune fille inconnue, petite et frêle, avec un pâle visage triste encadré de cheveux bruns et bouclés, coupés d’assez près.
Elle m’aborda en russe, avec un sourire doux : « Je viens de la part du Comité de secours des étudiants russes. Je viens d’arriver de Russie pour terminer mes études médicales et suis sans aucunes ressources. On m’a dit que, comme secrétaire du Comité, vous pourriez vous occuper de me trouver un logement. »
Dans ce petit monde très à part des étudiants russes, épris du rêve socialiste ou de celui, plus vaste, de l’anarchie, il est une grande sincérité de convictions : le devoir social de l’aide mutuelle est envisagé franchement et comme une nécessité absolue de la vie. La fausse et inique honte du pauvre est anéantie, remplacée par le sentiment du droit absolu à la vie.
Chouchina m’adressa donc sa demande sans gêne ni réticences, simplement.
Je lui offris une chambrette attenante à la mienne et elle y restera jusqu’à la fin de ses études.
Elle est Sibérienne, fille de petits bourgeois d’Ienisseïsk. Son but est de passer au plus vite son doctorat et de retourner là-bas secourir ses frères, dont elle parle avec attendrissement.
Elle se reconnaît un très humble, un très obscur soldat de la grande armée des précurseurs. Ce rôle la fait vivre et elle est heureuse.
Ah ! ce bonheur des fanatiques qui passent leur existence dans un rêve d’absolu !
Dans l’univers, Chouchina ne voit que l’homme – la bête aussi – au second plan. Il y a tout un monde de sensations – les plus subtiles – qu’elle n’a jamais abordé et qui lui est indifférent.
Comme caractère, beaucoup de sérieux, de modestie et de douceur. En résumé, charmante petite camarade avec laquelle je ne serai jamais en conflit.
3 mai.
Chouchina est d’une discrétion, d’un tact parfait dans la vie commune. Elle respecte mes rêveries, supporte mes trop fréquentes sautes d’humeur qu’elle accueille en souriant, tâchant de m’adoucir les heures noires d’angoisse provenant tellement de causes diverses et ténues qu’elle semble ne pas en avoir du tout… ces heures lourdes que je traverse depuis quelque temps.
Sous notre familiarité discrète de langage, il n’y en a pas d’esprit, car nous sommes très différentes, mais Chouchina est l’une des rares natures dont la présence autour de moi ne m’irrite ni ne m’ennuie. Mon attachement pour elle est basé, certes, sur un sentiment très égoïste de bien-être personnel… Mais le sait-elle seulement ?
Pour elle, cette médecine que nous étudions ensemble n’est ni un métier, ni un art : c’est un sacerdoce. Pour elle, Chouchina servira l’humanité. Parfois, elle s’étonne de me voir sourire de ses théories, quand elle sait que toute souffrance m’affecte profondément, quand elle voit que je souffre plus intensément qu’elle-même, peut-être, de voir souffrir.
… Elle est très frêle. Il semblerait que le moindre souffle devrait faire vaciller la petite flamme vive de son existence… Et cependant, elle est d’une activité menue et silencieuse de fourmi, d’un dévouement perpétuel et patient. Elle semble aussi inaccessible au découragement qu’à l’enthousiasme.
Juillet.
Chouchina m’inquiète. Sa santé est bien plus chancelante que je ne le croyais. Elle a depuis quelques jours des faiblesses. Son sommeil est troublé et elle se réveille baignée de sueur froide. Elle tousse…
Et, parfois, depuis que, plus attentivement, je l’observe, je surprends dans le regard jadis si calme de ses grands yeux gris lilas, une expression de crainte, presque d’angoisse. Mais elle ne se plaint pas, elle se soigne consciencieusement et continue son travail obstiné : en octobre, elle doit passer son doctorat.
À l’inquiétude réelle que j’éprouve, je vois que, peu à peu, inconsciemment, je me suis attachée à ce petit être qui tient si peu de place et qui, sous des dehors de faiblesse et d’effacement, est vaillant et bon.
Je lui ai parlé de sa santé. Alors, avec un sourire très calme, elle m’a répondu :
– Mais oui : je suis phtisique… il y a longtemps. Quand j’étais infirmière au dépôt de Tioumène, où passent les émigrants russes s’en allant en Sibérie, j’ai ressenti les premiers symptômes. Seulement, depuis lors, je m’observe et je me soigne. Je voudrais passer mon doctorat avec succès et, après, avoir quelques années devant moi pour travailler.
À ces derniers mots, une ombre grise passa dans son regard… Elle ne veut pas approfondir cette question. Elle ne veut pas laisser son angoisse se formuler… Elle en a peur.
Il y a une douloureuse incompatibilité entre les exigences contraires de son état de santé, car elle traverse une crise dangereuse, et celles aussi tyranniques du travail assidu et complexe qui lui incombe.
Et moi, admirant ce courage tranquille et ce vouloir de vivre et d’être utile, je ne puis rien pour elle, car elle n’a besoin ni d’encouragement, ni de consolations.
Elle ne veut pas consulter un médecin, disant qu’elle sait très bien ce qu’elle a et ce qu’elle doit faire… Et là encore, je devine une secrète faiblesse : n’a-t-elle pas peur d’entendre un autre dire tout haut, avec des mots d’une désespérante netteté, ce qu’elle pense ?
Octobre.
Pendant ces trois mois qui viennent de s’écouler, son état a été stationnaire. Par des prodiges de soins et surtout d’énergie, malgré le prorata très restreint de nos ressources – une brouille passagère avec ma famille me laisse sans subsides pour le moment – Chouchina s’est maintenue sur pied et à l’œuvre. Seulement, l’inquiétude de son regard s’accentuait souvent et semblait presque de l’épouvante.
Cependant, la sérénité de son caractère ne diminuait point, ni son assiduité au travail.
Visiblement, elle maigrissait. La petite toux brève et sèche était devenue presque continuelle.
Il y a peu de jours, elle se décida à consulter notre amie,
Marie Edouardowna, doctoresse experte et bienveillante…
À moi, Marie Edouardowna dit avec une gravité attristée :
Marie Edouardowna hocha la tête dubitativement.
Quand je rejoignis Chouchina, elle était assise sur son lit, inactive par extraordinaire, m’attendant. Je fus frappée du regard anxieux, interrogateur, presque sévère qu’elle darda sur moi, me révélant la lutte atroce qui s’était engagée en elle entre la certitude dictée par son intelligence lucide, savoir et le vouloir de vivre, obstiné, et l’espérance vivace.
J’eus de la peine à dominer l’émotion qui m’envahit sous ce regard et à lui dire :
Pour la première fois devant moi, Chouchina eut un mouvement de révolte à la fois et de faiblesse.
Elle joignit convulsivement les mains :
Elle se tut et, après un long silence, elle se leva, souriante de nouveau.
Depuis lors, elle dure, toujours semblable, quoique d’heure en heure plus faible… Et je sens que le vide qu’elle laissera auprès de moi sera profond… bien plus profond que je ne l’aurais supposé avant la certitude de sa mort prochaine.
Mardi, 28 octobre.
Chouchina est morte vendredi à la nuit.
Elle est restée alitée huit jours. Le vendredi, très faible, oppressée et toussant beaucoup, elle avait voulu assister à un cours qui l’intéressait. Elle rentra assez tard et me dit :
Je lisais.
Tout à coup, j’entendis un râle étouffé dans la chambre de Chouchina dont la porte restait entr’ouverte.
J’entrai.
Assise sur le lit, les mains crispées sur la couverture, les yeux brillants, elle regardait dans le vague. Elle me vit.
Je fus effrayée du changement de sa voix, saccadée et fébrile.
Mais son agitation croissait.
Elle avait le délire. Brusquement, elle retomba sur son oreiller, les yeux clos, tranquille… Profitant de cette accalmie, je montai chercher un camarade interne à l’Hôpital cantonal et nous passâmes la nuit au chevet de Chouchina, tantôt agitée, tantôt plongée en un marasme qui nous effrayait.
Elle ne reprit plus connaissance que pour de courts instants, redevenant tout de suite la proie des hallucinations sombres qui crispaient d’effroi les muscles de son visage décoloré, tout semblable à une fleur fanée et qui voilaient le regard plus bleu, plus immatériel.
Toutes les fois qu’elle sortait de ce cauchemar pesant, elle manifestait une croissante angoisse, réclamant désespérément les journaux du jour pour voir la date, démêlant, à travers le brouillard qui troublait déjà son intelligence, notre supercherie.
Une fois qu’elle était plus calme, elle prit la main de l’interne Vlassof, et lui dit d’un ton suppliant, avec un regard d’une tristesse infinie : « Vlassof ! Cher ami… Dites-moi la vérité ! Vous savez que je ne vivrai plus longtemps… Il ne faut pas me faire manquer cette session… L’autre est si loin. Prévenezmoi la veille, et je serai sur pied, je vous assure… »
La volonté de durer, de parfaire son œuvre était si forte en elle qu’elle s’illusionnait sur son état, croyant en la toutepuissance de la volonté.
Mais ces accalmies étaient brèves, et le sombre délire de la fin la reprenait presque aussitôt.
Elle craignait surtout la solitude. Elle voulait être veillée, comme si elle eût redouté l’apparition d’un fantôme déjà entrevu, mais que notre présence éloignait…
Parfois, elle croyait être aux examens et, dans le silence des nuits angoissées, elle répétait des formules, s’efforçant de les expliquer, de tirer une à une, péniblement, ses idées du grand vague, où son esprit flottait déjà.
Chose étrange, pas un seul instant elle ne perdit la notion très nette de la nécessité de se soigner et elle se laissait faire avec une soumission absolue.
Le dernier jour, elle fut plus calme, silencieuse, son regard déjà atone et indifférent flottait au loin. Sans nous voir, elle fixait ses yeux sur nous, et semblait regarder à travers nos corps, très loin.
Son corps décharné, son visage devenu anguleux paraissaient à peine dans les draps blancs du grand vieux lit à deux places, sur l’oreiller où sa tête légère faisait une presque imperceptible dépression.
Marie Edouardowna nous dit :
– Il ne faut pas la quitter. C’est tout à fait la fin.
Et Vlassof et moi nous demeurions là, assis près d’elle, silencieux comme ceux qui veillent les morts.
La journée fut longue dans cette attente d’une chose redoutée, inexorable.
Depuis plusieurs jours, Chouchina n’avait plus parlé des examens, ni demandé les dates des jours qui s’écoulaient.
C’était le jour des examens, et nous nous réjouissions de cet oubli où Chouchina semblait être plongée.
Vers cinq heures, tandis que le crépuscule froid d’automne assombrissait la chambre, Chouchina commença à parler. Ce fut d’abord un murmure inintelligible, entrecoupé. Puis, rapprochés, attentifs, nous entendîmes :
Avec une lucidité surprenante, malgré nos supercheries, elle se souvint des jours et des dates… Plus elle approchait de cette date fatale du 15, et plus son agitation grandissait.
Tout à coup, elle se souleva, s’assit, étendant les bras devant elle… Ses yeux étaient grands ouverts, ses joues colorées, ses lèvres sèches tremblaient.
Elle rejeta les couvertures et voulut se lever. Mais elle retomba sur le lit, d’une pâleur livide, les yeux clos.
Un hoquet bref et fréquent la secoua tout entière.
Puis Chouchina se calma. Elle rouvrit les yeux… nous regarda et, pour la première fois depuis qu’elle était alitée, son regard fut, comme jadis, pleinement conscient et profond… d’une profondeur d’abîme.
Elle nous sourit, doucement, tristement.
Après un long silence, elle ajouta, avec une ironie d’une amertume affreuse :
Puis, sa main blanche, allongée, sa petite main de morte se tendit vers les livres que, sur ses instances, nous avions dû laisser près de son lit… Elle prit un mince traité et, d’un grand effort, l’attira sur sa poitrine… Elle ferma les yeux et garda le silence, serrant le livre comme une chose chère, contre sa poitrine oppressée.
Lentement, deux larmes, lourdes, des larmes d’enfant, coulèrent de dessous ses paupières closes, sur ses joues creuses… son visage exprimait une désolation sans bornes, mais sans révolte, douce et résignée…
Son corps se tendit un peu, ses mains se crispèrent sur le livre, puis devinrent inertes. Ses yeux s’ouvrirent à demi-vides…
Un grand silence régna dans la chambre étroite où, silencieusement, Vlassof pleurait, dans la lueur rose de la lampe à abat-jour…
Dans la rue, des étudiants allemands passèrent en chantant un air alerte, fêtant leurs probables succès aux examens…
Yasmina conte algérien
Au pays des sables : Paysage de l’Aurès au Crayon.
Elle avait été élevée dans un site funèbre où, au sein de la désolation environnante, flottait l’âme mystérieuse des millénaires abolis.
Son enfance s’était écoulée là, dans les ruines grises, parmi les décombres et la poussière d’un passé dont elle ignorait tout.
De la grandeur morne de ces lieux, elle avait pris comme une surcharge de fatalisme et de rêve. Étrange, mélancolique, entre toutes les filles de sa race : telle était Yasmina la Bédouine.
Les gourbis de son village s’élevaient auprès des ruines romaines de Timgad, au milieu d’une immense plaine pulvérulente, semée de pierres sans âge, anonymes, débris disséminés dans les champs de chardons épineux d’aspect méchant, seule végétation herbacée qui pût résister à la chaleur torride des étés embrasés. Il y en avait là de toutes les tailles, de toutes les couleurs, de ces chardons : d’énormes, à grosses fleurs bleues, soyeuses parmi les épines longues et aiguës, de plus petits, étoilés d’or… et tous rampants enfin, à petites fleurs rose pâle. Par-ci par-là, un maigre buisson de jujubier ou un lentisque roussi par le soleil.
Un arc de triomphe, debout encore, s’ouvrait en une courbe hardie sur l’horizon ardent. Des colonnes géantes, les unes couronnées de leurs chapiteaux, les autres brisées, une légion de colonnes dressées vers le ciel, comme en une rageuse et inutile révolte contre l’inéluctable Mort…
Un amphithéâtre aux gradins récemment déblayés, un forum silencieux, des voies désertes, tout un squelette de grande cité défunte, toute la gloire triomphante des Césars vaincue par le temps et résorbée par les entrailles jalouses de cette terre d’Afrique qui dévore lentement, mais sûrement, toutes les civilisations étrangères ou hostiles à son âme…
Dès l’aube quand, au loin, le Djebel Aurès s’irisait de lueurs diaphanes, Yasmina sortait de son humble gourbi et s’en allait doucement, par la plaine, poussant devant elle son maigre troupeau de chèvres noires et de moutons grisâtres.
D’ordinaire, elle le menait dans la gorge tourmentée et sauvage d’un oued, assez loin du douar.
Là se réunissaient les petits pâtres de la tribu. Cependant, Yasmina se tenait à l’écart, ne se mêlant point aux jeux des autres enfants.
Elle passait toutes ses journées, dans le silence menaçant de la plaine, sans soucis, sans pensées, poursuivant des rêveries vagues, indéfinissables, intraduisibles en aucune langue humaine.
Parfois, pour se distraire, elle cueillait au fond de l’oued desséché quelques fleurettes bizarres, épargnées du soleil, et chantait des mélopées arabes.
Le père de Yasmina, El hadj Salem, était déjà vieux et cassé. Sa mère, Habiba, n’était plus, à trente-cinq ans, qu’une vieille momie sans âge, adonnée aux durs travaux du gourbi et du petit champ d’orge.
Yasmina avait deux frères aînés, engagés tous deux aux Spahis. On les avait envoyés tous deux très loin, dans le désert. Sa sœur aînée, Fathma, était mariée et habitait le douar principal des Ouled-Mériem. Il n’y avait plus au gourbi que les jeunes enfants et Yasmina, l’aînée, qui avait environ quatorze ans.
Ainsi, d’aurore radieuse en crépuscule mélancolique, la petite Yasmina avait vu s’écouler encore un printemps, très semblable aux autres, qui se confondaient dans sa mémoire.
Or, un soir, au commencement de l’été, Yasmina rentrait avec ses bêtes, remontant vers Timgad illuminée des derniers rayons du soleil à son déclin. La plaine resplendissait, elle aussi, en une pulvérulence rose d’une infinie délicatesse de teinte… Et Yasmina s’en revenait en chantant une complainte saharienne, apprise de son frère Slimène qui était venu en congé un an auparavant, et qu’elle aimait beaucoup :
« Jeune fille de Constantine, qu’es-tu venue faire ici, toi qui n’es point de mon pays, toi qui n’es point faite pour vivre dans la dune aveuglante…
« Jeune fille de Constantine, tu es venue et tu as pris mon cœur, et tu l’emporteras dans ton pays… Tu as juré de revenir, par le Nom très haut… Mais quand tu reviendras au pays des palmes, quand tu reviendras à El Oued, tu ne me retrouveras plus dans la DEMEURE DES PLEURS… Cherche-moi dans la DEMEURE DE L’ÉTERNITÉ… »
Et doucement, la chanson plaintive s’envolait dans l’espace illimité… Et doucement, le prestigieux soleil s’éteignait dans la plaine…
Elle était bien calme, la petite âme solitaire et naïve de Yasmina… Calme et douce comme ces petits lacs purs que les pluies laissent au printemps pour un instant dans les éphémères prairies africaines, et où rien ne se reflète, sauf l’azur infini du ciel sans nuages…
Quand Yasmina rentra, sa mère lui annonça qu’on allait la marier à Mohammed Elaour, cafetier à Batna.
D’abord, Yasmina pleura, parce que Mohammed était borgne et très laid et parce que c’était si subit et si imprévu, ce mariage.
Puis, elle se calma et sourit, car c’était écrit. Les jours se passèrent. Yasmina n’allait plus au pâturage. Elle cousait, de ses petites mains maladroites, son humble trousseau de fiancée nomade.
Personne, parmi les femmes du douar, ne songea à lui demander si elle était contente de ce mariage. On la donnait à Elaour, comme on l’eût donnée à tout autre Musulman. C’était dans l’ordre des choses, et il n’y avait là aucune raison d’être contente outre mesure, ni non plus de se désoler.
Yasmina savait même que son sort serait un peu meilleur que celui des autres femmes de sa tribu, puisqu’elle habiterait la ville et qu’elle n’aurait, comme les Mauresques, que son ménage à soigner et ses enfants à élever.
Seuls les enfants la taquinaient parfois, lui criant : « Marteel-Aour ! – La femme du borgne ! » Aussi évitait-elle d’aller, à la tombée de la nuit, chercher de l’eau à l’oued, avec les autres femmes. Il y avait bien une fontaine dans la cour du « bordj » des fouilles, mais le gardien Roumi, employé des Beaux-Arts, ne permettait point aux gens de la tribu de puiser l’eau pure et fraîche dans cette fontaine. Ils étaient donc réduits à se servir de l’eau saumâtre de l’oued où piétinaient, matin et soir, les troupeaux. De là, l’aspect maladif des gens de la tribu continuellement atteints de fièvres malignes.
Un jour, Elaour vint annoncer au père de Yasmina qu’il ne pourrait, avant l’automne, faire les frais de la noce et payer la dot de la jeune fille.
Yasmina avait achevé son trousseau et son petit frère Ahmed qui l’avait remplacée au pâturage, étant tombé malade, elle reprit ses fonctions de bergère et ses longues courses à travers la plaine.
Elle y poursuivait ses rêves imprécis de vierge primitive, que l’approche du mariage n’avait en rien modifiés.
Elle n’espérait ni même ne désirait rien. Elle était inconsciente, donc heureuse.
Il y avait alors à Batna un jeune lieutenant, détaché au Bureau Arabe, nouvellement débarqué de France. Il avait demandé à venir en Algérie, car la vie de caserne qu’il avait menée pendant deux ans, au sortir de Saint-Cyr, l’avait profondément dégoûté. Il avait l’âme aventureuse et rêveuse.
À Batna, il était vite devenu chasseur, par besoin de longues courses à travers cette âpre campagne algérienne qui, dès le début, l’avait charmé singulièrement.
Tous les dimanches, seul, il s’en allait à l’aube, suivant au hasard les routes raboteuses de la plaine et parfois les sentiers ardus de la montagne.
Un jour, accablé par la chaleur de midi, il poussa son cheval dans le ravin sauvage où Yasmina gardait son troupeau.
Assise sur une pierre, à l’ombre d’un rocher rougeâtre où des genévriers odorants croissaient, Yasmina jouait distraitement avec des brindilles vertes et chantait une complainte bédouine où, comme dans la vie, l’amour et la mort se côtoient.
L’officier était las et la poésie sauvage du lieu lui plut.
Quand il eut trouvé la ligne d’ombre pour abriter son cheval, il s’avança vers Yasmina et, ne sachant pas un mot d’arabe, lui dit en français :
Sans répondre, Yasmina se leva pour s’en aller, inquiète, presque farouche.
Mais elle fuyait l’ennemi de sa race vaincue et elle partit.
Longtemps, l’officier la suivit des yeux.
Yasmina lui était apparue, svelte et fine sous ses haillons bleus, avec son visage bronzé, d’un pur ovale, où les grands yeux noirs de la race berbère scintillaient mystérieusement, avec leur expression sombre et triste, contredisant étrangement le contour sensuel à la fois et enfantin des lèvres sanguines, un peu épaisses. Passés dans le lobe des oreilles gracieuses, deux lourds anneaux de fer encadraient cette figure charmante. Sur le front, juste au milieu, la croix berbère était tracée en bleu, symbole inconnu, inexplicable chez ces peuplades autochtones qui ne furent jamais chrétiennes et que l’Islam vint prendre toutes sauvages et fétichistes, pour sa grande floraison de foi et d’espérance.