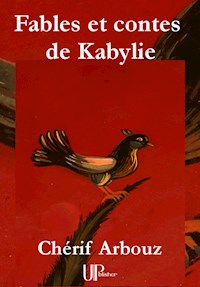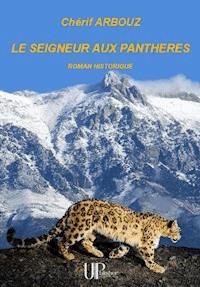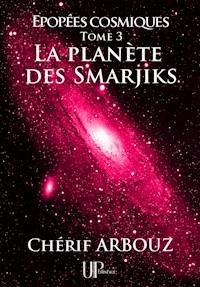Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UPblisher
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Chacun a son histoire, Chérif Arbouz raconte celle de quelques algériens hors du commun
Il a beaucoup été écrit sur le passé colonial de l’Algérie, le désir de soutenir une thèse l’emportant souvent sur une honnête relation historique exempte de toute passion. Dans le présent ouvrage, il ne s’agit nullement d’Histoire, mais de simples histoires vraies. Elles constituent une suite de récits se rapportant à des vécus authentiques, lesquels sont relatés d’une manière plaisante et instructive à la fois. Les personnages mis en scène ne sont cependant pas des gens ordinaires, bien au contraire, et c’est pourquoi, en leur temps, ils ont acquis une notoriété suffisante pour qu'elle leur survive.
L'Algérie, pays de tradition orale, a eu ses conteurs publics depuis les temps les plus anciens jusqu’à la fin de l’époque coloniale. Parallèlement à cela, l’actualité offrait l’occasion de mettre en valeur les faits et gestes de tel ou tel personnage, lorsque ceux-ci étaient dignes de susciter l’intérêt. L’auteur a réuni toute cette matière pour publier le présent ouvrage. Ainsi, par exemple, le lecteur découvrira dans ce livre, l’histoire d’un meunier rappelant Maître Cornille, ou celle de deux instituteurs, l’un Corse et l’autre Kabyle, rivalisant de roublardise sur fond de pédagogie. S’agissant d’instituteurs, toute la deuxième partie du livre est consacrée à l’un d’entre eux, dont la remarquable personnalité lui permit de se faire une place au soleil dans un village de colonisation. De fil en aiguille et d'est en ouest du pays, le lecteur découvrira de façon très agréable comment les gens vivaient leur siècle dans le dernier quart de l’époque coloniale en Algérie.
Une suite de récits historiques pour plonger dans la vie et les mœurs de l’Algérie coloniale
EXTRAIT
Faisant partie de la génération dont la prime jeunesse a eu comme cadre l’Algérie des années trente à cinquante du siècle dernier, c’est en qualité de témoin de cette période que je me suis employé à faire revivre des moments choisis de celle-ci, à travers une suite de récits. L’Algérie était alors colonie française, mais ce n’était déjà plus celle de nos parents, et encore moins celle de 'nos grands parents, telle que ceux-ci en parlaient, car beaucoup de choses avaient entre temps changé. Revenons-en maintenant au livre lui-même.
Celui-ci comporte deux parties distinctes, et la première, sous le titre « Anecdotes et récits d’époque. », est l’expression de ce qui se racontait ici et là, moi-même étant parfois impliqué en qualité d’acteur, sous tel ou tel pseudonyme. Ces authentiques relations ont été choisies parce qu’elles mettent en relief des manières d’être, de penser ou d’agir, propres à cette époque, dans le cadre de situations souvent insolites, cocasses, ou les deux en même temps.
La deuxième partie intitulée « L’inénarrable Si Djoudi », se présente pour sa part comme l’histoire d’un homme hors du commun, qui en son temps défraya la chronique, en des lieux divers où il vécut. Instituteur de son état, toute sa carrière se déroula en zone rurale, et l’essentiel de ce qui est relaté, eut pour cadre un village de colonisation, modèle du genre en l’occurrence.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
C'était en Algérie au temps des colonies Chérif Arbouz
UPblisher.com
L’auteur au lecteur
Faisant partie de la génération dont la prime jeunesse a eu comme cadre l’Algérie des années trente à cinquante du siècle dernier, c’est en qualité de témoin de cette période que je me suis employé à faire revivre des moments choisis de celle-ci, à travers une suite de récits. L’Algérie était alors colonie française, mais ce n’était déjà plus celle de nos parents, et encore moins celle de 'nos grands parents, telle que ceux-ci en parlaient, car beaucoup de choses avaient entre temps changé. Revenons-en maintenant au livre lui-même.
Celui-ci comporte deux parties distinctes, et la première, sous le titre « Anecdotes et récits d’époque. », est l’expression de ce qui se racontait ici et là, moi-même étant parfois impliqué en qualité d’acteur, sous tel ou tel pseudonyme. Ces authentiques relations ont été choisies parce qu’elles mettent en relief des manières d’être, de penser ou d’agir, propres à cette époque, dans le cadre de situations souvent insolites, cocasses, ou les deux en même temps.
La deuxième partie intitulée « L’inénarrable Si Djoudi », se présente pour sa part comme l’histoire d’un homme hors du commun, qui en son temps défraya la chronique, en des lieux divers où il vécut. Instituteur de son état, toute sa carrière se déroula en zone rurale, et l’essentiel de ce qui est relaté, eut pour cadre un village de colonisation, modèle du genre en l’occurrence. Ayant eu la chance de côtoyer cet homme, et parfois-même d’avoir été un témoin privilégié de ses faits et gestes, c’est à ce titre que je me suis employé à le mettre en scène, à travers les moments les plus marquants de son existence, rapportés comme autant d’épisodes. Fruit d’une double culture pleinement assumée, doté d’une forte personnalité et pourvu d’un savoir encyclopédique, Si Djoudi s’affirme en tant que tel tout au long du récit. Sa progéniture elle-même, ayant de qui tenir, lui emboîte allégrement le pas, s’illustrant à sa manière en diverses circonstances.
Si Djoudi et les siens sont présentés sous des noms d’emprunt, de même que dans le détail, les nécessités d’une version romanesque ont imposé leur loi, sans pour autant affecter pour l’essentiel, l’authenticité de ce qui a été rapporté.
Relativement à l’ensemble de l’ouvrage, il faut souligner que si les récits qui le composent se suffisent pleinement à eux-mêmes, il est cependant nécessaire de les situer dans leur contexte historique et sociologique, pour en saisir toute la portée.
L’époque dont il s’agit, voyait se côtoyer deux peuples, lesquels se différenciaient profondément par leur culture, leurs croyances et leur manière de vivre. D’un coté, il y avait les colonisés, numériquement majoritaires et de loin, mais pour le moins marginalisés du fait de la conquête de leur pays par une nation étrangère. De l’autre coté, c’étaient les colonisateurs, en partie Français de souche, mais comprenant surtout des Européens naturalisés de diverses origines, auxquels s’ajoutèrent en 1870, 32 000 Indigènes de confession judaïque, globalement francisés par décret. Les Européens qui représentaient au plus dix pour cent de la population vivant en Algérie, se caractérisaient pour les plus frustes d’entre eux, par une arrogance plus ou moins affichée à l’égard des autochtones.
Cependant et vaille que vaille, ces derniers s’accommodaient d’un sort imposé par les circonstances, et tiraient avantage de ce qui leur était bénéfique, comme par exemple l’instruction dans les écoles françaises, l’exercice de nouveaux métiers ou l’adoption de techniques agricoles modernes, et d’une façon générale par l’appropriation de tout ce qui pouvait peu ou prou améliorer les conditions d’existence de chacun.
Dans le contexte ainsi défini, les rapports entre colonisateurs et colonisés, étaient souvent marqués par l’antagonisme latent ou affirmé des deux communautés concernées, et ce, à l’échelle des groupes aussi bien qu’à celle des individus. À certaines exceptions près, car il y en avait, les relations amicales qui pouvaient exister entre Algériens du cru et Français d’Algérie, étaient elles-mêmes souvent faussées, les premiers se tenant sur la réserve, et les seconds ne pouvant se départir d’une attitude condescendante ou paternaliste, consciente ou se manifestant à leur insu.
Pour apprécier à leur juste valeur la nature et la variété des comportements respectifs des deux ensembles de populations, dans le cadre de leurs relations mutuelles, il est nécessaire de les situer dans le contexte historique et sociologique qui les explique, même s’il ne les justifie pas. Le fait majeur à prendre en considération est celui de la conquête de l’Algérie par les Français, à l’issue d’une guerre meurtrière qui a pratiquement duré de 1830 à 1905, cette dernière date marquant l’extension de la conquête à la partie extrême du Sahara algérien. Durant toute cette période, la politique française dite de pacification, fut constamment remise en cause par le soulèvement ça et là de populations non résignées à subir le sort qui leur était imposé. De tels évènements n’étaient toutefois pas nouveaux, l’Algérie en ayant vécu de semblables par le passé, à l’instar de beaucoup d’autres pays, dont la France elle-même qui avait connu sur son sol une guerre de cent ans contre l’occupant anglais.
Ce qui toutefois fut sans précédent, était que la France avait opté pour une politique de peuplement systématique, laquelle imposait dans toutes les villes et les campagnes du pays, la coexistence de deux peuples très différents à divers titres, dont l’un, fort d’une suprématie institutionnellement établie, avait beau jeu de s’imposer à l’autre, jusqu’à la fin des temps croyait-il. Si l’on remonte le cours de l’histoire de l’Algérie jusqu’aux périodes les plus reculées, on n’y trouve assurément rien de tel. Ainsi par exemple, l’antique royaume numide, devenu province romaine sous le nom de Maurétanie césarienne, eut à subir sa part des invasions barbares ayant fait crouler l’empire romain. Cependant cet épisode se traduisit par la dissolution pure et simple des tribus vandales initialement conquérantes, au sein des populations numides, les barbares ayant finalement adopté la religion et les coutumes du peuple conquis, lui-même depuis longtemps romanisé puis christianisé. La période même de l’islamisation de l’Afrique du nord, bien que faisant suite à une invasion, a vu l’intégration des populations arabes, dans le cadre d’un remodelage socioculturel s’étalant sur plusieurs siècles, et aboutissant en Algérie à ce qui aujourd’hui la caractérise.
Cependant et malgré un antagonisme plus ou moins affiché, les deux communautés de l’époque coloniale, devaient par la force des choses s’accommoder l’une de l’autre, à travers des relations de travail, d’échanges commerciaux et de services mutuels inévitables. Finalement, c’était le degré revêtu ici et là par ces diverses formes d’interdépendance, qui déterminait la manière d’être des Européens par rapport aux Algériens du cru et vice versa.
Il faut toutefois souligner que les manifestations de cette coexistence, pouvaient différer considérablement selon la variété des cadres d’existence et des nécessités en découlant. C’est ainsi par exemple que dans la plupart des grandes villes, les populations européennes étant numériquement beaucoup plus importantes que celles des autochtones, vivaient généralement en communautés fermées, où toutes les classes sociales étaient représentées. En de tels lieux, les « Arabes » comme on les appelait indistinctement, étaient soit exclus de résidence, soit confinés dans l’enceinte de casbahs comme celle d’Alger, soit réduits à élire domicile dans des quartiers excentriques tournant le dos à la ville proprement dite. Dans ces importantes cités, la vie se concentrait dans les quartiers européens qui les constituaient pour l’essentiel, et où l’on ne connaissait « d’Arabe », que le « Moutchou », le commerçant mozabite du quartier quand il y en avait, la « Fatma », employée de maison, le « yaouled », portefaix ou cireur et les quelques marchands de fruits et légumes ou poissonniers établis dans les marchés. Un tel contexte évidemment, faisait que les seuls mots de pseudo arabe que connaissaient les Européens des grandes villes étaient, « fissa » pour « en vitesse », « aroua ména » pour « viens ici » ainsi que d’autres expressions du même cru. En réalité, ils n’avaient nul besoin d’avoir recours à ce charabia, alors que la plupart de leurs interlocuteurs parlaient plus ou moins bien le français.
Cependant, comme près de 90% des autochtones vivaient dans les campagnes, c’est dans les zones rurales que le fait colonial revêtit sa pleine expression. Or à ce niveau, tout se passait différemment de ce qu’on pouvait constater dans les villes de quelque importance. Les activités en de tels lieux étant presque entièrement tournées vers l’agriculture, les colons, du simple cultivateur vivant de son labeur, au gros possédant, étaient au contact direct des populations autochtones qui leur fournissaient l’abondante main d’œuvre dont ils avaient besoin. Ceux là, même s’ils étaient souvent de rudes employeurs et à la limite des exploiteurs, étaient généralement amenés par la force des choses, à humaniser leurs relations avec les « Indigènes ». Tous ou presque, pratiquaient couramment soit l’arabe dialectal, soit le kabyle ou autre parler berbère. De plus, ils étaient plus ou moins influencés par les modes de vie des populations autochtones au sein desquelles ils vivaient, ne serait-ce qu’à travers des habitudes alimentaires quelque peu modifiées. Dans les gros villages ou petites villes cependant, les comportements des Européens étaient mitigés, se situant entre ceux des citadins et ceux des « blédards ». À ce niveau, ceux qui affichaient le plus d’ostracisme à l’égard des « Indigènes » formaient une catégorie comparable à celle des « petits blancs », vivant en d’autres contrées également colonisées, et cette frange était composée d’ouvriers, de boutiquiers, d’employés en tout genre et autres représentants des classes modestes.
Le pendant de ces comportements chez les Algériens de souche, allait de la soumission parfois servile, chez ceux dont le sort dépendait entièrement des Européens, à un amour propre toujours sur le qui vive pour les moins assujettis, jaloux de sauvegarder leur dignité à tout propos.
Tout cela évidemment, ne traduisait qu’une somme de tendances, grosso modo vérifiables. Cependant bien d’autres facteurs entraient en jeu, pouvant induire de grandes différences comportementales selon les diverses régions. Ainsi par exemple en Oranie, où les Européens étaient majoritairement d’origine espagnole, les relations inter ethniques étaient très détendues, les Algériens de la région s’accommodant mieux de leur situation que les populations du reste du pays. La raison à cela était qu’ils côtoyaient les Espagnols depuis l’époque ottomane, ayant alors adopté leur monnaie et parlant couramment l’espagnol. Il faut en effet préciser, que non seulement Oran et Mers El Kebir avaient été des places fortes espagnoles pendant des siècles, mais qu’à partir de là, s’exerçait sur l’Oranie une notable influence politique du royaume ibérique. On peut citer à titre d’exemple le cas de sultans locaux comme ceux successifs de Tlemcen et autres petites principautés, qui étaient épisodiquement les vassaux des rois d’Espagne, ceux-ci les soutenant militairement dans leurs démêlées avec les pachas ou les deys de la régence turque d’Alger.
À l’est par contre, c’était tout à fait l’inverse et c’était également le cas au centre, mais dans une moindre mesure. Les raisons à cela sont trop complexes pour faire ici l’objet d’une analyse, mais il suffira d’indiquer que ces deux régions étaient les plus sujettes aux soulèvements armés. On peut citer le plus notoire d’entre eux, celui de 1871, à l’appel d’El Mokrani, et bien d’autres encore. Le dernier en date, s’est traduit en 1945 par un massacre en règle entraînant la mort de milliers d’Algériens, dans les régions de Sétif et de Guelma.
Il y avait enfin les régions montagneuses, entre autres celles de Kabylie, des Aurès, du Titteri ou du Zaccar, où la population européenne se réduisait pratiquement aux instituteurs, lesquels jouèrent un grand rôle dans l’émancipation des habitants de ces lieux particulièrement déshérités. Dans certaines de ces régions et notamment en Kabylie, il y eut bien une tentative de colonisation effective après 1870, mais les terres y étant de faible rapport, la plupart des concessions furent revendues aux « Indigènes » par leurs bénéficiaires. Les acquéreurs étaient du reste bien souvent certains des anciens propriétaires, dépossédés après l’insurrection initiée par El Mokrani. Les quelques rares colons qui s’y maintinrent contre vents et marées, s’assimilèrent pratiquement et par la force des choses aux populations locales, dont ils parlaient la langue, partageaient les dures conditions d’existence et dont ils ne différaient que par leur statut et surtout par leur religion, laquelle constituait la vraie barrière qui les séparait.
Au chapitre religieux justement, il y a lieu de parler des congrégations chrétiennes, celle des pères blancs ou sœurs blanches surtout, qui se manifestaient principalement à travers une action sociale ou culturelle s’exerçant en milieu urbain aussi bien que rural, à partir de monastères ou couvents qui s’étaient implantés un peu partout. Si l’influence de ces congrégations était pratiquement nulle au plan religieux, elle fut d’une certaine importance au niveau où elle s’affirmait, à travers des actions caritatives, sanitaires ou éducatives, notamment là où les pouvoirs publics ne les prenaient pas en charge. Il faut citer sous ce rapport, des collèges, dont ceux réputés de l’Harrache, de Notre Dame d’Afrique ou des Ath Yenni, de très nombreux centres de santé, et même un hôpital de renom, celui de Michelet en Grande Kabylie, dédié à Sainte Eugénie. Il y eut enfin les fameuses écoles ouvroirs féminines de la Casbah d’Alger, des Attafs dans l’Ouarsenis ou des Ath Hichem en Grande Kabylie, à ne prendre que les plus connues, et à travers lesquelles s’exerça une action de sauvegarde et de promotion des arts traditionnels.
Les conversions au christianisme des autochtones, étaient, pour leur part, très rares, et, lorsqu’elles se produisaient, elles entraînaient pour les convertis, leur mise au ban de la communauté musulmane, celle des Européens leur demeurant fermée.
Pour compléter le tableau, il faut citer le rôle que jouèrent entre les deux guerres mondiales, une catégorie à part d’immigrés récents, des Italiens ou Espagnols surtout, qui, maçons, tailleurs de pierre ou puisatiers, parcouraient le pays en proposant leurs services jusque dans les endroits les plus reculés. C’est ainsi que ces derniers firent école partout où ils allèrent, transmettant leur art aux aides qu’ils recrutaient localement, lesquels à leur tour se firent apprécier à travers toute l’Algérie, par la qualité de leurs prestations.
Quelques mots maintenant et à titre de conclusion, relativement à ce qui précède, pour indiquer que sa conception répond au souci de munir le lecteur d’un cadre de référence utile, qui puisse l’aider à mieux placer dans son contexte, ce qui fait l’objet du présent ouvrage.
L’auteur
PREMIÈRE PARTIE : ANECDOTES ET RECITS D’EPOQUE
Mieux est de ris que de larmes escrire,
Pour ce que rire est le propre de l’homme.
François RABELAIS
Le sommeil du juste
Ferhat Oussalem était l’amine de son village, quelque part en haute Kabylie. Autrement dit, il était le président du conseil des sages dont chaque membre représentait un quartier et il était secondé par cinq dhomanes dont chacun avait des attributions précises. Ce conseil, veillait à faire respecter le « Qanoun », ensemble des règles traditionnelles de la vie communautaire, héritage d’un passé remontant à l’antiquité. Dans ce cadre, il pouvait édicter des arrêts dont les dhomanes veillaient à l’exécution. En cas d’infraction, des peines pouvaient être prononcées, allant de la simple amende au bannissement, en passant par la mise en quarantaine, et le conseil pouvait également imposer son arbitrage, en cas de conflit entre individus ou clans. L’instance souveraine était cependant l’Assemblée de village, regroupant l’ensemble des chefs de familles, qui elle, statuait sur tout en dernier ressort. Les autorités françaises reconnaissaient certes le statut de ces assemblées, mais dans des limites strictement définies qui en excluaient le champ judiciaire autrefois inclus. Cependant et dans la pratique, l’autorité morale de ce type d’instance était telle, que les restrictions légales n’étaient que clauses de style.
Ainsi donc était le cadre dans lequel Ferhat Oussalem exerçait ses fonctions, depuis bien longtemps, trop longtemps à son gré. Maintenant en effet, il se sentait usé par l’âge, ayant dépassé les quatre vingts ans, et c’est pourquoi un jour, il convoqua l’Assemblée de village en vue de l’élection d’un nouvel amine.
Le jour de la réunion, tous les efforts déployés pour le retenir furent vains, mais il prit la peine de plaider sa cause.
- L’exercice de la fonction d’amine dit-il, est une très lourde responsabilité et je ne suis plus en mesure de pouvoir l’assumer à l’âge qui est le mien. De plus, je ne suis pas éternel et il vous faudra tôt ou tard me remplacer, autant donc le faire dès maintenant.
- Alors propose-nous quelqu’un, dit un des dhomanes.
- Si je vous proposais quelqu’un, ce serait une façon de le cautionner, alors que je ne puis même pas être garant de ma personne.
Cependant, face à l’insistance des membres de l’Assemblée, il finit par céder. Il sollicita donc la candidature de l’un des dhomanes présents, le nommé Ali Namani, qui accepta et fut élu.
Quelques semaines passèrent et un beau jour, vers deux heures du matin, Ferhat Oussalem alla frapper à la porte du nouvel amine, et ce fut la femme de ce dernier qui vint s’enquérir du visiteur et de ce qu’il voulait.
- Mon mari dort dit-elle, veux-tu que je le réveille ?
- Non, ce n’est pas nécessaire, je le verrai demain.
En début de matinée Ali Namani se présenta donc tout effaré chez Ferhat et lui demanda la raison de sa visite nocturne.
- Je voulais simplement savoir si tu dormais et c’était le cas. Or sache-le, un amine digne de ce nom ne dort jamais que d’une oreille, devant être disponible de jour comme de nuit. Quant à moi, ce qui maintenant m’ôte le sommeil, c’est le fait de t’avoir proposé pour assurer cette fonction. Alors convoque l’assemblée du village pour que je lève la caution dont je t’ai couvert.
Et c’est ainsi que Ferhat Oussalem put enfin dormir du sommeil du Juste.
Trop c’est trop
Tous les mercredis comme aujourd’hui encore, se tenait le grand marché des Iraten, en dehors des fortifications de ce qui était alors Fort National, le bastion érigé par les autorité coloniales après la conquête de la Kabylie du Djurdjura en 1857. C’était à l’époque le seul lieu d’approvisionnement pour les nombreuses populations des alentours, et l’on voyait alors des cohortes de gens s’acheminer vers ce marché, par les innombrables sentiers abrupts y menant.
Tel fut le cas de Mohand Azouaw un certain Mercredi de 1910. Il habitait un des villages proches du fort et parmi les emplettes dont sa femme l’avait chargé, la principale était de ramener un chapelet de tripes. C’était un homme d’âge mûr particulièrement apprécié par ses concitoyens pour son caractère égal et son impavidité, dans les circonstances mêmes où d’autres seraient sortis de leurs gonds.
Le marché n’étant qu’à une demi-heure de marche de son village, il s’y rendit à pied et en revint en fin de matinée, veillant à tenir éloigné de sa personne son chapelet de tripes dégoulinantes. Ses autres achats quant à eux, se nichaient au fond du capuchon de son burnous et c’était si peu de choses qu’il en sentait à peine le poids. S’en allant ainsi, il croisait chemin faisant, bien des gens de son village, et chacun ne manquait pas de s’intéresser aux tripes qu’il tenait à bout de bras, lui demandant le plus souvent combien il les avait payées. Il répondait à tous, poussant au début sa complaisance, jusqu’à s’arrêter pour satisfaire à la curiosité de ceux qui l’interrogeaient.
Mais quand il fut à proximité de son village, la même scène se reproduisant tous les quarante ou cinquante pas, il finit par être excédé. Accélérant alors son allure, il ne il ne répondit plus que par de vagues grognements, à l’importune curiosité suscitée par son emplette. Le dernier de ceux à qui il eut affaire, était un homme jouissant dans le village de l’estime de tous, à commencer par la sienne propre. Mais pour Azouaw c’était la goutte d’eau qui faisait déborder le vase, et à la question posée, toujours la même, il s’emporta de telle sorte, qu’il abattit son chapelet de tripes sur le malheureux questionneur, maculant ainsi les vêtements de ce dernier. Alors, sans prêter la moindre attention aux cris indignés de sa victime, ce fut presque en courant qu’il s’employa à rentrer chez lui.
Cependant, l’affaire était grave et Azouaw en avait conscience. Aussi, ne s’étonna-t-il guère quand en fin d’après midi, un émissaire de l’amine vint le sommer de se présenter séance tenante devant l’assemblée de village, où il était attendu pour répondre de ses actes.
Lorsqu’il se trouva face à ses juges, l’amine donna aussitôt la parole à la victime, ce après quoi Azouaw fut invité à s’expliquer. Or la tradition kabyle veut que quiconque prend la parole en public, fasse précéder son propos de la formule sacramentelle « Que le salut soit sur l’envoyé de Dieu », ce à quoi les membres de l’auditoire doivent répondre par l’équivalent de « Ainsi soit-il ».
Azouaw donc commença par l’invocation attendue, et lorsqu’il en obtint la réponse rituelle, il recommença. Cependant, comme cet échange préliminaire se répéta quatre ou cinq fois, l’Amine excédé apostropha vertement l’accusé, lui enjoignant d’en arriver au fait, les membres de l’assemblée faisant chorus avec lui.
- Ainsi donc dit Azouaw, aucun de vous ne supporte que j’évoque de façon répétée le nom béni de notre prophète. Moi sachez-le, c’est 99 fois qu’on m’a demandé combien j’avais payé mon chapelet de tripes, et la centième était de trop.
On rit alors de cette boutade et l’affaire en resta là.
Tambour et point final
Dahmane Bérouaki va marier son fils aîné et il veut pour la circonstance organiser une grande fête, mais il lui faut pour cela obtenir une autorisation écrite du caïd de son douar. Rien n’était simple en ce temps là pour les « Indigènes », particulièrement dans les zones rurales, placées sous l’autorité de caïds assistés de gardes champêtres, à raison d’un par fraction de territoire. Ces caïds usaient et abusaient de pouvoirs exorbitants, les autorités françaises dont ils dépendaient, fermant les yeux sur leurs dépassements.
Voilà donc notre brave Dahmane, juché sur son mulet et cheminant par des sentiers abrupts vers la résidence du caïd. Il s’attendait évidemment à lester la main de ce dernier et à cette fin, il avait préparé une pièce de deux francs.
Le caïd le reçut, écouta sa requête, puis la pièce ayant changé de main, il se prépara à rédiger une autorisation.
- La fête lui dit-il, aura-t-elle lieu avec ou sans tambour ?
- Avec tambour Monsieur le caïd.
- Alors ça te fera deux francs de plus.
Kaddour s’exécuta avec une grimace, puis reçut une autorisation en bonne et due forme rédigée en ces termes : « Le nommé Dahmane Bérouaki du village de Bouadel est autorisé à organiser le 9 juillet 1921, une fête avec tambour. »
-Avant la fête, lui indiqua le caïd, tu présenteras ce papier au garde champêtre de ta fraction.
Pendant les jours qui suivirent, Dahmane fut tellement pris par les préparatifs de la noce qu’il faillit en oublier le garde champêtre, et ce fut par hasard qu’il croisa celui-ci au marché hebdomadaire de la région, où il s’était rendu pour ses dernières emplettes.
Ayant sur lui son autorisation, il saisit l’opportunité de cette rencontre pour aborder le dernier obstacle qu’il lui restait à franchir, une simple formalité pensa-t-il naïvement. Il annonça donc au garde champêtre le mariage de son fils, puis lui remit le document pour qu’il en prenne connaissance. Mais alors qu’il tendait la main pour se faire rendre celui-ci, le garde champêtre lui dit :
- Eh l’ami ! Doucement ! Sais-tu ce que dit ce papier ?
- Non, je ne sais pas lire, mais…
- Il n’y a pas de mais ; il est écrit là-dessus que ta fête se fera avec tambour. Cela donc veut dire qu’il n’y aura pas de trompettes. As-tu bien compris ?
- Bien sûr que j’ai compris. Mais comme il n’y a pas de tambour sans trompettes alors…
- Qui donc t’a raconté cette sornette ? Le tambour de ville se fait-il accompagner de trompettes ? Mais laissons cela et parlons sans détour. Combien as-tu donné au caïd pour qu’il mentionne le tambour ?
- Deux francs.
- Eh bien maintenant ça t’en fera deux autres pour les trompettes.
Dahmane paya donc et le garde champêtre alors, tira un crayon de sa poche pour ajouter sur l’autorisation du caïd la mention « et trompettes ».
- Vois-tu Dahmane dit-il, dans ce genre d’écrits chaque mot a son prix, et sache à l’avenir que celui d’un garde champêtre vaut celui d’un caïd.
Qui veut la fin veut les moyens
Saïd Akriche, « Instituteur Adjoint Indigène », exerçait en 1912 dans une petite école de la Kabylie du Djurdjura. Il était de par son statut, astreint à l’état de subalterne ou au mieux de maître unique chargé d’école, pour toute la durée de sa carrière et ce, bien qu’il eût rempli toutes les conditions exigées pour être instituteur à part entière. Il pouvait néanmoins, en sa qualité de titulaire, faire valoir les mêmes droits que ses collègues français de même grade, sauf à prétendre diriger un établissement de plus d’une classe.
Présentement, il secondait un directeur d’origine corse, du nom de Bertucelli (prononcer Bertoutchelli), et il avait en charge les petites divisions. Son collègue quant à lui, en sa qualité de directeur, s’occupait des grands, notamment le cours supérieur préparant au Certificat d’Études Primaires. Tous deux étaient logés dans l’enceinte de l’établissement, mais leurs rôles étant bien partagés, ils auraient pu vivre en parfait voisinage s’il n’y avait eu entre eux une pomme de discorde qui empoisonnait leurs relations. L’objet de leur mésentente était, sinon une simple pomme, du moins le jardin scolaire, un vaste terrain mi verger mi jardin potager, clos d’un mur de pierres. Le verger surtout était intéressant, car plus d’une centaine d’arbres fruitiers y croissaient : noyers et amandiers principalement, ainsi que pommiers, poiriers, abricotiers et bien d’autres encore. Qui plus est, ces arbres avaient atteint un fort développement, dû aux fertiles terres d’éboulis qui les nourrissaient, à la pluviométrie abondante de la région et surtout au climat sec d’altitude -- autour de 900 mètres – qui les exemptait de toutes sortes de maladies.
Malheureusement pour M.Akriche, son collègue mais néanmoins directeur, s’était abusivement prévalu de sa fonction pour s’accaparer de la totalité du jardin. Il alléguait en effet la vocation de celui-ci dans le cadre de l’enseignement agricole, lequel ne concernait que les grandes divisions, celles précisément qu’il avait en charge. M. Akriche n’ayant aucun argument défendable à opposer à cette manière de voir les choses, en était donc réduit à se résigner, observant de loin et avec envie tout ce que son directeur faisait pousser dans le potager, ainsi que les arbres chargés de fruits ne demandant qu’à être cueillis. Il était surtout malheureux pour sa progéniture qui souffrait le même martyre que lui, notamment lorsque les enfants Bertucelli se gavaient ostensiblement devant eux du produit de leurs arbres, sans jamais rien leur offrir. Les jeunes Akriche alors, se risquaient à aller marauder dans le verger, chaque fois qu’ils en avaient l’occasion, et lorsque le directeur les surprenait, cela dégénérait en violentes disputes entre celui-ci et son adjoint.
M. Akriche à la fin, las de cette situation, ne vit qu’une seule issue pour mettre fin au tourment qui le rongeait, et c’était de demander sa mutation pour un poste d’instituteur chargé d’école. Cela en effet, compenserait l’inconvénient d’avoir seul en charge la totalité des élèves, par l’avantage de ne plus dépendre d’un directeur, et surtout pour avoir un jardin scolaire à sa seule disposition. Ces types de postes étaient très disputés parmi les Adjoints Indigènes, mais la chance pouvait lui sourire, étant donné son ancienneté.
La chance en effet lui sourit, mais d’une façon tout à fait autre. Elle se présenta sous la forme d’une circulaire ministérielle, accompagnant des instructions officielles relatives à la promotion fortement recommandée des méthodes actives d’enseignement, alors nouvelles venues dans la famille des modes d’action pédagogiques. Ces instructions préconisaient entre autres, d’exploiter toutes les opportunités qu’offrait le milieu environnant de servir de support à toutes sortes d’activités, et les jardins scolaires y étaient nommément cités, comme exemples de lieux privilégiés de mise en œuvre de ces méthodes.
Dès qu’il eût parcouru et bien assimilé le contenu des instructions, M. Akriche se mit à jubiler en se frottant les mains.
- Maintenant je te tiens damné Bertucelli, dit-il à haute voix.
Alors il se mit à réfléchir intensément pour mettre au point et affiner le stratagème qu’il pensait mettre en œuvre, le plus tôt possible. Puis vint le moment qu’il attendait, le temps des cerises.
C’est ainsi que, lorsque celles-ci furent arrivées à maturité, il décida un beau matin de consacrer à leur cueillette, la leçon quotidienne de langage qu’il prodiguait à l’ensemble de sa classe. Il conduisit donc ses élèves dans le jardin, au pied d’un grand cerisier dont les branches ployaient sous le poids de leurs fruits vermeils.
Ce fut une magnifique leçon, marquée par l’application à la lettre des recommandations officielles concernant les méthodes actives. Les enfants grimpaient sur l’arbre par équipes successives de cinq à six, cueillaient des cerises à pleines poignées, puis les lançaient à leurs camarades qui s’en gavaient et s’en remplissaient les poches ou les capuchons de leurs burnous. Leur enthousiasme qui soulignait l’intérêt soutenu qu’ils portaient à ce genre d’activités, l’aisance et la spontanéité avec lesquelles ils s’exprimaient dans le respect des canons de la langue française, montraient on ne peut mieux l’efficacité de la méthode employée.
Cependant, M. Bertucelli, alerté par les bruits insolites lui parvenant du verger, quitta sa classe pour en savoir la cause. Il fut alors témoin d’un spectacle qui déclencha sa fureur, accompagnée d’un torrent de paroles la traduisant.
— Cessez donc de crier ! Lui dit M.Akriche. Ne vous donnez pas en spectacle devant les élèves, voyons ! Écartons nous un peu et parlons comme des gens raisonnables, voulez-vous ?
M. Akriche qui avait beau jeu de manifester son calme, expliqua alors à son directeur les tenants et aboutissants de l’affaire. Il vint donc à bout de son irascible collègue qui fut bien obligé de s’incliner devant la puissance de la raison pédagogique. Mais son adjoint ne s’en tint pas là, et il porta le coup de grâce à son adversaire maintenant terrassé.
—À partir d’aujourd’hui lui dit-il, je vais exploiter à fond une méthode aussi fructueuse, pour ne pas dire juteuse. Tous les arbres du verger y passeront un par un, je vous le garantis.
— N’en rajoutez pas Monsieur Akriche, vous avez gagné, je vous l’accorde. Mais qu’il soit bien entendu que vos expériences pédagogiques, vous les ferez dorénavant sur vos propres arbres, nous verrons lesquels.
— Pas seulement les arbres, mon très cher collègue ! Et le jardin potager, qu’en faites-vous ? Lui aussi constitue un bon terrain d’applications.
— Bon ! Cela aussi je vous l’accorde. Vous en aurez un petit bout.
— Petit bout ? Seulement un petit bout ? Vous plaisantez cher collègue !
— Que voulez-vous donc à la fin par tous les diables ?
— La moitié du verger et la moitié du potager ; après tirage au sort bien sûr !
Il en fut donc ainsi car le Corse de guerre lasse céda, admettant de ce fait que la rouerie de son collègue kabyle valait bien la sienne, et depuis, la paix régna sans partage entre les deux compères.