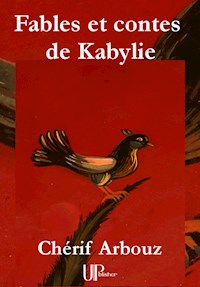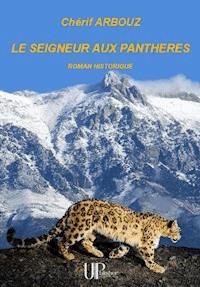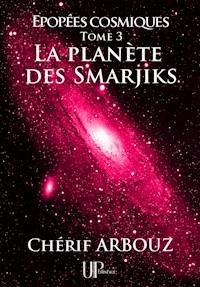Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UPblisher
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Un recueil de contes inspirés de La Fontaine
Les contes de La Fontaine sont la face cachée de son œuvre. Du poète et moraliste, on connaît les fables. Nombre de leurs vers sont devenus des proverbes comme « Petit poisson deviendra grand » (Le Petit Poisson et le Pêcheur) ou « Aide-toi, le Ciel t’aidera » (Le Chartier embourbé) !
Avec les contes, point de transposition animale, les acteurs sont des êtres humains, leurs travers incontestablement les nôtres : cupidité, vol, tromperie, adultère, concupiscence, péché, tout y est ! et « pire encore », sous le couvert des rimes, le poète ose la licence, raille avec férocité l’hypocrisie des membres du clergé, et fait ainsi réfléchir et rire son public. Enfer et damnation ! C’est à peu près le sort réservé à ces contes, mis à l’index puis oubliés.
Découvrez, au travers de ce recueil, l'influence de La Fontaine dans des contes mettant en scène la nature humaine et ses travers : vols, tromperies, cupidité. Une critique sociale qui résonne encore aujourd'hui !
EXTRAIT DE
L'ermite
Frère Luce un jeune ermite passait pour saint et en avait l’apparence. Revêtu d’une houppelande, ample robe grise munie d’un capuchon et de surcroît ceinte d’une corde, il allait et venait pieds nus dans des sandales, et l’on voyait suspendus à sa grossière ceinture, d’un côté un long chapelet, et de l’autre une écuelle destinée à recevoir des offrandes.
Ainsi donc se présentait Frère Luce, et pour gîte il disposait d’une cabane en un bois situé non loin d’un gros bourg où chacun le connaissait, puisqu’il y quémandait pour satisfaire à ses besoins. Respecté de tous, y compris du curé de la paroisse, il vivait dans une aisance relative, grâce à la générosité des habitants. Cependant, ainsi qu’on le verra, son accoutrement et son air humble, cachaient en vérité le plus dangereux paillard qui puisse exister.
À l’extrémité du bourg qu’il fréquentait, était une chaumière isolée, laquelle abritait Françoise, une veuve, et Janette sa fille. Celle-ci, âgée de dix-huit ans, était remarquablement jolie quoique non coquette, et à cela il faut ajouter qu’elle tenait de sa mère une extrême naïveté. Toutes deux en effet, ne faisaient que peu de différence entre ce qui était banal et ce qui ressortait de l’extra ordinaire.
Frère Luce au cours de ses pérégrinations, avait remarqué Janette, et l’ayant guignée de dessous sa capuche, son regard se fit concupiscent, l’amenant à se dire : « Frère Luce, voilà si tu sais t’y prendre de quoi t’offrir d’agréables moments. »
Chérif Arbouz connaît bien ces contes, et s’interroge sur la meilleure manière de les faire découvrir à un public contemporain. Avec un infini respect, et beaucoup de talent, il entreprend de les réinterpréter : il passe des vers à la prose, en conserve l’essentiel, élimine ce qu’ils ont de circonstanciel. Ce pari audacieux, il le gagne ! Il trouve les mots et le style qui rajeunissent ces textes tout en conservant l’humour, la liberté de ton mais aussi la morale si bien que l’équilibre entre le message et la forme est agréablement préservé.
Enfin, l’auteur a souhaité ajouter à la fin du recueil trois des contes dans leur forme originale.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 101
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Avant-propos
Relater des contes empruntés à La Fontaine à travers un français accessible à tous est une justice que j’ai tenu à rendre à celui qui est surtout connu pour ses fables. Une justice, car ses contes ont été pendant plusieurs siècles interdis de publication, sous prétexte d’atteinte aux bonnes mœurs et à la religion. Cependant, la langue française durant cette longue période, avait évolué au point de subir de profonds changements. De ce fait, après que l’interdit frappant ces contes eut été levé, ceux-ci ne furent publiés que rarement et à très peu d’exemplaires, en raison du nombre extrêmement réduit de lecteurs auxquels le français du 17e siècle demeurait accessible.
Ce qui a résulté d’un tel état de choses est qu’aujourd’hui très peu de personnes savent qu’en plus de ses fables telles qu’on les apprend à l’école, La Fontaine a aussi publié des contes.
Aussi, faire apprécier à leur juste valeur les dits contes, ou plus exactement les plus notoires d’entre eux, est l’objectif de la présente publication.
Avec cela, ma relation s’est faite conformément au souci qu’avait La Fontaine de conter sans choquer, ce dernier ayant eu recours à des métaphores ou sous-entendus, pour éviter toute trivialité quand la teneur particulière de son récit l’exigeait.
Par ailleurs, prenant en charge ce souci, j’en ai eu un autre, celui de conférer au présent ouvrage sous un rapport littéraire, une qualité qui soit digne de celle des contes originaux, sauf que la forme versifiée de ceux-ci a fait place à la prose.
Enfin, dans la perspective d’une satisfaction complète des lecteurs pour lesquels le français du 17e siècle est familier, ceux-ci trouveront à la fin du présent ouvrage, un appendice composé de trois contes sous leur forme originelle, en précisant que ces derniers font également partie de ceux qui ont fait l’objet de mon choix en vue de leur adaptation. Cependant, tout lecteur qui serait amené à comparer les deux versions, ne manquera pas de remarquer que l’adaptation se présente sous une forme ramassée, notamment par suppression des longs développements à caractère apologique, auxquels se livrait La Fontaine. Avec cela, et à y regarder de plus près, ce même lecteur notera que la manière dont j’ai usé dans le cadre de ma relation, est comparable à celle dont La Fontaine a lui-même écrit ses fables, s’inspirant de ce qu’il tenait d’autres fabulistes, dont principalement Ésope, et ce, en y mettant du sien ainsi qu’il l’affirmait sans ambages. Pour ma part et agissant donc de manière semblable, j’ai personnalisé mes récits à travers des formes langagières de mon crû, de même que j’ai procédé à des mises en situation souvent différentes de celles de La Fontaine. Nonobstant cela, j’ai toutefois eu le souci de ne rien ôter à ce qui d’essentiel caractérise chaque conte sous sa forme originelle.
L’auteur
Le cocu battu et content
Un certain jeune homme bien né, de ceux qu’on nomme cadets, s’en revenait de Rome très peu satisfait de son pèlerinage. Aussi, sur le chemin du retour, toute occasion lui fut bonne pour se rattraper, là où il trouvait bon gîte, bonne chère, bon vin, et surtout complaisante servante.
Il en allait ainsi jusqu’au jour où faisant halte en un bourg, il vit passer une pimpante et jolie dame escortée d’un valet. Aussitôt il convoita celle-ci puis s’enquit d’elle aux alentours. C’est, lui dit-on, la châtelaine du village, Messire Bon l’ayant épousée bien qu’il fût grisonnant et chauve plus qu’à demi. Mais comme il est des premiers du pays, son bien supplée au défaut de son âge.
Fort de ce qu’il venait d’apprendre, notre jouvenceau conçut alors un plan pour circonvenir la dame, ce après quoi il envoya tous ses valets dans une ville proche où plus tard il irait les rejoindre. Ainsi délesté, il se rendit au château où demeurait la belle, puis il s’y fit connaître en tant que jeune homme en quête de maître et sachant tout faire. Messire Bon le reçut, et à sa mine avenante il en fit son fauconnier, sa femme préalablement consultée y ayant souscrit. Cependant si cette dernière avait jugé bon d’agréer la décision de son mari, c’est qu‘en la circonstance elle fut très sensible au charme du jeune homme, lequel ne tardant guère à lui déclarer sa flamme, elle s’en réjouit et le lui fit savoir.
Mais encore fallait-il que tous deux puissent trouver l’occasion de se satisfaire pleinement l’un de l’autre, car le mari très jaloux quittait fort peu sa femme. De plus, comme aux jours de chasse le fauconnier accompagnait son maître, aucune occasion de se retrouver seuls ne s’offrait aux deux soupirants.
Cette contrainte cependant, leur inspira un stratagème que la belle châtelaine mit en train aussitôt, demandant à son mari de lui dire, lequel de ses valets il estimait le plus.
« C’est mon fauconnier, assurément, répliqua celui-ci sans aucune hésitation.
— Je me doutais bien qu’il en allait ainsi, reprit alors l’épouse, mais apprenez que ce valet n’est rien d’autre qu’un fieffé scélérat, et pour vous en convaincre écoutez donc ce que je vais maintenant vous dire le concernant. Ce matin-même sachez-le, ce goujat a tenté de me séduire, et alors, faisant semblant d’être consentante, je lui ai demandé de se rendre cette nuit dans notre jardin, et de m’y attendre sous le grand poirier. Tel est donc votre fauconnier, et pour que vous n’en doutiez pas, il vous suffira d’aller vous-même ce soir au lieu du rendez-vous, coiffé de mon cornet et revêtu de ma robe. Alors, dès que vous aurez ainsi la preuve que je n’invente rien, rossez d’importance cet impudent, puis chassez-le. »
Messire Bon, d’abord resté sans voix après ce qu’il venait d’entendre, fut ensuite pris d’une violente colère, que sa femme eut grand peine à calmer. Puis, le moment venu, il se rendit au jardin, dûment travesti et décidé à exécuter en tout point les recommandations de son épouse. Toutefois, comme il ne trouva personne sous le poirier, il décida de prendre place lui-même au pied de cet arbre jusqu’à l’arrivée du fauconnier. Celui-ci cependant était embusqué non loin de là, et quand il vit son maître arriver puis s’installer pour l’attendre, il alla aussitôt se substituer à lui dans le lit conjugal.
Plus d’une heure s’écoula, avant l’instant où Messire Bon vit enfin apparaître celui qu’il attendait, lequel dès qu’il se fut rapproché, s’adressa à lui d’une voix courroucée, lui disant :
« Te voilà donc mauvaise femme ! Me croyais-tu assez vil pour trahir la confiance dont ton mari m’honore depuis que je le sers ? Mais sache que le rendez-vous que j’ai obtenu de toi, n’était qu’une épreuve à laquelle je voulais te soumettre ; alors maintenant prépare-toi à recevoir le prix de ta honteuse conduite. »
À ces mots le fauconnier brandissant un solide bâton, se rua sur Messire Bon, et ne fit semblant de le reconnaître qu’après lui avoir administré force horions. Ainsi donc se termina la farce, et le mari berné s’accommoda des coups reçus, tant cette rude correction traduisait pour lui, le souci que son fauconnier avait de son honneur. Alors, pleinement satisfait qu’il en fût ainsi, il s’empressa d’aller rejoindre sa femme pour lui conter toute l’affaire.
« Dussions-nous vivre cent ans encore, dit-il pour conclure, jamais nous n’aurions un tel valet. Aussi à l’avenir, ne lui marchandez pas vos bontés je vous en prie.
— Je n’y manquerai pas soyez en sûr, répondit alors la châtelaine qu’une telle exigence comblait d’aise. »
Le mari confesseur
Messire Artus un gentilhomme campagnard, avait servi dans l’armée du grand roi François durant un épisode des guerres d’Italie. S’étant alors illustré par maints exploits, son général en avait fait un chevalier, avec faste et conformément au cérémonial usité à l’époque. Se sentant grandi après un tel honneur, le nouveau promu en vint à estimer que dès lors, tout baron devait s’effacer devant lui ; aussi, ce fut en personnage fier de son nouvel état qu’à l’expiration de son engagement il regagna son village.
Cependant il déchanta dès qu’il eut franchi le seuil de son domicile, car le spectacle face auquel il se trouva était de nature à faire de lui la risée du pays. Sa femme en effet, qu’il pensait trouver seule à la maison comme il l’y avait laissée, était à présent entourée de gais lurons, tous, elle comprise, dansant et festoyant à l’envie.
Messire Artus alors, ravalant son dépit, se donna le temps d’envisager ce qu’en l’occurrence il aurait à faire, hormis le fait d’interroger sa femme, dont il n’aurait obtenu que de fallacieuses réponses. Cette idée cependant en amena une autre, laquelle consistait à se substituer au curé du village, le jour où son épouse irait à son habitude se confesser, mais il devait auparavant convaincre le prêtre de souscrire à son projet. Il alla donc trouver ce dernier, un de ses camarades d’enfance, et il se fit suffisamment persuasif pour le rallier à son idée.
Quand le moment venu sa femme eut pris place dans le confessionnal, elle commença par expédier ses menus péchés, puis elle en arriva à de plus conséquents.
« Mon père, dit-elle, j’ai reçu en mon lit un gentilhomme, un chevalier, un prêtre…
— Un prêtre-même ! s’écria alors le mari outré ; à qui donc croyez-vous parler, femme infidèle ?
— À mon benêt de mari, tiens ! Puisque je vous ai reconnu quand je vous ai aperçu en train de vous faufiler en ce lieu, revêtu d’une soutane. Alors, ayant compris quelle était votre intention, je suis entrée dans votre jeu. Mais en cette affaire vous n’avez pas été en mesure de découvrir le fin mot de ma confession, car en fait le gentilhomme et le chevalier que j’ai cités, ne l’avez-vous pas été successivement ? Et le prêtre enfin, n’est-ce pas également vous, déguisé comme vous l’êtes pour me leurrer ?
— Dieu soit loué qu’il en aille ainsi ! dit alors Messire Artus, et je suis un sot de n’avoir pas saisi la finesse de votre prétendue confession. »
Conte d’un paysan qui avait offensé son seigneur
Un paysan avait, on ne sait trop comment, offensé son seigneur ; une bagatelle dit-on. Mais le seigneur avait très mal pris la chose, jugeant que l’affront était des plus graves.
« Tu mériterais, dit-il à l’offenseur, d’être pendu haut et court, ne serait-ce que pour l’exemple. Cependant, par bonté exceptionnelle, je vais me montrer clément, te donnant à choisir la peine qui te sera appliquée parmi les trois suivantes : manger trente bulbes d’ail, d’une seule traite et sans boire, recevoir trente coups d’un solide bâton, ou me verser cent écus. »
Le paysan ainsi acculé rumina là-dessus, se disant : « Manger tant d’ail à de telles conditions, je ne saurais comment y parvenir ; quant à recevoir trente coups de bâton je risquerais d’en mourir, et le pire serait de verser cent écus. » De désespoir alors il tomba à genoux, suppliant son seigneur de lui pardonner. Pour toute réponse celui-ci ordonna qu’on apporte une corde.
De peur d’être pendu, le paysan choisit alors de subir la première des peines offertes à son choix, et sans tarder on lui fournit la quantité d’ail requise. Il se mit alors à manger, avec force grimaces, le seigneur veillant à ce qu’il mâche bien avant d’avaler. Cependant, lorsque le malheureux en fut à sa douzième tête d’ail, ayant le gosier en feu il s’écria :
« Je n’en peux plus, qu’on m’apporte à boire par pitié !
— Ainsi donc tu as soif, répondit le seigneur ; fort bien, tu auras autant de vin qu’il te plaira, mais après cela, il te faudra choisir laquelle des deux autres peines tu auras à subir.
— Ce sera la bastonnade ; mais qu’il plaise à votre seigneurie d’en faire déduire l’équivalent de l’ail que j’ai mangé.
— N’y compte pas bonhomme, ce n’était pas dans le marché. Alors bois, puis prépare-toi à subir la totalité de la peine suivante. »