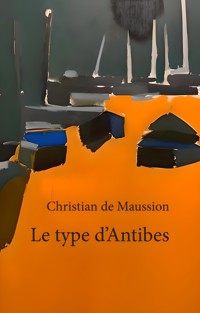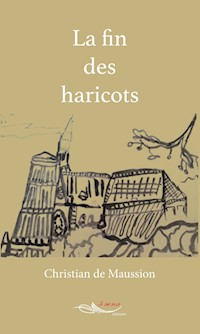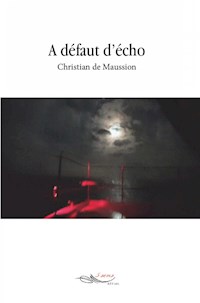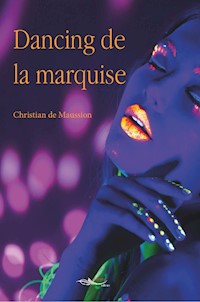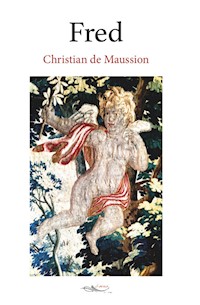Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: 5 sens éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Demos est un petit nom de classe, un diminutif pour parler vite, aller à l’essentiel quand on m’appelle. J’y vois un signe d’affection, l’impérieuse injonction de me soucier d’un peuple, de veiller à ce qu’il vienne au gala des mots, ni en tribus identitaires, ni en foule en colère, mais en petite bande amoureuse, comme les échappés du dernier kilomètre, avec une même et convulsive splendeur en ligne de mire. Aucune égalité n’est requise quand on vise le luxe d’une banquise, quand les paysages sont silencieusement sauvages, quand les ciels rouges s’ébrouent avec les loups. Aucune égalité n’est respectée, quand on décide de coudoyer une invincible beauté, quand on endosse l’humilité du fol guerrier, quand on décide, une fois pour toutes, d’y aller seul. Aucun peuple. Aucun peuple ne suit. Aucun peuple ne cause au néant. Tous les autres mentent. Le livre, il suffisait de trois mots pour l’écrire : assuétude, épiphanie, nostalgie. Nous étions trois aussi, agenouillés au pied du lit, les coudes plantés dans l’édredon, une mère et deux fils, à réciter la prière journalière avant d’éteindre la lumière. Je me réveille. Je ne vois plus ma mère. Je questionne un mur. Qu’est-ce que c’est, au juste, qu’une prière ? D’une abyssale ignorance, saurais-je faire une espérance ? Je me souviens de la musique des préaux et j’entends la clameur qui me baptise tout haut Demos, du nom qui désigne un peuple hellène.
A PROPOS DE L'AUTEUR
Christian de Maussion vit dans un pays ensoleillé, étoilé de jolies phrases, qui s’appelle « La langue française ». Il y séjourne à l’année depuis ses premières assiduités d’écolier. Ce treizième livre fait suite à « "Fred" » et à « "Tita Missa Est" » dont il compose le dernier pan du triptyque. Un jour, l’auteur, au terme de l’aventure, réunira ses textes sous un titre générique : « La plus belle fille du monde ». L’auteur aime lire, écrire, ne rien faire. À ses heures, il rédige des chroniques pour Service Littéraire.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 134
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christian de Maussion
Demos
À elle, à lui
« C’est à celui qui sait être seul, que je voudrais parler, et à personne d’autre. »
Alexander Grothendieck, Récoltes et Semailles, Gallimard, 2021
« Maintenant elle sentait bien que sa froideur apparente n’eût plus rien changé, et la tendresse qu’elle me prodiguait était comme ces aliments défendus qu’on ne refuse plus aux malades, quand il est assuré qu’ils ne peuvent plus guérir. »
Marcel Proust, Albertine disparue, page 203, Pléiade IV
La beauté me fait du bien. Avant de mourir, j’aimerais revoir un chien, coller mes regards au sien. Hopi, Romy, Roumi. Quelque chose des bois d’ici, des loups blancs de Mongolie. Serrer la patte de Roumi, le tumultueux épagneul des tilleuls, le dégager du piège masqué des braconniers. L’entendre à son cri, percuté par un mal d’animal, se hâter de libérer les dents d’une stridence, le voir lécher sa plaie, peu à peu dans l’instant d’un été.
J’ai les doigts tailladés, la paume ensanglantée. Roumi découvre une gueule mêlée d’écume et de rosée. Il m’enseigne une foi, le credo d’une joie, l’œil libre d’une fidélité sans pourquoi. La nuit s’annonce sans cause dans une lumière fauve, frangée des hautes fougères à couleur de terre. L’homme et le chien claudiquent, se noient d’instinct dans un sang noir, rentrent au bercail avant que la tête ne déraille.
Le drap blanc d’une page où je dévisage une phrase. Nue dans sa baignoire, je n’observe qu’elle. Un voyeur de voyelles la dévêt jusqu’aux yeux. Je la trouve bien faite. La phrase est offerte à la braise du regard. Ma fille est prête pour le bal.
Les chefs-d’œuvre, je les frotte l’un contre l’autre. Je sais faire un feu. Je connais la règle du jeu, la loi du feu sacré. J’évente un secret avant qu’il ne saigne, avant que la flamme ne s’éteigne. Les textes sont des silex, des mains jointes où se conserve une joie, la brûlure d’écriture, un murmure d’autrefois.
Sur le tard, au bord de la margelle, je me suis persuadé que j’étais le portrait craché d’elle.
Je n’étais pas assez intelligent pour tailler une pensée. Pas assez outillé pour forger des concepts, inventer une idée. En revanche, ma peau était sensible aux mots, assez peut-être pour jouer avec une voyelle, esquisser une phrase qui évoquât un style.
Les souvenirs sont la matière de l’imagination. À jouer avec la mémoire comme avec des allumettes, on fait flamber les songes, on fouette un feu dans sa tête.
L’ampleur que le silence donne à la présence. Le mutisme de l’homme seul, du lent piétinement qui rejoint l’horizon, ruine la géante prétention du monde.
Je me souviens de la musique des préaux et j’entends la clameur qui me baptise tout haut Demos, du nom qui désigne un peuple hellène. Le style est un nombre premier : il ne se divise par nul autre dernier, tracé à la craie, excepté l’unité.
Soupault compose un poème qui mène à la mer, sème compagnie aux vers qui mangent une chair en pleine terre. Foutez-le à la mer. « Seulement un coup d’épaule. » Aux premiers rires des jours de camaraderie, j’ai senti l’idiot éclat d’un regard d’omoplate.
J’ai compris. Avec un temps de retard, une décennie d’amnésie. J’ai compris qu’elle m’avait légué Chopin, la nostalgie des Nocturnes, un piano qui débarrasse des mots et des méchants refrains. J’ai su qu’un solitaire désignait une bête qui s’entête aussi bien qu’un sourire d’orfèvrerie. La solitude se porte au bout du doigt, presse une blessure droite à travers bois.
Au cercle d’épiciers qui meurtrissent un livre de piété, aux menteurs saisonniers qui lynchent les niais phraseurs, je hurle une vérité, ni provisoire, ni accessoire, je gueule une parole frivole : « Je ne raconte pas d’histoire. » Même sous la torture des fausses ratures, je ne renierai un songe merveilleux pour un odieux mensonge. J’écrirai à voix basse, éraillée par la grisaille, je ne ferai pas d’histoire. Sur la pâle falaise d’une page, je ne commettrai pas la moindre crasse, je proscrirai le sens fléché d’un terminus.
La Résurrection est un secret bien gardé, un mystère dont le dévoilement taraude l’entendement des derniers braves d’Occident. Ils interrogent un corps d’homme, observent un phallus à brusques intermittences, qui naît et meurt, renaît et succombe. L’indice d’un sexe corrobore une foi, figure une espérance dure, sans quoi la mort ne serait qu’une débandade irrévocable, une jardinière dispersion des poussières.
La vie m’était donnée, se disposait à m’étonner. Le préau d’école est une sorte de hangar où patiente une récolte, un purgatoire où se rêve une aurore.
J’ai l’impression que quelque chose de trop grand, de trop vaste pour moi, troue l’imagination, apparente un futur à sa fêlure.
Ces choses se sont passées, ont écorché la surface d’une peau, cherchent un mot qui les dégage de l’oubli, du muet éboulis comme un long crachat qui les enterre, les a ensevelies.
Je vois une première ligne de petits bitards aux yeux qui clignent dans le brouillard. Deux piliers, un talonneur, qui s’épaulent aux premières heures d’école, avant l’entrée en mêlée, avant de se colleter aux épines, aux grandes suées qui égratignent, à la ronde immobilité d’un monde.
Alban, Menou, Mazeline. J’ai grandi sous de Gaulle. Une grandeur d’école, l’effigie d’un pays. Si la vieillesse n’est pas ce qu’on croit, l’enfance est une trace de soi qui fait loi et ne s’efface pas. J’étais réfractaire au caractère utilitaire du récit linéaire. J’éparpillais les pointillés des histoires comme des confettis insincères. Je m’incarcérais dans les phrases, une à une, me consacrais aux choses rares, aux aurores.
Chardonne, en janvier, son avant-dernier, à moitié sourd, crie deux ou trois choses qu’il sait du bien écrire, observe une insensible majesté, sacralise le demi-jour du texte court. Il fait vibrer l’ennui comme un silence du soir, après la pluie. À Morand qui virevolte au volant, il confie : « Je cherche à m’ennuyer pour faire durer le plaisir de vivre. »
C’est un plaisir que j’entame, juste après le collège Notre Dame. J’ai du temps. J’attends la neige. Le trio se réchauffe à se serrer près du préau. Alban, Menou, Mazeline. Cloués aux voix qui bégaient, fixés à l’immobilité, dans le vent qui gifle, le grésil qui blanchit nos blouses anthracite, le froid qui rougit les doigts, la sirène de midi qui mugit du ciel gris.
Alban est petit, batailleur. Menou est moyen, rieur. Mazeline est grand, séducteur. J’envie son tablier, la qualité du drapé. Les heures périssent sans savoir qu’elles meurtrissent.
La mort, je l’ai frôlée, à l’instant d’évoquer les premières sensations, les giclées d’une étrangeté au monde. Le passé est un champ tapissé de blessés. Je repasse la leçon, récite mes poèmes de petit garçon. J’accommode les restes, je bricole un texte, j’époussète un palimpseste.
Mazeline fut jadis garagiste. Dessous sa blouse, il masque une rose des sables, cueillie des dunes d’Algérie. On eût dit un guerrier exhibant une perdrix, sortie de la doublure de sa pèlerine.
Les samedis, à l’heure où la flamme de la cheminée ravigote un corps d’enfant, quand la porte de la cuisine s’entrouvre sur la nuit dégringolée, je dénombre les oiseaux alignés du tableau de la journée. Mes doigts saisissent la perdrix à bec ensanglanté, lissent les plumes d’exquise douceur, se chauffent à l’abdomen du petit volatile, à peine mort, se croisent sur le duvet grenat qui gît là sur le gravier. La chasse est une manie ancestrale qui jette la mort, comme un sort, sur la beauté du vivant. J’appartiens, dès cette date, au cercle des tueurs saisonniers.
Mazeline a dérobé un secret qu’il masque sous un tablier. Soudain, comme un prestidigitateur qui pivote sur une jambe, il dévoile l’ocre du sable dans sa couleur d’octobre. La rose minérale déplisse ses pétales. Je suis prisonnier d’une lumière, d’une églantine de désert. J’obéis à Mazeline. J’acquiesce à pareille magie. Je mesure les vertus de sa parure.
J’ignorais que l’accès à Tertu me serait un jour interdit, que la porte serait scellée sans perspective cavalière, que la sérieuse serrure serait fermée à double tour. Je ne savais pas que j’adorais voir courir une femme quand elle est amoureuse, sauvagement heureuse.
Je me remémore le film de Tanner. J’observe la classe étriquée en matériau de prisonnier, préfabriquée, son nom d’usage, qui jouxte le préau. Je vois un ciel sans joie. Bruno Ganz est un marin d’instinct qui fuit l’eau, se terre dans une ville blanche, danse avec les ruelles. Paul s’anime, parle de la mer, du bateau qui fait mal, de la salle des machines. « La cabine, c’est trop petit. Dehors, c’est trop grand. »
On est seul devant la page, aussi blême qu’un linceul, aussi vert de peur que devant la mort. Le monde s’est échappé des yeux. Il s’est réfugié dans ma tête. Je lisais une vieillesse sur mes mains froissées, incisées par les temps achevés, qui souriaient au soleil comme une mer à peau striée. Il n’y a pas un jour, un après-midi, où je ne pense à eux, à l’homme et à la femme qui m’ont soufflé la vie. Tita, je crois bien qu’elle jeta son dévolu sur lui, Fred, parce qu’elle n’y avait qu’un mot et des sons qui prévalaient dans un nom, qui préludaient une nostalgie, identique à Chopin. Fred était sourd à la musique. Il était muet sur le sujet, ne dansait ni ne chantait. Il avait des yeux, faute de mieux, qui emmagasinaient le merveilleux.
Son bras en équerre ressemblait à un trapèze. La noire Chinoise exhibe une face meurtrie, engrossée de coups qui bleuissent et boursouflent ses hautes pommettes. Je m’étends sur les draps. J’attends un regard. Une lumière qui choit du plafond.
On s’agenouille sur le tapis au bord du lit. On croise les doigts. On les mêle, on les mélange en attente du premier ange. On plante les coudes dans l’édredon. Et le fil d’une prière se dévide dans un silence d’hiver, livide. Mes livres guettent l’élan juste, inabouti, d’une nostalgie. Dans les lieux périphériques, j’observe un visage absenté, rebelle à la physique.
Un petit muret de briques sépare l’enclos des marmots de la chapelle des Rédemptoristes. S’y collent des feuilles orangées qu’asphyxient les gris mortuaires d’une lumière empêchée. Les graffitis de bites charbonnent les jaunes latrines. La friponnerie s’est retranchée dans d’étroites cabines, ponctuées au mur de sexes et de scélératesses. Au bout du mince boyau, l’œil au sol troue l’obscur étau. On s’accroupit, comme dans une transe immobile, face au jour sans rougeur d’un portail sans verrou. L’odeur n’a pas d’heures pour saturer l’isoloir d’une souillure. Je défèque à contre penchant.
La vieillesse échappe au visage, à l’espèce de faciès, dessus le lavabo. Elle s’observe dans le miroir, le petit mouroir d’une main veinée, striée, tachetée de cent et mille années. Elle se lit sur les doigts qui patientent, sur les phalanges d’écorce blanche. Je me suis fait mal voir se désole un peintre d’atelier, incarcéré dans l’isoloir.
Une lumière envenime une nostalgie. À la maison, j’entends Gyorgy Cziffra, Samson François, qui imposent un son à mes songes d’autrefois. Mam dépoussière l’aiguille du pick-up, fixe le cercle solaire sur le plateau, hausse le volume qui s’échappe du vinyle entaillé. Elle délaisse un instant son tricot, ravigote une flamme entre les chenets de la cheminée, pose une nuque contre les boiseries du fauteuil tapissé d’un vieux jaune.
Mam cède à la sentimentalité du piano, déploie ses longs doigts sur une joue sans défaut. Le concerto de Chopin squatte un gîte, donne une sonorité à l’obscurité d’hiver. Je tiens Chopin pour un langoureux clampin, un musicien féminin, un languissant artiste.
Au bout d’un demi-siècle, j’ai fait le tour des voyelles. Aucun mot ne vaut le sanglot du piano. Ma haine a dépéri. Mam et Frédéric logent à l’année dans un vieux corps abandonné, une sorte de mémoire cadavérique.
Je vois l’élégant Samson frôler les touches du clavier, produire ses maléfices, glisser une phalange de fée sur l’émail d’un monde. Je pleure sur l’image désuète d’une mèche qui strie un noble visage et croise une patricienne moustache. J’ai renié ma détestation de jadis au seuil d’une solitude sans artifice.
Je suis propulsé dans la vie des signes. J’en bégaie la multiplicité. Dès l’origine, je balbutie dans une couleur écarlate. J’ai les joues rouges. Je suis entaché d’une faute. Le soleil tire une dernière cartouche. L’œil borgne choit dans le vide, se noie dans le rouge.
La nuit éponge la sueur du jour, gomme l’ardoise de sa craie d’été. Au paradis, les gens ne se rendent pas compte qu’ils sont au paradis. Un jour où il rêva trop fort, Dieu créa un monde. La musique, je la contemple de loin, sur la plage sans la comprendre, comme une mer dont la vague hésite, reflue comme une sorcellerie de Chopin, où la ligne de ciel est trouée d’un faux sourire infini, de l’étoile rouge d’un Nocturne.
« Qu’est-ce que c’est, dégueulasse ? » Et ce signe de croix sur la lèvre. Le premier Godard s’achève sur un silence de culasse. Je ne sais pas si je travaille mais je suis seul au soleil.
Tous les grands textes frôlent le grotesque. Le génie, l’idiotie, le fascisme, c’est comme l’eau froide de la mer. Le plus dur c’est d’y rentrer. Mais une fois qu’on y est, c’est un régal !
Dieu parle français, première langue. Sa langue maternelle, c’est celle du ciel. La mienne a frayé d’instinct avec l’italien. Elle s’est serrée contre l’idiome latin plutôt que de se lier aux tambours germains, aux sons brutaux d’une langue hurlée qui klaxonne qu’elle est saxonne. L’affinité des peuples est inscrite dans le chant de leurs phrases.
La vérité jaillit comme l’éclair d’un œil. Mais la colère est plus vraie, plus sincère qu’un sourire. La mémoire n’imprime rien, ni passé ni futur, collecte l’immédiateté d’un corps.
Écrire au plus près de soi-même, s’identifier à sa phrase, y trouver un gîte, y demeurer à cause d’un goût de fraise.
L’insouciance. Ni la vieillesse, ni la jeunesse, ni la tiédasse maturité ne l’enseignent un peu, ni même à moitié. C’est une science morte, peut-être une saveur insue, un savoir perdu qui n’appartient qu’aux dieux d’hier.
Il est une habitude que défie la simple et sotte assuétude. Elle se calque sur la ronde saisonnière des bonjours de la terre. Elle est d’origine écolière, consciencieuse, appliquée, attentive aux sourires les plus rares.
On peut être dans la tête d’un autre, voire même dans son cœur, partager un sentiment, des mots, comme on rompt le pain, mais personne n’est dans votre peau. Ma mère brunissait facilement au soleil. Je prenais de violents coups de rouge. Elle ne le comprenait pas.
Désespoir pour la soif. Libre comme l’air, léger comme une plume : free-vol. Je ne veux pas connaître. Il est trop tard. Je veux retrouver ce que j’ai connu. Je veux reconnaître.
La laideur exerce une violence grimacière. L’affreux crève les yeux bleus. Les peintres s’ébrouent dans le luxe, se vautrent dans la luxure. Parce qu’ils aiment la lumière, la couleur sacrificielle, scarifient une ombre.
Quand il a sauté, enjambé le parapet, quand il a plongé, Nicolas de Staël a fait l’aplat sur le ciel. Il fait sienne les toiles parkinsoniennes de Van Gogh. La mort, on la cache sous l’humus terminus, comme un dieu qui se terre.
Un jour, on se lève en guerrier : « C’est à moi de le faire ! » Avant d’ajouter : « C’est mon tour. » La démente étrangeté, celle d’écrire, obnubile comme un drap sale, un sang de meurtrier.
Quand je vois le ciel, son bleu d’aurore, je me demande comment on peut s’y fourvoyer à faire l’aviateur. De la mer, saisir une seconde de brièveté, une heure d’immensité, un siècle de majesté. Boire quelque chose.
Les gens vivent en dedans, sacrifient à la hâte, sans foi ni piété, je crois bien qu’ils sont athées. Soudain je comprends pourquoi Mam regardait le ciel, longuement, s’était même dotée d’une lunette d’astronomie, l’observait au plus près. Elle inspectait les lieux, sa demeure de morte, son gîte d’après transat, face au cyprès. Pas seulement. Faute de mer devant laquelle s’agenouiller, Mam évaluait le bleu de ses yeux dans les nuages au-dessus des paysages.