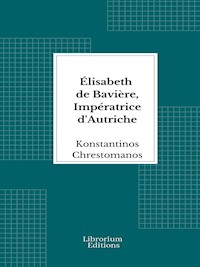
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Cette impératrice qui, par une fuite continuelle, par son éventail interposé et par la pratique de la restriction mentale avait pu jusqu’à sa mort cacher le chef-d’œuvre qu’elle s’était elle-même créée, nous allons la contempler, sinon directement, du moins telle qu’elle se réfléchit dans la mémoire d’un jeune poète tout préparé par son tempérament et par les circonstances à ressentir la beauté. Le docteur Christomanos se souvient que j’ai essayé de décrire une méthode pour créer et pour gouverner notre sensibilité, et même, nous raconte-t-il, l’impératrice daignait se plaire à ces petits romans dont il lui donnait lecture; il pense à juste titre que son analyse lyrique d’une reine qui ne voulut d’autre royaume que sa vie intérieure, qui s’appliqua uniquement à s’épurer et à reculer les bornes de sa rêverie, nous fournira la plus abondante et la plus poétique contribution au Culte du Moi.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
CONSTANTIN CHRISTOMANOS
Élisabeth de Bavière Impératrice d’Autriche
—PAGES DE JOURNAL— IMPRESSIONS, CONVERSATIONS, SOUVENIRS TRADUCTION DE GABRIEL SYVETON PRÉFACE DE MAURICE BARRÈS1900
© 2022 Librorium Editions
ISBN : 9782383835905
Élisabeth de BavièreIMPÉRATRICE D’AUTRICHE
DU MÊME AUTEUR
Chants orphiques (Orphische Lieder, éditions allemandes de 1898 et de 1899, épuisées).—Édition française en préparation.
La Dame Grise (Die Graue Frau), dialogues dans le crépuscule, poème dramatique, traduit en français par Jean de Néthy.
PRÉFACE
UNE IMPÉRATRICE DE LA SOLITUDE
Cette impératrice qui, par une fuite continuelle, par son éventail interposé et par la pratique de la restriction mentale avait pu jusqu’à sa mort cacher le chef-d’œuvre qu’elle s’était elle-même créée, nous allons la contempler, sinon directement, du moins telle qu’elle se réfléchit dans la mémoire d’un jeune poète tout préparé par son tempérament et par les circonstances à ressentir la beauté.
Le docteur Christomanos se souvient que j’ai essayé de décrire une méthode pour créer et pour gouverner notre sensibilité, et même, nous raconte-t-il, l’impératrice daignait se plaire à ces petits romans dont il lui donnait lecture; il pense à juste titre que son analyse lyrique d’une reine qui ne voulut d’autre royaume que sa vie intérieure, qui s’appliqua uniquement à s’épurer et à reculer les bornes de sa rêverie, nous fournira la plus abondante et la plus poétique contribution au Culte du Moi. Mais qui sommes-nous pour toucher à ce magnifique poème où l’imagination du plus pauvre lecteur amassera d’elle-même un abondant et magnifique commentaire? La divine Antigone de Sophocle dit à sa sœur Ismène: «Depuis longtemps je suis morte à la vie, je ne peux plus servir que les morts.» C’est une insensée, pense Créon. «Prince, lui répond Ismène, jamais la raison que la nature nous a donnée ne résiste à l’excès du malheur.» On aime à trouver dans la langue que préférait l’impératrice Elisabeth les mots qui peuvent le moins offenser sa plaie vive.
Du point de vue où nous nous plaçons, nous devons bénir ses souffrances. La jeune impératrice Elisabeth d’Autriche émerveillait ses peuples et la haute société européenne, mais quel que fût le romanesque de sa première beauté, on préférera celle que lui firent les meurtrissures de la vie. L’Impératrice Eugénie la copiait. Qui donc pourrait nier ce que des pleurs de sang sur leurs visages et les stigmates de la vie ajoutèrent à des charmes de déesse?
Au seul prononcer de ce nom, l’impératrice Elisabeth, le lecteur imaginatif—et celui-là seul poursuivra cette lecture—voit de ses propres yeux un confus amas d’horreurs autour d’un trône chancelant! Sa sœur, la duchesse Sophie d’Alençon, brûlée vive au Bazar de la Charité; une autre sœur, qui perd héroïquement un royaume; son beau-frère, l’empereur Maximilien Iᵉʳ, fusillé, le 19 juin 1867, à Queretaro; sa belle-sœur, l’impératrice Charlotte, folle de douleur; son cousin préféré, le roi Louis II de Bavière, noyé, le 13 juin 1886, dans le lac de Starnberg; son beau-frère, le comte Louis de Trani, suicidé à Zurich; l’archiduc Jean de Toscane renonçant à ses dignités et se perdant en mer; l’archiduc Guillaume tué par son cheval; sa nièce, l’archiduchesse Mathilde, brûlée vive; l’archiduc Ladislas, fils de l’archiduc Joseph, tué à la chasse; son propre fils enfin, le prince héritier Rodolphe, suicidé ou assassiné, le 30 janvier 1889, au château de Meyerling. Ainsi, chez cette descendante des Wittelsbach, les circonstances extérieures aident les inclinations naturelles. Et la mort vient donner un suprême prestige à cette âme que les coups acharnés du destin avaient travaillée comme une matière rare.
Le docteur Christomanos ne nous fait pas l’histoire des souffrances de l’impératrice Elisabeth. Sans doute, il serait intéressant d’étudier ces cruelles étapes de sa beauté et cette lente altération qui la menait, vivante, dans les solitudes et qui, morte, la sort de la foule vulgaire des ombres. On aimerait une biographie-psychologie pareille à celle que Jacques Bainville vient de consacrer à Louis II de Bavière. Mais nous prendrons l’Impératrice telle qu’on la trouve dans ce «Journal», sur cette table d’anatomie.
Il faut d’abord que l’on sache de qui nous tenons ces précieuses révélations. Regardons ce que vaut l’instrument par lequel nous allons voir, M. le docteur Christomanos.
Il était un petit étudiant d’Athènes qui travaillait tout le jour et fort avant le soir, dans une maison triste et décente d’un faubourg de Vienne. Seulement, quand il cherchait des citations latines pour sa thèse sur «les Institutions byzantines dans le droit franc», parfois il rêvait et soupirait. Au soir tombant, un merle venait se poser sur le toit d’en face et chantait, chantait, jusqu’à ce que l’obscurité effaçât sa petite forme et sa petite voix. Or, voici que l’Impératrice eut le caprice d’apprendre le grec et voulut un jeune Hellène qui la suivit dans ses promenades. On lui désigna l’étudiant. Elle le fit chercher par une voiture de la cour.
Vous connaîtrez ce qu’il y a de défauts et de qualités dans celui qui va être notre guide rien qu’à lire cette première page, charmante d’amour pour la beauté, et dans laquelle nous reconnaissons un frère très lointain, tout imprégné d’orientalisme, de notre Julien Sorel:
«Un valet de pied, vêtu de noir, me reçut à l’entrée du parc, et me signifia que Sa Majesté m’invitait à l’attendre dans le jardin. Il me conduisit à un endroit du parc, près du château, et m’y laissa seul, après s’être profondément incliné devant moi. Subitement transporté de l’atmosphère grise et du banal tous les jours de la ville dans cet impérial jardin fermé où ne pénétraient pas les simples mortels, secoué par l’attente d’un événement décisif, je me trouvais jeté pour ainsi dire hors des bornes de ma conscience. C’était comme si j’éprouvais tout cela en une autre personne qui pourtant était bien moi. J’avais le sentiment de rêver un beau rêve, et je craignais qu’il ne s’évanouît trop tôt; d’autre part, le désir impatient de ce qui allait venir me torturait, comme si je ne pouvais pas attendre le réveil.
«Je ne connaissais l’impératrice que par ses portraits qui la représentaient presque toujours le diadème au front. J’étais plein d’un indicible émoi. Autour d’un buisson tremblant de mimosa aux innombrables fleurs d’or, des essaims d’abeilles bourdonnaient. De toutes ces petites boules en floraison, rayonnait, avec leur doux parfum enivrant, un sourire d’or. Certes, elles ne savaient pas qu’elles étaient là pour moi autant que pour les abeilles, pour que leur regard, pour que leur souffle embaumé me rendissent cette heure inoubliable, autant que pour donner leur miel aux abeilles. Comme les abeilles, mon sang bourdonnait à mes tempes, et je me disais: «Voilà un monde qui vit sans nous, qui ne semble pas nous connaître, et qui, cependant, d’une distance infinie, tend vers nous.
«Je ressens encore la poésie de cette heure d’attente qui m’emportait loin de moi-même vers un infini lointain, qui me précipitait dans un abîme! Si bien que, lorsque je revins à moi, j’étais la proie d’une sensation étrange, comme si du fond crépusculaire et verdâtre des mers, une vague puissante m’eût jeté sur une terre étrangère et inconnue du pays de la vie. Et tandis que j’attendais là, mon cœur s’emplissait de plus en plus de la certitude que j’étais sur le point de voir apparaître ce que ma vie aurait de plus précieux.
«Soudain, elle fut devant moi, sans que je l’eusse entendue venir, svelte et noire.
«Dès avant que son ombre m’eût atteint pour me tirer en sursaut du rêve où je m’abîmais, je sentis son approche, et cette sensation surgit juste avec sa venue, et cependant me sembla être née en moi depuis bien longtemps, comme si j’avais vécu avec elle des heures et des années. Elle était devant moi, un peu penchée en avant; sa tête se détachait sur le fond d’une ombrelle blanche que traversaient les rayons du soleil, et qui mettait une sorte de nimbe léger autour de son front. De la main gauche, elle tenait un éventail noir légèrement incliné vers sa joue. Ses yeux d’or clair me fixaient, parcourant les traits de ma figure, et comme animés du désir d’y découvrir quelque chose. Ont-ils trouvé ce qu’ils cherchaient? Est-ce plus tard seulement qu’ils me sourirent, ou bien ont-ils eu pour moi, dès le premier jour, ces rayons souriants?
«En cet instant, je n’avais pas le temps de réfléchir à cela, et les sentiments que je distingue aujourd’hui si clairement n’existaient alors qu’en germe, inconsciemment et momentanément réunis en moi. Je ne sus tout de suite qu’une chose: c’était Elle. Et j’eus aussi une grande surprise: comme elle ressemblait peu à tous les portraits que je connaissais d’elle! C’était un être tout autre, et pourtant c’était l’impératrice: j’étais devant une des apparitions les plus idéales et les plus tragiques de l’humanité. Ce que je lui dis alors? J’ai honte de le rappeler à mon imagination. Je balbutiais quelques phrases embrouillées sur ma joie et le grand honneur... Mais elle me tira de mon grand embarras en disant, les yeux rayonnants d’une grâce infinie: «Quand les Hellènes parlent leur langue, c’est comme une musique.»
Que parlai-je de Julien Sorel. Cet étudiant hellène, c’est un jeune frère de la jeune Esther quand elle s’évanouit devant Assuérus. On croit entendre, plus délicat et plus approprié à ce professeur de grec le vers racinien:
Esther, que craignez-vous? suis-je pas votre frère?
A la suite de ce guide d’une folle sensibilité unie au goût des plus rares fantaisies esthétiques, pénétrons un instant dans l’intimité d’Elisabeth d’Autriche. Lisons ensemble le récit que nous donne M. Christomanos de son premier séjour à la Hofburg:
«Mon appartement se trouve dans l’aile léopoldine. On arrive du Franzensplatz, à côté du corps de garde, par un étroit escalier en colimaçon, jour et nuit éclairé au gaz,—«l’escalier des confiseurs»,—à un long corridor tapissé de nattes,—«le passage des demoiselles». Une suite de portes avec des noms de dames d’honneur sur des cartons blancs. Tout au bout, des gardes de la Burg qui vont et viennent lentement avec des cliquetis de sabres. A ma surprise, je lis sur une de ces portes mon nom. C’est l’étiquette de mon existence à venir dans l’armoire à tiroirs de la cour. Ma chambre est vaste, mais basse de plafond. Un parquet poli comme un miroir, sur lequel le feu du poële fait glisser de rouges feux follets. Teintures et meubles à rayures grises et blanches. Une grande double fenêtre donne sur la place extérieure du château et sur le Volksgarten que maintenant un crépuscule gris enveloppe. Un paravent de soie rouge devant le lit que recouvre aussi une lourde soie,—tout, du reste, d’une distinction très simple.
«Le même soir, l’impératrice me reçut. Un domestique de service privé vint m’avertir que Sa Majesté avait appris mon arrivée et me priait de me rendre près d’elle. Je me hâtai vers elle, à pas muets sur les nattes, tout le long du couloir, parmi des laquais et des femmes de chambre qui chuchotaient, puis, après un coude, par un corridor plus large, qui traverse l’aile de l’impératrice Amélie. C’est la partie du château qui regarde le Franzensplatz du gros œil de son horloge, étincelant le soir; elle est habitée exclusivement par l’Impératrice et sa suite. Par une porte secrète, j’arrivai au grand escalier d’honneur, puis, un étage plus bas, sur un palier, où un garde de la Burg en grand uniforme était planté immobile devant une portière de velours; derrière cette portière, un vestibule de style empire, avec ce luxe froid et nu des antichambres princières où l’on gèle si atrocement quand on n’est pas un laquais. Plusieurs huissiers à bas blancs, culottes vert amande, s’inclinèrent devant moi jusques à terre, les portes s’ouvrirent comme d’elles-mêmes, et je me trouvai à l’improviste dans une seconde pièce qui était encore plus somptueuse, mais dont l’accueil me fut moins fermé et moins hautain. Là, un huissier en frac noir vint à ma rencontre. Et, à ce moment, je m’aperçus que j’avais pris instinctivement une nouvelle allure, et que je la soutenais avec une grande virtuosité; ici, il s’agit de marcher sans s’arrêter et sans hâte, en glissant sur le parquet plutôt qu’en le foulant, sans butter aux saluts ni aux révérences. Le valet de chambre de l’impératrice, également en frac noir (la livrée de deuil privée de l’impératrice), sortit de la porte opposée, s’inclina profondément, et disparut aussitôt par la même porte, sur la pointe des pieds, pour m’annoncer. Tous ces gens retenaient leurs souffle et leur âme, et n’étaient que frac et pointes des pieds. Et alors, la porte s’ouvrit à deux battants, sans bruit. Derrière un paravent de soie rouge, j’entrai dans une salle vaste et brillamment éclairée. Les murs étaient tendus de soie rouge, et devant mes yeux scintillaient meubles dorés, larges et profonds miroirs tenant des panneaux entiers, et grands lustres pendants. Une atmosphère d’une pureté presque immatérielle s’exhalait vers moi.
«D’une porte opposée, qui était ouverte, et laissait voir un petit salon, l’impératrice vint à ma rencontre. Les murs scintillaient de rouge sombre, les flammes sans nombre ruisselaient sur les dorures et rejaillissaient de la profondeur des miroirs, les cristaux en losange des lustres étincelaient comme des pierres précieuses suspendues, et l’impératrice, vêtue de noir, se tenait devant moi, souveraine de tout cet éclat. Elle me salua, d’abord, de loin, et me dit qu’elle se réjouissait de me revoir près d’elle. Et dès qu’elle eut ouvert la bouche et que sa voix eût résonné, le rayonnement autour d’elle pâlit. Ainsi je connus qu’elle était plus rayonnante encore que tout ce qui l’entourait. Je savais déjà, avant d’entrer, ce que je trouverais ici, et pourtant j’étais ébloui. Nous nous promenâmes, une heure durant, sur le tapis mat, où le pied s’enfonçait comme dans un jeune gazon, dans des flots de lumière dont l’attouchement, comme un air tiède, agissait plus musicalement encore.
«Tout autour se dressaient les meubles dorés, à de longues distances, et dans un calme parfait, comme des objets enchantés. Dans cette pièce, sur ces meubles, ne se posait ni rire ni pleur, nulle ligne ne remuait ni ne changeait de place. Des grands miroirs, qui prolongeaient la pièce en des lointains infinis, comme sous des masses d’eau transparentes, la lumière rebondissait, comme une buée fluide d’or et de sang. Je regardai autour de moi et reconnus l’air de l’étiquette espagnole qui se levait des coins sombres vers les portraits princiers dans leurs cadres lourds.»
Quelques jours plus tard, le jeune Christomanos, appelé à Schoenbrunn auprès de l’impératrice, voit des cordes, des appareils de gymnastique et de suspension fixés à la porte qui mène du salon au boudoir. «Je la trouvai justement en train de «faire des anneaux». Elle portait une robe de soie noire à longue queue, bordée de superbes plumes d’autruche, noires aussi. Elle avait à recevoir quelques archiduchesses. Je ne l’avais jamais vue habillée avec tant de pompe. Suspendue aux cordes, elle faisait un effet fantastique, comme d’un être entre le serpent et l’oiseau. Pour poser les pieds à terre, elle dut sauter par-dessus une corde tendue assez bas. «Cette corde, dit-elle, est là pour que je ne désapprenne pas de sauter. Mon père était un grand chasseur devant l’Eternel, et il voulait nous apprendre à sauter comme les chamois.» Puis elle me pria de continuer la lecture de l’Odyssée.»
Dans tous ses châteaux, l’Impératrice avait fait peindre Titania caressant la tête d’âne. «C’est la tête d’âne de nos illusions que nous caressons sans trêve,» disait-elle. On comprend la vie par les éléments qu’elle nous donne et avec l’âme qu’on reçut de ses pères. Cette personne singulièrement née jugea toutes choses, comme fait Hamlet, d’après la vue de cour. Une existence infiniment luxueuse, une humanité infiniment fourbe (par platitude et par diplomatie) développent chez un être délicat des besoins et des tristesses heureusement inconnus à la foule laborieuse.
La satiété et le mépris, voilà, si l’on écarte cet enchantement de poésie, les deux caractères que l’on distingue d’abord chez l’impératrice. Elle n’aimait plus qu’une chose, impossible à trouver: le pur, le simple, la nature dépouillée de tout artificiel. Ce besoin, qu’elle sait bien ne pouvoir satisfaire, commande toutes ses opinions: «Moins les femmes apprennent, disait-elle à Christomanos, plus elles ont de prix, car elles tirent d’elles-mêmes toute science. Ce qu’elles apprennent ne fait à vrai dire que les égarer; elles désapprennent une partie d’elles-mêmes pour s’approprier imparfaitement de la grammaire ou de la logique. C’est une illusion d’alléguer qu’ainsi cultivées elles donneront des fils intellectuellement mieux doués. Et, pour aider les hommes dans leurs affaires, elles ne doivent pas leur souffler des conseils et des pensées, mais par leur seul contact elles doivent éveiller et faire mûrir chez les hommes des idées et des résolutions.»
Ceux qui ont quelque habitude des atténuations que les personnes bien élevées se plaisent à donner à leurs pensées distingueront la force de ce cerveau qui comprenait, à une époque où ces simples notions sont étrangement méconnues, que les êtres peuvent seulement porter les fruits produits de toute éternité par leur souche. Elevée d’instinct par sa délicatesse esthétique à cette vérité scientifique des naturalistes, l’impératrice disait un autre jour: «La culture se rencontre même dans les déserts de l’Arabie, sur les mers et les prairies solitaires. La civilisation étouffe la culture; elle réclame pour soi chaque être humain et nous met tous dans une cage. La culture, chaque homme la porte en soi comme un legs de toutes ses existences antérieures. Souvent la civilisation et la culture viennent de directions opposées et s’entrechoquent; alors l’être humain est dégradé. Les pauvres, quelles victimes! On leur a pris la culture, et en retour on leur montre la civilisation dans un lointain inaccessible.»
Des vues aussi saines, où nous vérifions, une fois de plus, la concordance de l’instinct et de la science, la rendaient méprisante pour les cuistres. Elle aimait à réciter avec l’accent le plus ironique ces vers de Heine: «Le monde et la vie sont trop fragmentaires: je veux aller trouver le professeur allemand. Celui-là sait harmoniser la vie, et il en fait un système intelligible: avec ses bonnets de nuit et les pans de sa robe de chambre, il bouche les trous de l’édifice du monde.»
Ces accents stridents, ces états nerveux qu’elle appréciait si fort chez Heine et qui sont proprement des accès méphistophéliques, lui étaient familiers. C’est une sorte de désespoir, où l’humilité et l’orgueil se combattent; c’est d’une nature hautaine qui raille les conditions mêmes de l’humanité. Aspirer si haut et trouver si bas! Un jour, à Miramar, contemplant le pavillon où sa parente l’impératrice Charlotte enferma sa folie à son retour du Mexique, elle murmure, après une longue rêverie: «Un abîme de trente ans plein d’horreur! Et avec cela on dit qu’elle engraisse!»
Des railleries de cette qualité et dans un pareil moment offensent la piété des gens simples. Mais ne semble-t-il pas au lecteur que des états analogues existent chez le philosophe? Epris des plus beaux cas de noblesse, il vit dans le siècle, il en voit la duperie et devient dur. Il est amené à considérer les choses sous un aspect immoral, parce qu’il les regarde d’un point où bien peu de personnes se placent. L’impératrice Elisabeth cherchait toujours à sortir de la vie, à ne se laisser posséder ni par les choses, ni par les êtres. «Quand je me meus parmi les gens, je n’emploie pour eux que la partie de moi-même qui m’est commune avec eux. Ils s’étonnent de me trouver si semblable à eux. Mais c’est un vieux vêtement que, de temps en temps, je tire de l’armoire pour le porter quelques heures.»
On sait qu’elle interposait constamment son éventail, son ombrelle, entre son visage et les regards. Ceux-ci paraissaient vraiment la faire souffrir. Ils la privaient d’elle-même. «Nous devons songer autant que possible à sauver au moins quelques instants pendant lesquels, chacun à notre manière, nous puissions pénétrer dans notre propre vie. Eh bien! quand je me trouve toute seule dans un site solitaire, dont je sais qu’il fut peu fréquenté, je sens que mes rapports avec les choses diffèrent absolument de ce qu’ils sont si des humains m’entourent. A cette différence seulement, je me reconnais moi-même.» Un autre jour elle disait: «Nous n’avons pas le temps d’aller jusqu’à nous, tout occupés que nous sommes à des choses étrangères. Nous n’avons pas le temps de regarder le ciel qui attend nos regards.» Elle s’exprimait enfin dans cette magnifique image, d’un surprenant raccourci, lourde et sombre et qui fait miroir à nos plus secrètes pensées: «J’ai vu une fois à Tälz une paysanne en train de distribuer la soupe aux valets. Elle n’arriva pas à remplir sa propre assiette.»
C’est à réfléchir sur l’émotion éveillée en nous par la femme qui put, au hasard d’une promenade, laisser s’évader de son âme une telle pensée, que nous vérifions la vérité et la magnificence de sa théorie du tragique. «Je crois, disait-elle, que les conflits tragiques agissent moins par eux que parce qu’ils nous mettent dans un tel état que nous croyons nous approcher de quelque chose d’indéfini et que nous attendons toujours dans notre vie. Ce sont des passions ordinaires que l’on met sous nos yeux, mais nous les reconnaissons, cependant, pour quelque chose d’autre que ce pour quoi elles se donnent. Ce n’est point par le tragique du théâtre que nous sommes pris, mais par des vues plus profondes qui ont été éveillées dans notre cœur.» Un autre jour, elle disait: «La joie n’est qu’une chose éphémère, un épisode, en attendant la passion qui doit venir. Celle-ci vient toujours, car elle est l’attente de la destinée que notre vie a pour but d’atteindre; elle est la chose la plus triste et par là la plus magnifique qui soit au monde. Tous les êtres qui sont beaux attendent leur destinée, et ils sont tristes aussi, quand ils n’en sont pas détournés.»
Si vous voulez comprendre davantage cette personne extraordinaire qui trahit ses angoisses de nerveuse dans ces grandes vérités à demi-voilées et qui faillit elle-même s’anéantir sans rien nous livrer des beautés qu’avaient suscitées en elle la préparation des siècles et ses douleurs, voyez-la, celle qui fut d’abord une Titania caressant la tête d’âne de ses illusions, voyez-la finir comme un roi Lear, trahie par tous ses beaux rêves.
Je ne sais rien de plus émouvant et qui donne mieux l’impression d’une génialité cherchant éperdument un milieu favorable que les fuites continuelles de cette impératrice, et surtout ce jour où elle entraîna le jeune Christomanos à Schœnbrunn, sous une pluie de neige fondue, dans une tempête de vent, à travers de grandes flaques d’eau. «Nous courons comme des grenouilles dans les marais, dit-elle. Nous sommes comme deux damnés errant dans le monde infernal. Oui, pour beaucoup de gens, ce serait l’enfer. Pour moi, c’est mon temps préféré, car il n’est pas pour les autres, je puis en jouir seule. A vrai dire, il n’est là que pour moi, comme les pièces de théâtre que le pauvre roi Louis se faisait jouer pour lui seul. Encore ce plein air est-il beaucoup plus grandiose.» Et elle ajoute: «Certes, je voudrais que l’ouragan fût encore plus enragé, car on se sent alors si proche de toutes les choses, comme en conversation avec elles!»
On touche ici aux parties les plus élevées de cette rare nature. Avec le strident des violons tziganes qui pleurent et sourient, elle nous fait entendre l’hymne panthéiste, l’acceptation, la mort, la vie dispersée dans les choses; et parfois les profondes clameurs de la mer viennent doubler cette plainte demi-étouffée.
«Sur la mer, dit-elle, ma respiration s’élargit. Elle se règle sur la houle. Quand les lames deviennent plus larges, je commence à respirer plus profondément. La mer nous déshumanise, ne souffre rien en nous de l’animalité terrestre. Dans la tempête, je crois souvent que je suis devenue moi-même une vague écumante.»
Quand elle arrive à cette élévation de pensée, cette rare créature égale ces grands maîtres de l’humanité qui firent leur principale étude d’«accepter» et de mourir, de mourir continuellement. L’un d’eux s’exprima-t-il jamais avec plus de magnificence que le jour où cette femme déclare: «L’idée de la mort purifie et fait l’office du jardinier qui arrache la mauvaise herbe dans son jardin. Mais ce jardinier veut toujours être seul et se fâche si des curieux regardent par-dessus son mur. Ainsi je me cache la figure derrière mon ombrelle et mon éventail, pour que l’idée de la mort puisse jardiner paisiblement en moi.»
Quelles devaient être ses pensées le jour où Christomanos, dans l’aube de Corfou, les troubla? La scène se passe au Palais d’Achille. «Hier, au petit jour, écrit Christomanos, je me suis levé et je suis allé—sans savoir pourquoi—tout droit, par l’escalier des dieux, sur la terrasse d’Hermès. Un blanc reflet surgissait à l’est, derrière les croupes noires des montagnes, dont les corps immergeaient dans l’obscurité, comme dans les ténèbres de leurs propres ombres. De la mer, que l’on devinait, plus qu’on ne la voyait, en une immense pâleur noyée, montaient les fraîcheurs humides du matin. Au ciel, presque toutes les étoiles s’étaient éteintes; une seule, d’une terrifiante grandeur et magnificence, était au zénith. C’était Sirius. Au-dessous se dressait dans l’air un grand cyprès noir, dont le faîte s’inclinait légèrement sous un souffle de brise que l’on ne sentait ni n’entendait... Soudain, je la vis glisser, comme une ombre, entre les colonnes du blanc palais. Je fus extrêmement surpris de la trouver là à cette heure, et je voulus me retirer; mais elle s’approcha, rapide comme un ange noir qui aurait à défendre un paradis, et me dit: «Je suis toujours ici avant le lever du soleil pour voir comme tout s’éveille. Il ne faudra plus monter jusqu’ici à cette heure. C’est le seul moment où je sois tout à fait seule.»
Voilà une indication, insuffisante pourtant et qui irrite nos plus nobles curiosités, sur les mystères et les énigmes où s’épuisent les intelligences hautaines. Mais surtout nous voyons les ravages de la satiété et la névrose des tout-puissants.
L’audace et l’ironie amère, l’invincible dégoût de toutes choses, le sentiment perpétuel de la mort et même ces enfantillages esthétiques d’une mélancolique qui cherche à s’étourdir me font considérer ces «Idées et sensations» d’Elisabeth d’Autriche comme le plus étonnant poème nihiliste qu’on ait jamais vécu dans nos climats. Il semble que chez cette duchesse en Bavière des fusées orientales soient venues irriter les forces du rêve. Cet accent sceptique et fataliste, ce mépris absolu des choses d’ici-bas, cette perpétuelle contemplation ou mieux cette constante présence de l’idéal indiquent une âme ardente et blasée, mais d’une qualité esthétique que je trouve seulement chez ces incomparables soufis persans qui couraient le monde dans la familiarité de la mort. Et cette volupté de la satiété où s’enfonçait avec une complaisance si douloureuse cette impératrice évoque certains rêveurs mystérieux des trônes asiatiques.
Bien entendu, je ne prétends point donner par ces rapprochements une explication; mais, comme un air de musique parfois nous transporte dans un paysage, l’atmosphère de réserve silencieuse et de sensibilité bizarre qui flotte autour de l’impératrice évoque pour moi ces cours des Khalifes où la plus monotone philosophie du néant, parfois avec mièvrerie, développe ses sentences au milieu de drames qui la justifient.





























