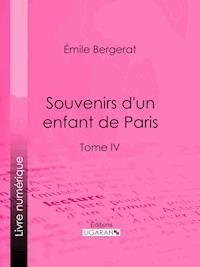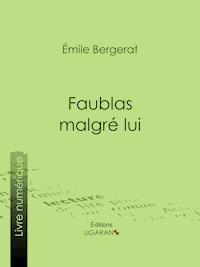
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Extrait : "La Société des Places-aux-Jeunes, dont cette étude est destinée à éterniser le souvenir, – au moins pendant une heure, – florissait dans les dernières années du Second Empire. Elle en a partagé le sort à la guerre de 1870. Malgré son nom un peu batailleur, – et qui je le crois, s'explique de lui-même à des Parisiens, – cette société n'avait point pour but, avoué ou secret, de renverser les gouvernements et même de changer les cultes reconnus".
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les bons statuts font les bonnes sociétés.
(Œuvres complètes de M. de Soubeyran.)
La Société des Place-aux-Jeunes, dont cette étude est destinée à éterniser le souvenir, – au moins pendant une heure, – florissait dans les dernières années du second Empire. Elle en a partagé le sort à la guerre de 1870. – Malgré son nom un peu batailleur, – et qui je le crois, s’explique de lui-même à des Parisiens, – cette société n’avait point pour but, avoué ou secret, de renverser les gouvernements et même de changer les cultes reconnus. Elle ne tendait pas d’avantage à saper le vieil édifice vermoulu des vieilles institutions françaises. Le cri de : Place-aux-Jeunes ! qui devint le titre de sa raison sociale, n’exprimait l’angoisse d’aucune revendication politique. Le lecteur connaîtra par les statuts qui la régirent quelle sorte de place ces jeunes – ils l’étaient véritablement, ceux-là, – ambitionnaient au soleil.
Admirables statuts, plus sages que les lois de Lycurgue, et plus prudents que les vers dorés de Pythagore ! Statuts auprès desquels Salomon semble un vague rédacteur du Tintamarre, Marc-Aurèle un Joseph Prudhomme et La Rochefoucauld un… rien du tout. Statuts pleins d’une philosophie pratique autant que généreuse ! Statuts, enfin, qui eussent rendu réalisables la Salente de Fénelon, l’Icarie de Cabet, et au moyen desquels Alfred Lavrille, l’un des sociétaires se chargeait à l’en croire, de pacifier la Pologne, en dix minutes et l’Irlande en moins de temps encore. S’il ne parlait pas de l’Algérie, c’était par pur patriotisme. Pour y être demeurés fidèles, à ces statuts mémorables, Lavrille et ses camarades sont aujourd’hui ce qu’ils avaient rêvé d’être, c’est-à-dire d’excellents artistes dans la peau de parfaits honnêtes gens. Plusieurs même ont payé leurs dettes.
À la fondation, la Société se composait de sept membres titulaires, six hommes et une femme. Le nombre sept est fatidique ; il porte bonheur, dit-on, surtout aux personnes qui croient en sa vertu. Il y a sept merveilles du monde, sept sages-grecs, sept couleurs dans l’arc-en-ciel et sept lettres au mot : mariage, toutes choses belles et réputées heureuses. Gabriel Brianton y ajoutait sept sens : les cinq connus d’abord, puis le sanscrit et le sens-devant-dimanche. Que cette facétie lui retombe sur la tête ! Pour ces raisons et pour d’autres non moins graves, il y eut donc sept Place-aux-Jeunes. Le chiffre est formel, quoi qu’on en ait dit. À la dissolution de la Société, il était encore intact. Rare exemple d’union entre jeunes hommes, – dont une jeune femme, – et qui suffira, je l’espère, à faire apprécier l’affection réelle qu’ils se portaient entre eux.
J’ajoute bien vite, – et c’est là ce que veut établir cette présentation, moins brève encore qu’indispensable, – que cette affection avait pour base de granit et d’airain une honnêteté poussée jusqu’au dernier scrupule de la fierté. C’est sur ce point que mes bohèmes demandent à être distingués des autres bohèmes, et notamment de ceux d’Henry Mürger, dont la moralité justifie trop souvent l’extravagante distinction de M. Désiré Nisard. Si les personnages de Mürger ne relevèrent guère que de la petite morale, les Place-aux-Jeunes sont adeptes et sectateurs de la grande. Ma bohème, à moi, n’est pas une impasse ; elle n’est qu’un chemin épineux et dur qui aboutit. Il aboutit, parce que ceux qui y marchent ne se sont pas laissé souiller par la misère, parce qu’ils ont fraternisé dans une foi commune, parce que, s’ils ont eu leurs heures de paresse et leurs nuits de doute, ils n’ont jamais été des paresseux de métier et des blasés de profession. Ils avaient l’âme robuste dans un corps bien trempé, et chez eux la bonne humeur n’était que la fleur de la bonne santé. Et sur ce mot de bohème, expliquons-nous une bonne fois.
Si « bohème » définit la jeunesse pauvre de l’artiste et ce que le poète de Weimar nomme les années d’apprentissage, la bohème est éternelle comme le monde et, tout au moins, autant que lui.
Elle fournira, après nous, aux écrivains futurs autant de types et de créations diverses qu’il y aura de modifications successives de la société. Son thème littéraire est inépuisable, car tant qu’il y aura des vieux et des riches, il y aura des jeunes et des pauvres. Valère est immortel au même titre qu’Harpagon, et Figaro que Bartholo. – Si, au contraire, le sens du vocable devait être celui que lui ont donné Mürger et ses imitateurs, je récuserais le nom de bohèmes pour mes héros. Il ne leur est point applicable. Les Place-aux-Jeunes, encore une fois, ne furent poitrinaires ni de corps ni d’esprit. Ils ne toussotaient pas leurs gaies calembredaines. Ils criaient à pleins poumons et ils embrassaient à pleines joues. Werther et Réné les agaçaient affreusement, et ils auraient mis Rolla dans une maison de santé, couronné de lauriers, certes ! mais ils l’y auraient mis. Quant à Graziella, ils en faisaient des gorges chaudes. Cette italienne mélancolique les précipitait dans une allégresse nerveuse qui les transformait en clowns. Jean Sapan, le musicien du groupe, avait refait la mélodie du Lac, pour les jours de pluie et à leur usage ; cette composition à six-huit était fort divertissante.
Est-ce à dire que les Place-aux-Jeunes se fissent de la vertu une idée tout à fait conforme à celle qui dicta à M. de Montyon ses dernières volontés et son testament ? Doit-on inférer de ce qui précède que les prédicateurs évangéliques pussent, du haut de la chaire sacrée, les proposer pour modèles aux fidèles édifiés ? Ce serait se forger de folles illusions que le croire. Les Place-aux-Jeunes étaient de leur temps – et de Paris ! Ils étaient de ce Paris, où les maires sont obligés d’offrir des primes aux ménages clandestins pour les décider à se laisser consacrer, eux et leurs enfants, par l’écharpe tricolore ; de ce Paris moderne, la ville du monde où l’on aime le plus et où l’on se marie le moins ; de ce Paris, Babel et Babylone, où la civilisation (le mot même est devenu comique et prudhommesque) est parvenue à la limite de tous les progrès, et si bien, qu’elle n’a plus d’inexploré devant elle et de nouveau que l’état de nature, et qu’il y retourne amoureusement. Les Place-aux-Jeunes ont eu des maîtresses ; ils ont vécu sur les marges du Code. Mais que celui qui n’a jamais bu un verre d’absinthe leur jette le premier caillou du tombereau ! De l’absinthe même, ils en ont bu quelquefois ; mais que celui qui n’a jamais eu de maîtresse, avant, pendant ou après le mariage, leur jette le tombereau tout entier ! Seulement, aucune de leurs maîtresses n’est morte à l’hôpital, à la suite d’excès de plaisir – ou même de misère. Elles étaient saines et bien portantes et n’avaient de fêlé que le timbre. Ludovic Saintonge a pu dire d’elles plus tard avec le bon sens érudit qui caractérisait sa manière : « De la dépouille de nos bois l’automne eut beau joncher la terre, le bocage, pour nous, resta plein de mystère, et le rossignol plein de voix ! »
Peut-être devrais-je en historien habile, et pour conquérir à mes héros la sympathie du public féminin, laisser croire du moins que les Place-aux-Jeunes ne fumaient point la pipe. Ce serait courir le risque trop grave de n’être cru qu’en province. Je préfère citer là-dessus la réponse bizarre mais profonde d’Olivier Mézouard qui, surpris un matin par une femme du monde, en négligeant et fumant un narghilé de deux sous à sa fenêtre, se contenta d’obvier à la stupéfaction de l’élégante par ces paroles significatives : – Une pipe ! oui, marquise, je vous en demande pardon ! Mais j’ai donné hier à un pauvre, qui n’avait pas de pain, la boîte de londrès que votre imbécile de mari m’avait offerte !
Qu’on me pardonne d’insister sur cette nuance si bien établie par le mot précédent, mais les Place-aux-Jeunes ont eu ceci de distinctif entre tous les bohèmes qu’ils flairaient d’abord l’argent avant de s’en servir, trouvant à l’encontre du proverbe, qu’il a parfois une odeur douteuse. Il n’y a pas d’exemple qu’un sociétaire ait jamais apporté à la collecte une pièce de cinq francs dont il ne pût avouer l’histoire devant les hommes et signer le poème devant Dieu. Dans ce long tournoi, en pleine clarté, qu’ils ont livré à la pauvreté, ils ne se sont servis que d’armes courtoises, qu’ils peuvent suspendre aujourd’hui sans rougir à leurs panoplies, sous les yeux de leurs enfants, à l’endroit le plus apparent du salon de famille.
ARTICLE PREMIER
L’association est fondée sous le titre provisoire de Société des Place-aux-Jeunes. (Nota. Le titre est définitif). Son but, incertain jusqu’à ce jour, 3 juillet 1866, sera ultérieurement fixé ; mais il se dessine déjà très énergiquement comme gastronomique, amical et littéraire.
ARTICLE 2.
Jusqu’au démembrement inclusivement, démembrement auquel la force des choses assigne un terme imprévu mais fatal, les Sociétaires sont portés au nombre de sept ; ils s’y bornent. Ces Sociétaires sont, par rang d’âge :
MM. OLIVIER MÉZOUARD, vingt-deux ans et sept jours,
MM. LUDOVIC SAINTONGE, vingt-deux ans et six jours ;
ABRAHAM KNUSS, dit Tétabouc, vingt-deux ans moins douze jours ;
ALFRED LAVRILLE, vingt-deux ans moins treize jours ;
JEAN SAPAN, vingt et un ans et trois quarts ;
GABRIEL BRIANTON, dit l’Enfant, vingt et un ans et deux tiers ;
Mademoiselle BLANCHE, dite ROSE-ET-LYS, quatre saisons.
SCOLIE DE L’ARTICLE 2.
Toutefois il sera créé des membres honoraires ; – et même des membres invités, dont le rôle invitateur sera toujours fixé par un débat auquel ils ne prendront point part. La vaccine et le baccalauréat ne constituent pas des titres suffisants pour se voir reçu membre invité ou honoraire. Une connaissance, à tout le moins succincte, de la constitution du vers français donne seule cette chance, mais après épreuve avec pièges.
ARTICLE 3.
Une condamnation à mort n’entraîne pas forcément la radiation. Cependant tout membre guillotiné devra donner sa démission, le plus possible au préalable. Par contre, le Sociétaire convaincu de comprendre quoi que ce soit à ce que l’on appelle la politique, sera, de ce fait seul, rayé de la liste, et les autres porteront son deuil pendant un mois et un jour. Ce deuil peut être remplacé par une lecture de Jocelyn, mais devant témoins.
NOTA.– Exception est faite pour l’opinion dite Opposition, qui relève moins de la politique que de la physiologie nationale.
ANNEXE À L’ARTICLE 3.
Question posée par le membre Olivier Mézouard. – Un Sociétaire a-t-il le droit d’accepter les avances du Pouvoir, telles que sous-préfecture, bureau de tabac, recette générale ou gouvernement de l’Algérie ? – À l’unanimité, la réponse reste indécise. Cependant, dans le cas de force majeure, le bureau de tabac devrait être préféré à toute autre corruption, mais à la condition que le Sociétaire le tiendrait lui-même et en personne, et y donnerait des soirées dansantes.
ARTICLE 4.
L’école littéraire représentée par la Revue des Deux-Mondes, l’Académie, les prix de vertu et les discours du trône, est non avenue pour les sociétaires. Elle n’a pas lui ! – Victor Hugo n’est pas considéré comme académicien.
Proposé par M. Gabriel Brianton, – excepté par Mlle Blanche, bien entendu ! –
ARTICLE 5.
Un dîner mensuel est fondé, auquel tout Sociétaire est tenu d’assister sous peine de ne pas être tutoyé jusqu’à la fois suivante. Ce dîner aura lieu le 3 de chaque mois, chez Joubois, à la Tête-de-Veau. Il sera soldé le soir même par cotisation. M. Ludovic Saintonge est élevé aux fonctions de receveur-payeur, sans cautionnement, mais sans appointements aussi. Le manque absolu de fonds ne pourra, en aucun cas, servir d’excuse à une absence de ce festin, attendu que, si on n’a pas d’argent, on devrait en avoir. La dépense n’excédera jamais le total de la collecte, à moins d’erreur.
ARTICLE 6.
L’usage inhumain et asiatique du pourboire est renoncé par la Société, à ses risques et périls. M. Alfred Lavrille, qui, en sa qualité de professeur de langues, doit posséder à fond le répertoire de Vadé, est chargé des combats pittoresques de gueule avec les vaisseliers récalcitrants. Cependant quelques boutons de culottes en cuivre, dûment astiqués à cet effet par le membre Tétabouc, seront toujours prêts à sauvegarder la dignité commune, et pourront être jetés à main fermée dans les tirelires sonores placées trop en vue des consommateurs.
ARTICLE 7.
Nul ne sera forcé d’aimer les tripes à la mode de Caen.
ARTICLE 8.
Un prêt d’argent dépassant la somme de 5 francs et 5 centimes pourra être remboursé par l’obligé au bienfaiteur. – À la moindre réquisition d’un de ses co-sociétaires, tout Place-aux-Jeunes est tenu de partager ce qu’il a en poche avec le requérant. Dans le cas litigieux où le total atteindrait à un chiffre impair, la différence reste au profit de l’emprunteur, soit, par exemple, en dix-sept sous, huit pour le riche et neuf pour le pauvre. Albert Gratigny, l’un des Pères de l’Église de la Bohème révélée, a dit : « Au-dessus d’un louis, je rends, même aux bourgeois. » – Le mot louis est pris là pour napoléon, mais les créanciers cessent d’être des bourgeois dès qu’ils deviennent des créanciers. Le napoléon vaut vingt balles, pas de coton, dans toute l’Europe civilisée.
ARTICLE 9.
Le Sociétaire, parvenu à entrer comme rédacteur dans un journal, devra d’abord circonvenir l’esprit débile du directeur et le capter pour lui glisser insidieusement tous les Place-aux-Jeunes dans sa rédaction. Il ne touchera pas pour cela de remise. Il n’aura même droit à la reconnaissance des membres que s’il leur fait insérer, – soit par force, soit par ruse, – DES VERS ! et sacrifie ainsi, sur les autels de la divine Poésie sa position dans ce journal et son avenir dans tous les autres.
ARTICLE 10.
Mlle Blanche est une amie, dans toute l’acception du mot.
ARTICLE 11.
Le membre qui aura écrit, déclamé, fait recevoir ou représenter une œuvre dramatique dans la forme philistine et coloniale dite : prose, sera publiquement accusé de caducité ou de besoin de luxe effréné, à son choix. S’il réitère, il sera tenu pour décidément acquis à la Société rivale des Auteurs et Compositeurs, et le titre de Place-aux-Jeunes devra disparaître de ses cartes. La Société antagoniste dont il s’agit est par excellence la Société des Place-aux-Vieux et la caverne des reprises.
ARTICLE 12.
En qualité d’amie, Mlle Blanche, dite Rose-et-Lys, est sacrée. Elle est chargée de l’exécution du présent article.
ARTICLE 13.
Le mariage ou l’héritage ne sont pas acceptés pour cas de force majeure, nul n’étant forcé par la nature souveraine de se marier ou d’hériter. La Société ne recevra pas sur ce point les excuses des délinquants. Toutefois le divorce et la ruine rendent tous les droits au sociétariat et justifient d’un festin extraordinaire offert par les Sociétaires, les Honoraires, les Invités et les Correspondants réunis pour célébrer un tel retour à la moralité. Le veuvage ne donne droit qu’à un repas ordinaire.
ARTICLE 14.
Les Sociétaires peuvent embrasser Mlle Blanche, dite Rose-et-Lys, sur les deux joues ; les Honoraires sur le front ; les Invités sur les mains et les Correspondants par lettre.
ARTICLE 15 ET DERNIER.
Les précédents articles, pouvant être arbitraires, sont facultatifs, et ce dernier lui-même est révisable.
FIN DE LA PRÉFACE PSYCHOLOGIQUE
Il était sept littérateurs
Qui n’avaient que sept francs cinquante
Mon Dieu ! que la chose est fréquente
Dans ces états peu producteurs !
…
La santé du père Joubois
Est celle à laquelle je bois !
(La Ronde de la Tête-de-Veau.)
Tout à coup, au milieu de l’entrain général, Alfred Lavrille se leva, et, après avoir remis sur selle son binocle désarçonné par le plaisir, il dit :
– Ô mes amis, il n’y a plus d’oie et j’ajoute que c’est dommage !
Il se rassit, et la pâle consternation régna. Il n’y avait plus d’oie en effet, plus d’oie ni de farce, car cette oie avait été farcie, c’est-à-dire presque truffée. Elle avait renfermé des marrons ! Seule la carcasse restait, mais combien décharnée !
– Tel, reprit Lavrille, dut apparaître le cheval de Troie quand il eut été vidé des Grecs aux belles cnémides, sur les boulevards extérieurs d’Ilion.
– Par Falstaff ! que cette oie était brève ! fit Jean Sapan, et il en mesura tristement le squelette.
Gabriel Brianton, dit l’Enfant, jeta dessus sa serviette en signe de deuil, et les sept Place-aux-Jeunes se regardèrent. Ils avaient encore faim, évidemment.
– Si nous en redemandions une autre ! suggéra Mlle Blanche, surnommée Rose-et-Lys. Et déjà l’espérance refleurissait tous les visages, lorsque, farouche, Abraham Knuss, dit Tétabouc, – se basant sur les statuts, – établit qu’il fallait au préalable consulter le gousset de Ludovic Saintonge.
Le gousset de Ludovic (quel titre pour une comédie de caractère !) était le coffre-fort de la Société – Consulté avec soin et retourné du concave au convexe, il justifiait d’une rentrée de sept francs et dix sous, – soit un franc et neuf centimes par tête, Mlle Blanche n’étant pas considérée comme tête, mais comme fleur !…
– Calculons ! – formula Tétabouc. – Les Place-aux-Jeunes descendirent profondément en eux-mêmes. Tétabouc disait :
– Trois bouteilles et demie à un franc la bouteille, soit trois francs et cinquante centimes. – L’oie ?
– Oui, l’oie, combien l’oie ? appuyait Sapan, est-ce plus de cent sous ?
– Peuh ! grommela dédaigneusement Saintonge, qui savait le cours des Halles.
– J’en ai connu à quarante sous, soumit Lavrille. (Il avait voyagé.)
– Et moi à quarante francs, risqua Gabriel, perdu d’angoisse.
Ce récit détermina des rires, même dans une situation tendue comme une chanterelle de contrebasse.
– Elles étaient donc lardées de paillettes d’or, proféra Saintonge, et cuites dans de l’eau-de-vie de Dantzig ?
Ces mots ironiques résumaient l’opinion générale.
– Mettez votre oie à six francs, intervint Rose-et-Lys.
Ludovic opina du bonnet ; c’était le cours des Halles.
– Donc l’écart, résuma Tétabouc, est de deux francs. Nous sommes déshonorés de quarante sous, ou de dix fois quatre sous, ajouta-t-il pour plus de clarté.
– Mais je les ai, s’écria Mlle Blanche. Et tirant son petit mouchoir, – son mouchoir de jeune fille, disait Lavrille, – elle dénoua le coin blanc qui renfermait sa fortune. C’était une pièce de deux francs, à l’effigie du Saint-Père, toute neuve, et qui éclaboussa les lambris d’un rayon d’argent.
Jean Sapan prit la pièce et la contempla longuement.
– Messieurs, dit-il enfin, réjouissons-nous ! Le Pape a toujours la bonne mine que nous lui connaissons ! Et il rendit le trésor à Rose-et-Lys.
La jeune fille se dressa toute rouge :
– Je suis Sociétaire ! s’écria-t-elle ; j’ai le droit de payer ma part. D’ailleurs, je la précipite par la fenêtre je vous en avertis. Il y a des pauvres ! Douze bras la saisirent par le milieu du corps.
À ce moment, Olivier Mézouard, qui fumait en mangeant pour faire croire qu’il était aimé par des grandes dames russes, – et qui n’avait pas encore ouvert la bouche, du moins pour parler fit entendre sa voix susurrante et brisée aux rythmes des sérénades :
– Ô Rose-et-Lys, apaise-toi ! car ton dévouement et ta double-lire ne sauraient combler l’abîme où tu nous as précipités, imprudente fille d’Ève.
– Qu’a-t-elle fait, la pauvrette ? interrogèrent les bohèmes.
– Ce ne serait rien dans le monde, dit Mézouard, mais dans une auberge, c’est grave ! Elle a mangé une crevette !!!
Pour juger de l’importance de l’accusation, sans gravité apparente au premier abord, il faut connaître les usages des restaurants de Paris et savoir que, – dès qu’un bateau de hors-d’œuvre est entamé, – son prix intégral est exigible. Dans la législation gargotière, un radis vaut la botte ; la prise d’une seule crevette équivaut à l’enlèvement de toutes les autres. Dura lex, sed lex.
– Patatras ! fit Jean Sapan, et le silence, précurseur des orages, s’amoncela.
Or ceci se passait l’an 1866 de notre ère, vers les premiers jours de juillet, entre Montmartre et Batignolles en France, dans cet illustre cabaret du boulevard Clichy, tenu par le père Joubois, et dont l’enseigne représentait une tête de veau, décollée du tronc, mais souriant encore sur un lit de fines herbes et d’ognons hachés. Un plat d’or lui formait auréole et, de chaque côté, sous les oreilles, deux huiliers montaient la garde, la fourchette au poing.
Jean Sapan, qui avait des prétentions à l’expertise, prétendait y reconnaître le sujet primitif d’un concours de Rome, et la première manière d’un coloriste mort jeune. En vain Ludovic Saintonge s’efforçait-il de lui arracher son illusion prétentieuse. – Je te dis, s’écriait Sapan, que, dans le principe, c’était une décollation de Saint-Jean-Baptiste. Le plat le prouve ! Il a changé les hallebardiers en huiliers, – pour le commerce ; voilà tout ; il a supprimé Salomé qui n’était pas comprise. – Je ferais un livre pour le prouver !
– Il suffirait peut-être de la préface ! observait Saintonge ébranlé.
Torturez-vous, Saumaises futurs ! La Tête-de-Veau n’existe plus. Mais le souvenir n’en périra qu’avec toute une génération d’artistes qui s’y est perdue l’estomac. C’était un véritable temple à la Gastrite qu’avait élevé là le père Joubois sans compter de petites chapelles latérales à la Dyspepsie ! D’ailleurs Joubois est mort pendant le siège de Paris pour avoir été forcé de manger de sa cuisine. Le dieu des Noces de Cana l’a pris sans doute en son paradis !
Raconter par quel enchaînement de hasards propices s’étaient rencontrés et aimés les divers jeunes gens groupés, autour d’une table de gargote, ce serait vouloir remonter les courants occultes de la destinée ! Qui dira de quelles rives du ciel viennent les moineaux francs que l’aurore rassemble sur la margelle d’une fontaine publique ? (Cette pensée est de Brianton pour l’idée mère et de Mézouard pour le style.) L’heure des repas sonne à toutes les horloges et quelquefois aussi aux coucous des artistes. De là vient que l’on dîne, et parfois en commun. Les festins populaires de Lacédémone et les bouillons Duval ont la même origine philosophique. De longues amitiés sont nées d’un voisinage à la crèmerie, de l’échange d’une salière ou d’une méprise de couvre-chefs. La jeunesse, l’esprit, la santé et la pauvreté cimentent ces commerces sincères pendant les années de sincérité ; puis la vie arrive, avec ses vérités conventionnelles, qui désagrègent les associations, s’empare de l’homme seul et l’absorbe selon sa valeur individuelle. Les scissions se forment, les fossés se creusent, et chacun va où il devait aller ! Telle est la loi sociale ! Elle est très triste, très bête au fond, mais qu’y faire ? Les plus heureux sont ceux qui se souviennent, les plus sages sont ceux qui rient toujours. Amen.
Dieu, dans ses goûts patriarcaux,
Créa, – j’en bénis le mystère ! –
Le bœuf pour les pommes de terre,
Le mouton pour les haricots !
(Ronde de la Tête-de-Veau.)
La disparition de la crevette dûment constatée, même par le binocle mal en selle d’Alfred Lavrille on délibéra. Plusieurs expédients se présentaient. D’abord achever le bateau, puisqu’on devait le payer. Ensuite, fuir par la fenêtre au moyen d’une échelle de corde. Puis, nier l’engloutissement du crustacé disparu et rendre probable la donnée d’une évaporation chimique par des explications savantes. Enfin… enfin payer ! C’est à ce dernier parti qu’on s’arrêta, unanimement. Les Place-aux-Jeunes étaient d’honnêtes garçons qui n’auraient pas fait tort d’un million à Rothschild. La résolution prise, on s’aperçut qu’elle était illusoire. Le gousset de Saintonge, n’avait, quoique coffre-fort, que des ressources de coffre faible. Quant à l’effigie papale, dot elle était, dot elle devait rester.
Rose-et-Lys sombrait dans la désolation : elle demandait le temps matériel de courir emprunter cinq francs à une de ses amies qui perchait sur une gouttière du voisinage. Ce à quoi Lavrille lui avait répondu :
– Ma chère, si ton amie est jolie, va la chercher et ramène-la ; nous lui offrirons un punch et un lunch, et nous la reconduirons en calèche avec un bouquet dans chaque main. Mais si elle a cinq francs, qu’elle reste chez elle. Elle est déjà trop heureuse !
Pendant le développement de ce dialogue, Jean Sapan, qui était un peu sculpteur, – quoique pas autant que Michel-Ange, disait Saintonge ; – s’était emparé de la carapace rose de la crevette, et il essayait de ressusciter cette salicoque en lui modelant un corps de mie de pain.
– Ce sera à s’y tromper, même au goût ! avançait le téméraire.
L’Enfant avait allumé sa pipe, et, grâce à un tempérament particulier qu’il avait, il songeait déjà à autre chose et rêvait qu’il mariait des mouches. Tétabouc s’était accoudé à la balustrade de la fenêtre et, tout en regardant vaciller les becs de gaz du boulevard, il était en proie à une agitation désordonnée.
Olivier Mézouard tira le cordon de la sonnette. Le garçon parut :
– Priez M. de Joubois de nous faire l’honneur de monter, dit-il simplement.
Tétebouc se retourna, très pâle :
– Nous en tirer par de la rhétorique ? Tu es fou, Olivier. Où prendras-tu tes métaphores ? Connais-tu seulement ses opinions prosodiques ?
Mais, sans répliquer, Mézouard s’était campé devant la glace et il rajustait son magnifique faux-col. D’une secousse de l’avant-bras, – secousse dont il possédait seul au monde le secret élégant – il avait fait glisser sur ses poignets ses blanches manchettes en papier-carton. Puis il boutonna sa redingote sur son torse bombé, et en rejeta les revers en velours olive de chaque côté de la poitrine ; enfin il ficha son chapeau sur la tête correctement lustrée et ratissée, et il s’adossa à la cheminée, les jambes croisées, les coudes appuyés sur la tablette de marbre, dans une pose de jardinier de pendule.
– Est-ce qu’il va provoquer Joubois ? demanda Lavrille à Sapan.
– Laissons-le faire, dit celui-ci ; il a l’habitude du monde, et il sait le langage des cours.
Joubois entra. – Les mille tons de l’or, du cuivre et du feu se disputaient sa face cramoisie, flambée aux brasiers des rôtissoires et toute pareille à un chaudron frais étamé réfléchissant les incendies de la cuisine de Gargamelle. Cette rubiconderie était relevée d’une rotondité formidable qui, revêtue elle-même des blancheurs du costume traditionnel, rendait le personnage tragiquement bouffon, et Moyen Âge.
– C’est Torquemada ! murmura Gabriel, assez inquiet.
– Je ne me le représentais pas ainsi, balbutia Saintonge.
Et, de fait, nul ne pouvait se dire tout à fait rassuré, si ce n’est Olivier Mézouard dont l’attitude exprimait le noble spleen des lords.
– Qu’est-ce qu’on me veut ici ? avait grogné Joubois.
– Pardon, grasseya Olivier, pardon, monsieur de Joubois !
Et cette phrase fut lancée avec un tel dandysme que le vénérable empoisonneur se sentit vaguement coupable de quelque chose et que, se grattant le nez, il dit :
– Voyons ! qu’est-ce que vous avez encore trouvé dans le potage ?
La question, compliquée d’un aveu sans artifices, faillit décontenancer Mézouard, et une énorme hilarité s’ensuivit, qui gagna jusqu’aux assiettes, dont deux tombèrent aux éclats. La note s’augmentait d’autant.
– Monsieur de Joubois, repartit Olivier, la gastronomie a des bornes ; elle s’arrête à la salubrité. De qui êtes-vous élève ? de Barigoule ou de Borgia, de Brinvilliers ou de Béchamelle ? Faites-moi l’honneur de me répondre.
– Mais, Monsieur !… fit Joubois, interloqué par cette érudition restauratoire.
– Je vous entends, continua Mézouard, ce dernier maître vous revendique. Vous vous croyez le disciple et l’héritier du grand Béchamelle ! Eh bien, sachez ceci : Vous ne l’êtes même pas de Béchameau ! !
L’à-peu-près retentit comme un coup de tonnerre. Un indescriptible fou rire éclata dans la petite salle. On se tordait. Les vitres en vacillèrent dans leurs sertissures de mastic.
– Ah ! Béchameau ! pleurait Lavrille, c’est du génie !
Tétabouc, le nez dans la barbe, flagellait la table, à coups de poing, Saintonge gloussait ses : Peuh ! peuh ! en desserrant son gilet. Seul, Mézouard ne bronchait pas. Il s’aperçut cependant qu’il était allé un peu loin, à l’effet produit sur Joubois par son incartade extraordinaire. D’écarlate, la face du gargotier avait passé au brun mordoré des cuirs cordouans, ce qui était sa manière de pâlir, et ses petits yeux de faïence s’étaient émaillés des fleurs de la colère.
Olivier se hâta de reprendre la parole.
– Quoi ! monsieur de Joubois ! sur la foi de votre renommée naissante, – et déjà trop imméritée, – nous venons incognito, ces messieurs et moi, expérimenter votre savoir-faire ! Nous avions projeté de mettre la Tête-de-Veau à la mode, sans calembour ! Notre intention était de vous amener des femmes titrées et des barons de la finance ; de renouveler chez vous les soupers galants, qui ont été la honte élégante du siècle passé ! On serait venu ici s’encanailler en noble compagnie. Vous auriez eu la Cour et la noblesse, comme il est dit dans le Pré-aux-Clercs, et des files de voitures armoriées, commençant à votre seuil pour se perdre hors de la vue, auraient chanté votre clientèle. Pajot, votre voisin et votre rival, mais qui, lui, au moins, soigne sa réputation et ses tripes à la mode de Caen, en serait crevé de rage peut-être ! Mais, après l’ignominie obscure que vous nous avez servie sous le titre d’oie farcie ! Après ces vins qui ne datent même pas de 1807 !… Ah ! monsieur de Joubois ! cachez ces vins que je ne saurais boire ! Après ces salicoques, si j’ose les nommer de ce nom, salicoques telles que Madame, qui les idolâtre, se sont vue contrainte de rester sur la première… constatez-le vous-même, cher monsieur de Joubois ! Nous n’avons plus qu’une chose à vous dire : Vous travaillez pour des artistes ! Dressez votre addition : nous retournons aux Frères-Provençaux !
Joubois, assez incertain, et ne sachant pas ce qu’il pouvait y avoir de vrai dans ce discours plein d’hyperboles, commença à se gratter la tête, de façon à renverser un peu son bonnet de marmiton. Mais, après ce geste, cher à César, dit l’histoire, il se fourra le petit doigt dans l’oreille, autre geste qui lui était plus particulier, et après l’y avoir secoué fortement comme pour en agrandir l’orifice, le rusé compère argumenta :
– Si l’oie était si mauvaise, d’où vient donc qu’il n’en reste plus ? Et si mes vins ne sont pas buvables, pourquoi les avez-vous bus ?
Mézouard ne s’attendait pas à celles-là : le coup était droit.
– Oh ! oh ! fit-il, ad hominem !
– C’est-à-dire, remarqua l’Enfant, que ce n’est plus Joubois, mais Joubois de la Mirandole.
– Quel casuiste, bone deus ! exclamait Sapan.
– Il sait du barocco ! communiqua Lavrille à Tétabouc.
– Et du baralipton ! assentit celui-ci.
– Peuh ! peuh ! rétorqua Saintonge. Si nous ne l’avions pas mangée, votre oie, comment saurions-nous qu’elle n’était pas mangeable ?
Accablé d’érudition, de logique, et de langues mortes, Joubois comprit qu’il n’aurait pas le dernier mot et qu’il fallait en finir. Il tira donc sa tabatière, huma une prise et, refermant le couvercle, d’un petit coup sec et sonore :
– Écoutez, proposa-t-il, je ne suis pas si mauvais diable que j’en ai l’air. Je vous défalque les crevettes ! Maintenant laissez-moi m’en aller, car j’ai des pièces sur le feu !
– Ouf ! ça y est ! soupira Mézouard.
– Pas sans trinquer ensemble, père Joubois ! venait de lâcher étourdiment Gabriel, qui ne mérita jamais mieux le surnom de l’Enfant.
– Malheureux ! chuchota Tétabouc, tu veux trinquer et tu n’as pas de quoi boire !
Mais il était écrit que ce jour-là serait marqué du caillou blanc des chances inespérées. Après un rapide regard promené sur la table, Joubois consentit au toast proposé, mais à la condition que c’était lui qui régalerait. Il demanda seulement une minute pour jeter un coup d’œil sur ses fourneaux et une seconde pour descendre lui-même à la cave.
À peine eut-il refermé la porte derrière lui qu’une sarabande, mêlée de cris de joie et ponctuée de serviettes en l’air, déroula ses spirales frénétiques autour de la salle. Rose-et-Lys embrassa Olivier au nom de la Société.
– Jamais je ne me suis tant amusée ! avouait-clic avec une indulgence qui fit bien augurer de la simplicité de ses goûts.
Quelques instants après, accoudée à la fenêtre avec Tétabouc, elle ne put s’empêcher de lui dire :
– C’est égal ! j’ai eu une rude peur ! Comment aurions-nous fait pour payer si Olivier n’avait pas réussi ?
– Et ça ? fit Abraham Knuss, en se collant dans l’œil un beau louis d’or frais, qu’il réintégra aussitôt dans sa poche. Tétabouc était israélite.
Joubois venait de rentrer, une bouteille sous chaque bras ; il avait une pose extrêmement décorative dans le cadre de la porte, et il fut salué par un hurrah !
– Il n’est peut-être pas de 1807, dit-il, en posant les fioles sur la table, mais c’est du nanan ; je n’en donne même pas à ma femme !
De respectables toiles d’araignée, – vraies ou artificielles, – les drapaient de mousseline argentée, et, autour des bouchons cachetés, une mousse irisée s’évasait en collerette.
– Comme je comprends qu’on ait une cave ! soupira Alfred Lavrille.
Inutile de révéler que le plus vif enthousiasme accueillit la politesse du père Joubois et son vin pelure de pêche.
– C’est au moins du Château-Joubois ! disait Sapan en essayant de faire claquer sa langue à la façon des dégustateurs et des conducteurs de diligence.
– Dis plutôt que c’est du Jouboinisberg ! observa Saintonge, qui était œnophile.
On décréta à l’unanimité qu’il serait fait sur Joubois une chanson immortelle. Jean Sapan, homme musicien, – quoique pas autant que Beethoven, disait Saintonge, – fut chargé de trouver un air parfaitement approprié aux paroles, vif, savant et populaire, mais distingué cependant. Quant au texte, la Société ne comptant que des paroliers, il devait être improvisé en commun et par une sextuple collaboration, sous la direction de Rose-et-Lys à qui incombait le soin de compter les pieds sur ses doigts et de présider à la césure.
– Messieurs, dit le père Joubois, chatouillé jusqu’à la moelle de sa vanité, si vous faites cela, ce n’est plus deux bouteilles que je vous offre, c’est un dîner tout entier ! Un dîner pour une chanson ! Mais je veux du Béranger !
Le mot était lâché. Il s’agissait de le saisir au bond, mais sans se compromettre, toutefois, car les Place-aux-Jeunes étaient de ces bohèmes qui ne permettent pas ainsi à tout venant de s’interposer entre eux et leur appétit.
Olivier Mézouard intervint encore une fois :
– Monsieur de Joubois, vous nous prenez pour des journalistes !… Cette chanson, nous la ferons, d’abord parce que le sujet en est beau et s’impose à notre génie ; ensuite parce que nous vous avons promis la gloire ! Nous vous octroyons la gloire, monsieur de Joubois, mais à pur don gratuit de poètes à négociant !… Faites-nous simplement monter du café très fort, veuf de chicorée, des liqueurs très fines, et du tabac très sec ! enfin ce qu’il faut pour écrire, mais ne vous occupez pas du reste, et sevrez-nous de votre aimable présence ! Nous travaillons sans modèle !
Joubois finissait par être subjugué par la dignité crâne d’Olivier ; le respect l’envahissait ostensiblement. Aussi fut-ce d’une voix presque humble qu’il lui proposa de se transporter avec ses amis dans le salon des noces, qui était orné d’un piano, et, par cette raison, plus propre à la composition que la petite salle nue où ils étaient en ce moment, Mézouard acquiesça à ce vœu d’un geste.
Le salon de noces de la Tête-de-Veau