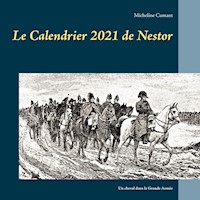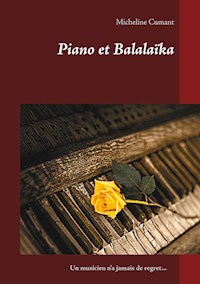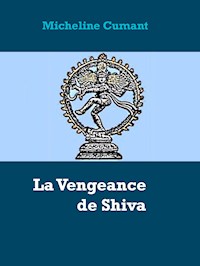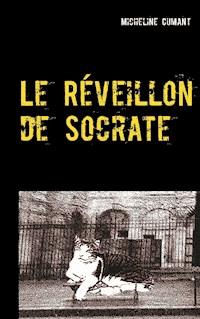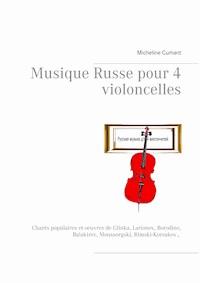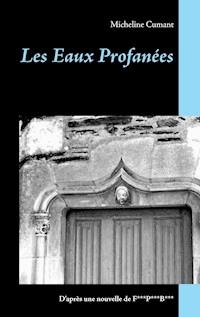Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Marie-Agnès est une jeune violoniste, premier prix du Conservatoire, qui entame une carrière de musicienne d'orchestre. Nous sommes en 1974, et elle est une femme, elle a ses sentiments, ses inclinations, ses coups de coeur, et la vie d'artiste n'est pas de tout repos ! Elle doit composer entre son violon, ses amours, et l'aspect matériel de la vie, il faut bien la gagner ! Contrainte de quitter Paris, elle se retrouve chez un ami en Espagne, puis dans le Midi de la France, puis dans le Centre, à rencontrer toutes sortes de personnages, hommes et femmes. Elle court à la fois après sa carrière et après l'âme soeur. Elle est confrontée à la médiocrité, à la petitesse, à la souffrance des autres, à la méchanceté, mais elle cherche à traiter ces événements avec humour. Et nous sommes en 1974, la pilule est autorisée depuis peu, et Madame Simone Veil présente la loi sur l'interruption volontaire de grossesse. Marie-Agnès, qui ne s'intéresse pas à la politique, comprend qu'elle fait partie de la génération qui voit ces changements, qu'elle vit une époque qui décide de l'avenir des femmes. Mais elle cherche aussi sa "moitié d'orange", un autre, un double, qui acceptera qu'elle le partage avec son violon...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Toute ressemblance avec des personnages ayant existé ...
Eh bien, non, tous les faits relatés ont bien eu lieu...
Il va sans dire que les noms de lieux et de personnages ont été changés...
On sait vivre, tout de même ! Mais si quelqu’un se reconnaît... tant pis pour lui ou pour elle !
TABLE DES MATIÈRES
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.
I.
Eh bien voilà, c’est moi, Marie-Agnès, là, essayant d’avancer parmi la foule, aïe mes pieds et attention à mes bagages. Sur un quai de gare, nous nous dirigeons vers la sortie, le troupeau et moi.
Un quai de gare, un de plus. Plein de monde, de la pluie, et puis moi qui n’ai presque plus un rond et le cafard. Où vais-je, je n’en sais rien, mais cette foule me presse, m’oblige à descendre les marches du passage souterrain, puis à les remonter, qu’est-ce que c’est que cette ville que je ne connais pas, et cette pluie alors que nous sommes dans le sud de la France, cela ne colle pas, arrêtez, je ne veux pas descendre ici, je remonte dans le wagon, non, je ne veux pas aller ici, c’est trop laid.
Mais voilà, le train est reparti, me laissant ici. Je n’ai jamais été copine avec les trains, je déteste les gares, j’ai horreur des escaliers, j’abomine la foule et je suis obligée de suivre le même chemin, c’est pire qu’une manif » , c’est une fuite, non, un troupeau, je suis un mouton comme tous ces gens qui rentrent chez eux après Pâques en famille ou ailleurs, mais qu’est-ce qu’ils font, pourquoi vont-ils ici, dans ce hall de gare gris, qui sent le rance, la sueur et la boue, et dehors, sur ce trottoir. Aïe ! Ne me poussez pas, mes valises sont lourdes et je tiens à mon violon, mon seul ami, mon seul viatique, pourquoi est-ce que je l’emmène ici, sous cette pluie qui ressemble plutôt à une douche. Je traverse la rue, histoire de me repérer.
Ah ! Un hôtel. Pas luxueux, mais convenable, j’ai besoin de me refaire non pas une beauté, mais une propreté, et de rassembler mes idées qui sont pour l’instant froissées avec mes affaires dans les valises et le sac. Et de vérifier l’état de mon violon, quoiqu’il soit protégé dans son étui. Et de sortir agenda, carnet d’adresses, et puis les notes que j’ai gribouillées au hasard des idées dont m’a illuminée le compartiment de deuxième-classe-assise. Oui, parce que c’était encore un de ces vieux trains, avec des compartiments, où l’on se regarde en chiens de faïence avec ses voisins de transport. Heureusement, ils n’étaient pas bavards, le gros monsieur n’a fait que ronfler, la dame âgée lisait une revue en somnolant, le petit militaire avait gardé obstinément le nez collé à la vitre, comme s’il cherchait quelque chose dans l’obscurité, et les autres, je ne les ai ni regardés ni entendus.
J’entre dans l’hôtel, je commande un café et je demande une chambre. La dame : « Vous êtes toute seule ? » d’un air très étonné. Et alors ? J’ai besoin de ma maman pour prendre le train ? Il y a des progrès à faire touchant à la condition féminine, çà, je l’ai toujours dit. C’était bien la peine de faire mai 68, de voir dépaver les rues du cinquième arrondissement de Paris, de gueuler des slogans, pour s’entendre dire que c’est bizarre, une femme qui voyage seule. C’est vrai, on est en province. Je ne connaissais pas ça, mes rares déplacements avaient jusqu’à présent duré une journée, ou deux, pour un concert et tout était organisé, nous restions entre nous, musiciens.
C’est vrai, je suis musicienne. Violoniste. Et présentement, je cherche du travail, au hasard d’une gare. Et aussi à me loger. Enfin, à vivre, quoi ! En attendant, je me jette sur un café qui me fait l’effet d’un philtre de jouvence, me réchauffe les intérieurs, enfin pas tout à fait, j’ai les pieds mouillés. La chambre est correcte, la douche ? « Au fond du couloir » , me dit la dame, une nouvelle fois étonnée. Ah, bon, elle ne prend sans doute jamais de douche ? Non, dans « l’Hôtel de la Gare » , elle ne doit avoir comme clients que des voyageurs de commerce. Ils ne doivent pas se laver, la douche crache un jet vaguement tiède, elle se vide mal, on s’en contentera. Reposons-nous, maintenant.
Une petite station sur le plumard tant pour se reposer que pour d’un doigt léger se regonfler le sensitif, on ne sait jamais je risque de me retrouver demain dans un collectif convenable où ce genre de plaisir solitaire serait mal venu.
Et c’est toujours dans ces moments-là que des pensées suprêmement agaçantes arrivent. Un Tel, et Truc, et Machine, et surtout le numéro un, qui a duré, que j’ai quitté en y laissant des plumes et toutes mes illusions. Enfin, non, des illusions, j’en avais gardé un peu, il y a eu l’autre, le deuxième — plus exactement, le deuxième important — que je viens de quitter. Soyons honnête, qui m’a obligée à le quitter. Pour raisons économiques, psychologiques, affectives... et de carrière. Enfin, carrière... de boulot, soyons modeste. Et puis Paris.
Paris, mon Paris, lui aussi j’ai dû le quitter parce que pas de fric, pas de métier stable, amis disséminés en France et en Europe. La famille, n’en parlons pas ! La musique, ce n’est pas un job convenable pour une jeune fille que l’on a élevée pour être institutrice. Et le mec qui partait pour je ne sais où, raisons professionnelles. Disait-il, du moins. Non, c’était vrai, j’avais vu ses papiers, pour un stage. Lui, il n’était pas musicien, du coup on se croisait plus qu’on ne se rencontrait, je ne fonctionnais pas aux heures de bureau. Séparation pour incompatibilité d’horaires. Mais enfin, puisqu’on était à Paris, où l’on peut tout faire, tout voir... Mais où l’on est regardé comme un zombie quand on trimballe un violon. Encore heureux que l’on ne m’ait pas imposé le violoncelle ou la contrebasse, dans l’école de musique où j’ai débuté !
Je m’endors vaguement, et voilà que je revois le numéro un. Robert, Bob, Bobby, Bibi, il essayait d’être violoniste, je l’avais rencontré dans un orchestre d’amateurs qui prenait de jeunes professionnels pour renforcer l’effectif. Payé deux sous, mais l’ambiance était bonne et on nous offrait le restaurant. J’étais devant, à côté d’un copain du Conservatoire, un gars super doué qui depuis avait démarré une fulgurante carrière de soliste. Le Bibi, lui, il était au fond des seconds violons, raclant son instrument comme il pouvait, mais il amusait tout le monde par ses réflexions et ses grimaces. Moi, je débarquais, je ne m’étais pas rendu compte qu’il était à voile et à vapeur. J’avais rigolé à une de ses sorties, le chef l’avait rembarré gentiment, en ayant visiblement du mal à garder son sérieux, et mon voisin, très — trop — sérieux avait grogné : « Zut, il va se taire, l’autre pédé ! » J’avais ressenti comme une douche froide, mais trop tard, j’étais accrochée à ce clown en perpétuelle représentation.
Après, au restaurant, je m’étais collée à lui, il m’avait coincée entre la porte des cuisines et celle du vestiaire, le baiser avait duré, duré... – du moins, j’en avais eu l’impression — et je ne savais plus où j’habitais lorsque j’étais revenue récupérer mes affaires, tout juste capable de reconnaître mon étui à violon, n’arrivant plus à retrouver mon manteau.
Comme je savais qu’il suivait des cours dans une école de musique privée, j’étais allée me promener dans le quartier. Je l’avais rencontré, l’étreinte avait été passionnée, d’ailleurs des gens s’étaient retournés en nous voyant, avec des réflexions amusées ou choquées, selon leur degré d’évolution. Je l’avais suivi, et j’avais passé ma première nuit, il avait été très gentil, car j’avais l’impression que mon inexpérience devait être pénible pour un mec qui collectionnait les aventures des deux sexes. Ça, il ne me l’avait pas caché. Je ne savais pas où je mettais les pieds, enfin, les pieds... vous comprenez, quoi ! Excusez, c’était le coup d’envoi, bref, le premier ! Je disais ouf, j’en avais marre de la virginité, du style convenable, d’être la bonne petite élève bien sage de mes profs, de mes copains et copines. Pas de mes parents, ils ne parlaient de moi qu’en disant « elle est étudiante, pour être professeur de musique » . Pas violoniste, mais prof, c’est convenable, c’est fonctionnaire, c’est bien ancré dans les mentalités bourgeoises ou ouvrières, avoir casé son rejeton dans la fonction publique sanctifie, sans doute. Musicienne d’orchestre, cela voulait dire des tournées, des hôtels, un travail instable, et cetera... La mère d’une amie m’avait glissé « Marie-toi d’abord, s’il a une situation correcte, tu pourras avoir un travail d’appoint » . Instrumentiste, c’est un travail d’appoint. Grrr ...
J’avais emménagé chez Robert, par coup de chance il demeurait assez près du conservatoire et je pouvais aller y travailler mon instrument. Quand je rentrais, je mettais la clé dans la serrure et souvent j’entendais : « Occupé, reviens plus tard ! » Accompagné de quelques chuchotements, je l’avais même entendu répondre une fois au mec avec qui il s’ébattait : « C’est rien, c’est Carmen, celle qui me fait le ménage » . Là, je n’avais pas aimé. En plus, cela arrivait en général quand je rentrais le soir, donc le conservatoire était fermé, le jardin public à côté aussi, j’allais au bistrot et je retrouvais des copains à qui j’éprouvais le besoin de dire que j’avais oublié ma clé et que j’attendais mon colocataire. Et il y avait des fois où je n’avais d’autre ressource que d’attendre, assise sur les marches de l’escalier.
Il y avait mes copines, Manuela et Isabelle, l’une était fille de concierge, l’autre de PDG, nous étions ensemble au lycée. Manuela était puéricultrice, Isabelle planchait sur sa thèse de doctorat en droit. Nous avions en commun de supporter des mères un peu spéciales, la mienne qui voulait me voir rester célibataire pour pouvoir m’occuper d’elle dans ses vieux jours, celle de Manuela qui rêvait de voir sa jolie fille épouser un prince de contes de fées, et celle d’Isabelle qui était constamment en déprime, usant tous les psychiatres et psychanalystes du seizième arrondissement. Quand je leur avais raconté mon aventure, elles avaient dit « Ah, quand même ! Tu t’y mets » , en se marrant. Manuela, avec son esprit pratique, avait même ajouté « Pardon, tu t’es fait mettre » . Effectivement, nous avions le même âge, mais elles « s’y étaient mises » nettement plus tôt.
Et nous avions discuté. Nous étions en 1968, la pilule venait d’être autorisée en France, et nous voulions bénéficier de cette liberté. Les mecs qui disaient « je fais attention » , ou la méthode Ogino, bouh ! Nous étions la preuve vivante que cela ne marchait pas vraiment, ayant été toutes les trois non désirées. Sauf pour Manuela, chez elle, on aimait les enfants, mais elle était la cinquième d’une famille modeste, et ses parents avaient eu recours aux services d’une faiseuse d’anges par la suite. Isabelle avait essayé de parler de la pilule à sa mère, celle-ci avait poussé des hauts cris : « Je ne veux pas grossir ! » Elle avait fait le tour des médecins de famille, d’étudiants en médecine, et était finalement tombée sur une femme membre du planning familial qui l’avait éclairée. En vacances au « Club Med’ » , elle avait pu avoir une ordonnance, il est vrai qu’à dix-sept ans, elle en paraissait largement plus. Quant à Manuela, elle était contente d’avoir trouvé une chambre, car sa mère n’aurait jamais admis que sa fille touche à « ça » . Pour cette brave dame, cela se passait toujours de la même façon : on fréquente un gars, il vous met enceinte, on l’épouse. Pour le reste, on « se débrouillait » . Et on n’en parlait pas.
C’était Manuela qui, par l’intermédiaire d’une infirmière qu’elle connaissait, avait pu avoir l’adresse d’un médecin. Je me sentais gourde d’y aller... Le toubib, un gentil petit vieux, m’avait posé des questions indiscrètes, je m’étais efforcée de ne pas bafouiller, mais ouf, j’étais repartie avec l’ordonnance. En fait, le brave homme en avait assez de voir s’effondrer en larmes des adolescentes en situation peu intéressante qui « ne savaient pas comment on faisait » et le suppliaient de les aider, ou des mères de famille déjà nombreuse épuisées à qui un médecin bien pensant avait dit « surtout pas de nouvelle grossesse, vu vos problèmes cardiaques actuels... » , et à qui on reprochait de « se tromper dans leurs calculs intimes » .
J’avais parlé de cela avec Robert, il disait que c’était à la femme de choisir et était content que les choses évoluent. Il m’avait appris qu’il avait eu une fille, d’une petite voisine de sa tante à Lille, à seize ans on peut « batifoler » , on l’avait prié de disparaître de la région, il ne savait pas ce qu’il était advenu de sa copine et de l’enfant. Bon, après, il avait découvert les mecs, là il n’y avait pas de risques, mais fréquenter les saunas « spécialisés » lui avait fait faire connaissance avec les chaudes-pisses et autres véroles, et lui et ses copains avaient tout un réseau de médecins qui les soignaient sans leur faire la leçon. Parce que, pour ça non plus, on ne pouvait pas aller voir n’importe qui.
Un jour, j’allais dans un cinéma du Quartier latin avec Robert, quand nous avions rencontré Manuela. Je le lui avais présenté, elle avait été sympa, mais m’avait glissé « Tu as de drôles de goûts » . On ne risquait pas de se piquer les mecs.
J’avais eu mon prix au Conservatoire — seul regret, mon Bibi n’était pas venu m’écouter pour le concours —, Isabelle avait soutenu sa thèse et était entrée à l’école de la Magistrature à Bordeaux. Manuela était toujours là, mais ses parents avaient des soucis de santé et elle et son frère se relayaient pour les aider. Ma bourse d’études avait pris fin, je logeais toujours chez mon copain. J’avais fait une saison à l’orchestre des prix, et ensuite je m’étais lancée dans le métier, je vivotais entre concerts, enregistrements, leçons et remplacements dans des conservatoires.
Robert, lui, pointait au chômage. J’avais appris qu’en fait, il avait commencé par travailler dans une entreprise qui avait fermé. Ceci lui ayant paru un signe du destin, il s’était inscrit dans une école privée de musique pour « reprendre ses études » . Ses parents, qui n’y connaissaient rien, l’avaient aidé, mais leurs ressources n’étaient pas extensibles et il bossait son violon tant bien que mal entre deux aventures masculines ou féminines, espérant réussir un concours pour entrer dans un orchestre. Apprenant que j’allais en passer un, il s’y était inscrit lui aussi. Nous étions arrivés bras dessus bras dessous. J’avais joué, pour moi tout s’était bien passé, puis on avait appelé Bibi, qui était arrivé en rigolant, en faisant un clin d’œil à un des membres titulaires de l’orchestre, avec qui il avait eu une aventure, et au bout de deux lignes de fausses notes, on l’avait remercié. Le fait qu’il soit arrivé avec moi n’avait pas plaidé en ma faveur, mais ils m’avaient demandé de faire quelques remplacements. Je commençais à m’inquiéter pour mon avenir, traîner un rigolo à mes basques n’allait pas m’aider.
Heureusement, Bibi, qui avait décidé de s’appeler « Roberto de Marchi » , du nom du créateur du rôle de Mario Cavaradossi dans l’opéra La Tosca, avait décidé de devenir comédien. Il fréquentait un metteur en scène, un petit maigrichon tout gentil, qu’il avait su subjuguer et qui lui avait obtenu quelques petites figurations, et travaillait un rôle pour un spectacle consacré à Molière, révisé par l’équipe d’une Maison de la Culture de la région parisienne.
Le petit ami de Bibi n’ayant aucune expérience des rapports hétérosexuels, la future vedette avait entrepris de compléter sa culture en la matière en me faisant participer à leurs ébats. Également, j’avais rencontré une de ses partenaires de théâtre, Nicole, une grande femme sportive, ancienne prof de gym à qui l’on avait fait comprendre que ses goûts étaient incompatibles avec la moralité de l’éducation nationale. À vingt-deux ans, je paraissais en avoir quinze, elle était en manque de chair fraîche et j’avais tout de suite cédé, ravie d’ennuyer un peu mon copain, car Nicole n’avait aucune intention de partager ses ébats avec lui. « Il a beau se faire prendre, c’est tout de même un mec » , disait-elle. Et puis, ç’avait été bizarre... Je me croyais comblée avec Bibi, mais j’avais découvert certaines sensations avec Nicole, qui était un peu plus à l’écoute du corps de ses partenaires. Entre femmes, c’est sans doute plus facile et j’avais été très surprise de mes réactions, je lui avais avoué que jamais je n’avais connu cela, l’existence du « point G » m’était inconnue. Elle avait dit : « Ça ne m’étonne pas ! Les mecs, tout ce qu’ils savent faire, c’est vous enfourner, quand ils ne vous engrossent pas... » La réputation de bon amant de Bibi en avait pris un coup. Était-ce pareil avec les hommes ? Là, je ne pouvais pas me mettre à la place de ses partenaires mâles. Et en ce qui concernait ses aventures féminines, apparemment elles avaient plus d’expérience que moi, ou leur sensitif fonctionnait plus rapidement. Ou elles s’en fichaient... Bref...
Il y eut une période bizarre, j’avais trouvé un engagement de deux mois dans un théâtre de province, je faisais l’expérience des fosses d’orchestre. Mais également celle de « la province » . On me disait : « oh, c’est joli comme région, tu pourras faire de belles balades dans la campagne » . Ouais, quand ? Nous étions coincés au théâtre par les répétitions, samedis, dimanches et fêtes, de la Toussaint au Premier de l’an, et après chaque représentation du dimanche, tous ceux qui n’étaient pas du coin, nous foncions à la gare pour regagner Paris, pour y revenir le mercredi en traînant les pieds. Bibi me parlait des chanteurs, me demandant comment un tel avait interprété telle œuvre, je ne pouvais rien lui dire, dans le fond de la fosse, on n’entend rien. En plus, les mecs étaient collants, le chef un tyran, et nous étions logés dans un dortoir de colonies de vacances loin du centre-ville, on ne faisait que s’enrhumer. J’avais dit ouf quand la saison s’était terminée.
Grâce à Nicole, je trouvai quelques concerts, dans des théâtres de la périphérie. Le plus drôle fut l’orchestre d’un cirque où elle officiait comme acrobate, et où elle avait fait engager Maître Roberto comme clown. Le rôle lui convenait à merveille, il avait le chic pour trouver le gag qui allait faire rire au bon moment. Néanmoins, il considérait cet office comme « alimentaire » , ayant pour ambition de faire carrière dans le théâtre classique — à l’extrême rigueur, dans le cinéma —, aussi avait-il prié Nicole de ne pas mentionner son nom dans les programmes. Elle n’en avait pas tenu compte, ils s’étaient fâchés, elle l’avait traité de tous les noms, je m’étais éloignée en me demandant lequel je devais plaquer.
J’étais allée raconter la chose à Manuela, qui m’avait dit « Enfin, tu as compris que c’est un minus ! » Cela ne m’avait pas plu, mais je savais qu’elle avait raison. Enfin, un peu. J’étais restée coucher chez elle, et, le lendemain, elle m’avait remis la clé d’une chambre de service dans un immeuble tenu par une amie de sa mère, en me prévenant qu’il ne fallait pas recevoir qui que ce soit, mais que je pouvais jouer du violon toute la journée, il n’y avait que deux personnes qui habitaient là, dont un clandestinement, les autres pièces servant de dépôts d’archives. Je me l’étais tenu pour dit et avais pleuré toute une semaine, essayant seulement de faire bonne figure en allant récupérer mes affaires chez Robert qui ne comprenait rien à ce qui se passait et à qui j’avais raconté que ma mère était malade.
Un beau jour, je m’étais réveillée en ayant l’impression d’être passée dans un tunnel de lavage, et en même temps d’avoir enfin posé des valises trop lourdes : je n’avais plus aucun sentiment pour lui. Rien. Aucune envie. J’étais surprise : c’est donc comme cela que ça se passe ? Une accumulation, une crise, et après, on est nettoyé ? Bizarre, tout de même. Enfin, j’étais délivrée. Pour le moment.
Avec Manuela, j’étais allée voir « West Side Story » , et tout le long du chemin de retour nous avions chanté « Who knows ? » Car, autant elle que moi, nous avions eu des aventures qui nous avaient laissé de mauvais souvenirs, mais nous nous sentions vides, on a besoin de penser à quelqu’un, de se focaliser sur une personne en qui on a confiance et contre qui on a envie de se blottir. « Encore, toi, tu as la musique ! » Me disait-elle. D’accord, elle adorait son métier, mais aurait bien voulu donner un peu de la tendresse qu’elle réservait aux petits enfants dont elle s’occupait à quelqu’un de sérieux et à des enfants à elle. Moi, sur ce dernier plan, j’étais plus dubitative, mais je n’aimais pas être seule. Nous attendions.
Il y eut un intermède, Isabelle qui arriva chez Manuela, en transit vers Amsterdam, car elle était enceinte. Elle avait arrêté sa pilule un petit mois, mais voilà qu’était passé un beau garçon... cela la rendait furieuse d’être aussi stupidement tombée dans le panneau. Elle était accompagnée de deux nanas, une à qui elle payait le voyage, une petite employée complètement paumée, qui avait déjà un enfant en nourrice, et une autre qui n’avait pas voulu prendre la pilule parce qu’elle « ne voulait pas grossir » et qu’elle avait entendu dire que c’était cancérigène. Mais son mec ne voulait pas utiliser de préservatifs, c’était bon pour Papa ! Il avait « fait attention » , et affirmait que c’était elle qui s’était gourée dans ses calculs. Sûrement ! Résultat, un voyage vers la Venise du Nord. Isabelle n’avait pas le moral, et m’avait demandé de l’accompagner. J’avais accepté, ç’avait été pour moi une escapade touristique, mais le spectacle de ces pauvres filles contraintes de se cacher me donnait froid dans le dos. Nous étions revenues avec ses deux copines, toutes trois soulagées et affirmant qu’« on ne les y prendrait plus » . Retrouvant Manuela, nous avions fait une sortie cinoche-resto, « Orange Mécanique» nous avait fait rigoler, et nous ne parlions plus que de « Ludwig Van » , chantant à tue-tête la neuvième symphonie. La violence du film ne nous atteignait pas, à notre âge nous n’avions peur de rien. Surtout Isabelle, qui avait l’impression que rien de pire ne pouvait plus lui arriver.
J’étais finalement entrée dans un orchestre, qui tournait bien. Mais François, le chef, jeune, enthousiaste, ne se rendait pas compte de la masse de travail administratif qu’il y a à gérer, et oubliait de remplir les vignettes, n’envoyait pas les papiers à la Sécurité Sociale, ne précisait pas aux directeurs de salle qu’il fallait des chaises, les programmes arrivaient après le début du concert... Bref, malgré de bonnes critiques, l’orchestre se disloqua et un concert à Saint-Séverin fut le dernier. Il y avait eu de l’orage entre le chef et deux des musiciens. Un peu plus, ils en venaient aux mains, finalement ils avaient décidé de respecter le lieu, le concert se déroulant tout de même dans une église, mais après cela, tout serait fini.
La chorale était arrivée à l’heure, s’était tant bien que mal installée, les solistes également. Nous n’avions pas pu répéter longtemps avec eux, mais tout se passait bien, pas de faux départs, ils chantaient juste, nous suivions le chef qui, tout le monde en convenait, savait diriger. Il y avait un solo de ténor, nous avions juste répété le début. Il fallait faire très attention.
Le chanteur entonna son air. Je sursautai : il avait une voix extraordinaire, prononçait parfaitement, bougeait à peine, tout coulait comme une source régénératrice. Il acheva son air, le public applaudit, il salua, et se tourna. À ce moment, nos regards se croisèrent et je frémis, me noyant dans ces yeux qui semblaient rire, comme si la musique l’amusait. C’était cela, il s’amusait. Après tout, la musique classique ou baroque n’impose pas de prendre un air constipé, Bach ne devait pas être un mec sinistre, tout de même !
J’attaquai le morceau suivant avec une demi-seconde de retard, mais tout continua. La voix du chanteur portait le discours des instruments, les chœurs étaient un mur infranchissable, la soprano ressemblait aux petits anges du retable, pourquoi ce concert était-il le dernier ? Mes yeux se posaient constamment sur cette silhouette, ce visage qui m’attirait, c’était celui d’un magicien...
Nous rangeâmes nos instruments, je reçus comme les autres mon enveloppe avec mon dû, je ramassai mes affaires et sortis. Il m’attendait. Moi, ou quelqu’un d’autre ? Non, j’étais sûre que c’était moi. Il me demanda si je voulais prendre un verre avec eux, je le suivis pour rejoindre le flûtiste et les trois choristes qui se dirigeaient vers le café.
Comme nous n’avions pas eu le temps de faire connaissance, le ténor fit les présentations à table : le flûtiste était son frère, et l’une des choristes sa femme.
Bing ! Qu’avais-je cru ? Les emballements artistiques, c’est dans la tête que cela se passe, pas dans la vie. Séparons, s’il vous plaît. Comme certains disent, jamais dans le travail. Mais ils en ont de bonnes : à part dans la rue ou dans le métro, nous ne fréquentions personne, pas le temps. Pas de sport, il ne faut pas s’abîmer les mains, et nous n’avions guère de moyens financiers pour sortir. Quand étais-je partie en vacances pour la dernière fois ? Ah, oui, au Tréport avec mes parents, il y avait à peu près huit ans de cela. Il faut que j’en parle à Manuela, comment trouver l’âme sœur quand on ne vit pas aux mêmes heures que les autres ?
Un mois plus tard, achetant un accessoire rue de Rome, je me cognai dans le chef d’orchestre, toujours aussi enthousiaste, toujours aussi inconscient du fait qu’il avait fait couler une entreprise intéressante, et il m’entraîna vers le plus proche café. Serais-je partante pour un concert ? T’inquiète pas, ce n’est pas moi qui m’occupe de la partie financière, c’est l’éditeur. On va sans doute faire un disque. C’est payé... Oh, je ne sais plus combien, mais... Tu peux me redonner ton téléphone ?
Je lui rappelai que je n’avais pas le téléphone, mais que je passais régulièrement au café du coin, où le barman servait de boîte aux lettres, qu’il pouvait contacter X, Y... et Manuela, qui avaient des chances de me trouver. Il nota mon adresse, ah, oui : son visage s’éclaira, eurêka ! Il pouvait m’envoyer un télégramme. Ce cher François venait de s’apercevoir que cela existait, que tout le monde n’avait pas le téléphone, ni une voiture, ni l’eau courante.
À ma grande surprise, tout était bien organisé. Le concert fut un succès, l’enregistrement se passa sans anicroche. On nous donna rendez-vous pour enregistrer d’autres œuvres, et on nous présenta Hervé M..., un critique musical. Le chef, occupé avec les organisateurs, et sachant que j’avais quelques connaissances en musique baroque, me poussa vers le critique qui cherchait visiblement quelqu’un de moins excité à qui parler. J’appris qu’il sortait d’une école de journalisme, qu’il aimait la musique, mais ne cherchait pas pour l’instant à se spécialiser, qu’il avait un article à écrire pour une revue et devait rédiger la pochette du disque. Je lui décrivis les œuvres de façon concise, et lui donnai quelques références d’ouvrages de bons auteurs. Il me fit parler des études musicales, fut très surpris d’apprendre que certains instrumentistes n’avaient qu’une culture technique et considéraient l’histoire de la musique comme une perte de temps, et ouvrit de grands yeux quand je lui dis que j’avais passé mon bac par correspondance en travaillant mon violon quatre à six heures par jour, et que je n’étais pas une exception. Lui-même avait une bonne culture artistique, ayant un peu étudié l’histoire de l’art et aimant l’histoire, mais, avec une maîtrise de droit, il s’intéressait sur le plan professionnel à la chronique judiciaire.
On me donna mon enveloppe, je saluai le chef, les collègues, et sortis avec Hervé. Très tard, ou plutôt très tôt le lendemain, le restaurant fermait, nous étions toujours en train de discuter. Je ne l’avais pratiquement pas regardé, sans doute lui non plus n’avait pas remarqué si j’étais brune ou blonde, nous sortîmes et marchâmes jusqu’à chez lui.
Il était donc le numéro deux.
Après, l’orchestre avait continué, nous étions enthousiastes, l’organisateur avait décidé d’écumer les banlieues, pour porter la bonne parole de Bach et Vivaldi, avec l’espoir que les populations laborieuses parviendraient à décrocher de devant leur télévision. À part les soirs de match, avaient ajouté deux d’entre nous, on peut être musicien et aimer le football. En plus, le père de l’un des musiciens étant le maire d’une petite commune de l’est de Paris, nous avions monté un embryon d’école de musique.
Mais bon, les rêves sont une chose et la réalité une autre. Le nerf de la guerre finit par faire défaut, un concert, ça va, mais parvenir à en donner dix par mois était du domaine de l’utopie. L’organisateur faisait son travail, les papiers étaient en règle, mais il se faisait payer lui aussi, le chef ne comprenait pas que « ces paperasseries » ne soient pas dévolues à un bénévole, et à force de maladresses il commençait à avoir mauvaise réputation dans le milieu. En plus, il avait claqué la porte de l’école de musique où il enseignait le solfège, sous des prétextes fallacieux, et du coup nous avions tous été remerciés en bloc par l’adjoint au maire. J’étais repartie à la pêche aux remplacements.
Il y eut un concours, j’avais des chances. Je me défonçai pour travailler le programme, et arrivai gonflée à bloc. On me laissa jouer. Et puis, à la fin, je voyais les membres du jury chuchoter, secouer la tête, soupirer, je perçus un « Dommage ! » . Et on me dit :
— C’est très bien, vous trouverez sûrement un poste. Mais en attendant, donnez le bonjour à votre copain. »
Quel copain ? Robert, bien sûr. Le gars était un de ses ex, sans doute. Je précisai que je ne l’avais pas vu depuis un an, on ne m’écouta pas. J’avais donc une casserole à traîner.
II.
Et puis Hervé était parti en stage aux États-Unis, bon, d’accord, c’était génial pour lui, mais moi, cela me laissait sur le carreau. Il fallait que je comprenne... Oui, ça va, je comprends, c’est pour ton boulot, tes ambitions vont un peu plus loin que la rubrique des achats et ventes de la gazette de Trifouilly-les-Oies, tu parles bien anglais, oui, je comprends. Et moi qui avais refusé un engagement en Allemagne pour rester avec lui... Dans la série je suis idiote... Ça, je ne l’avais pas dit à Manuela.
Mais, du coup, je n’avais plus de logement, puisque j’étais installée chez lui, le propriétaire ne voulant pas louer à « une artiste, en plus une femme seule» . De toute façon, le loyer était trop cher. La chambre de l’amie de Manuela n’était plus libre, du coup, j’avais rameuté les copains, et Juan, un pianiste, un ex de Robert, qui à la suite d’une déception amoureuse était reparti dans sa famille en Espagne, m’avait dit de venir chez lui dans la banlieue de Barcelone, il donnait des leçons de piano, jouait du jazz dans des boîtes, et on pourrait donner quelques concerts, il connaissait un peu de monde pour me recommander. Je ne parlais pas espagnol, mais Juan m’avait fait travailler de façon accélérée, pensant que j’allais pouvoir donner des leçons.
Il y avait eu deux concerts, dans un très bel endroit, mais payés un minimum. Juan m’avait présenté des amis musiciens, mais ils étaient surtout des jazzmen, et il n’y avait pas pour le moment de concours de recrutement pour les orchestres. J’étais repartie pour Paris, une copine en tournée m’avait laissé sa chambre. Je passai une soirée sympathique avec Manuela et son mec, « le bon, cette fois » . Le lendemain, j’avais contacté quelques personnes à droite et à gauche, participé à un concert à Rouen, et, revenue à Paris, un collègue me prit à part dans un coin de bistrot, pour me parler franchement : je devais me faire oublier quelque temps, à cause de « mon copain le pot de colle » . Ce fichu Robert faisait parler de lui, il y avait eu un scandale avec un directeur de théâtre, bref... Nicole avait également disparu, sans doute en province, j’étais à l’hôtel et avais besoin de disparaître. J’envoyai une lettre à Juan, qui me répondit aussitôt « mais viens ! » , il avait eu lui aussi des problèmes à cause de Bibi, quand il jouait dans un groupe de jazz et que l’autre prétendait expliquer à des musiciens chevronnés l’art de l’harmonie. Il ajoutait qu’il venait de trouver un ami, tout se passait bien, ils étaient en train de s’installer tous les deux. J’étais un peu gênée, ne voulant pas les encombrer, et avais décidé d’explorer les opportunités musicales dans le Sud, pas trop loin de l’Espagne au cas où je doive me replier chez mes amis.
Quand j’avais quitté Paris, il faisait gris, moche, froid, c’était même excessif pour un mois d’avril, et là, dans le sud de la France, il pleuvait, une sorte de douche glacée comme si on avait de là-haut renversé une cuvette. Dans l’hôtel, je rangeai mes affaires, aucune catastrophe n’était survenue, tout était intact, et j’avais empoigné le Bottin du téléphone qui calait la porte de la douche pour chercher des adresses.
Ne voulant pas raconter ma vie à tout le pays — l’hôtel n’avait pas de cabine téléphonique —, et profitant d’une accalmie des éléments météorologiques, j’étais sortie et avais marché jusqu’à quelque chose qui ressemblait à un bureau de poste. Là, j’avais entrepris d’appeler ceux que je croyais « possibles » : deux écoles de musique de la région cherchaient des professeurs, mais non, pas de violon, de piano, mais non, pour l’année prochaine, une association de concerts n’existait plus, une personne que je connaissais vaguement m’avait dit « oh, ma pauvre, la musique est bien délaissée dans la région ! Venez donc me voir, que l’on bavarde ! » Je n’avais pas envie de participer à un concert de gémissements. Le conservatoire local ? Mais non, est-ce la peine ? J’avais entendu dire que tout était bouché dans la région, et il faut des diplômes spécifiques... J’avais quand même composé le numéro. Tiens, personne pour répondre ? C’est vrai, il est assez tôt. Ah, si.
Une secrétaire décrocha, avec une voix pourvue de décibels qui m’obligèrent à éloigner le récepteur de mon oreille. Vous cherchez quoi ? Non, il n’y a plus de place en classe de violon. Non ? Vous jouez du violon ? Un orchestre ? Oui, il y en a un, il joue au théâtre. Pour des places, il faut les réserver au théâtre même... Pardon ? Parlez plus fort !
Elle faisait toute seule les questions et les réponses, je n’arrivais pas à placer un mot. Finalement, elle me dit de venir, le directeur serait là... elle ne savait pas vraiment à quelle heure, mais il venait tous les jours. Si c’est pour des places, c’est au théâtre, hein ? Pas ici, ici c’est le conservatoire ! Où c’est ? Ben dans la rue... Où est la rue ? Vous ne connaissez pas l’avenue Victor Hugo ? Dans le centre, près de la mairie, après vous cherchez le musée, il y a un grand parc à droite, nous on est à gauche. Vous savez bien où est la mairie !
Je répondis oui, n’ayant pas envie de devenir sourde et m’apercevant que cette brave dame ne comprenait pas que l’on ne connaisse pas l’avenue Victor Hugo locale. J’en connaissais une, à Paris seizième, une autre à Boulogne-Billancourt, une autre à Montrouge, ce brave Hugo avait sa rue dans presque toutes les communes de France, mais je ne connaissais pas celle d’ici. Trouvons une nouvelle avenue Victor Hugo à ajouter à notre cartographie de l’hexagone.
Heureusement, dans cette ville où l’accent des gens m’obligeait à leur faire répéter ce qu’ils disaient, et réciproquement, il y a comme partout en France des panneaux lisibles, indiquant la mairie, le théâtre, le musée. Non, il n’y avait pas le conservatoire, mais j’avais cru comprendre que c’était par ici. Je me risquai à demander l’avenue Victor Hugo, un brave papy me répondit dans une langue que je ne comprenais pas, pour m’expliquer par signes que j’y étais. Il n’y avait pas de plaque à cet endroit, mais c’était une avenue assez grande, je repérai les numéros de rue, et finalement arrivai devant un vieil immeuble d’où s’échappaient des sons de piano, des gammes hésitantes, le son d’une flûte. Et il y avait une plaque. Ouf, j’avais trouvé. Maintenant, il faut voir si le directeur est là, en essayant de ne pas avoir à faire la conversation avec la secrétaire qui a une voix comme une trompette de cavalerie.
Sur le palier, j’entendis une voix féminine tonitruante... zut, ce doit être la même, qu’est-ce que je fais... Cela ne me disait rien qui vaille. Il y eut une voix masculine, calme, posée, et la trompette de cavalerie s’arrêtait pour laisser parler son interlocuteur... Alors ce doit être quelqu’un d’important. J’étais devant la porte, hésitant à frapper, quand un homme sortit et me demanda ce que je cherchais. Il était le directeur.
Je fus très surprise. Je m’expliquai, rapidement, il eut un grand sourire et me fit entrer dans son bureau. Apparemment, les on-dit qui prétendaient que tout était bouché dans la région étaient complètement faux, venez vite, ici les bons musiciens sont rares, on paye, on paye. Et voilà, j’ai signé pour le prochain concert.
III.
Je suis rentrée à Barcelone deux jours, j’ai fait la connaissance d’Elie chez qui Juan venait d’emménager. Autant Juan, qui avait vécu longtemps en France, avait l’air d’un titi parisien, ayant été à l’école dans le quartier de Ménilmontant, autant Élie avait tout du jeune homme de bonne famille, soigné et même maniaque dans sa tenue, travaillant dans l’événementiel et féru d’art moderne, de littérature, observant tous les mouvements artistiques qui se faisaient jour en Espagne, fréquentant metteurs en scène, musiciens et peintres d’avant-garde. Tous deux ont ouvert le champagne pour fêter mon engagement, nous sommes allés nous promener sur les Ramblas et avons failli nous faire piétiner par une foule excitée, car ni mes amis ni moi ne nous intéressions au football et il venait d’y avoir un match important, que Barcelone avait gagné... ou était-ce l’Espagne ? Enfin, ça hurlait, ça dansait... nous n’avons pas dormi de tout le week-end. J’ai eu bien du mal à faire mes gammes, mon violon semblait me dire qu’il n’appréciait pas le bruit extérieur, ma sonorité n’était pas des meilleures. Mais je m’appliquais tout de même, n’ayant pas l’intention d’être ridicule lors des répétitions à venir.
Voilà, je me suis levée très tôt, j’ai gagné la gare, le train était à l’heure, ouf, j’ai passé la frontière sans encombre, je suis descendue du train... oui, encore un train, mais aujourd’hui il fait beau. J’ai juste une petite valise, et le violon. Où est-ce, déjà, le théâtre ? Ah, voilà, la mairie, la fameuse avenue Victor Hugo, et après il faut suivre les panneaux. Ça y est, je suis devant la porte.
Et je m’arrête. C’est bizarre, tout de même, que l’on m’ait engagée comme ça, de suite. Bon, évidemment, un prix du Conservatoire, ça vous pose, le directeur sait ce que cela exige comme niveau. Au fait, est-ce lui qui va diriger ? Et qu’est-ce qu’on va jouer, déjà ? C’est un opéra, non, une opérette, je crois.
Bon, je suis en avance, personne ne me voit, du moins je l’espère, je reste là, devant la porte où il y a marqué « Entrée des Artistes » en jolies lettres dorées, une grande porte avec des décorations. Je fais mine d’examiner les moulures, au cas où quelqu’un arriverait. J’entre, ou pas ? J’hésite, je trouve toujours bizarre que l’on m’ait engagée comme ça. Bon, on n’est pas à Paris, il y a sûrement moins de musiciens, mais j’hésite. C’est bête, l’être humain.
Et voilà la fosse aux ours. L’orchestre d’opérette de province dans toute sa splendeur. Quelques bons musiciens, dont les professeurs du conservatoire local, quelques bons amateurs, et de jeunes élèves, des retraités, et d’autres... Ce que j’entends... aïe, le Bibi serait parmi les musiciens, il ne déparerait pas ! On fait avec ce que l’on trouve. Plusieurs viennent de villes voisines. Le chef arrive : un homme âgé, avec une tête rigolote, qui assène une claque dans le dos à un trompettiste, embrasse sur les deux joues une violoniste qui semble aussi âgée que le théâtre, et qui doit être une notoriété musicale locale, je comprends qu’elle enseigne dans le conservatoire de la ville voisine. Je me présente : « Ah, c’est vous l’Espagnole ? Hablas francès ? » Je précise que je suis française et loge provisoirement à Barcelone. Un type qui a l’air de toiser tout le monde avec un dédain souverain m’indique une chaise au fond du groupe des premiers violons, en me demandant si j’ai eu la partition pour la travailler. Non ? Vous déchiffrez bien ? Le chef qui apparemment a été renseigné par le directeur précise que j’ai un premier prix du conservatoire de Paris, l’homme me regarde de haut en bas et dit entre ses dents à son copain : « On va voir ce qu’elle vaut, la Parisienne... bof, on pourra toujours en faire quelque chose... » Et, se tournant vers moi : « Ici, on fait de la bonne musique, pas de l’à-peu-près ! » Et il s’installe à la place de premier violon.
Charmant comme accueil. Raciste anti-parisien, et sexiste, en plus. Je m’assieds, on s’accorde, ma voisine de pupitre me montre la partition et me dit « J’ai mis des indications, j’espère que ça ne va pas vous gêner pour lire » . Ce qui me gêne, c’est qu’elle ne sait pas s’accorder, son violon est un peu faux. J’esquisse un geste pour l’aider, elle accepte volontiers de me laisser tourner les chevilles et resserrer un tendeur qui vibre. Même, elle dit merci. Ça change. Gentille, mais elle joue faux. Contentons-nous de suivre le chef.
Un passage difficile, il est tout gribouillé, je dois mettre le nez dessus pour pouvoir lire, mais j’arrive à le jouer. On s’arrête, on me regarde, le premier violon précise : « Ce n’est pas jouable, je l’ai simplifié » . Le chef a l’air de rigoler et signale que j’ai pu le faire. Alors, qu’il travaille. « T’as qu’à faire tes gammes, la petite, elle y arrive » , dit-il.
J’essaie de ne pas me faire remarquer, mais bon, je joue juste, enfin il me semble. Parce que, arrivé là... Le chef arrête tout le monde :
— Dites, les altos, c’est faux ! Accordez-vous, au moins !
On reprend. Nouvel arrêt.
— Les altos ! Yves, dit-il au premier alto, aide-les à s’accorder, on ne va pas y passer la journée !
Le nommé Yves, dont j’apprendrai plus tard qu’il est le professeur du conservatoire, s’accorde, empoigne l’alto de son voisin, l’accorde, et va pour prendre celui de l’instrumentiste qui est derrière. Le monsieur pousse un cri d’orfraie :
— Non ! N’y touchez pas ! Les chevilles sont collées, il n’a pas bougé depuis deux ans ! »
Là, la majorité des musiciens explose de rire. Le chef descend de son siège et s’approche du monsieur, lui dit quelques mots, puis se tourne vers le nommé Yves, qui acquiesce et dit au pseudo-altiste : « Je t’en trouverai un jouable, t’en fais pas » . Et l’autre s’en va.
Où est-ce que je suis tombée...
J’ai presque envie d’appeler Bibi pour qu’il vienne renforcer cet orchestre branlant. Non, ne pensons pas à cet individu, c’est de sa faute si je suis perdue dans cette fosse pleine de vieux fauves déplumés, je n’avais qu’à... enfin, c’est aussi la faute d’Hervé, et puis je n’ai pas voulu aller à Stuttgart... Zut ! C’est de ma faute, tout ça ! J’ai laissé les sentiments passer en premier, la musique doit primer, pas les histoires de cul ! Redescendons sur terre... J’apprends de ma voisine qu’il va y avoir des renforts, mais ils ne viennent que demain. Bon, cela peut s’arranger. Je fais un rapide tour d’horizon, la population est du même style que celle de pas mal d’orchestres. Côté cordes : majorité féminine d’âge mûr, les jeunots au fond. On y papote, on y tricote, on s’y plaint de sa santé. Côté vents : majorité masculine, les jeunots bizutés au milieu des anciens. On y rigole, on y drague, on s’y plaint de sa santé.